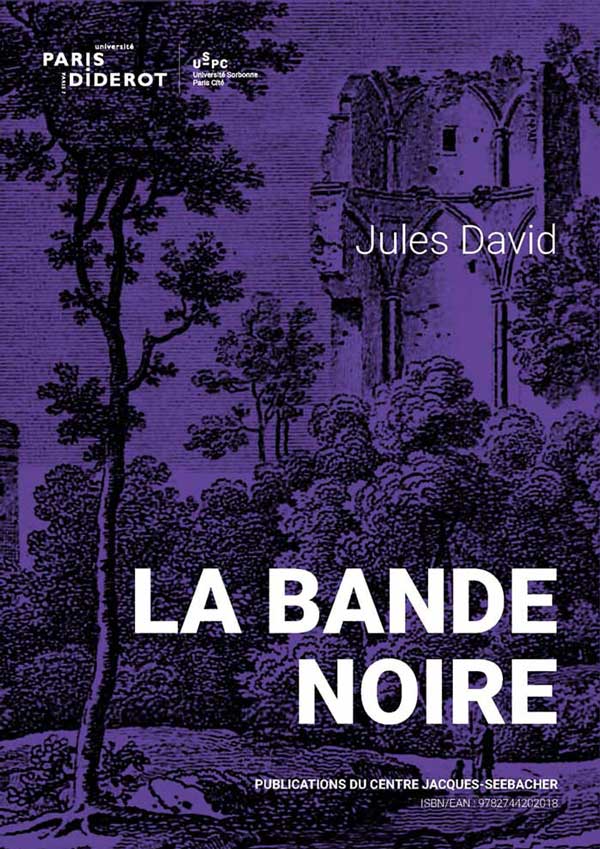Avertissement : ceci est une copie au format HTML du livre électronique téléchargeable au format ePub sur la bibliothèque numérique du centre Jacques-Seebacher.
LA BANDE NOIRE
Édition critique réalisée par Vincent Bierce, Margot Favard, Magalie Myoupo et Yohann Ringuedé
PUBLICATIONS DU CENTRE JACQUES-SEEBACHER
ISBN/EAN (ePub) : 9782744202018
À propos de cette édition
Jules David, La Bande noire, édition numérique réalisée par Vincent Bierce, Margot Favard, Magalie Myoupo et Yohann Ringuedé, « Publications du centre Seebacher », 2018.
Cette édition a été réalisée par un groupe de jeunes chercheurs composé de Vincent Bierce (ENS de Lyon/IHRIM), Margot Favard (Université Paris Diderot/CERILAC), Magalie Myoupo (Université Paris Diderot/CERILAC) et Yohann Ringuedé (UPEM/LISAA - Université de Bâle).
Le travail d’annotation du texte a été fait sur la plateforme PLANETE (PLAteforme Numérique d’Édition de TExtes), créée à l’initiative de Paule Petitier, professeur de littérature et responsable du centre de ressources Jacques-Seebacher de l’université Paris Diderot. L’outil grâce auquel cette plateforme a été mise en place a été fourni par Anne Vikhrova, doctorante de l’université Grenoble Alpes, travaillant sous la direction de Thomas Lebarbé. Il a été adapté à des fins d’édition critique par Chloé Menut, étudiante au centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) à Tours, dans le cadre d’un stage financé par un appel d’offre « Projet pédagogique innovant ».
Pour l’édition de ce texte, la mise en place du texte sur la plateforme et sa maintenance ont été assurées par Chloé Menut, pour le compte du centre de ressources, et le secrétariat éditorial a été effectué par Cécile Brémon, ingénieur d’études au centre.
Le texte édité est celui de la seule édition connue (1837). La ponctuation a été maintenue.
Sommaire
- Introduction
- Un roman de l’Histoire ? Usage en trompe-l’œil et poétique de l’intime
- Les modèles génériques : du roman au théâtre, de l’imitation à la confusion
- Les sciences dans La Bande noire : modèle romanesque et fertilité poétique
- PRÉFACE.
- Tome I
- Tome II
- Aperçu de la réception de La Bande noire et de l’œuvre de Jules David
- Index des noms de personnes
- Index des noms de lieux
Introduction
Fils de Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne David, homme politique devenu bonapartiste après avoir signé une pétition en faveur de Louis XVI et qui publia des poèmes, du théâtre et des écrits politiques[1], Jules-François-Amyntas David (parfois appelé Jules-Antoine David) naît en Bosnie le 2 juin 1811. Son père y avait été envoyé en 1806 comme consul général. Après des études parisiennes au lycée Louis-le-Grand et à l’École des langues orientales où il apprend l’arabe, il se détourne d’abord de la carrière diplomatique pour se consacrer à la littérature. Proche de la génération romantique, il publie en feuilleton des romans et de nombreuses nouvelles dans la presse. Sa production romanesque, fournie, s’étend de 1835 à 1847. Suite à la mort de son père, il décide de déposer la plume du romancier[2] (mais il éditera des essais d’histoire, de folklore et de littérature) pour commencer une carrière administrative (en particulier dans les ports fluviaux et la Conférence internationale sanitaire de Paris) jusqu’en 1883. Il meurt en 1890[3].
Auteur prolixe, lorsque paraît La Bande noire¸ en 1837, il a déjà fait paraître Lucien Spalma (1835), Le Dernier marquis (1835) et La Duchesse de Presles (1836), ainsi qu’un certain nombre de nouvelles dont « La Bague de Madame la Comtesse », parue dans La Revue étrangère de la littérature, des sciences et des arts, en mai 1836[4]. Si Jules David reconnaît la continuité qu’il établit lui-même entre Lucien Spalma, La Duchesse de Presles et La Bande noire, le deuxième roman et cette nouvelle sont passés sous silence. Pourtant, cette dernière préfigure de façon troublante l’histoire développée dans La Bande noire.
Ces œuvres lui rapportent d’emblée un solide succès comme en témoignent plusieurs comptes rendus élogieux dans la presse[5]. Il collabore notamment avec Balzac[6] qui l’influence manifestement. Néanmoins, il n’est pas impossible de considérer qu’il exerça à son tour une influence importante sur l’auteur de La Comédie humaine lui-même (visible notamment dans Les Paysans), ainsi que, plus tard, sur Flaubert (en particulier pour Madame Bovary) et Zola[7].
La présente édition se propose de donner à nouveau accès à un texte qui, malgré ses faiblesses manifestes, connut un certain succès dans le monde des lettres françaises, avant de tomber dans l’oubli. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, l’intérêt de ce roman ne se situe pas tout entier dans la peinture historique, loin s’en faut. Il est aussi le lieu d’expériences génériques, de l’exposé d’une méthode, qui font de l’art romanesque de Jules David un concentré des préoccupations littéraires d’une époque aiguillonnée par le désir de dire la vérité du monde mais surtout du cœur.
Un roman de l’Histoire ? Usage en trompe-l’œil et poétique de l’intime
La Bande noire perd d’emblée son lecteur en mettant en exergue, dans son titre, une fausse piste : malgré les apparences, il ne sera point question ici d’une description détaillée de ces spéculateurs qui achetaient des biens du clergé et de la noblesse d’Ancien Régime afin de revendre leurs matières premières au plus offrant. Point de roman historique, de tableaux de démantèlement et de mises à sac, de nobles expropriés, autant de séquences narratives qui auraient été l’occasion de représenter une violence à la fois physique et symbolique dont les soubresauts avaient agité le pays. La période révolutionnaire, sur laquelle le xixe siècle ne cesse pourtant de revenir dans l’espoir de saisir ce qui s’est joué au tournant du siècle, est escamotée : l’action du roman prend place des dizaines d’années plus tard, dans les premières années de la monarchie de Juillet alors que la double rupture de la Révolution et de l’Empire a été consommée et que, dans le monde des lettres, le motif de la Bande noire est déjà quelque peu passé de mode[8]. Le décalage observé entre ce qui est annoncé et ce qui est effectivement offert au lecteur laisse présager un rapport profondément ambigu à l’Histoire entendue comme récit collectif.
Dans un premier temps, ce titre déceptif nous enseigne que l’inscription de l’action dans une période historique donnée est un leurre. Tout comme la Bande noire n’est finalement pas présentée au lecteur, le contexte particulier de la monarchie de Juillet ne le sera pas non plus. En effet, le récit prenant place dans la campagne, le lecteur est tenu à distance de l’actualité politique. Si la description de la Brie qui ouvre le roman évoque l’Histoire de l’Empire, elle ne cesse cependant d’insister sur le caractère atemporel du lieu. L’aspect « compassé » des bâtiments dont il est parsemé trahit le travail de l’ingénieur et non la stratification des temps. La Brie est une campagne sans Histoire ; dans son paysage, aucune mémoire n’est perceptible :
Là vous ne trouverez point de ces vieilles murailles noircies par le temps et couvertes de mousse […]. Mais peut-être y rencontrerez-vous, non sans plaisir, quelques-unes de ces habitations nées d’hier et qui mourront demain […]. Là aussi votre œil s’arrêtera sur ces édifices carrés surmontés d’une terrasse à l’italienne, dont l’aristocratie impériale affectionne tant les lignes droites et la symétrie compassée, image de ces murailles d’hommes que la volonté de Napoléon faisait mouvoir et tomber comme les pierres fragiles d’un édifice aligné au cordeau. La Brie […] convenait assez à ces existences équivoques, qui se sont tenues également à distance des grandes vertus républicaines et de l’élégance aristocratique, et n’apparaissent dans l’histoire que comme un point déjà à demi effacé. (I-1)
La Brie s’inscrit en faux contre un siècle qui, devant la destruction de l’ordre ancien, veut se bâtir des monuments afin de commémorer et de célébrer une nouvelle histoire. Les traces du passé récent, celui de l’Empire, sont déjà des ruines qui ne portent en elles aucune signification pour le présent, semble-t-il. À l’absence de l’ordre politique répond celle de tout sens métaphysique : les châteaux n’ont pas « […] ce caractère d’antiquité religieuse ou de grandeur monumentale » ; « [n]ulle part, en Brie, [on] ne rencontr[e] un de ces signes extérieurs qui attest[ent] la foi au passé et le culte des souvenirs religieux […] » (I-1). L’étendue de cette campagne est présentée comme une tabula rasa historique qui a pu accueillir les velléités de renouveau de l’Empire, période déjà révolue et avalée par le temps au moment où commence le roman.
Cette absence d’héritage, inscrite métaphoriquement dans le paysage de la Brie, fait écho à un élément-clé de l’action du roman : l’achat du château par Arthur Raimbaut. Ce geste décisif qui lance l’action – puisque c’est lui qui détermine d’une part sa rencontre avec le personnel campagnard dont Marguerite fait partie et d’autre part avec le couple de Noï – reproduit la rupture historique dans l’ordre des péripéties. Le récit suggère que ce château est une « concession à temps » (I-2) que l’empereur a faite au général afin de le récompenser. Le lecteur ne saura rien des propriétaires précédents du lieu. L’objet de l’achat, qui devait plutôt être un legs dans une perspective de transmission, est coupé de son origine – la famille noble qui le détenait – pour être donné à un général. Cette cassure de la transmission se reproduit par la suite : le général, qui voulait pourtant le « passer à [s]es derniers neveux » (I-2), se voit dans l’obligation de le vendre. Le roman semble mettre en scène l’impossibilité de rétablir un temps long : l’époque antérieure à la Révolution est irrémédiablement révolue mais les tentatives politiques nouvelles, telles que l’Empire, peinent aussi à s’installer dans la durée. Le château, symbole de la continuité d’une famille et d’une autorité, ne cesse de changer de propriétaires et ne peut être détenu « qu’à temps », c’est-à-dire pour une période déterminée. La poésie des ruines s’adosse à un discours sur la vanité des actions humaines qui ressurgira au début du deuxième tome (II-3). En somme, des trois périodes historiques évoquées, aucune n’est réellement développée comme si la narration entérinait par-là la versatilité de l’Histoire : la Bande noire est reléguée dans un passé lointain, l’Empire dans un passé récent et la monarchie de Juillet, qui correspond pourtant au temps de l’écriture, est absente de cette intrigue qui se joue pour une bonne part loin des grandes villes et de l’agitation politique.
Le deuxième enseignement de ce titre déceptif serait peut-être que le rapport à l’Histoire est davantage une question de représentation que de faits ou de dates. Le roman permet de saisir une « […] nébuleuse imaginaire, à l’intérieur de laquelle se mêlent toutes les passions liées à la terre, à l’appartenance sociale et au caprice amoureux[9] », selon Nicole Mozet. Le narrateur l’avoue, dès le début du tome I :
Il n’entre pas dans le plan de ce livre d’expliquer ce qu’est en réalité la Bande noire, et d’en esquisser la physionomie générique, nous voulons peindre un type spécial et exceptionnel qui ne se rattache que par des liens apparents à cet esprit de démembrement brutal et de conquête, dont les poètes et les artistes ont stigmatisé l’avidité et les funestes résultats ; mais nous avons à cœur d’expliquer tous les effets d’un pareil mot sur les habitants de nos campagnes. Pour un paysan, la Bande noire est un être mystérieux, une espèce de monstre qui n’a qu’une tête et fait mouvoir cent bras ; c’est une personnification vivante de tout ce qui est ruine, morcellement, instinct d’audace et d’astuce […]. (I-2)
Dans le roman, l’Histoire n’est pas un cadre, mais une source de fantasme qui règle en partie les rapports entre les êtres. La Bande noire n’est pas un roman historique[10] mais le roman d’un fantasme sur l’Histoire. Pour autant, celui-ci ne correspond pas à l’imagerie officielle qui accompagne chacun des régimes : dès la préface, Jules David affirme que « [l]a vérité qu[’il] cherch[e] n’est ni épaisse et enrouée comme une déesse de la liberté, ni souriante et fardée comme une petite maîtresse de la régence […] ».
Les deux supports réels sur lesquels repose ce discours sur le fantasme seront, bien sûr, la Bande noire mais aussi la figure de l’empereur. En ce qui concerne la Bande noire, les discours du général ruiné et des paysans, plus particulièrement de Guillaume Évon qui avait entendu parler d’Arthur « […] comme d’un intrigant, d’un démolisseur de châteaux, d’un révolutionnaire qui voulait ruiner tout le monde, les grands et les petits » (I-8), portent ces rêveries. Quant à l’Empire, la figure de Napoléon a durablement marqué les paysans de la Brie qui voient en elle « […] cet effroi de tous les trônes de la terre, ce dieu de toutes les joies pauvres, cette idole de toutes les misères qui veulent s’étourdir […] » (I-2) ; ils construisent « cette grande image qui s’était appelée autrefois Napoléon » (I-2) plutôt qu’ils n’évoquent la personne historique. Le protagoniste lui-même, en appliquant à son destin le décalque de celui de Napoléon, indique le pouvoir de fascination de cette figure qui ne touche pas seulement le peuple supposé crédule : en regardant, tel Julien Sorel, un portrait de l’empereur, Arthur « […] s’associ[e] […] à la fortune du génie malheureux et détrôné » (I-2). Selon le réseau de signifiants choisi par le narrateur, la capacité d’Arthur à faire fléchir et à diriger les âmes n’est d’ailleurs pas si différente de celle de l’empereur :
Arthur Raimbaut se levait et emmenait avec lui son cortège de subalternes ; les clercs de notaires et les géomètres se rendaient silencieusement à leurs postes comme des militaires, qui, au sortir d’une fête oublient en un instant leurs impressions récentes et leurs émotions encore vives pour se soumettre de nouveau aux règles exigeantes de la discipline. Dans cette vie tumultueuse et pourtant régulière, il y avait quelque chose de la ponctualité soldatesque ; les moments étaient comptés, les heures fixées avec une précision rigoureuse ; à la volonté du maître toutes les fantaisies individuelles s’annihilaient sans murmures ; un ordre de lui faisait loi, et tous les intérêts divergents qui se ralliaient à lui semblaient se fondre en un seul, l’instinct de l’obéissance. (I-7)
Arthur est perçu comme fils de la Révolution et de l’Empire. À cause de cette double imposition historique qui renvoie à deux périodes exceptionnelles de l’Histoire de France, il apparaît comme un symbole de rupture. Il permet de réfléchir la nouveauté politique et d’évaluer ses répercussions dans les représentations mentales. Par ailleurs, on pourrait dire que la grande Histoire des faits, des révolutions et des batailles est dédaignée au profit de l’Histoire sociologique des peuples, de leurs croyances et de leurs coutumes. La présentation des « fantasmes historiques » participe des aperçus sur le folklore, au même titre que les épisodes de fêtes paysannes ou de veillées où l’on raconte les « anecdotes du temps passé » (I-5).
La principale conséquence de cette apparente dérobade de l’Histoire est que les personnages du roman de Jules David semblent saisis dans un éternel présent – ce qui explique en partie l’indexation sur le modèle théâtral sur laquelle nous reviendrons. Leurs vies, « point[s] entre [les] deux abîmes » (I-1) que sont le passé et l’avenir pour reprendre les termes d’Arthur Raimbaut, se situent selon leurs dires sur la fine crête de l’ici et du maintenant. C’est le cas d’Arthur dont la garde-robe, par exemple, « n’[a] ni passé ni avenir. Ainsi que font les voyageurs qui laissent à chaque étape leur défroque de la veille pour une enveloppe nouvelle qu’ils laisseront demain ; ainsi fai[t] Arthur » (II-1). Il tente de prêcher ce carpe diem mélancolique et non convaincu à Henri : « Heureux ceux qui se laissent aller au courant des plaisirs et acceptent le présent sans interroger l’avenir ! » lors du bal (I-8). Tel Napoléon renversant les traditions de la vieille France, Arthur veut faire fi des époques antérieures de sa vie[11].
Toutefois, cette fiction de l’homme neuf qu’entretient le protagoniste se fissure peu à peu. Si l’Histoire des régimes et des révolutions semble mise en sourdine dans le roman, ce n’est pas le cas de l’histoire intime qui vient réinjecter le devenir et les révolutions au niveau des existences particulières. Henri est à Arthur « par droit d’héritage » (I-1), c’est-à-dire en vertu de leur lien de parenté (leurs mères étaient amies) ; selon les dires d’Arthur, lorsqu’il cède au désespoir et se montre vulnérable, « […] le passé n’existe que pour [lui] » (I-9) ; l’anneau d’or qu’il porte à son index et qui le rattache à l’épisode traumatique qui a déterminé toute sa vie est le « souvenir des temps évanouis et d[es] […] espérances envolées » (II-1) et la poésie des ruines qui pourrait porter un discours politique épouse les contours de l’amour contrarié et inassouvi porté à celle qui est devenue Amélie de Noï. L’Histoire commune laisse la place au passé individuel, ou plutôt elle se loge en lui : Arthur, dans des tentatives de justification de ses actions, alléguera, dans plusieurs discours, la volonté « de démolir pièces à pièces toutes ces aristocraties orgueilleuses […], [d’]humilier ces grands de la terre […] » (II-4). C’est uniquement dans le cadre de l’histoire intime que le protagoniste convoque ces rapports de classes et la rhétorique égalitaire pour se justifier. Il est tiraillé entre le présent de son nouveau moi et son passé où règne en maître deux principes absolus et despotiques : celui de l’Ancien Régime et celui de l’amour.
Ce double statut crée des effets temporels intéressants : le personnage peut, en l’espace d’une nuit, vieillir de dix ans, accusant par-là les aller-retours incessants de son esprit et de la logique de son agir entre passé et présent (I-2). Niée comme cadre principal du roman, l’histoire ressurgit dans l’intimité et met au jour la complexité des identités derrière les rôles de façade. Parallèlement, tout comme Arthur se présente au monde sans passé, il en est de même pour M. de Noï qui, lors de son apparition dans le roman, en matière de mode, « […] se t[ient] à une égale distance de la vieillerie et de la nouveauté » (II-1), mais, aux marges du récit, est associé au parti légitimiste et à ses luttes. La révolution de 1830, antérieure au temps de la diégèse, vient mettre fin à son activité légitimiste :
Vers 1829, un mariage brillant avait encore consolidé cette position si savamment établie. […] [T]ous ses plans réussissaient, toutes ses combinaisons atteignaient leur résultat, lorsqu’un coup de main de trois jours vint renverser toutes ces illusions si légitimes, toutes ces espérances si chèrement couvées […]. D’abord, il avait pris à cœur de protester par une retraite éclatante contre un gouvernement qui, par le fait de son avènement, l’avait blessé dans ses intérêts les plus chers. Il voulait se renfermer dans un vaste hôtel du faubourg Saint-Germain, et y pleurer à loisir la légitimité déchue […]. (II-1)
Puis il renonce à « ses projets de solitudes légitimistes ». Il ne reprendra le fil de son engagement politique qu’à la fin du roman, une fois l’intrigue sentimentale résolue. Sans donner la formule de son mélange, Jules David semble imbriquer les causes historiques et les causes intimes, si bien que le lecteur ne sait pas si l’Histoire générale se reflète dans le passé intime ou l’inverse. D’un point de vue stylistique, ce mélange fait migrer le vocabulaire politique dans la sphère de l’intime : ainsi les femmes sont-elles tout à tour couronnées et découronnées selon qu’Arthur les aime ou les délaisse. Amélie, « reine » à Paris, « abdiqu[e] » (II-5), en arrivant à la campagne.
Toutefois, l’excipit du roman, apparaît comme un repentir de cette minoration de l’Histoire. Tout d’abord, il semble rejoindre le temps de la lecture en évoquant les rumeurs qui ont couru « tout cet hiver, dans la haute société parisienne […] » (II-12) et renouer avec une forme d’Histoire qui est, pour le dire communément, l’équivalent de ce qu’en tant que lecteurs du xxie siècle nous pourrions nommer l’actualité. Cet effet d’actualisation est renforcé par un parallèle que Nicole Mozet a mis au jour entre la mort d’Arthur Raimbaut et l’histoire napoléonienne :
La seule hypothèse qui me parait susceptible d’expliquer ce dénouement de façon un peu plausible serait de faire d’Arthur Raimbaut une transposition romanesque de la figure de Napoléon, écrite à un moment – juste après l’échec du soulèvement de Strasbourg par Louis-Napoléon, le 30 octobre 1836 – où il était impossible de prévoir la revanche du bonapartisme. D’où ce mélange de frustration, de fureur et de désir de vengeance qui est caractéristique de tout le roman. Comme Napoléon, Arthur Raimbaut ne peut s’empêcher d’aimer une grande dame et il sera écrasé par un légitimiste fervent, un homme qui n’est rien d’autre que légitimiste, de même que Napoléon a dû rendre le trône à la monarchie d’Ancien Régime. Pourtant, c’est de leur côté qu’est la véritable légitimité, celle qui vient du peuple[12].
Par ailleurs, le roman nous propose un deuxième dénouement – dont le caractère lapidaire n’est pas sans faire penser à celui de La Chartreuse de Parme qui paraîtra en 1839 – qui excède l’histoire particulière et retrouve explicitement la grande Histoire : « M. de Noï [se] dévou[e] tout entier à la cause légitimiste. On le dit en Espagne et on espère qu’il deviendra ministre de don Carlos » (II-12) ; sa femme se terre dans un couvent, et retrouve symboliquement une religion et une tradition inconnues au paysage de la Brie ; Marguerite retourne chez son père et se réinscrit dans une filiation. À l’inverse, Henri prend la décision d’occuper la place de l’homme neuf en entrant dans la grande société. Toutefois, par cette action, n’établit-il pas une continuité en occupant la place laissée vacante par le suicide de son cousin, père de substitution ? Si le discours idéologique du roman n’est en aucune façon évident, la fin semble mettre en scène une normalisation après une mise à l’écart du passé. Peut-être Jules David, sans pour autant prendre parti, comme l’affirme Nicole Mozet[13], met-il en scène à travers ce roman qui refoule l’Histoire aux marges, le repli sur la vie individuelle provoqué par les grandes déceptions politiques du début du siècle mais aussi la difficulté à faire le tri dans le passé : que faut-il garder ? Que faut-il solder ? De ce point de vue, le fait que l’action de La Bande noire soit centrée sur deux couples sans enfant et que le personnage qui embrasse une vie mondaine à la fin du roman soit Henri, l’orphelin, est significatif. Ces deux réalités semblent correspondre à deux questions posées à l’Histoire : celle de la continuité par-delà la rupture et celle du recommencement ex nihilo.
Les modèles génériques : du roman au théâtre, de l’imitation à la confusion
Dans La Bande noire, le modèle romanesque se complique de renvois multiples à l’univers théâtral. Dans un premier temps, la référence à Balzac est constante, et tout se passe comme si Jules David cherchait à faire de son roman un véritable récit balzacien, ou du moins un récit s’inscrivant explicitement dans la lignée de son illustre modèle. Les points communs entre La Bande noire et La Comédie humaine abondent, et l’on peut les regrouper en trois grandes catégories.
C’est d’abord la construction globale et la conduite du récit qui semblent directement empruntées à la création balzacienne. Dès les premières pages, l’imitation est explicite : on retrouve cette forme de début statique propre à l’incipit balzacien, dont la caractéristique principale est de « différer le moment d’entrée dans l’histoire en suscitant en même temps chez le lecteur une attente du récit des événements[14] ». Jules David donne en effet à lire une introduction commentative et descriptive qui propose des développements topographiques sur une vallée de la Brie et dont la fonction principale, en plus de repousser le début de l’histoire proprement dite, est de préparer le récit à venir en l’inscrivant dans une réalité référentielle tout en produisant un effet de réalisme. Le narrateur entremêle dès l’abord descriptions et commentaires, il endosse une posture autoritaire qui « établit la nécessité d’une introduction à l’histoire racontée[15] » et pousse l’imitation jusqu’à décrire le paysage en faisant appel à « l’œil du voyageur » (I-1), ce qui n’est rien moins qu’un « motif typique de l’incipit balzacien[16] ».
À la manière de Balzac, Jules David propose une nouvelle « Scène de la vie de campagne » et adopte un modèle de représentation réaliste qui s’attache à décrire avec force précisions les conditions de vie dans un cadre rural : à la description détaillée de la ferme de Guillaume Évon succède par exemple une discussion sur les nouveaux modes de production et l’agriculture moderne (I-4) puis un tableau d’une veillée villageoise (I-5). Ce travail de représentation est d’ailleurs renforcé par la référence constante à la peinture, et les renvois aux Caravage, Rubens et autre Cagliari abondent[17].
En outre, les personnages sont tous pensés et construits comme des types[18] : Arthur Raimbaut est un « type spécial et exceptionnel » (I-2) et même un « type exceptionnel et supérieur entre tous » (I-3), Henri représente « ces créatures faibles […] qui ne cherchent dans le monde qu’un couvert pour s’abriter » (I-1), et M. de Noï est décrit comme le « type de [la] courtoisie sévère » (II-1). La veillée villageoise est également l’occasion de décrire une vieille paysanne présentée comme « un de ces types qu’on ne rencontre guère que dans les villages » (I-5), et l’affrontement final entre M. de Noï, Arthur et Guillaume Évon permet de juxtaposer « ces trois types d’hommes si diversement accentués » (II-11).
L’usage de la digression est une autre technique empruntée à Balzac. Aude Déruelle a montré comment chez l’auteur de La Comédie humaine, la digression « n’est plus utilisée comme moyen de sape, mais à des fins constructives[19] ». Car Balzac a cherché à fonder un nouveau type de roman, un roman sérieux, c’est-à-dire un roman qui ne se contente pas de distraire son lecteur mais qui vise également à l’instruire. Loin de miner la narration romanesque, la digression apparaît alors comme une règle générique de ce nouveau roman : mise au service du drame, elle est l’instrument qui permet à l’auteur de réaliser son projet romanesque. C’est également ainsi que Jules David conçoit les digressions : il parsème son récit de développements sur le sentiment amoureux en général (II-9) ou l’amour féminin en particulier (I-10), sur les coutumes villageoises (I-5) ou encore les effets produits par les différentes saisons sur les âmes (I-8).
La Bande noire reprend également le procédé du récit à énigme, procédé dont l’emploi est déjà relativement fréquent dans le récit romantique[20] mais dont la récurrence dans l’œuvre balzacienne est tout à fait frappante[21]. Cette figure commande largement la dramaturgie de l’œuvre comme sa poétique, et sa présence engage de constants processus de déchiffrement et d’interprétation.
Enfin, les intrigues diverses mènent toutes à une clausule commune, elles « se rejoignent pour éclater et concourir à un dénoûment fatal » (II-11) qui là encore prend la forme d’une conclusion typique d’un récit balzacien. Dans les romans de La Comédie humaine, la fin est bien souvent le lieu d’une dissociation entre le récit et la parole : le dénouement diégétique est suivi d’un commentaire, et l’on constate « comme un “supplément” entre un dénouement fictif (la diégèse) et une clôture réelle (instaurée par le blanc final[22]) ». De même, dans La Bande noire, la mort du héros, cet « événement typique de la fin[23] », est suivie d’un court développement que l’auteur intitule « conclusion » et qui vient comme redoubler la fin du récit. Tout se passe comme si l’histoire avait besoin de se prolonger par le discours des personnages : la parole rapportée qui termine le roman en est comme « l’écho nécessaire[24] ». Le lecteur est alors obligé de revenir sur les pages qui ont précédé pour discerner le sens réel de cette ultime parole, qui transforme l’impératif lancé à Henri par Arthur agonisant (« Essaye », II-12) en un présent formulant une sorte de constat (« il essaye »).
Le deuxième grand trait stylistique que Jules David emprunte à son aîné concerne la position du narrateur. Le narrateur balzacien se distingue par son « individualité multiple[25] », qui développe tantôt le discours du témoin commentant et jugeant l’histoire narrée, tantôt le discours de moraliste s’élevant au-dessus de l’histoire pour atteindre l’universel et l’atemporel, tantôt encore le discours d’écrivain explicitant le fonctionnement de ce qu’il rend possible. Or dans La Bande noire, l’instance narratoriale est également construite selon ce modèle. Elle n’hésite pas, par exemple, à s’immiscer régulièrement dans la fiction pour la juger : à l’instar des narrateurs balzaciens qui manifestent constamment un véritable « manque de retenue[26] » et « s’assigne[nt] le droit – et le devoir ? – de juger la fiction[27] », la locution narrative matricielle multiplie les interventions gnomiques ainsi que les déclarations à valeur de vérité générale[28], et ces intrusions dans la fiction déterminent le rythme de la narration. L’inscription d’une discursivité prégnante dans l’énonciation du récit, qui est l’une des caractéristiques majeures du récit balzacien, devient alors également l’un des traits essentiels du roman de Jules David.
En outre, le narrateur de La Bande noire fait un usage abondant du métadiscours, ce discours extérieur à la fiction qui vient prendre en charge le récit et préciser le mode de fonctionnement de la narration, notamment pour rendre possible et adéquate la lecture. Or c’est là encore très précisément ainsi que fonctionne l’énonciation romanesque dans les romans de La Comédie humaine : d’une part, une « énonciation métadiscursive qui relève de la locution propre à cette instance suprême qu’est le narrateur, lequel se donne ici des allures de deus ex machina pour venir résoudre un problème de cohérence[29] », et d’autre part une « énonciation narrative qui rapporte les faits, éventuellement d’une façon subjective et insidieuse, mais qui ne se désigne pas comme réalité linguistique concrète[30] ». Dans La Bande noire, le narrateur multiplie les références explicites à la construction du récit en qualifiant directement la fiction (« drame naissant », I-5), en assumant pleinement sa fonction de régie (« depuis l’entrevue que nous venons de décrire », II-5) ou en mettant en valeur la nécessité d’expliciter les sutures artificielles entre les événements pour la bonne compréhension du récit[31]. L’énoncé métadiscursif concerne exclusivement la poétique du récit et il n’est jamais une rupture dans la narration, puisque sa fonction est au contraire de la prendre en charge. Le métadiscours permet également à l’auteur de se présenter comme un « historien » (II-1) tout en demandant au lecteur de lire le roman jusqu’au bout avant de pouvoir en juger la moralité (II-1) : si cette oscillation entre le statut de romancier et celui d’historien apparaît tout à fait représentative d’une période durant laquelle histoire et littérature étaient étroitement mêlées et se confondaient[32], on reconnaîtra surtout là une obsession balzacienne, exprimée notamment dans l’« Avant-Propos » de La Comédie humaine[33].
Jules David pousse d’ailleurs l’imitation de son modèle jusqu’à donner à son narrateur les mêmes expressions. On retrouve dans sa prose des stylèmes balzaciens bien connus, depuis la désignation par exophore mémorielle développée à partir du tour « un de ces… qui[34] », présent quasiment à chaque page, jusqu’à l’excuse artificielle que constitue l’expression figée « il est nécessaire de » pour justifier une pause dans le développement du récit ou une digression[35].
En plus de ces techniques narratives qui ressortent toutes de la poétique du récit, on retrouve çà et là dans La Bande noire des références à des motifs et à des thèmes balzaciens, qui parfois semblent même renvoyer très précisément à des récits spécifiques de La Comédie humaine. S’il serait vain d’essayer de toutes les lister, on notera cependant que le romancier aborde la question de la passion qui tue et de l’idée fixe[36], celle de l’opposition entre Paris et la province, et notamment Paris et la campagne[37], ou encore la problématique de l’amour dans le mariage et de l’éducation des femmes[38] – autant de thèmes dont on connaît l’importance dans la création balzacienne. Jules David semble en outre faire par endroits des références précises à des textes balzaciens : la supériorité marquée de Marguerite sur son mari et les malheurs qui en découlent paraissent par exemple empruntés à La Femme de trente ans, dont les principaux épisodes étaient déjà parus en 1837. Quant à la filature de M. de Noï par Arthur jusqu’à une « habitation ignoble » et la description qui suit d’une rue parisienne bordée de « maisons à mine équivoque » (II-3), elles semblent directement tirées de Ferragus (1833).
La première tâche du romancier semble bien avoir été de se positionner par rapport à Balzac et à l’ensemble de sa création, dans la lignée de laquelle il s’inscrit explicitement. Et si l’on a souvent dit que La Bande noire avait influencé Les Paysans[39], c’est par un amusant jeu de réciprocité qui ne doit pas occulter l’influence énorme, et première, de Balzac sur Jules David.
L’autre grand modèle générique sur lequel ce dernier s’est fondé pour construire et organiser sa création est le modèle théâtral. Mais là encore, diverses influences se mêlent, qui vont de la tragédie à la comédie-vaudeville en passant par le mélodrame.
La tragédie apparaît bien sûr comme la première des références ; elle constitue un modèle prégnant tout au long du récit. Le roman reprend par exemple, et d’abord, des scènes topiques du genre tragique comme la scène d’aveux. On avoue beaucoup dans La Bande noire, et surtout des amours interdites : c’est par exemple Marguerite qui affirme à Arthur son amour pour lui (I-8) puis Arthur qui déclare à son tour qu’il l’aime (I-11) avant, dans le deuxième tome, d’avouer à Marguerite qu’il est en vérité épris de Mme de Noï (II-8). Or ces scènes d’aveux sont constamment traduites dans un vocabulaire qui est bien celui de la tragédie : Marguerite est « dominée par une puissance maudite » (I-8), Arthur et Henri prennent acte de l’impossibilité de revenir en arrière (« tout est-il donc irréparable ? dit-il – irréparable », I-11). Au fur et à mesure que le dénouement approche, ce vocabulaire se fait de plus en plus présent, et il en vient même à saturer toute la fin du roman[40], lorsque « la passion arriv[e] à son dernier terme » (II-8). Se dessine une intrigue qui laisse libre cours à la « jalousie la plus basse » (I-9) et à la « haine » (II-4) et qui, au fil des serments trahis et des promesses non tenues, donne à lire la rivalité amoureuse puis la séparation finale d’Arthur et Henri (« nous ne sommes plus frères », II-7).
En outre, les trajectoires des personnages sont comme constamment dominées par la fatalité, autre élément qui renvoie évidemment à la tragédie. Leurs vies paraissent soumises « à une de ces destinées invisibles » (II-7) contre laquelle ils ne peuvent rien : Arthur n’entend pas « ces avertissements que le ciel semblait lui donner dans sa colère » (I-9), il affirme n’être que « le misérable jouet de cette puissance aveugle qui nous égare à sa suite » (II-7), et le narrateur renforce cette interprétation : « par quelle fatalité, si près du but, se trouvait-il subitement arrêté par une barrière infranchissable ? Un génie moqueur s’était-il donc acharné à sa perte[41] […] ? » (II-7).
Mais au modèle tragique est également mêlée une référence importante au mélodrame, ce genre très à la mode dans le premier xixe siècle. Le mélodrame est un genre théâtral qui privilégie d’abord l’émotion et la sensation, qui cherche à varier les émotions dans l’alternance et le contraste de scènes calmes ou mouvementées, gaies ou pathétiques. C’est également un théâtre où « l’action romanesque et spectaculaire interdit la réflexion et laisse les nerfs à vif[42] ». Si le mélodrame répond à une poétique et à des techniques précises[43], on peut cependant déceler une réelle proximité de La Bande noire avec l’esthétique mélodramatique, notamment dans le rapport que le roman entretient avec le pathos.
Le récit, qui reprend au mélodrame l’esthétique du tableau, s’organise en effet en juxtaposant des scènes à l’intensité émotionnelle contrastée. Exemplaire à cet égard est l’ensemble du premier tome : après un troisième chapitre qui donne à lire une sorte de combat entre Arthur et un taureau furieux, le chapitre 4 propose une description bien plus apaisée de la ferme Évon et un dialogue sur l’agriculture moderne. Puis le chapitre suivant, décrivant la veillée villageoise, développe l’intrigue sentimentale : la relation amoureuse entre Henri et Marguerite, comme scellée symboliquement dans un pacte par l’échange de gages, est soudainement interrompue par le mari de cette dernière. L’intensité dramatique de ce tableau laisse alors la place à un chapitre entièrement centré sur Mme Évon : à la description mélancolique d’une Marguerite enfermée dans sa chambre succède l’intrusion d’un Guillaume menaçant et aviné qui menace de la brutaliser. Les chapitres suivants présentent un schéma identique : ils alternent des épisodes à forte tension dramatique et d’autres où le suspens est moins éclatant.
Le mélodrame se caractérise également par un pathétique violent dont l’intensité s’accroît au fur et à mesure que l’on progresse dans les scènes, et le second tome de La Bande noire semble tout à fait obéir à ce canevas. Or le pathétique du mélodrame a bien souvent partie liée à l’amour : si, dans l’éthique mélodramatique, l’amour-passion est une faute contre la raison et le bon sens, un facteur de déséquilibre personnel et social, après 1815, sous la pression de la sensibilité romantique notamment, les mélodrames donnent de plus en plus d’importance à la peinture d’amours malheureuses. C’est là un autre élément que reprend le roman de Jules David, dans lequel Mme Évon, Arthur et Henri sont tour à tour en proie à la passion amoureuse. Les scènes à forte intensité émotionnelle se multiplient, et les divers chapitres donnent souvent à entendre les discours pleins de pathos de personnages confrontés au malheur et à la douleur d’aimer[44].
On constate en outre une intéressante inversion des valeurs avec le mélodrame qui sera appelé « romantique » et qui voit le jour avec la Restauration. La mentalité collective change, engendrant une nouvelle forme d’écriture et de perception des intrigues théâtrales : de nouveaux éléments sont alors introduits dans la thématique et la typologie, et les asociaux, les marginaux, les bandits, autrefois exclus et châtiés au troisième acte, deviennent des héros. Or Arthur revendique précisément ce statut à la marge : dans un véhément discours adressé à Mme de Noï, il lance un véritable cri de défi social, revendique sa volonté de « se faire l’instrument d’une œuvre de destruction et de ruine » et attaque la société, ce « vieux théâtre de foire » (II-4).
Le registre tragique se trouve mêlé au modèle mélodramatique, et les deux influences se combinent dans le roman. Il est intéressant à cet égard de noter la prolifération au sein du récit des scènes d’aveux qui, en lien avec le thème des amours perdues et des intrigues sentimentales, ne renvoient plus tant à la tragédie ou même au mélodrame qu’à une sorte de troisième genre, un genre bâtard qui regarderait à la fois du côté de la comédie et du vaudeville. Car si l’on a pu décrire quelques scènes d’aveux comme reprenant explicitement une trame et un vocabulaire tragiques, certains épisodes proposent au contraire des aveux dégradés. Ces derniers ne donnent en effet plus à lire la description pathétique d’une douleur dépassant les personnages ; ils concernent au contraire des éléments qui ont plutôt tout à voir avec une intrigue sentimentale aux enjeux matrimoniaux. C’est ainsi que Marguerite confesse à Arthur que c’est Henri qui l’a trahi (I-10), Arthur qui explique à Mme de Noï qu’il est le petit pâtre qu’elle a éconduit autrefois (II-4), ou encore M. de Noï qui déclare être joueur (II-2). Quant à Guillaume, persuadé d’être trompé par Marguerite, il réclame à cette dernière un aveu qui officialiserait son statut de cocu (« tout cela n’est-il pas la vérité ? Parlez ! mais parlez donc ! » II-2).
Ces diverses influences peuvent alors s’allier dans un finale étonnant, qui développe une variation autour d’une scène topique de comédie (un homme trompé vient trouver sa femme en flagrant délit chez son amant) mais que l’ensemble de la narration pousse à lire comme un moment de tension fondamentale.
Guillaume Évon se rend dans l’appartement d’Arthur alors même que Marguerite y est cachée en compagnie de Mme de Noï, et cette situation proprement vaudevillesque est d’ailleurs comme redoublée, puisqu’il y a deux femmes, deux maris et donc deux amants potentiels. M. Évon assume jusqu’au bout son emploi de fâcheux, puisqu’il refuse de quitter la pièce et multiplie des discours qui ressemblent fortement à des dialogues de vaudeville, tant ils en reprennent les caractéristiques : le ton railleur du personnage cocu fondé sur un persiflage insistant, les allusions érotico-scabreuses ou encore les traditionnelles moqueries misogynes. Le terme « comédie » apparaît d’ailleurs à deux reprises au chapitre 11[45], comme s’il s’agissait précisément d’expliciter le fonctionnement de la scène qui se joue ici.
Pour autant, et malgré la variation autour d’un canevas de comédie-vaudeville, l’épisode est tout entier vidé de sa substance comique pour ne plus servir que le suspens du drame en train de s’achever. Le narrateur multiplie les indications de lecture pour faire de la scène l’acmé de la tension dramatique. Métaphores et commentaires narratoriaux la font tendre vers le drame en exhibant une signification grave et douloureuse. Le face-à-face final entre Guillaume et sa femme se développe alors clairement comme une scène tragique : on y retrouve un lexique et une situation qui semblent tout droit tirés d’une tragédie, et ce jusqu’à la menace du suicide de Marguerite, comparée à « l’antique Niobé » (II-11).
La Bande noire mélange ainsi deux types de modèles génériques : au modèle romanesque balzacien, inévitable et quasiment visible à chaque page, se mêlent des références à divers genres théâtraux dont la combinaison ne laisse pas de produire des effets étonnants.
Les sciences dans La Bande noire : modèle romanesque et fertilité poétique
Tandis que les observateurs signalent une tendance à la déliaison entre les sciences et les lettres dès le début du xixe siècle – que l’on songe à Louis de Bonald et son retentissant Sur la guerre des sciences et des lettres qui date de 1808[46] – Jules David revendique, dès la préface de La Bande noire, l’influence de la démarche scientifique sur sa conception romanesque, notamment en termes de méthodologie, influence qui était déjà présente dans l’œuvre balzacienne.
Cette préface dresse d’abord un portrait de la génération romantique en forme de repoussoir. Les jeunes romantiques se sont affranchis de toute démarche scientifique au point de « préfér[er] à tout l’imprévu », ce qui les conduit à
affect[er] un dédain superbe pour les procédés lents, mais sûrs, de la réflexion qui reconstruit, comme une mosaïque, les passions, les instincts, les faits de l’humanité, prenant le connu pour le point de départ, et ne s’élançant à la poursuite de l’inconnu qu’avec d’infinies précautions.
Ce précautionneux chercheur de vérités humaines, contempteur d’un jeune romantisme trop frivole, Jules David, à l’instar de Balzac, souhaite l’incarner à l’occasion de son troisième roman qu’il place dès cette préface sous le signe de l’analyse. Cette démarche constitue « dans l’art le levier d’Archimède », c’est-à-dire la méthode grâce à laquelle le romancier souhaite fonder son entreprise en prenant pour point d’appui des éléments de la réalité. Le levier d’Archimède suppose en effet deux choses : un point fixe et une barre d’appui qui exerce une force sur lui et permet de soulever les charges les plus lourdes. Dans cette métaphore mécanique, le point fixe de Jules David est représenté par ce qu’il nomme « la vérité », qui est « la base essentielle de l’art ». Il affirme que son œuvre doit s’appuyer sur des éléments réels de la société et de ses habitudes, c’est-à-dire « le connu ». D’autre part, le principe découvert par Archimède nécessite un levier qui prenne appui sur ce point fixe : il s’agit de la méthode analytique. Muni de cet outil mécanique, le romancier se déclare prêt à soulever des montagnes en fondant son analyse romanesque sur des observations véritables.
L’attitude analytique, propre aux sciences qui s’érigent alors par ce moyen en seule voie possible pour atteindre les causes des éléments observés empiriquement, est à la source même du programme démonstratif que se propose le romancier. Dans cette préface, il formule une analogie entre son entreprise est celle du scientifique : il est lui aussi à la recherche de la cause enfouie, « le scalpel à la main ». Au fil du roman, la référence à un voile que l’on déchire pour faire apparaître cette cause cachée revient à deux reprises (II-1, II-4). Il est fait mention d’un « voile d’Isis » (II-1) que « nul œil humain n[…]’a jamais soulevé ». Cette expression renvoie à la fois à un système ésotérique hérité de l’Antiquité pour décrypter le monde qui entoure l’homme, mais également, selon l’analyse de Pierre Hadot, à la survivance dans la science moderne de cette imagerie antique dans l’iconographie des découvertes scientifiques[47]. La démarche analytique que revendique Jules David prétend déchirer ce voile (II-4) à force de « longues études et de longs tâtonnements » (préface).
La Bande noire se pense, selon le discours péritextuel, comme un roman scientifique : analytique, déductif et démonstratif, il est narratologiquement construit selon le modèle de l’enquête, d’une énigme à résoudre, d’un problème mathématique en forme d’équation à inconnues multiples.
Force est de constater que la référence aux sciences parsème le texte de bout en bout. Médecine, géologie, astronomie, biologie, mathématiques, physique mécanique et optique, les disciplines de science dure émaillent autant le discours narratorial que celui des personnages. Les sciences les plus présentes sont significativement les sciences de la recherche déductive. Arthur Raimbaut, en sa qualité de spéculateur, est capable de reconnaître la nature profonde de ses interlocuteurs en observant leur demeure, leur mise ou les traits de leur visage. La physiognomonie est une discipline omniprésente dans le texte, dans la mesure où elle permet de donner accès à du contenu caché, à une vérité d’ordre psychologique, en observant les signes physiques extérieurs. Le premier chapitre souligne les différences profondes qui existent entre Arthur et Henri « tant l’aspect de leur physionomie paraissait les séparer profondément ». Arthur est un analyste comme le prouve « son front large », tandis qu’Henri est un poète, comme le montrent sa « frai[cheur] [de] jeune fille » et sa « souplesse » « dans toutes les poses de son corps ». Son allure provoque en elle-même des épanchements poétiques, puisqu’elle procure « à ceux qui le vo[ient] une de ces émotions rafraîchissantes et douces qu’on peut comparer aux effets d’une harmonie lointaine, ou au murmure des flots le soir sur la grève. » Le narrateur justifie lui-même ces analyses physiognomoniques : « qu’on ne s’y trompe pas, le physique a des reflets sûrs, qui illuminent les secrets instincts de l’âme mieux que ne le pourraient faire les plus patientes observations et les inductions les plus subtiles et les plus logiques. » Prenant parti pour une discipline en plein essor en même temps que déjà fort discutée – notamment par Hegel[48] – Jules David s’inscrit dans une controverse scientifique[49]. Une équivalence existerait bien entre personnalité et enveloppe corporelle.
Dans le même ordre d’idée, le romancier se dépeint lui-même, en ouverture du second tome, comme un Cuvier de la société et du « cœur humain » :
Il y a dans le cœur humain bien des landes inexplorées qu’on ne prend pas la peine d’observer et de décrire. La vie parisienne cache sous sa surface d’agitation et de bruit mille sentiments limoneux, mille douleurs concentrées et stagnantes que les écrivains modernes, pressés qu’ils sont de mettre au jour les ébauches faciles d’un talent prématuré, n’ont pas la patience de sonder dans leurs replis intimes et de suivre jusqu’au bout dans leur marche capricieuse et dans leurs convulsions souterraines. On ne voit de la société que ce qui en jaillit au premier abord : tandis qu’on étudie minutieusement ses superfétations et ses excroissances, on néglige ces plaies rentrantes et aigries qui, semblables à la lame d’un poignard, cachent leur pointe empoisonnée au plus profond des entrailles humaines. Peu de gens ont assez de courage pour creuser jusqu’au tuf cet immense désert du monde.
La présence de termes géologiques suggère que Jules David se pense comme un disciple de l’un des scientifiques français les plus influents de ce début du siècle, Cuvier, qui, de l’aveu même de Balzac dans l’ouverture de La Peau de chagrin, savait reconstruire des vies entières en trouvant dans les profondeurs enfouies de la terre des morceaux fossilisés[50]. Le fossile est un motif convoqué significativement à deux reprises au cours du roman (I-2, II-4), pour décrire des physionomies « pétrifié[es] » qu’il est difficile d’analyser. L’herméneutique de l’objet fossilisé est une opération délicate, digne des plus grands sondeurs de mystère. Le romancier utilise cette comparaison géologique à propos de deux personnages qui, mystérieux initialement, vont finir par dévoiler leurs secrets et leur âme à mesure que l’intrigue évolue : Arthur Raimbaut et Amélie de Noï. Ces acteurs fossilisés retrouvent les causes initiales de leurs actions au fil des progrès de la démonstration romanesque, ce qui permet à Jules David de se faire l’égal artistique de Cuvier.
De même, l’influence de la médecine que revendique le romancier comme méthode analytique fondamentale – l’écrivain au « scalpel » – se retrouve dans la démarche déductive d’Arthur qui formule des diagnostics à propos de ses interlocuteurs, diagnostics qu’il tire méthodiquement d’une observation rigoureuse. Lorsqu’il arrive pour la première fois à la ferme de Guillaume Évon (I-4), son « coup d’œil » pratique un examen méthodique et systématique de tous les éléments qu’il rencontre, car selon son axiome : « [l]es formes extérieures révèlent toujours quelque chose à celui qui sait en découvrir les secrets. » Là où le « poète » – caractère fréquemment attribué au double inversé d’Arthur, Henri – s’épancherait sur la vie heureuse des fermiers en voyant les longs bancs dans la cour, « pour Arthur, ces bancs étaient muets et froids : il n’en concluait qu’une chose, c’est que la famille ou la domesticité du fermier devait être nombreuse. » Dès l’extérieur de la propriété de celui qu’il cherche à sonder pour lui vendre des terres, Arthur a donc opéré un « rapide examen ». Il applique « aux affaires la certitude mathématique des probabilités » et revendique la maîtrise d’une « science [des] hommes » (II-7).
Un parallélisme s’esquisse alors entre la méthode du personnage spéculateur et la démarche programmatique telle que la définit Jules David dans sa préface, démarche qui l’empêche, confesse-t-il à de nombreuses reprises, de conclure avant le terme. Il place le lecteur lui-même dans une posture active, celle du chercheur à qui l’on s’évertue à ne présenter que des faits bruts, et à qui il incombe de les interpréter et d’en tirer les conclusions nécessaires :
Que le lecteur lui permette maintenant de continuer son récit comme il l’a commencé, fatalement pour ainsi dire, et ainsi qu’un historien qui raconte sans conclure. […] Mais jusqu’à présent, et nous l’avons fait à dessein, notre pensée ne s’est produite que sous l’une de ses faces ; il nous reste la moitié de notre tâche à accomplir, et nous aurons soin qu’à travers le tissu de la fable, l’intention finale de l’écrivain grandisse successivement et se fasse jour par degrés jusqu’à son expression la plus complète, si bien que la formule de nos conclusions vienne d’elle-même à nos lecteurs. (II-1)
La structure du roman est une démonstration scientifique qui peut prendre une forme mathématique, celle d’un résultat d’opération algébrique (« la formule de nos conclusions »).
Le paradoxe de l’entreprise de Jules David repose sur un parallélisme entre le personnage et le narrateur qui semble desservir la prétention du roman à s’ériger comme une œuvre analytique et scientifique dont la démonstration mathématique fonctionnerait effectivement. Malgré sa grande science et ses fulgurances herméneutiques, Arthur se fourvoie et devient le prototype du personnage que la science ne peut sauver d’un tragique destin – c’est-à-dire d’un avenir implacable. Le narrateur, à l’image de son protagoniste, multiplie les aveux d’impuissance de sa plume analytique. Le verbe « analyser » est souvent pris dans des tours syntaxiquement marqués par la négation et l’impuissance[51]. La science est reléguée du côté de la froideur désabusée d’un esprit vieillissant, face auquel la passion de la jeunesse est une fraîcheur poétique.
Le roman tout entier se trouve pris dans une tension dynamique entre la foi en la science (sur laquelle s’appuie la démarche spéculative d’Arthur Raimbaut) et son incapacité fondamentale à pouvoir expliquer les causes profondes. Dans la structure même du personnel romanesque, un écho à la préface est perceptible : Arthur reconnaît que la façon d’agir qui caractérise les jeunes romantiques – pourtant décriée dans le discours préfaciel – est la plus apte à apporter du bonheur. La Bande noire se place donc du côté des discours désabusés, qui aspirent à la scientificité sans se leurrer sur ses prétentions à pouvoir tout régler. Le chantre du progrès lui-même, défendant les agricultures modernes face à un Guillaume Évon que les implications sociales de ce progrès effraient (I-4), confesse une forme d’imposture de la science lorsqu’il s’adresse à Henri :
[…] prenez-y garde ! Le silence, la nuit, les étoiles, sont de mystérieuses illusions qui gardent leurs secrets et ne répondent pas à ceux qui les interrogent. […] ne regardez plus le ciel et les étoiles ! le désir de savoir et la faculté de se souvenir sont deux tristes cadeaux que le ciel nous a faits : la vie est un point entre deux abîmes, il faut passer sans regarder ! (I-1)
L’entreprise herméneutique qui vise à expliquer le monde, ici emblématisée par la recherche astronomique, est mise sur le même plan que le souvenir d’une jeunesse à jamais enfouie : ce sont deux opérations de vision qui n’apportent que déception et frustration. Arthur poursuit par conséquent ses conseils en affirmant : « Heureux ceux qui ne descendent pas trop souvent dans leur âme, et respectent les instincts que la nature y a jetés ! La science est un mal qui dessèche et flétrit ! Vous êtes jeune, vous, Henri ! » (i-8). Tout se passe comme si l’innocence de la jeunesse préservait d’une aspiration pour les sciences qui dessèche l’âme et le cœur.
En somme, ce qui échappe à la démonstration analytique concerne les choses du cœur. Là réside probablement la leçon que le narrateur refuse de transmettre ouvertement. Jules David paraît se souvenir de la conclusion des Affinités électives dans lesquelles Goethe, feignant une expérimentation chimique à l’échelle affective, achoppe sur cette même impuissance de la science à prévoir les réactions du cœur.
Le programme du roman est contenu dans cette seule interrogation : « Aimer ! oh ! comment expliquer la mystérieuse puissance de ce mot magique ! Comment analyser cette absorption complète de toutes les facultés ! […] qu’est-ce donc, mon Dieu, que l’amour ? » Cette ouverture du dernier chapitre du premier tome révèle bien un aveu d’impuissance. Le pacte de lecture formulé par la préface est impossible à remplir. La science et ses outils analytiques (ici formulés par les verbes « expliquer » et « analyser ») sont incapables d’expliquer une vérité psychologique capitale pour le roman et sa structure : l’amour. Le roman emprunte une voie médiane entre poésie et science, entre Henri et Arthur. La froideur « mathématique » du paysage de la Brie entre en confrontation avec les souvenirs poétiques de la vallée d’Auge normande, qui a constitué pour les amours premières des protagonistes (Arthur, Henri, Marguerite et Amélie) un écrin que la perspective rétrospective colore d’une teinte élégiaque. Le poétique est relégué dans le passé tandis que la modernité, scientifique, brille par la froideur des procédés positifs.
La résolution de cette dualité advient par l’analogie, outil poétique qui légitime l’omniprésence des références scientifiques : les sciences, dans La Bande noire, n’apparaissent le plus fréquemment que comme un miroir des choses du cœur et de son fonctionnement complexe et insondable. À cet égard, Jules David convoque deux sciences qui pensent les rapports entre l’universel et l’intimité : l’astronomie et le magnétisme, réunies toutes deux, en ce qui concerne les liens secrets entre le cosmique et le particulier, par un seul savant controversé mais à l’influence immense : Franz-Anton Mesmer. Le médecin autrichien soutient en 1766, à Vienne, une thèse qui prolonge les travaux de Newton sur l’influence des corps astraux. Dans cette thèse, il postule que les corps humains subissent la même force que les corps célestes[52]. Cette théorie trouvera une application poétique rapprochant les cœurs amoureux des astres qui ne se démentira pas tout au long du xixe siècle[53]. Dans La Bande noire, le chapitre 10 du premier tome confirme le fait que le terme « révolution », en parlant des errements sentimentaux, se charge non seulement, sous la plume de David, d’une connotation historique inévitable, mais aussi d’une portée astronomique :
Alors toutes les préoccupations disparaissent devant une préoccupation exclusive ; sans cesse tourmentées du mal mystérieux qui les dévore, elles portent incessamment leur regard de la terre au ciel et du ciel à la terre, et errent à la dérive, comme un de ces mondes tourbillonnants qui cherchent un appui dans l’espace et tournent perpétuellement dans un cercle mille fois décrit.
Cette description concerne les errements sentimentaux de la femme qui subit les influences d’un astre terrestre tout masculin. C’est un argument que reprend toutefois Henri au narrateur en s’adressant à Arthur qui est sur le point de se détourner de Marguerite pour s’enfuir avec Amélie : « votre vie est-elle condamnée à se mouvoir dans un cercle sans fin ? votre désir de locomotion et de mouvement est-il insatiable ? » (II-7). La conclusion rapproche une dernière fois le fonctionnement de la société mondaine de la cosmographie, lorsque les gens à la mode de la capitale évoquent à propos du départ d’Amélie pour le couvent une « éclipse totale de soleil ». Dans un ultime geste paradoxal, Jules David semble se moquer lui-même de ces analogies à la mode qui émaillent pourtant son texte.
Mesmer poursuit ses travaux de thèse en postulant un fluide vital qui s’apparente à l’électricité et explique la force du monde vivant. Le magnétisme animal connaît un succès retentissant qui sera débattu lui aussi tout au long du xixe siècle. Il est également utilisé par le romancier comme une analogie destinée à refléter le fonctionnement des impulsions intimes. Dans le chapitre 3 du premier tome, lorsqu’Arthur est attaqué par le taureau, il est sauvé au dernier moment par une femme que le narrateur décrit comme une sorte d’apparition surnaturelle. Tout comme cette femme est parvenue à imposer à l’animal « une volonté supérieure » qui le « comprim[e] » et lui donne un sentiment d’« impuissan[ce] », vocabulaire et modus operandi qui rappellent le magnétisme, il semble que l’effet produit sur le spéculateur soit aussi fort. Celui-ci sent un « nuage » lui passer « sur la vue », ne peut plus voir qu’« à travers un voile confus », sensation qu’il s’explique lui-même par une forme « d’accablement, rapide d’ailleurs comme l’éclair, et dont […] les plus fortes âmes ne sauraient se défendre ». Cette description en focalisation interne suggère que Marguerite, qui apparaît ici pour la première fois, exerce une force magnétique sur les êtres masculins qui l’entourent (il est d’ailleurs question d’une âme en proie à des « choc[s] électrique[s] » dans le chapitre 4 du second tome), et plus particulièrement sur leur cœur. Arthur ressentira cette force une seconde fois au chapitre 6 du premier tome :
La fermière entendant ces mots balança le cou par un mouvement significatif ; et posant, par une nonchalance affectée, comme elle l’avait fait déjà dans la scène de la prairie, l’index sur ses lèvres fermées :
— Silence, lui répéta-t-elle dans son langage muet.
Arthur Raimbaut s’étonna de la discrétion qu’on lui imposait avec tant d’opiniâtreté.
Le fonctionnement de cet ordre, « muet » et impérieux, relève bien de la communication informulée et magnétique. Le choix du discours rapporté direct laisse entendre une efficacité de ce moyen de communication : le fluide magnétique de Marguerite opère par l’énonciation jusque sur l’esprit du lecteur. Ce charme scientifique influence d’ailleurs tout autant les esprits poétiques que les esprits scientifiques, puisqu’il touche également Henri au chapitre 6 du premier tome :
Henri comprit en la regardant la cause de son trouble, et par une commotion sympathique, la rougeur de la jeune femme passa sur le front du jeune homme. En le voyant immobile et presque tremblant, on eût pu croire à ces effets du magnétisme qui relie deux âmes sœurs par un nœud invisible, et transmet subitement à l’une les affections de l’autre.
Cet extrait réunit deux théories dont la scientificité est soumise à débat : le magnétisme animal et la physiognomonie, auxquelles Jules David recourt pour exploiter la poéticité d’une approche du monde somme toute romantique qui postule des points de contact entre la nature de toute chose et la psychologie de l’âme humaine.
La Bande noire cherche à expliquer les errements du cœur dans une démonstration implacable que reconduit d’ailleurs la référence générique à la tragédie, mais reconnaît en même temps l’impossibilité de la science à pouvoir déterminer les causes de ces impulsions affectives, de ces affinités que le langage mathématique ne peut prévoir. Le magnétisme et la physiognomonie apparaissent donc comme les symboles les plus à même de représenter une œuvre qui chemine entre la voie scientifique et la voie poétique, entre la sécheresse de la déduction mathématique et le charme inexplicable de théories scientifiques qui peuvent servir de détours analogiques puissants pour expliquer les voies insondables du cœur.
Ces différents excursus réflexifs sur La Bande noire, à la fois thématiques et formels, offrent l’image d’un roman sans cesse miné. À l’échec de la reconstitution d’un passé cohérent, compréhensible, capable de donner des leçons au présent, se superpose celui de l’établissement d’un discours univoque. L’autorité narratoriale et la référence au modèle théâtral reprises à Balzac se trouvent alors nuancées par la confrontation de la tragédie et du vaudeville. Dernier recours dans une tentative d’appréhension d’un monde qui se recompose, la science est elle-même jugée caduque. Tout restera insondable : les motivations des personnages – ceux du roman comme ceux de la scène historique – le passé et le présent, et, partant, la signification du récit dont la révélation, sans cesse promise, n’advient pas. Revers de l’opacité que suggère le qualificatif de « bande noire », l’étrange éclat du personnage principal – que symbolise le renvoi récurrent à sa chaîne d’or qui éblouit par ses reflets – demeure.
PRÉFACE.
Il s’est introduit dans le champ de l’art un parti aventureux qui entraîne à sa suite un certain nombre de serviteurs fidèles et dévoués. Ces esprits ardents et jeunes, écoutant plutôt la voix de leurs sensations que les conseils d’une raison éclairée, prenant pour le dernier mot du génie une certaine chaleur de sang, qui donne à leurs compositions et à leur style je ne sais quelle couleur incandescente, se lancent dans la carrière par mouvements précipités, et, pour ainsi dire, par soubresauts ; le terrain qu’ils foulent n’est point un chemin plane [sic] et continu, déroulant à l’œil son ruban varié ; c’est un de ces sites alpestres, coupé de ravins et de rocs, sillonné de précipices, balayé par les avalanches, et qui semble offrir pêle-mêle tous les contrastes et tous les dangers [1]. Ceux-là, donc, bondissent plutôt qu’ils ne marchent, et à les voir tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt au sommet des montagnes, tantôt au plus profond des abîmes, on dirait qu’un invisible tremplin les renvoie incessamment de la terre au ciel, et les lance dans l’espace sans fil pour les guider, sans lest pour les maintenir[2]. Préférant à tout l’imprévu, ils affectent un dédain superbe pour les procédés lents, mais sûrs, de la réflexion qui reconstruit, comme une mosaïque, les passions, les instincts, les faits de l’humanité, prenant le connu pour le point de départ, et ne s’élançant à la poursuite de l’inconnu qu’avec d’infinies précautions. Pour ceux dont nous parlons, il semble que l’esprit de l’homme soit un cratère bouillonnant qui lance fatalement des flammes sans avoir même la conscience des moissons que sa lave féconde ou que ses torrents ravagent[3].
Non pas, d’ailleurs, que de cette école d’artistes spontanés il ne sorte quelquefois certaines œuvres hardiment jetées, comme ces ponts audacieux que la main de l’homme a imposés aux chutes du Rhin[4]. Nous aimons, autant qu’un autre, l’imprévu dans l’art ; mais, nous l’avouons hautement, les surprises multipliées nous fatiguent, ainsi que feraient dans une ouverture les transitions trop brusques des instruments à vent[5]. L’art n’est pas, à notre sens, une arène dont il faut enlever le prix à la course, mais plutôt un sanctuaire étroit, où l’on doit se recueillir, et, l’œil encore tourné vers la terre qui fuit, demander religieusement ses inspirations au ciel[6]. L’analyse, pour nous, représente dans l’art le levier d’Archimède[7]. C’est par elle que les rayons divergents du cœur et de la société doivent arriver à l’œil de l’artiste consciencieux ; c’est elle qui, le scalpel à la main, doit lui montrer les artères et les fibres de l’humanité, sous ses chairs roses ou flétries, décrépites ou fermes[8]. On ne trouve pas la vérité du premier jet, il faut, pour s’en rendre maître, de longues études et de longs tâtonnements ; or, la vérité est la base essentielle de l’art[9].
Beaucoup ont proclamé ce principe avant nous, peu ont eu à cœur de le mettre en pratique ; il semble même que ceux-là, qui les premiers avaient arboré l’étendard, se soient tout d’abord fourvoyés dans la route ; esprits légers qui, en concluant bien, raisonnaient mal, et tiraient une conséquence juste de prémisses fausses ; car enfin il faudrait s’accorder et savoir la véritable signification des mots. Entre ces deux doctrines, dont l’une proclame que le vrai, c’est le beau, et dont l’autre admet, comme droit sacré, tous les caprices de l’esprit, toutes les fantaisies de l’artiste, n’y a t-il pas contradiction évidente[10] ? D’une part, la vérité est le résultat de l’observation, cela ne peut se nier ; et d’autre part, vous admettez, comme première condition d’existence, l’inspiration prime-sautière [sic][11] et le jet de l’esprit. Or, peut-on reproduire sans avoir vu ? peindre sans avoir étudié ? asseoir un raisonnement sur des bases qu’on ignore ? Quoi ! vous voulez le vrai, et, sans tenir compte des faits, des passions, du mouvement de l’esprit humain, vous dites à l’artiste : « Marche sans autre guide que ta volonté, sans autre loi que ton inspiration ». Mais que signifie alors ce cri de vérité que vous avez jeté si haut ? Est-ce assez qu’un sculpteur creuse dans le marbre quelque sillon éclatant, si l’homme ne se révèle pas tout entier dans son œuvre, avec ses lignes, avec ses saillies, avec ses muscles et les mille variétés de son torse[12]. Nous appartenons donc, pour notre part, à cette classe d’hommes qui, sans se laisser étourdir par le retentissement de quelques convictions, ont pris au sérieux la vérité dans l’art, et poursuivent avec conscience, tantôt sur les grands chemins, tantôt à travers les faux-fuyants et les sentes perdues, la marche de leur pensée et l’accomplissement de leur œuvre. Amoureux de l’art autant que personne au monde, nous croyons que la ligne correcte peut être belle et vraie quand on sait en diriger l’emploi ; il est bien que le ciseau de Phidias vienne en aide au marteau de Michel-Ange[13].
Notre principe de foi le plus invariable, c’est que l’esprit progresse de jour en jour, et ne se fortifie que par degrés ; il faut du temps pour que les idées extérieures s’infiltrent peu à peu dans le sang et fassent chair commune avec l’artiste. Il faut que le suc de la réalité ait longtemps pénétré dans ses membres, pour qu’ils acquièrent la vigueur souple de l’athlète expérimenté et toujours prêt au combat ; ce travail d’assimilation et, si je puis parler ainsi, d’absorption, se fait plus vite chez les uns, plus lentement chez les autres ; mais en fait, c’est toujours le même travail nécessaire et continu ; quand l’artiste exsude les pensées qui ont pénétré sa substance intime, il ne fait donc qu’obéir aux lois d’une transpiration intellectuelle, il ne trouve rien, ne crée rien, il rend ce qu’il a pris[14].
C’est la première fois qu’il nous arrive de formuler aussi explicitement des idées générales, et de mettre le public dans la confidence de certaines pensées que nous avions, jusqu’à présent, silencieusement contenues[15]. Sans sacrifier le fond des choses, nous avouons que l’expression et la pureté des formes nous ont toujours paru très précieuses, non pas que nous aimions cette afféterie[16] de toilette, cette coquetterie mignarde qui ravale la mission de l’artiste, la plus noble des missions, à des soins féminins et puérils, sans grandeur dans leur but et dans leur résultat[17] ; nous n’acceptons pas entièrement tout cet attirail mondain, dont quelques-uns se sont plu à revendiquer les grâces maniérées ; les longues draperies flottantes de la muse antique nous semblent aussi quelque peu embarrassantes et roides ; nous n’aimons pas plus la manière que la roideur. Nous n’aimons ni ces grossières images taillées dans le roc, et qui semblent plutôt calcinées au vinaigre comme les rochers des Alpes par Annibal[18], que modelées à l’embouchoir et polies au ciseau, ni ces médaillons sculptés qui ressemblent à des vignettes. La vérité que nous cherchons n’est ni épaisse et enrouée comme une déesse de la liberté, ni souriante et fardée comme une petite maîtresse de la régence ; elle a de la grâce, mais une grâce virile, elle a de la vigueur, mais une vigueur adoucie. Nous peignons les hommes tels qu’ils sont, sans nous demander ce qu’ils pourraient être, ni ce qu’ils devraient être ; quant à présent, nous copions, peut-être conclurons-nous plus tard[19].
Et certes, le procédé que nous adoptons n’est pas une ressource pour la paresse[20]. La tâche que nous avons entreprise est laborieuse, nous sommes loin de nous le dissimuler ; dans le champ des fantaisies, l’esprit peut se jouer avec bien plus de liberté que dans le champ des réalités ; mais, lorsque pour but final on s’est imposé de suivre pas à pas la vérité, de calmer un à un tous ses traits, de rendre avec une égale conscience ses demi-tons et ses teintes éclatantes, lorsqu’on veut reproduire fidèlement la silhouette du monde, sans ménagement comme sans emphase, et si bien fondre sur sa palette les gradations et les divergences de la couleur qu’au bout d’un long temps le tableau se produise complet et vivant[21], alors il faut mettre sa vie entière au service de cette pénible entreprise, il faut que chaque heure apporte son observation, chaque jour son labeur ; il n’y a que les monuments de carton que l’on puisse lever d’un seul coup, et en un seul instant ; les édifices durables se font lentement et pierre à pierre[22].
Qu’il nous soit permis de jeter sur nos quelques antécédents littéraires un regard rétrospectif : en jugeant le passé, on comprend mieux l’avenir[23]. Les deux premiers livres que nous avons publiés jusqu’ici, quoique différents, au premier abord, de forme et d’aspect, n’en sont pas moins nés d’une mère commune, d’une pensée homogène. La Duchesse de Presles[24] procède de Lucien Spalma[25], sinon en ligne directe, du moins en ligne collatérale. Dans l’un, nous avions voulu montrer l’imagination tendre et poétique de l’homme aux prises avec les exigences cruelles et le froid scepticisme d’une société qui se meurt ; dans l’autre, nous avons voulu peindre la sensibilité ardente et naïve de la femme, perdue dans la fange des convictions sociales, et marchant par la voie de l’imagination au but de l’infamie, comme d’autres y marchent par la voie du vice et des sens. Donc nous avons raison de dire que ces deux livres sont frères ; c’est le double revers d’une médaille, que nous avons simultanément exprimé, et si quelque chose nous a failli, ce n’est ni la volonté, ni le courage. Aujourd’hui, nous publions un livre qui ne trahira peut-être pas, aux yeux de tous, ses liens de parenté avec ceux qui l’ont précédé ; et cependant, dans notre esprit, La Bande noire procède de la Duchesse de Presles, comme celle-ci procédait de Lucien Spalma[26]. Quoiqu’il en soit, nous ne dirons rien de plus maintenant : nous laisserons à l’avenir le soin d’expliquer nos intentions et d’éclairer la marche logique de nos idées[27].
Tome I
I.
À onze lieues[1] de Paris, entre Corbeil et Melun, la Seine forme un coude sinueux. L’espèce de promontoire, qui s’avance en cet endroit et va se perdre dans les flots, est une prairie plate à son extrémité, et qui, du rivage s’élevant par une montée insensible, va se mêler au loin aux horizons de la plaine[2]. Quoique moins belle et moins majestueuse que dans les environs de Rouen, la Seine, au-dessus de Corbeil, ne manque ni de grâce, ni de cette élégance qui, providentiellement sans doute, devait caractériser le fleuve parisien. Bordée par intervalles de bouquets d’arbres, la nappe d’eau s’échappe, agile et gracieuse, à travers mille ondulations, ainsi que la taille flexible d’une jeune fille qui glisse entre les doigts de son amant[3]. Moins jaune et moins aride que la Beauce, moins verte et moins luxuriante que la Normandie, la Brie offre pourtant des accidents de perspective assez curieux et assez suaves pour solliciter le pinceau de quelque jeune peintre, impuissant encore à rendre fidèlement les grands effets de la nature. Sans y être prodiguée avec ce luxe qui distingue les vallées de la Manche ou du Calvados, la verdure s’y marie harmonieusement aux blés jaunissants ; et l’œil du voyageur[4] peut éprouver encore un charme assez doux, lorsqu’au bas d’une pente rapide et semée d’un cailloutage inégal, un petit village se déroule devant lui, avec ses maisons blanches et nouvellement crépies, et les dômes de peupliers qui le couronnent sur les hauteurs, et ses échappées d’eau, qui tantôt filent à travers les prairies comme un liséré d’argent sur un manteau soyeux, et tantôt grossissant leur volume, vont briser leur écume blanche aux ailes tournoyantes d’un moulin[5]. La Brie d’ailleurs, comme la Normandie, a ceci de remarquable entre les autres provinces françaises que l’industrie humaine s’y montre à chaque pas, et que le travail de l’intelligence laborieuse s’y rencontre partout. Si les châteaux qui la parsèment, perdus dans ses bas-fonds, ou accroupis sur ses côtes, n’ont pas ce caractère d’antiquité religieuse ou de grandeur monumentale que les poëtes sentent si profondément et cherchent à exprimer, au moins réunissent-ils tout ce que l’instinct du bien-être et le sentiment de l’élégance mondaine peuvent réaliser[6]. Là vous[7] ne trouverez point de ces vieilles murailles noircies par le temps et couvertes de mousse, où les graminées aiment à implanter leurs racines vivaces, et la giroflée jaune à balancer les topazes de son panache. Mais peut-être y rencontrerez- vous, non sans plaisir, quelques-unes de ces habitations nées d’hier et qui mourront demain, avec leurs toitures de tuiles et leurs blanches murailles, qui les font ressembler à des salles de théâtre perdues au milieu des champs[8]. Là aussi votre œil s’arrêtera sur ces édifices carrés surmontés d’une terrasse à l’italienne, dont l’aristocratie impériale affectionne tant les lignes droites et la symétrie compassée, image de ces murailles d’hommes que la volonté de Napoléon faisait mouvoir et tomber comme les pierres fragiles d’un édifice aligné au cordeau. La Brie, en effet, province bâtarde qui ne ressemble ni à nos pays de montagnes, ni à nos pays de vallées, mais qui tient à la fois de ces deux natures, et en marie les nuances, la Brie, esquisse rapetissée des beautés agrestes qu’on trouve ailleurs dans leur éclat primitif, convenait assez à ces existences équivoques, qui se sont tenues également à distance des grandes vertus républicaines et de l’élégance aristocratique, et n’apparaissent dans l’histoire que comme un point déjà à demi effacé[9].
Autour de Corbeil, et dans toute la Brie, se groupent donc tous ces noms de l’ère impériale que le burin des victoires et conquêtes[10] a récemment immortalisés ; là se pressent tous ces châteaux, tous ces palais, aumônes de l’Empereur à ses courtisans militaires. On dirait que la nouvelle noblesse n’a pas osé empiéter sur les possessions des vieilles races, il lui a fallu une province nouvelle aussi bien que des noms nouveaux ; elle s’est parquée dans la Brie ainsi que sur un terrain neutre, elle y a placé, comme en temps de guerre, ses lignes de circonvallation[11]. Au fait, ces maisons rectilignes et lourdes encadrées par des allées de peupliers ou de tilleuls, ces immenses parcs sablés avec un soin minutieux, et qui, des jardins de Louis XIV, n’ont gardé que la raideur, représentent assez bien cet esprit de l’empire égoïste et étroit, habitué à considérer les hommes comme des chiffres, et à déplacer les idées comme on déplace des canons[12]. Nulle part, en Brie, vous ne rencontrerez un de ces signes extérieurs qui[13] attestent la foi au passé et le culte des souvenirs religieux ; nulle part il ne vous sera donné de vous incliner devant une fenêtre à ogives, monument d’un autre âge ; nulle part une de ces petites madones, que les Italiens cachent si élégamment sous des dômes de verdure, ne sollicitera votre dévotion, ne fera appel à vos prières ; tout est roide, exact, mathématique ; on croirait que des ingénieurs ont dessiné le plan de toutes ces maisons sans poésie, et qu’ils ont tracé les lignes d’un camp au lieu d’un dessin animé et pittoresque[14].
À l’extrémité de la langue de terrain que nous avons décrite, et qui s’arrondit en forme de corbeille, pour aboutir en pointe aux rives de la Seine, il existe un grand château, bâti à l’italienne, et qui, borné d’un côté par le fleuve, de l’autre par des massifs d’arbres, offre à l’œil un aspect assez opulent, quoique froid et compassé. L’entrée du parc présente ce dessin correct que Le Nôtre[15] a mis à la mode : une allée bordée d’ormes conduit sur un sable fin à un péristyle soutenu par quatre colonnettes couronnées de feuilles d’acanthe et surmontées de rosaces en relief. Mais des croisées du premier étage, la perspective qui se développe au regard est vraiment d’une richesse remarquable ; mille arpents de terre semblent entourer le château de leur immense ceinture et se presser autour du maître, pour que celui-ci, d’un coup d’œil, puisse compter sa fortune, embrasser ses propriétés. Le château de Saintry est le point central d’un immense domaine ; les deux fermes qui en dépendent sont les deux fermes les plus magnifiques de la Brie ; et à l’extrémité de l’horizon, vous apercevriez les immenses bâtiments qui servent à leur exploitation.
Au moment où nous parlons, la plaine était dépouillée de sa parure et n’apparaissait plus que comme une grande surface grisâtre, entrecoupée çà et là par quelques arbres maigres et déjà fatigués par les pluies. Tant que l’œil pouvait s’étendre, on ne voyait qu’une superficie plate, rasée, renvoyant avec une âpreté incendiaire les rayons du soleil tombant à plomb sur ses plans, et brisant leur lumière aux aspérités des épis fauchés et des luzernes coupées à fleur de terre. On était au commencement du mois de septembre, la moisson venait de finir, et la plaine présentait cette immobilité, qui ressemble à une halte, à un moment de repos accordé à la nature ainsi qu’à un ouvrier laborieux. À peine si dans les champs, on rencontrait par hasard une charrue ou une houe ; dans ce moment et de ce côté, la Brie ressemblait à la Beauce comme une sœur à sa sœur.
Sur la route qui conduit de Corbeil au château, par une soirée de septembre fraîche et douce, deux voyageurs couraient dans une sorte de tilbury tressé en paille, et attelé d’un cheval bai[16], qui, sous le coup de fouet de son maître, semblait dévorer le terrain. Entre ces deux voyageurs il eût été difficile d’apercevoir, au premier abord, un lien commun, tant l’aspect de leur physionomie paraissait les séparer profondément. L’un était grand, maigre, tendu par l’usage fréquent d’une volonté impérieuse, et par les habitudes d’une vie tourmentée ; sa figure était toute en saillie, et on eût dit à le voir quelque masque antique accusant en reliefs vigoureux les symptômes de l’intelligence hâtive, ou des passions mordantes. Le front, les joues, le cou de cet homme étaient sillonnés par places, et devaient produire ces brusques transitions de la lumière à l’ombre que le pinceau du Caravage[17] a tant affectionnées ; creusé dans la chair comme dans le roc vif, son œil apparaissait voilé, pour ainsi dire ; à force de puissance et d’arrection[18], il ne réfléchissait plus les couleurs extérieures ; toute sa vie, tout son éclat s’étaient réfugiés en lui-même, et si je puis m’exprimer ainsi, il brillait en dedans.
Lorsque la brise venait à souffler, apportant avec elle les émanations humides de la rivière, celui dont nous parlons ôtait avec précipitation son chapeau pour ne pas perdre une seule bouffée de fraîcheur ; et alors, son front large, élevé, saillant, bruni vers le couronnement des yeux et coloré à l’endroit des tempes de ces teintes bistrées[19] qui ressemblent de loin aux laves d’un cratère, se montrait sur le devant dépouillé de cheveux. En le voyant on ressentait cette impression douloureuse que font éprouver les ruines précoces, les vieillesses prématurées ; on se demandait pourquoi cet homme était ainsi dépouillé de sa jeunesse ; pourquoi cette terre était frappée de stérilité[20] ? Toutefois, à cette compassion première se mêlait aussi ce sentiment de respect et de muette admiration qu’on accorde aux grands désastres et aux volontés supérieures. La poésie du malheur avait consacré cet homme, c’était un grand débris.
Autant l’aspect de celui-ci resserrait l’âme et la jetait en de tristes pensées, autant le second voyageur communiquait tout d’abord à ceux qui le voyaient une de ces émotions rafraîchissantes et douces qu’on peut comparer aux effets d’une harmonie lointaine, ou au murmure des flots le soir sur la grève. C’était un jeune homme de vingt à vingt-deux ans, frais comme une jeune fille[21], et doué dans toutes les poses de son corps, dans tous ses mouvements, de cette souplesse qui, aux yeux de certaines femmes, exclut tout caractère de virilité ; ses cheveux blonds et soyeux n’affectaient aucune forme favorite, et se jouaient au hasard sur son front, selon qu’il plaisait aux ondulations de la route et aux caprices du vent. Sa figure formait cet ovale régulier que les artistes de la renaissance ont tant aimé à reproduire ; ses yeux, d’un bleu remarquable, avaient cette expression d’étonnement naïf et de curiosité instinctive qui caractérise les jeunes gens non encore éprouvés aux enseignements de la vie, et demandant à tout ce qui les entoure des émotions et du bonheur. Sa carnation était blanche avec ces reflets rosés, symptômes d’une nature riche ; à peine caché par une cravate de soie négligemment enroulée, son cou apparaissait flexible; et chaque fois que le cheval excité précipitait son allure, le frêle jeune homme se penchait en avant et son corps reproduisait tous les mouvements du léger équipage. On eût dit[22] un enfant qui n’a ni force, ni volonté par lui-même, et se laisse aller au roulis des événements sans essayer de résister à leur choc ; peut-être était-ce une de ces créatures faibles, une de ces plantes débiles, qui ne cherchent dans le monde qu’un couvert où s’abriter[23]. Et qu’on ne s’y trompe pas, le physique a des reflets sûrs, qui illuminent les secrets instincts de l’âme mieux que ne le pourraient faire les plus patientes observations et les inductions les plus subtiles et les plus logiques[24].
La nuit commençait à tomber, et les ombres à couvrir la vallée. Le ciel était gris et de rares étoiles entrecoupaient ses lignes nuageuses. À l’extrémité de l’allée que suivaient les deux voyageurs se dessinait une masse blanche, à demi éclairée par la lumière du ciel, et épaississant en contre-bas son ombre sur les plans inclinés de la plaine ; en ce moment le plus âgé des deux voyageurs laissa tomber les rênes sur le cou du cheval. Il l’avait arrêté pour le faire reprendre haleine ; et sans honorer d’un regard la voûte magnifique qui se déroulait au-dessus de sa tête :
— Voilà le château, dit-il en faisant repartir le cheval.
Le jeune homme qui l’accompagnait ne répondit pas ; il se contenta de hocher la tête en signe de respectueuse déférence, et contempla mélancoliquement la scène nocturne qui s’ouvrait devant lui[25]. À quelque distance du bâtiment principal, dans un pavillon éclairé par deux étroites croisées, brillait une petite lumière pareille à celles que les gardes-côtes allument sur le rivage, et qui de temps en temps vacillait ainsi qu’un de ces feux qui sillonnent l’atmosphère pendant les nuits d’été ; des deux côtés de la route s’étendaient de vastes champs de blé, et le silence doublait le bruit des roues frôlant le cailloutage du chemin.
— Eh bien ! Henri, continua celui qui avait parlé le premier, à quoi songez-vous donc ? L’ange du souvenir vous emporte-t-il sur ses ailes ; et en quels espaces voyagez-vous maintenant ? Vous avez, Henri, une prédisposition singulière à la rêverie ; je vous soupçonne fort d’être un poëte déguisé. Le silence et la nuit ne manquent jamais de produire sur vous un effet étrange, et vous vous plaisez à attacher vos regards au front des étoiles : prenez-y garde ! Le silence, la nuit, les étoiles, sont de mystérieuses illusions qui gardent leurs secrets et ne répondent pas à ceux qui les interrogent. Voyons, à quoi pensez-vous ?
Henri, penché jusque-là sur le dossier de la voiture, releva vivement la tête ainsi qu’une sentinelle réveillée en sursaut, qui se roidit sur ses jambes et apprête ses armes.
— Arthur, dit-il, parlez-moi, et je vous répondrai. Mais au nom du ciel, ne souriez pas comme vous le faites en me parlant ; votre ironie a toujours quelque chose d’amer, et vos sourires me font mal. Adressez-vous à mon amitié, à ma reconnaissance, à mon dévouement, vous savez bien que vos avances ne seront jamais vaines. J’ai foi en vous, et je vous plains ; car il me semble parfois, en voyant votre sourire, que vous devez avoir cruellement souffert.
Henri s’arrêta et pencha de nouveau sa tête en arrière, en rassemblant sur son front les boucles dispersées de sa chevelure. Arthur fixa sur son jeune compagnon de voyage un regard empreint à la fois de compassion et de tendresse. Il y avait, dans toute son attitude, ce demi-abattement de la force qui se reconnaît impuissante, et presse en vain dans une étreinte inutile un objet prêt à échapper de ses bras.
— Henri, dit-il, n’êtes-vous pas content de votre sort ?
— Autant qu’on puisse l’être, murmura doucement l’enfant.
— N’ai-je pas dignement accepté la mission qui m’a été confiée ? Ne suis-je pas un second père pour vous ?
— Vraiment un second père, dit Henri, mais pardonnez-moi de pleurer encore quelquefois le premier.
Arthur lui prit la main.
— Pleure, pleure, enfant, répéta-t-il en prolongeant chaque note de ses paroles, comme s’il eût évoqué à la fois toutes les images du passé. Pleure, les larmes sont le dernier bonheur accordé à l’homme ; après celui-là, il n’en est pas d’autre. Oui ! tu as raison de le penser ainsi ! Ton existence a été frappée dans son origine ; ton bonheur a été flétri dans son germe ! Un père, une mère, Henri ! ce sont bien là les deux choses les plus saintes de la terre, et qui ne les a plus peut pleurer !
Il se fit encore un silence : la voiture roulait sur un fond de sable, et l’on entendait un bruit monotone et doux, semblable au sillage d’une chaloupe ; les deux acteurs de cette scène mélancolique se laissaient diverger dans les routes de leur passé, et s’abandonnaient silencieusement au courant de cette amollissante rêverie. Arthur le premier domina son involontaire émotion, et donnant à sa voix un accent plus ferme :
— Henri, reprit-il, nous sommes du même sang, de la même famille, ta mère était la sœur de ma mère ; toutes les deux sont mortes, nous sommes frères maintenant[26]. La mort nous a unis d’une chaîne indissoluble que la mort seule peut rompre ! Tu es à moi par droit d’héritage, et si tu trébuches dans le chemin de la vie, mon bras sera toujours là pour te soutenir et te défendre ! Si tu verses des larmes, donne-m’en la moitié ! quant au bonheur, garde-le pour toi seul, et ne m’en demande pas, je ne pourrais ni partager le tien, ni te donner du mien[27].
La voix d’Arthur était sonore et timbrée ; sa figure empruntait de pâles reflets aux teintes douteuses du crépuscule ; en prononçant ces derniers mots si profondément empreints d’une amertume incurable, son accent n’avait pas faibli, son haleine ne s’était pas arrêtée ; ainsi parle un vieillard depuis longtemps rompu à toutes les douleurs, supérieur à toutes les faiblesses, et qui sait qu’à certains maux il n’est pas de guérison.
— Mais pour Dieu, mon enfant, ajouta-t-il, ne regardez plus le ciel et les étoiles ! le désir de savoir et la faculté de se souvenir sont deux tristes cadeaux que le ciel nous a faits : la vie est un point entre deux abîmes, il faut passer sans regarder !
Les rôles venaient de changer : c’était Henri qui, à son tour, contemplait son interlocuteur avec un muet étonnement. Pour son âme juvénile les paroles d’Arthur avaient d’étranges mystères ; c’était maintenant la faiblesse qui se prenait de compassion pour la force souffrante[28], et qui, ne comprenant qu’à demi, ne pouvait que sentir et pleurer.
— Arthur, dit-il, pourquoi souffrez-vous?
Le jeune homme prononça ces mots d’une voix timide et confuse, ainsi qu’un novice qui interroge le prêtre et craint de compromettre son dévouement par une vaine curiosité. Le prêtre se tut un instant ; seulement un pli presque imperceptible sillonna sa face, et se reproduisit dans tous les angles du masque, comme un son répercuté dans l’espace des eaux, et renvoyé par les cavités du rivage.
— Assez, assez, dit-il en donnant à sa voix une expression d’ironique enjouement. Savez-vous, Henri, que nous tournons un peu trop à la mélancolie, et beaucoup plus qu’il ne convient à des gens comme nous, à des spéculateurs[29] accoutumés à lutter corps à corps contre la fortune, et à jeter dans une seule balance l’existence de vingt familles ? Autant vaudrait entendre un joueur[30] parler de l’existence de Dieu, ou de l’immortalité de l’âme ; vous n’avez pas l’esprit des affaires, vous ne comprenez pas le commerce, Henri.
Ils étaient arrivés auprès d’une grille qui se prolongeait devant toute la façade du château. Arthur se précipita en bas du tilbury. Derrière la porte d’entrée entrouverte, et debout sur la marche unique qui servait de péristyle à la loge du concierge, un homme, en habit de garde-chasse, fumait silencieusement sa pipe d’un air d’attente soucieuse et de résignation mêlée de regrets ; la main gauche placée sur la couture de son pantalon à la hauteur du port d’armes, il ressemblait à un factionnaire attendant une ronde d’officier, et remplissant passivement une fatigante mission ; son attitude, du reste, et sa figure encadrée par des mèches de cheveux grisonnants, complétaient cette apparence militaire, et la raideur de ses poses témoignait en lui ces habitudes de discipline que les vieux soldats n’oublient jamais. Au bruit que fit la grille en roulant sur ses gonds, il s’avança d’un pas égal ; et à l’aspect du nouveau venu, il quitta sa pipe et porta sa main droite à la tête, conformément aux usages de la politesse de camps.
— Vous nous attendiez, père Jérôme, dit Arthur ; monsieur le général a dû vous annoncer notre arrivée ?
Le concierge du château ne put si bien dissimuler sa pensée aux yeux de son interlocuteur, que celui-ci n’en devinât le secret.
— Je vois ce que vous avez, reprit-il, vous regrettez vos anciens maîtres, et vous souffrez de voir ce château devenu la proie d’un étranger.
— Monsieur le général ne reviendra-t-il plus ici ? demanda Jérôme avec cet accent d’un vieux serviteur fidèle, et cette dévotion presque religieuse dont le Caleb[31] de Walter Scott est la sublime réalisation.
— Si fait, dit Arthur, j’aurai toujours du plaisir à recevoir monsieur le général dans ma propriété (il appuya sur ce dernier mot) ; mais j’ai peur de ne pouvoir le recevoir longtemps. Que voulez-vous, mon brave, il en est des hasards de la vie, comme du sort des armes : aujourd’hui, c’est l’un qui gagne, et demain, l’autre ; celui-ci vend, celui-là achète.
— Ainsi, demanda le concierge d’une voix presque tremblante, monsieur le général a vendu son château ?
— Il l’a vendu, dit Arthur.
Jérôme poussa, du fond de sa poitrine, un soupir étouffé.
— Je le disais bien à Monsieur ! ajouta-t-il, qu’il menait trop grand train, et que ses dépenses le conduiraient à de dures extrémités. Quand on m’a dit que le château allait se vendre, je ne l’ai pas cru d’abord ; il me semblait que cela ne pouvait pas être…
Le vieux domestique se laissait aller à l’expression de ses doléances, et peut-être eût-il longtemps fatigué le propriétaire de ces retours vers le passé que les esprits vulgaires aiment tant à noyer dans un flux de paroles, lorsque celui-ci l’interrompit d’une voix impérative, et en homme qui connaît le prix des instants.
— Est-il venu, demanda-t-il, des visiteurs au château, ce matin ?
— Oui, monsieur, des hommes d’affaires, des arpenteurs, des notaires.
— Bien. A-t-on apporté des affiches ?
— Oui.
— Donne-les-moi.
Jérôme entra dans le pavillon, et en sortit un instant après avec des paperasses et un paquet de clefs à la main.
— Voici les affiches et les clefs, dit-il en s’inclinant.
Arthur prit le bras de son jeune compagnon de voyage, et se dirigea vers le château qui apparaissait au bout d’une longue allée de tilleuls. En montant les degrés du péristyle, ce même sourire dont Henri avait déjà remarqué l’amertume reparut de nouveau sur ses lèvres et contracta les muscles anguleux de sa figure.
II.
Les révolutions patrimoniales ressemblent aux révolutions politiques, en ceci qu’elles impriment une sorte de commotion et déplacent un assez grand nombre d’existences jusque-là contenues dans des limites certaines. Les grandes propriétés en croulant entraînent, comme les trônes, plus ou moins de désordres après elles, et suscitent des désirs jusque-là cachés, des ambitions inconnues, des passions mauvaises. L’esprit de l’homme est ainsi fait, qu’aussitôt qu’une voie lui est ouverte, il s’y lance avec une impétuosité d’autant plus grande, que son essor a été plus longtemps comprimé. La vente du château de Saintry avait produit, dans les villages avoisinants, une sensation profonde ; tous les paysans, dont les sentiments gagnent en énergie ce qui leur manque en étendue, tous ces hommes qui, faute d’intelligence peut-être, concentrent sur un seul point leurs facultés et leurs désirs, et semblent annihiler tous les instincts de leur nature au profit d’un instinct unique, celui de la propriété[32], sans savoir encore en quoi la vente du château les touchait, s’en occupaient comme d’un événement personnel qui devait exercer sur eux une réelle influence.
Que si vous voulez calculer la puissance de ce mot : avoir[33] ! sur le cœur des hommes, c’est à la campagne surtout, c’est dans les villages les plus obscurs qu’il en faut étudier les effets. Un malheureux, qui gagne vingt sous[34]par jour, travaillera sous le soleil pendant douze heures, et mettra dix sous de côté pour pouvoir dire au bout de vingt ans : j’ai un arpent[35] de terre à moi. Sa femme et ses enfants mangeront toute leur année du pain bis et boiront de l’aine[36] ; lui-même s’imposera les plus dures privations, les fatigues les plus inouïes ; pour un écu[37], il se fera le domestique du premier venu ; il prendra le sommeil de ses nuits et le repos de ses dimanches ; il durcira ses mains dans la neige, accoutumera ses yeux aux plus cuisants rayons de la lumière ; il remplira les fonctions les plus viles, s’acquittera des services les plus dégradants, et tout cela pour avoir cinquante perches de vignes qui lui rapporteront, bon an mal an, quatre pièces de mauvais vin.
L’instinct de la propriété a, dans notre siècle, plus de pouvoir sur l’esprit de l’habitant des campagnes que n’en eût au Moyen Âge le zèle religieux ; on dirait que la plupart des hommes ne voient dans la vie qu’un seul but : posséder un coin de la terre qu’ils habitent, ne fût-ce que pour y laisser leurs os. Entrez chez un ouvrier de la Beauce, et dites-lui : « Si tu veux me servir dix ans sans repos, sans relâche, avec un zèle et une obéissance de tous les instants, dans dix ans je te donnerai un champ en jachère, que tu retourneras à ton gré, à l’aide de tes bras » [38] ; dût-il ne survivre qu’un an à un bonheur si chèrement acheté, il vous répondra : « Maître, je suis à vous ». Car il n’y a pas un paysan qui ne donnerait sa vie pour pouvoir dire avant sa mort : « J’ai eu quelque chose à moi, j’ai possédé ».
Ceci n’est pas une exagération ; un paysan vit pour dix sous par jour avec sa femme et quatre enfants ; la chaumière qu’il habite lui coûte quarante francs de loyer par an, et il y trouve tout le logement dont il a besoin, c’est-à-dire une grande chambre qui sert à la fois de cuisine, de huchoir[39] et de chambre à coucher pour toute la famille, puis une étable creusée en terre, assez grande pour contenir deux vaches.[40] La femme, pendant les veillées d’hiver, file du chanvre et fait des chemises pour son homme et ses enfants. Quant au feu, on n’en a pas besoin, on se contente seulement de bien clore l’étable, et on compte, pour se réchauffer, sur la chaleur des deux vaches. Pain, habillement, loyer, tout cela peut revenir à huit sous par jour ; on garde l’excédant pour les jours de fête, et le dimanche, l’homme peut encore se soûler convenablement avec deux bouteilles de vin à quatre sous. Les plaisirs de la femme sont toujours gratuits ; ils consistent à aller s’asseoir sur les bancs de la grange où l’on danse, et à chanter sa chanson le soir à la veillée. Eh bien, parmi ces gens vous entendrez rarement un murmure, une plainte ; car semblables aux Israélites du désert, ils ont toujours devant eux leur terre promise et leur pays de Chanaan ; qu’importe qu’ils meurent au bout de la route, pourvu qu’ils aperçoivent en mourant la borne qu’ils auront plantée. Aussi, quand une grande propriété se démembre, c’est chose curieuse de voir toute cette meute de petites gens se ruer sur les lopins de terre longtemps convoités, comme une bande de corbeaux sur une proie fraîche ; heureux alors ceux qui, sou à sou, ont amassé, et caché dans la toile de leur paillasse, un trésor de cent écus, représentant à peu près dix perches[41] de terrain y compris les frais du notaire et les droits de l’enregistrement ! Malheureux ceux qui ont trop pris de plaisir à choquer leur verre contre le verre d’un ami et à chanter à tue-tête les exploits du grand empereur[42], cet effroi de tous les trônes de la terre, ce dieu de toutes les joies pauvres, cette idole de toutes les misères qui veulent s’étourdir ; ceux-là sont les parias de cette civilisation égoïste et avide ; à ceux-là, on lance cet anathème terrible qui renferme tout un monde de mépris : ils n’auront jamais rien !
Dans tous les villages qui avoisinent le château de Saintry une grande rumeur s’était répandue ; de proche en proche, de porte en porte, elle avait gagné toutes les habitations, frappé toutes les oreilles : le château était vendu. D’abord, on s’était inquiété des causes probables qui avaient pu amener ce grand événement ; et, comme il arrive d’ordinaire les suppositions les plus absurdes avaient trouvé le plus de créance. Le général, disait-on, avait perdu des sommes énormes au jeu, et il avait été obligé, pour satisfaire ses créanciers, de vendre son magnifique domaine. D’autres prétendaient que le château n’était qu’une concession à temps faite par l’Empereur à l’un de ses meilleurs officiers[43] ; et que le terme une fois expiré, celui-ci s’était trouvé dépossédé tout d’un coup ; d’autres enfin mêlaient, comme toujours, l’action du gouvernement à cette catastrophe inattendue ; quelques-uns ne craignaient pas d’affirmer que le général avait été forcé, pour cause d’opinion, de passer à l’étranger sans oser tourner la tête derrière lui,. Toujours plus disposés que les autres aux sentiments vindicatifs et haineux, les plus pauvres se consolaient de leur misère[44] en accablant d’injures cette fortune déchue qu’ils avaient respectée si servilement aux temps de sa splendeur. Le général, murmuraient-ils, avait mené trop grand train, il avait dépensé en un an des millions, il était d’ailleurs hautain, dur aux petits, et c’était un coup du ciel d’avoir abattu son orgueil. Ainsi est faite la nature humaine ; toute puissance qui tombe est maudite, toute grandeur qui s’éteint est calomniée : éternelle réaction de l’égoïsme humain, toujours également prêt à baiser la main qui l’engraisse même en le frappant et à mordre celle qui n’a plus de pain ni de coups de fouet à lui donner !
Un intérêt mystérieux s’attachait en outre à la vente. On s’était d’abord imaginé que le nouveau propriétaire devait être quelque capitaliste[45] en renom mais lorsqu’une connaissance approfondie des choses avait appris aux curieux qu’un homme obscur, sans titre, qui n’était ni prince, ni marquis, ni maréchal d’empire, avait acheté le domaine du général moyennant un million comptant ; lorsqu’au bout de cette révolution territoriale, matière à tant d’absurdes suppositions, on avait vu apparaître pour dénouement un nom inconnu : Arthur Raimbaut[46] ! Les conjectures avaient pris alors une route toute différente, et le mot de Bande noire[47] s’était transmis de bouche en bouche.
Il n’entre pas dans le plan de ce livre d’expliquer ce qu’est en réalité la Bande noire, et d’en esquisser la physionomie[48] générique, nous voulons peindre un type spécial et exceptionnel qui ne se rattache que par des liens apparents à cet esprit de démembrement brutal et de conquête, dont les poëtes et les artistes ont stigmatisé l’avidité et les funestes résultats ; mais nous avons à cœur d’expliquer tous les effets d’un pareil mot[49] sur les habitants de nos campagnes. Pour un paysan, la Bande noire est un être mystérieux, une espèce de monstre qui n’a qu’une tête et fait mouvoir cent bras ; c’est une personnification vivante de tout ce qui est ruine, morcellement, instinct d’audace et d’astuce ; c’est l’ennemi-né de tous les grands noms ; c’est un fantôme dont nul ne connaît l’origine, dont nul ne devine le secret : chose étrange que la passion la plus sèche et la plus positive, la passion de l’argent, enfante seule et nourrisse en notre temps les creuses rêveries de la superstition !
Devant la porte du château stationnaient presque tous les jours des groupes nombreux, questionnant le concierge qui hochait la tête pour toute réponse, et regardant d’un œil stupidement émerveillé les grandes affiches jaunes qui brillaient au soleil sur les pilastres de la grille d’entrée avec leurs énormes majuscules et leurs interminables divisions de lots. Là, on discutait le prix des enchères, et déjà, comme pour s’essayer aux roueries d’une adjudication[50], les plus habiles prenaient à tâche de dissimuler leur pensée en dépréciant la valeur du terrain qui excitait le plus spécialement leur convoitise. L’arrivée du nouveau propriétaire avait un peu ralenti cette ardeur de curiosité, et fait taire ces démonstrations extérieures : les abords du château étaient devenus déserts, et à peine si, de temps en temps, quelque personnage employé sans doute au service accidentel de la maison en traversait les solitudes.
Le lendemain de son arrivée, le personnage que nous nommons Arthur avait pris possession du château sans bruit et sans pompe. Dès la pointe du jour on l’avait vu sillonner en tous sens les allées du jardin et du parc ; une grande redingote brune, croisée sur sa poitrine jusqu’au menton, lui donnait, en vieillissant ses traits, un air austère et sombre ; toutes les lignes de sa physionomie semblaient tendues par une pensée unique, et ses yeux, immobiles dans leur orbite, concentraient une lumière fauve sans chaleur et sans vie[51] ; sur son front roide et uni, vous eussiez vainement essayé de retrouver la trace des émotions de la veille, ainsi que dans quelque arbre pétrifié vous chercheriez, sans les trouver, les ondulations de sa ramée et le dessin de ses feuilles. Il avait parcouru rapidement tous les appartements du château sans accorder un seul coup d’œil sympathique à ces vastes salles désertes, sans ornements et sans meubles, qui ressemblaient à des galeries funéraires, à d’élégantes catacombes. Quelquefois seulement, il paraissait éprouver un plaisir étrange à faire résonner le talon de ses bottes poudreuses sur le bois des parquets lustrés, sur le granit poli des dalles, comme s’il eût voulu insulter aux échos muets de l’habitation abandonnée, et imprimer au front des pierres elles-mêmes le cachet de sa suzeraineté. Un moment, il s’arrêta devant une peinture à fresque placée entre le double encadrement des croisées, et qui représentait Napoléon entouré d’une suite dorée de valets à sa livrée, et il se prit à regarder face à face la pâle figure de l’Empereur qui se dessinait fantastiquement dans le demi-jour de l’appartement. Par quelle secrète union de pensées cet homme s’associait-il en ce moment à la fortune du génie malheureux et détrôné ? Comment cet inconnu, appelé Arthur Raimbaut, osait-il contempler silencieusement et sans baisser les yeux, cette grande image qui s’était appelée autrefois Napoléon[52] ? Ceux-là le pressentiront peut-être, qui comprennent qu’entre la destinée la plus obscure et la destinée la plus brillante, il est parfois et dans les profondeurs de l’âme des rapprochements irrévélés, et que César aurait peut-être trouvé son prototype à la tête d’une bande de brigands ou parmi les pâtres du Latium[53].
Par un de ces accidents d’optique qui ressemblent aux effets magiques d’un diorama[54], Arthur Raimbaut avait vieilli de dix années depuis la veille ; les mèches de ses cheveux grisonnants tombaient en désordre sur le derrière de sa tête, et se hérissaient à pic vers les tempes comme pour laisser deviner la tension des muscles du visage ; les coins de sa bouche étaient plissés avec une sorte d’opiniâtreté, qui eût fait croire à la pétrification réelle du galbe ; ce n’était plus l’homme fort, quoique souffrant, qui, la veille, entretenait avec son jeune compagnon un commerce de pensées à demi contenues, c’était plutôt l’homme aguerri aux hautes luttes, et ramassant ses forces pour livrer un dernier et terrible combat. Quand par hasard il adressait la parole à ceux qui se trouvaient sur sa route, sa voix était brève, claire, tranchante comme le bruit d’une pièce d’or frémissant dans le plateau d’une balance. Dans le son de sa voix, dans l’immobilité de sa face, dans l’impatience nerveuse de ses gestes, il y avait du joueur[55].
Au milieu du salon du château, autour d’une table circulaire couverte d’un tapis vert, deux jeunes gens, penchés sur de longs registres, paraissaient absorbés dans un travail de chiffres qui ne leur laissait pas un seul instant de repos ; outre la table dont nous parlons, trois ou quatre chaises de paille complétaient l’ameublement ; et dans le silence du vaste appartement, on n’entendait que le bruit des plumes agaçant le papier. Lorsque Arthur Raimbaut parut devant les deux jeunes gens, celui qui occupait le haut bout de la table fit un mouvement et se leva à moitié.
— Ne vous dérangez-pas, Henri ! dit celui-ci d’un ton bref.
Le jeune homme laissa retomber sa tête et se remit au travail avec une respectueuse docilité. Pour son compagnon, il était muet, immobile, semblable à un soldat qui tremble devant son supérieur, ou à quelque pauvre écolier qui redoute les avertissements d’un maître sévère.
Arthur Raimbaut prit encore une fois la parole :
— Le notaire n’est pas venu ? dit-il.
— Non, répondit Henri.
— Qu’on aille le chercher ! reprit vivement Arthur Raimbaut. Allez, Henri, allez vous-même ! Prenez mon cabriolet et amenez-moi cet homme, à l’instant même ! entendez-vous ?
Henri se leva rapidement ; et sans dire un seul mot il se dirigeait vers la porte, lorsqu’un nouveau personnage entra dans le salon. C’était un petit homme de quarante ans environ, rouge, gras, avec un sourire stéréotypé[56] sur les lèvres, et cette politesse banale des hommes d’affaires qui n’a d’analogie qu’avec la politesse des marchands. Il portait un habit noir brossé avec soin, et qui, en s’élargissant sur le devant, laissait voir le plastron officiel d’une chemise correctement plissée, et une cravate soigneusement empesée et rebondissante autour du cou.
Lorsque Arthur Raimbaut eut aperçu l’homme dont nous parlons, un mouvement de colère plissa un moment sa figure, et disparut aussitôt sous la sérénité d’un accueil flatteur et d’un sourire calculé.
— Ah ! vous voilà, monsieur le notaire, dit-il en lui prenant le bras et en le conduisant hors du salon, sans même lui donner le temps d’achever son salut ; nous avons à causer, venez donc.
Ils descendirent tous deux les degrés du péristyle, et s’enfoncèrent dans les sentiers d’un petit bois qui descendait par une pente insensible vers la plaine.
— Eh bien ! monsieur le notaire, reprit Arthur ; je vous avais bien dit que cette propriété serait à moi ; et cependant les renseignements que vous m’aviez donnés n’étaient pas favorables ! Le général, affirmiez-vous, ne voulait pas entendre parler de vente ; vous lui aviez fait des offres qu’il avait toujours violemment repoussées ; il craignait, avant tout, de voir sa propriété devenir la proie des spéculateurs et des fripons (je parle son langage). Eh bien ! monsieur le notaire, tout cela n’était que du vent. Vous connaissez le mot du Mazarin à Anne d’Autriche : « Un million, madame ! »[57] Allons donc ! Et voilà une Marion Delorme[58] toute trouvée ! Telle est l’histoire du général, monsieur le notaire.
Au mot de million, le petit homme avait relevé sa tête, assez semblable à un poney qui aspire de tous ses poumons les émanations d’une brise fécondante. Par une de ces intuitions rapides, qui dans les hommes d’affaires semblent les effets d’une seconde vue, il avait déjà calculé combien un pareil contrat de vente avait dû rapporter au notaire du vendeur, et combien la division d’une pareille propriété devait produire.
— Ainsi, dit-il en faisant pivoter l’un sur l’autre ses deux pouces, vous avez payé tout cela un million[59] ?
— Oui, dit Arthur Raimbaut ; et l’affaire a été conclue en une heure au plus.
— Monsieur le général était donc pressé de vendre ? objecta le notaire.
— Apparemment, dit l’autre ; car voici ce qui s’est passé[60] : Il y a quinze jours au plus, j’allai trouver le général à son hôtel, il était dans le salon étendu sur un divan, et fumant un cigare de Manille ; lorsqu’on m’annonça, il ne leva même pas la tête et continua de fumer, c’était juste ; je pris un fauteuil et je m’assis en face de lui :
— Que me voulez-vous ? me demanda-t-il de ce ton bref et absolu que l’Empereur a légué à ses lieutenants.
— Général, lui dis-je, voulez-vous vendre votre château ? Il se leva sur son séant ; ses moustaches frissonnaient de colère ; ainsi ému, il eût été superbe à la tête d’une charge de cavalerie.
— Vendre mon château ! s’écria-t-il ; une dotation de l’Empereur ! un titre de famille qui doit passer à mes derniers neveux ! Vous êtes bien hardi, monsieur, de venir ici, chez moi, me faire une pareille proposition !
Je m’attendais à cette sortie, et je ne répondis pas. Sa fureur s’accrut de mon silence ; il commença à mêler des jurons soldatesques à ses déclamations seigneuriales.
— Je vois qui vous êtes ! me dit-il à la fin avec une insolence vraiment très-remarquable, vous êtes un de ces spéculateurs comme on en voit tant ! un de ces agioteurs[61] qui dévalisent toutes nos provinces, et démolissent pierre à pierre les plus beaux monuments de notre France !
— Et vous gardiez le silence ? demanda le notaire, qui ne concevait pas dans un autre un sang-froid qu’il ne sentait pas en lui-même.
— Pourquoi pas ? dit Arthur ; cet homme avait du plaisir à faire des phrases, ne faut-il pas que tout le monde s’amuse ? Quand il eut fini d’exhaler sa bile contre ce qu’il appelait la Bande noire :
— Général, lui dis-je, combien voulez-vous de votre château ? Pour la première fois il laissa tomber sur moi un regard, et de nous deux, ce fut lui qui détourna le premier les yeux.
— Qui vous a dit que je voulais vendre ? demanda-t-il avec un reste de colère qui s’éteignait pourtant.
— Je le sais.
— Et où trouveriez-vous de l’argent pour payer mon domaine à sa valeur ?
— Pourvu que je vous le paye, peu vous importe comment ! Voulez-vous un million ? (Je me rappelais toujours le mot du Mazarin). Le général se leva cette fois sur son séant.
— Un million comptant ? dit-il.
— Comptant ; est-ce un marché fait, général ?
— Oui, répondit-il brusquement en laissant percer sous le laconisme monosyllabique de sa réponse le dernier regret de la vanité vaincue ; mais que je n’entende plus parler de tout cela ! Passez chez mon notaire, traitez avec lui les détails de l’affaire comme il l’entendra ; vous avez ma parole.
Je me levai, il ne me salua même pas : c’était juste, il me méprisait.
Arthur Raimbaut prononça ce dernier mot en l’accompagnant d’un sourire.
— Mais, qu’importe, ajouta-t-il, n’est-ce pas, monsieur le notaire, un peu plus ou un peu moins de délicatesse dans les procédés, pourvu que les affaires se fassent et que le jeu s’engage ! la partie est commencée, et je la jouerai bien, soyez-en sûr.
Les deux interlocuteurs étaient arrivés à l’extrémité du parc. Du haut d’une terrasse au niveau de la plaine, et protégée par un fossé en guise de mur, ils pouvaient d’un coup d’œil embrasser tous les accidents de la perspective. Le notaire promenait son regard étonné sur l’immensité d’horizon qui se développait devant lui.
— C’est une belle propriété ! n’est-ce pas, monsieur le notaire? dit Arthur Raimbaut ; c’est un beau domaine à gruger[62] ! une belle fortune à mettre au mortier !
Arthur se tut un instant ; dans ses yeux brillait une joie sauvage, et cet instinct féroce des animaux de proie à l’aspect d’un cadavre. Le notaire le regarda en clignotant ; cet éclair imprévu de passion l’avait ébloui, et il essayait de ramasser toute son intelligence pour en deviner le sens.
Arthur avait ouvert une petite porte qui conduisait du parc dans la plaine, et son compagnon le suivait avec la docilité d’un chien de chasse qui attend sa gueulée[63].
— Monsieur, dit Arthur, comme vous êtes le notaire du pays, j’ai cru qu’il était convenable de m’adresser à vous de préférence à tout autre !
Le notaire s’inclina en signe de respectueux remerciement.
— Vous, qui avez l’expérience des affaires, comment me conseillez-vous d’opérer ma vente ?
— Par adjudication, dit le notaire sans hésiter.
— Pourquoi cela ?
— L’adjudication, dit le petit homme, échauffe les intérêts en les mettant en présence ; les plus-values jaillissent du choc des amours-propres rivaux.
— Bien ! bien, dit Arthur, vous connaissez les hommes ! et quel droit prenez-vous sur une vente par adjudication?
Le notaire sentit le piège qu’on lui tendait ; il recula d’un pas et tressaillit comme un homme qui verrait se dresser devant lui le dard enflammé d’une vipère[64].
— Nous prenons cinq pour cent, murmura-t-il à voix basse.
Arthur s’arrêta à son tour comme pour savourer à loisir l’embarras de son interlocuteur. Puis s’avançant d’un pas :
— Monsieur le notaire, dit-il, contrairement à votre avis, nous ne vendrons pas aux enchères. Cinq pour cent ! mais savez-vous que c’est vouloir ruiner les acheteurs ! je vendrai à l’amiable, je traiterai moi-même avec les paysans contrat en main ! maintenant, voulez-vous faire les actes de la vente ? Voyons, monsieur le notaire, soyons francs. Combien me prendrez-vous ?
Malgré l’aplomb et l’imperturbable habitude de finesse qui caractérise les hommes d’affaires de la province, celui-ci se sentait dominé par le sang-froid de son interlocuteur et la fixité d’un regard qui ne le quittait pas. Avant de répondre, il hésita comme s’il eût tâté du doigt la jointure d’une articulation délicate, et interrogé secrètement les différentes probabilités de sa position.
— L’habitude, dans le notariat, dit-il à la fin, est de prendre un pour cent ; plus les frais de grosses[65] et d’expéditions.
— C’est trop, dit Arthur ; je vous donnerai un demi pour cent.
— Un demi pour cent ! s’écria le notaire ; mais cela ne s’est jamais vu ! Voulez-vous donc que tous mes confrères me placent au ban du notariat ! Voulez-vous qu’on m’accuse d’oublier les intérêts du corps et de sa dignité !
— J’ai pensé à tout cela, dit celui-ci du ton froid et acéré qui lui était habituel ; je ferai faire ma vente par un huissier ; n’en parlons plus, monsieur le notaire !
Le notaire ne répondit pas. Une crispation nerveuse bouleversa sa figure et hérissa presque ses cheveux ; pour bien comprendre toute l’étendue de son émotion, il faudrait savoir avec quelle avidité les différentes castes d’hommes d’affaires à la campagne s’entre-déchirent perpétuellement ; il faudrait avoir suivi attentivement de l’œil ces guerres intestines, sans pitié ni merci, entre les notaires d’une part, et les huissiers de l’autre ; il faudrait savoir combien à propos d’une affaire surgissent et grondent de basses passions, de plates rivalités, de haines invétérées et chicanières, et comme ces amours-propres sans cesse en contact deviennent irritables et toujours prêts à saigner à la première blessure. Peut-être le spéculateur lut-il sur la figure du notaire tous ces sentiments d’orgueil blessé et de rancune inassouvie ; car, en le regardant, il laissa tomber ces mots d’un air de certitude qui n’admettait pas la possibilité d’un refus.
— Est-ce un marché fait ?
— Oui, dit le notaire d’une voix presque éteinte.[66]
— À la bonne heure, reprit l’autre, et maintenant allons déjeuner, monsieur le notaire, car nous avons encore beaucoup à causer.
III.
Un matin, Arthur Raimbaut sortait du château et s’avançait dans la plaine par un petit sentier tortueux et inégal qui aboutissait à de vastes bâtiments de service propre à l’exploitation d’une ferme. Sa toilette avait quelque chose de plus apprêté qu’à l’ordinaire : il portait un habit bleu, et sur un gilet de satin noir brillait une chaîne en or[67], qui, sous les rayons du soleil projetait ces reflets chatoyants dont les joueurs et les femmes aiment tant la mystérieuse poésie. Il avait à l’index de la main droite un diamant encadré dans une monture noire[68] qui mêlait aux rayonnements de l’or ses prestigieux scintillements ; sa figure, d’ailleurs, exprimait cette sorte de grâce étudiée d’un acteur qui se prépare à entrer en scène et médite les effets probables de son rôle ; ainsi vêtu, on pouvait lui trouver un caractère de beauté remarquable, car la puissance est aussi de la beauté[69].
À quelques pas du château, il s’arrêta comme pour attendre un compagnon de route, et quelques instants après, Henri parut derrière lui. Le jeune homme n’avait rien d’insolite dans sa mise : une redingote noire étroitement pincée dessinait ses formes un peu grêles et les proportions presque féminines de son torse gracieux[70] ; son visage était rose et frais, et les boucles de ses blonds cheveux, qui se jouaient au moindre souffle de la brise, effleuraient la peau lisse de son front et les contours de ses tempes veinées. Lorsqu’il arriva auprès d’Arthur Raimbaut, celui-ci le considéra quelque temps d’un air de bonté paternelle et d’intérêt mêlé d’attendrissement, à peu près comme un vieux pilote considère le novice timide qui va livrer pour la première fois sa barque à la merci des flots.
Henri ressemblait exactement à un enfant ; il avait dans sa démarche, dans son attitude, dans toutes ses poses, ce laisser-aller capricieux des natures jeunes, qui semblent comme les fleurs des champs mal attachées sur leurs tiges, et se laissent mollement dériver aux ondulations de l’air, ou au contact d’un grain de sable. Les formes rondes et adoucies dominaient dans sa personne, les lignes pures dans sa physionomie comme dans celle d’une femme ; sa bouche était petite, ses lèvres pourprées et à demi entr’ouvertes, ainsi que le calice d’une primevère ; sa main était allongée et mince avec des doigts effilés, qui trahissaient à peine sous leur enveloppe blanche les saillies des os et la jonction des artères. Sa voix avait ces modulations fragiles et comme brisées, qui ressemblent aux soupirs des poëtes, ou aux tremblements d’une jeune fille émue au souffle du premier amour[71]. Les cils blonds qui voilaient à demi ses yeux affectaient cette nonchalance moelleuse, qui indique la douceur des sentiments de l’âme ou les émotions contenues d’un cœur inaguerri et plutôt fait pour la vie intérieure du gynécée[72], que pour les combats du cirque et les luttes violentes. Il parlait peu d’ordinaire, et ses paroles s’arrondissaient, pour ainsi dire, comme la pointe émoussée d’un glaive. La forme dubitative était celle qui lui convenait le mieux ; ses axiomes les plus énergiquement formulés ressemblaient à des interrogations timides ; la négation était l’essence de son langage, et on pouvait dire de lui, qu’il ne vivait pas, mais qu’il se laissait vivre.
Pour démêler en lui les jets étouffés d’une intelligence distinguée, il fallait une de ces intelligences actives et fortes qui suppléent par l’éducation à l’expression visible, et retrouvent en elles-mêmes le sentiment des caractères effacés. Aux yeux du commun des hommes, Henri avait toujours passé pour un enfant ordinaire ; car il est donné à peu d’esprits d’apercevoir ce qui se cache, et de deviner la lumière sous le boisseau[73] qui la couvre. Les femmes surtout se montraient envers lui d’une remarquable indifférence ; aussi quand on lui parlait d’amour, avait-il coutume de sourire doucement, comme s’il eût senti que l’amour chez lui était une impuissance, et que le premier devoir des faibles est de cacher leur faiblesse.
Lancé à la suite d’Arthur Raimbaut dans un cercle de jours orageux et d’audacieuses spéculations, il avait peine, malgré tous ses efforts, à se persuader qu’il avait dans cette vie une part d’intérêt direct, et chaque fois qu’il assistait à une lutte nouvelle, il admirait les prodigieux élans de virilité qui faisaient de son ami et de son maître, un type[74] exceptionnel et supérieur entre tous ; mais pour en deviner le sens, pour en expliquer le but, il ne le pouvait pas. Volontiers, si on l’avait laissé faire, il se fût croisé les bras et eût regardé passer la vie comme on regarde quelque insignifiant spectacle ; parmi tous les rôles qui se jouaient devant lui, il n’en trouvait pas un fait à sa taille. Le seul sentiment qui parût en lui empreint d’une certaine activité, c’était son amitié et son dévouement pour Arthur ; dans l’affection qu’il lui portait, on eût pu reconnaître cette sorte d’admiration aveugle qui s’attache aux grands caractères ou aux grandes souffrances ; il semblait avoir compris par instinct la supériorité de cet homme, et il l’aimait quoiqu’il ne le comprît pas.
Arthur Raimbaut lui avait pris le bras et marchait avec lui comme un compagnon discret qui connaît le prix du silence, et sait au moins que vis-à-vis de certains hommes, se taire est une politesse et souvent une obligation. Dans ses relations ordinaires avec Henri, Arthur était bref, concis, mais toujours affectueux et bon ; quand il le prenait pour confident de sa pensée, c’était toujours avec bienveillance et douceur ; mais aussi il l’estimait assez pour ne pas se croire obligé envers lui à de perpétuels efforts, et quand Arthur se taisait, Henri se taisait comme lui.
Il était près de midi ; le soleil de septembre illuminait la plaine de ses rayons ; les deux amis continuaient silencieusement leur route, l’un insouciant et passif, l’autre méditatif et absorbé.
— Savez-vous, Henri, dit le premier en laissant tomber un regard sur son jeune compagnon, que nous jouons gros jeu[75] cette fois ? et quand je considère cette immense plaine dépouillée de ses moissons, il me semble voir un grand tapis vert sur lequel nous venons de jeter un million pour enjeu ! Avez-vous joué quelquefois, vous, Henri ?
La question était directe, et le jeune homme eût cru manquer à son devoir en n’y répondant pas.
— Oui, dit Henri, quelquefois ; j’ai jeté comme un autre ma pièce de vingt francs sur une table d’écarté[76] ; et à dire vrai, le jeu ne m’amuse pas[77].
Arthur se prit à sourire, et fit encore quelques pas dans le silence, puis élevant la voix, il reprit ainsi :
— Mais jouer un million, Henri ! un million ! c’est-à-dire une existence tout entière ! exposer sur un seul coup de dés, sa vie, sa réputation, son honneur, n’est-ce pas là un beau jeu ? dites, ou plutôt une grande bataille ?
— Si vous gagnez, demanda timidement Henri, que gagnerez-vous ?
— Un demi-million, peut-être, dit froidement Arthur Raimbaut.
— Et si vous perdez ? continua le jeune homme.
— Je perdrai tout, dit l’autre ; je serai ruiné[78], flétri, marqué au front d’un stigmate indélébile, ce sont là les chances du jeu et de la guerre : gloire aux vainqueurs, opprobre et misère aux vaincus !
— Et trouvez-vous, dit Henri, la proportion égale ?
Arthur s’arrêta un instant, comme si cette continuité de questions logiques l’eût étonné et eût déjoué toutes ses prévisions.
— Henri, dit-il d’une voix grave[79], il est certains hommes qui ont besoin de produire au dehors l’activité qui les consume en dedans ; il est des flammes qui s’éteignent faute d’aliments à dévorer ; pour les âmes actives et puissantes, le repos, c’est la mort ! Ne savez-vous pas que la vie factice de la fièvre supplée à la vie réelle, et qu’on a vu des convalescents mourir pour avoir été trop tôt guéris ! Heureux soyez-vous, vous qui ne sentez pas encore cet impérieux besoin de mouvement qui déplace l’âme, et la lance incessamment en des espaces mouvants ! Heureux êtes-vous, si en contemplant le cratère d’un abime, le désir ne vous a jamais pris de vous y précipiter, seulement pour en toucher le fond ! votre vie à vous, Henri, s’écoule calme et paisible comme le ruisseau de la vallée qui poursuit fatalement sa route ; vous ne regardez ni derrière vous, ni devant vous ; mais attendez que vous ayez vécu ! Vous êtes jeune, Henri, et je suis déjà bien vieux, moi ! Un jour, peut-être, il vous sera donné de comprendre l’explication que vous cherchez, mais, pour Dieu ! ne désirez pas que la fièvre me quitte, car la fièvre pour moi, c’est la vie. Il y a au monde des soldats qui se battent pour se battre, et sans plus se soucier de la victoire que de la défaite ; de même, il y a des joueurs qui jouent pour jouer. Perte ou gain, qu’importe pourvu qu’on joue, pourvu qu’on vive ! Et d’ailleurs, n’éprouveriez-vous pas un certain plaisir à mettre le pied sur des oripeaux de bateleurs comme sur une proie ? ne comprenez-vous pas que l’instinct de la ruine est inné au cœur de certains hommes[80], et que c’est une sorte de juste réparation que de contribuer par soi-même à la spoliation des fortunes insolentes, à la chute de ces fausses grandeurs qui se font de leur niaiserie même un piédestal pour nous écraser ? Oui, Henri, toutes les fois que j’ai eu entre mes serres un de ces grands domaines qui cachent sous la splendeur de leur entourage tant de platitude et d’arrogance, ç’a été pour moi un plaisir étrange de le dépecer à mon aise, et de le jeter en pâture à la nuée des corbeaux avides.
En parlant ainsi, la voix d’Arthur s’était élevée par degrés comme le rinforzando[81] d’une ouverture guerrière ; sa figure s’était colorée, par place, de ces teintes rougeâtres, symptômes des émotions fébriles. Mais en un instant ce soulèvement passager s’abaissa ; Arthur redevint calme et froid comme il était presque toujours, avec son demi-sourire sur les lèvres.
— Et gagnerez-vous ? demanda Henri en feignant d’attacher à sa question plus d’intérêt qu’il n’en attachait en réalité.
— Peut-être, dit Arthur avec ce ton froid des hommes d’argent, habitués à calculer sur les probabilités comme sur une matière inerte, et à traiter les affaires les plus importantes comme d’autres traitent les plus petites. Notre début n’est pas bon et nous avons des chances contre nous ; la cupidité des gens sur laquelle je comptais, est dominée par une influence qui paralyse mes efforts et déjoue mes calculs. J’ai contre moi l’homme le plus riche et par conséquent le plus puissant des environs[82].
— Quel est cet homme ? demanda Henri.
— Un fermier du général, nommé Guillaume Évon, le maire de Saintry. Vous riez, Henri ! c’est que vous ne savez pas qu’en affaires, il n’y a ni petits moyens, ni petits obstacles ? à moins d’avoir cent pièces de canon à ses ordres, on ne gouverne les hommes que difficilement ; et il faut, pour forcer un écu[83] à se déplacer, mille fois plus d’efforts que pour enfoncer un bataillon carré. Ce Guillaume Évon tient en ses mains ma fortune ou ma ruine. Si je ne triomphe pas de lui, l’affaire est manquée. C’est lui qui jusqu’à présent a empêché les acheteurs de se présenter au château ; et si je n’ai pas sa signature au bas de mes premiers contrats de vente, mon opération tombe à plat, et je suis ruiné.
— Et pourquoi cet homme est-il votre ennemi ? dit Henri.
— C’est qu’apparemment il a intérêt à l’être. Quel est cet intérêt ? Je l’ignore ; mais je le saurai, car je vais chez lui.
Henri ne répondit pas. La tête penchée et l’œil baissé vers le sol, il semblait absorbé dans une vague et profonde rêverie ; son corps semblait suivre machinalement une impulsion donnée dont son esprit n’avait déjà plus la conscience. Peut-être le nom de Guillaume Évon avait-il éveillé en lui un de ces mystérieux échos, qui troublent notre âme et deviennent quelquefois des souvenirs ou des pressentiments.
Ils étaient arrivés à une centaine de pas de la ferme, lorsque Arthur, quittant précipitamment le sentier qu’ils avaient suivi jusque-là, entraîna son jeune compagnon à travers une prairie bordée de tous côtés de peupliers, et qui conduisait en droite ligne à l’entrée principale de la ferme. Lorsqu’ils eurent fait quelques pas à travers de hautes herbes déjà jaunes et frémissantes sous le pied, Arthur s’arrêta, et prenant la main d’Henri :
— Retournez au château ! dit-il, me voici arrivé, et je vous remercie de m’avoir accompagné.
Henri ne répondit pas. Une subite pâleur passa tout à coup sur sa face ; toutes les lignes de sa figure se contractèrent ; ses lèvres blanchirent, et d’un air d’effroi indicible, il s’écria d’une voix éteinte :
— Le taureau ! Arthur, prenez garde à vous !
Un taureau furieux, s’était en effet élancé, et débordait déjà de la tête le rideau de peupliers qui l’avait masqué jusque-là ; soit que l’aspect des deux étrangers eût causé son irritation, soit qu’il obéit à un de ces mouvements de fureur dont les pâtres qui gardent ces animaux ne connaissent pas toujours les causes secrètes, il s’avançait en mugissant et les cornes basses vers les deux amis. Arthur, avec le sang-froid[84] qui lui était ordinaire, calcula d’un seul coup d’œil le danger imminent qui le menaçait ; et sans pâlir, sans reculer d’un pas, il attendit le taureau les deux mains en avant, les deux pieds écartés et roidis, comme s’il se fût apprêté à une lutte désespérée.
— Fuyez ! fuyez ! s’écria encore une fois Henri, qui regardait en tremblant l’exposition rapide du drame sanglant qui se préparait.
Il n’était plus temps. Le taureau était à trois pas d’Arthur, et s’avançait en sillonnant la terre avec la pointe de ses cornes, préludes terribles du combat[85]. D’un bond, il se précipita sur son adversaire exhalant sa rage avec le souffle de ses naseaux, et faisant saillir, en se baissant vers la terre, les muscles vigoureux de son cou. Arthur sentit presque sur sa cuisse le frôlement des cornes terribles ; mais par une de ces illuminations soudaines que l’instinct désespéré de la vie inspire à tous les hommes, il posa le pied sur la tête de l’animal, et fut d’un saut à quatre pas derrière lui. Le taureau se retourna avec un nouvel accroissement de fureur ; et, comme s’il eût compris la ruse qui avait déjoué sa colère, il prit cette fois une marche oblique et présenta sa corne aux flancs d’Arthur.
C’en était fait, lorsqu’au moment où celui-ci faisait un écart de côté pour éviter l’arme menaçante, une femme apparut entre lui et le redoutable animal qui s’arrêta tout d’un coup comme comprimé par une volonté supérieure[86], et s’éloigna lentement en étouffant les derniers frémissements de sa rage impuissante.
Un nuage avait passé sur la vue d’Arthur, qui pour la première fois peut-être venait de perdre le sentiment distinct de sa position ; il n’apercevait plus qu’à travers un voile confus la silhouette tremblante des objets. Lorsqu’il fut revenu de cette espèce d’accablement, rapide d’ailleurs comme l’éclair, et dont en certaines occasions capitales les plus fortes âmes ne sauraient se défendre, il porta ses regards autour de lui pour chercher la forme indécise qui avait ébloui ses yeux comme une fantastique vision, et remercier le fantôme[87] secourable qui venait de l’arracher à la mort : la vision avait disparu. La prairie était redevenue silencieuse ; et derrière le rideau de peupliers qui tremblaient au vent, on ne distinguait pas une ombre, on n’entendait pas un souffle.
— Sauvé ! dit Henri en se précipitant dans les bras d’Arthur Raimbaut comme un enfant qui retrouve son père[88] après une sanglante mêlée.
— As-tu vu la femme ? demanda Arthur avec un reste d’émotion.
— Non, dit Henri, je n’ai rien vu, car je me sentais mourir.
— Enfant ! dit Arthur en souriant. Mais savez-vous bien, monsieur le poëte, que ceci est le premier chapitre d’un roman renversé[89] ! Une femme qui sauve la vie d’un homme, ceci est neuf, n’est-ce pas ?
— Je crois pourtant, dit Henri, que nous ferons mieux de suivre le sentier battu que de nous exposer encore dans cette prairie aux coups d’un taureau furieux.
— Bah ! dit Arthur en continuant bravement sa route, et en faisant à son jeune compagnon un geste d’adieu, la même couleur ne gagne pas deux fois de suite ! et j’ai toujours aimé à jouer sur la couleur perdante[90].
Henri le suivit quelque temps des yeux ; et ce ne fut qu’après l’avoir vu disparaître derrière la première enceinte de la ferme, qu’il se décida à regagner le château.
IV.
Arthur Raimbaut était à peine remis de l’émotion toute physique que lui avait causée l’attaque du taureau, que déjà il se disposait à pénétrer auprès du fermier Guillaume Évon. Ce n’était pas une vaine affectation de bravoure qui l’amenait, par une brusque transition, à un état aussi calme et tranquille. Chez cet homme, les impressions étaient réellement vives et puissantes, mais il savait les dominer. Ainsi, dans la circonstance si imprévue où ses jours avaient été momentanément en danger, il eût semblé qu’il craignait moins de perdre la vie que de voir lui échapper l’occasion de triompher d’une volonté qui s’opposait à la sienne, que de laisser en mourant sa victoire incomplète. Il entrait donc dans ces dispositions à la ferme ; bien décidé d’ailleurs à ne rien perdre de son rôle d’observateur.
Ce n’est pas un des moindres devoirs de l’homme qui se propose une négociation quelconque, que celui d’étudier les mœurs et les habitudes des gens avec lesquels il doit se trouver en rapport. Les formes extérieures révèlent toujours quelque chose à celui qui sait en découvrir les secrets. Le coup d’œil rapide d’Arthur pouvait sans doute lui donner une idée générale ; mais ce n’était pas assez, il lui fallait encore descendre aux détails[91]. Toutefois, le premier aspect de la ferme prouvait cette richesse et cette abondance qui ne sont acquises à la campagne que par le travail et par l’ordre. Deux charrues, dont les socs étaient encore chargés d’une terre grasse et épaisse s’appuyaient contre un des murs d’une vaste cour. Tout auprès, une porte entr’ouverte laissait voir une étable remplie de bœufs vigoureux. Plus loin, un berger faisait sortir un troupeau de moutons, tandis que, pour leur faire passage, un enfant chassait devant lui une armée de dindes, de poules et de canards. Partout c’était un grand mouvement et un grand bruit : ici, des garçons d’écurie préparaient des attelages ; là, une fille de basse-cour, aux formes athlétiques, souriait à leurs agaceries tout en balayant une partie du pavé. Enfin, il n’était pas jusqu’aux ramiers qui ne fissent entendre leur voix au milieu de la sonore harmonie de la ferme[92]. Ce rapide examen terminé, il en restait un autre à faire, non moins intéressant, celui de l’intérieur. La maison était située au fond de la cour ; à chaque extrémité, deux tilleuls la protégeaient de leur ombre, sans pourtant en masquer la vue. Des bancs en bois, placés de chaque côté de la porte d’entrée, s’étendaient jusqu’aux tilleuls. C’était là sans doute que pendant les longues soirées d’été, le fermier et sa famille venaient respirer l’air pur du soir ; c’était là que serviteurs et maîtres se délassaient des fatigues du jour en écoutant les chroniques du village, ou de sombres histoires de revenants[93]. Pour un poëte, il y aurait eu bien des pages à écrire à propos de ces bancs rustiques, où chaque jour revenaient s’asseoir les heureux habitants de cette ferme ; pour Arthur, ces bancs étaient muets et froids : il n’en concluait qu’une chose, c’est que la famille ou la domesticité du fermier devait être nombreuse. Or, sans s’y arrêter davantage, il monta les trois degrés de pierre qui devaient l’introduire dans la maison.
La première pièce servait à la fois de salle commune et de cuisine ; l’œil était frappé en y entrant d’un luxe de propreté peu commun. Au milieu, se trouvait une longue table en chêne, brune et polie ; autour de cette table, des chaises aux pieds façonnés dans le goût de la renaissance attendaient les cultivateurs, car c’était l’heure du repas, s’annonçant assez, d’ailleurs, par la surcharge de bois qui pétillait dans l’âtre. Vis-à-vis la porte d’entrée, une de ces grandes horloges qu’on nomme coucou[94] faisait entendre son bruit régulier et monotone. À droite, des corbeilles toutes prêtes à recevoir la pâte que venait de pétrir une robuste servante ; à gauche, un énorme bahut, verni à se mirer dedans, et orné de ferrures formant des losanges ; enfin, tout autour de cette large pièce, étaient placées des étagères destinées à recevoir divers ustensiles de ménage. Notre observateur ne s’arrêta pas à les considérer, il comprit seulement que chaque chose demeurait exactement à sa place, et qu’une volonté intelligente avait présidé à tout cet arrangement[95].
Arthur, afin de continuer son examen, allait pénétrer dans une pièce contiguë, lorsque l’étonnement qui le saisit tout à coup l’attacha sur le seuil qu’il s’apprêtait à franchir. Au milieu de cette seconde chambre une jeune femme était assise devant une table ; le dos tourné à la porte d’entrée, elle semblait vouloir éviter toute distraction. Sa tête était à la fois penchée sur un livre, et soutenue dans sa main droite ; sa pose était gracieuse, sans prétention ; ses vêtements, qui n’avaient point l’ampleur de ceux des dames de la ville, laissaient deviner des formes élégantes et pures ; il y avait enfin, en cette femme, quelque chose d’étrange et de poétique[96] qu’Arthur voulut s’expliquer en arrivant auprès d’elle, sans l’avertir et sans la troubler ; mais quelque attention qu’il mit à ne point interrompre le recueillement de la lectrice, un léger bruit du plancher le trahit. La jeune femme alors, s’étant retournée vivement, se leva avec grâce et marcha quelques pas en avant, et une rougeur subite colora ses joues quand elle dit à Arthur :
— Mon mari n’y est pas, monsieur, mais il va bientôt rentrer.
Cette jeune femme, Arthur l’avait déjà vue. Où ? Comment ? Était-ce la vision qui suit le rêve lui-même ? Non, cependant, car elle lui adressait la parole comme une personne qu’on connaît, car elle avait rougi comme à un souvenir, car elle tremblait encore en détournant les yeux. Arthur, quelque temps indécis, avait résolu de lui répondre, mais l’entrée bruyante des gens de la ferme vint arrêter la parole sur ses lèvres. Garçons et filles, batteurs en grange et bergers, palefreniers et laboureurs, prirent place à la table commune avec force plaisanteries triviales et force cris sur tous les tons. La jeune femme, heureuse sans doute de cet incident qui lui permettait d’échapper à une conversation qu’elle semblait redouter, profita du tumulte pour se retirer dans sa petite chambre dont elle ferma soigneusement la porte sur elle. Arthur, de son côté, ne chercha point à la retenir, et il se contenta de prévenir une servante qu’il reviendrait dans la journée pour causer avec M. Guillaume Évon.
Il était trois heures de l’après-midi lorsque Arthur Raimbaut retourna à la ferme. M. Guillaume Évon l’attendait avec deux verres et un broc de vin.
— Eh bien ! monsieur Évon, l’année a-t-elle été bonne ?
— Médiocrement, monsieur ; j’en ai vu de meilleures, j’en ai vu de plus mauvaises. Le blé est toujours à trop bas prix ; on ne retire guère que ses avances[97].
— Eh ! pourquoi, aussi, tant de blé ? ce mécompte est la faute des producteurs, des vieilles routines.
— Je crois, moi, que c’est la faute de nos douanes ; on nous apporte trop de blés étrangers.
— Vous êtes dans l’erreur ; le gouvernement publie le tableau des importations ; or, il n’entre presque rien. Non, vous dis-je, c’est la faute des producteurs ; ils en font trop : la surabondance les tue.
— Mais, monsieur, si la France manquait souvent de blé quand elle n’avait que vingt-cinq millions d’habitants, comment se fait-il qu’elle en produise trop aujourd’hui, que nous sommes trente-deux millions ?
— C’est qu’elle n’a plus de jachères, de biens de mainmorte[98], qu’elle dessèche ses marais et qu’elle défriche ses bois superflus. Oui, monsieur Évon, si le bas prix du blé n’est pas la faute des producteurs, c’est du moins celle des vieilles routines. Pourquoi n’essayez-vous pas en Brie les nouveaux procédés d’agriculture[99] ?
— Parce qu’ils sont incertains ou nuisibles.
— Bah ! l’avez-vous éprouvé ?
— Quelques riches bourgeois les ont essayés, et ont perdu la moitié de leurs revenus d’une année.
— Ils ont essayé la charrue et le semoir de la ferme modèle ?
— Oui, et leurs terres s’en sont mal trouvées. Vous ignorez donc, messieurs de la ville, que la charrue d’un canton ne convient pas à un autre, qu’il faut autant de charrues différentes qu’il y a de différences de terrain ; que, par exemple, la charrue de Beauce ne vaut rien pour notre Brie ; que le meilleur semoir est la main de l’homme, parce qu’elle est conduite par son intelligence ?
— Erreur que tout cela, vieux préjugés. Nos sociétés d’agriculture ont prouvé tout le contraire ; au fait, restez si vous voulez dans vos habitudes pour l’exécution, mais du moins changez la production. Au lieu de blé, que ne semez-vous des betteraves à sucre, des colzas à huile ? On en fait un commerce immense.
— Monsieur, tous les terrains n’y sont pas propres.
— Vous le croyez ; si la Brie est trop maigre, n’avez-vous pas l’engrais Renaud qui se fait en douze jours, et se vend cinq francs le kilogramme ? Il y a de quoi rendre vos saisonnières plus fertiles que la Belgique.
— Qui me répondrait de la rentrée de mes avances ?
— Moi. Voyez la Normandie, qui se couvre de colza ; depuis que ce chou sauvage nous fournit tant d’herbe, les fermiers de l’Eure et du Calvados, de la Manche et de la Seine-Inférieure y achètent les châteaux des maîtres. Voyez la Flandre qui semble suer le sucre, tant elle fournit de betteraves à nos raffineries. Les cultivateurs y ont changé leur étain en argent, et leur bure en drap de Louviers[100] : voilà les exemples qu’il faut suivre.
— Monsieur, chaque pays, chaque guise, dit le proverbe de nos pères ; je veux faire comme eux : c’est le plus sûr ! Vos Flamands et vos Normands peuvent avoir raison pour un temps, et grand tort pour l’avenir. Qui sait s’ils n’appauvrissent pas leurs terres, en leur faisant produire tant d’huile et de sucre ! Et puis en aura-t-on toujours le même besoin ? Tandis que le pain, oui, monsieur, le pain sera de tous les temps, et on aimera mieux le voir venir à côté de soi que de le tirer de l’Égypte ou de la Russie. La guerre peut affamer vos faiseurs de sucre et d’huile ; mangeront-ils leurs betteraves et leurs choux sauvages dans ces années-là ? Et le peuple, que deviendra-t-il avec les raffineries, quand les moulins ne tourneront plus pour lui ? Tenez, monsieur, ne me parlez pas de toutes ces inventions ; je les regarde comme une menace de l’avenir, ainsi que vos machines à vapeur qui ôtent aux bras de l’ouvrier le moyen de remplir sa bouche ; ainsi que vos chemins de fer, qui vont diminuer nos chevaux, diminuer nos engrais, et rendre nos herbages aussi stériles que les rochers de Fontainebleau ; ce sont des illusions, monsieur, que tous ces perfectionnements, ce seront bientôt des causes de ruine. Et si votre compagnie achetait pour faire valoir et non pour revendre…
— Quelle compagnie ? que voulez-vous dire ?
— Je veux dire la compagnie qui achète les châteaux, celle dont vous êtes membre, sans doute…
— Vous vous trompez, je ne suis d’aucune compagnie ; j’achète pour moi seul.
— Ah ! je croyais…
— Oui, que j’étais de ce que vous appelez la Bande noire ; détrompez-vous, je suis tout simplement un capitaliste qui fait valoir ses fonds ; mais sachez que je suis en même temps un de ces vrais citoyens[101], amis de la patrie et de la classe nourricière de l’État, de cette classe de cultivateurs qui supportent la chaleur du jour et la masse énorme des impôts. Je songe, dans mes spéculations, à lui alléger le fardeau, à lui faire une plus forte part des moissons qu’elle sème et des fruits qu’elle recueille. Je suis un de ces partisans pratiques de la véritable égalité, et pour la réaliser, je cherche à diviser ces fortunes colossales qui nourrissent l’oisiveté et l’insolence du petit nombre, à les partager entre ce bon peuple des campagnes qui produit ces fortunes et qui n’en jouit pas. Voilà, mon cher M. Évon, tout mon secret, tout mon système ; je n’en fais point mystère. Revenez donc de vos préventions injustes contre des hommes estimables ; ne vous laissez plus effrayer par ces noms de Bande noire et de démolisseurs, qui courent dans vos campagnes contre les amis mêmes de leurs plus nombreux habitants. Vous, qui êtes un de ses magistrats, et qui devez être le père de votre commune, n’êtes-vous pas le plus intéressé à ces opérations qui enrichissent graduellement vos administrés, les attachent au sol, et leur rendent les dépenses publiques et communales plus faciles à supporter ?
— Non, je ne pense pas ainsi, répondit le fermier.
Raimbaut se pinça les lèvres, se leva brusquement de sa chaise, et reboutonnant son habit sur sa chaîne d’or, il salua le fermier et sortit[102].
V.
Pour un homme habitué à emporter de haute lutte les obstacles, et à calculer sur les passions humaines comme un joueur d’échecs sur le casier longtemps étudié, la longue résistance de Guillaume Évon devait être chose difficile à concevoir et propre à irriter profondément cet orgueil de la supériorité, cet amour-propre de la science, le plus irritable, le plus exclusif de tous les amours-propres. Arthur Raimbaut traversait silencieusement le village ; la nuit commençait à tomber, et on n’entendait plus au loin que les hurlements prolongés des chiens de ferme, se répondant d’échos en échos. Le village était désert et morne ; çà et là seulement, à travers les contrevents mal fermés des maisons, vous eussiez vu se glisser des filets de lumière, seul signe de vie au milieu de toutes ces images de repos et de mort. Toutes les portes étaient fermées, et l’ombre qui s’épaississait aux angles des rues, aux encoignures des allées, donnait à ce tableau[103] cette teinte profondément triste et glacée, qui semble étendre un voile sombre sur le monde intérieur de nos pensées, et affliger notre âme de la même tristesse qui afflige la nature.
Il n’est pas possible de traverser le soir, à la fin de l’automne, un petit village perdu dans un creux, et loin de la grande route, sans se sentir au cœur une insurmontable mélancolie. Il nous semble alors que tous les bruits du monde viennent expirer à nos oreilles, comme le souffle du vent s’engouffrant dans une tombe. Il nous semble que l’espace n’existe plus, que la lumière est morte, que le temps se prolonge uniforme et sans aucun de ces accidents de la passion qui en marquent et en divisent l’étendue. Tout est muet, tout est désert, il fait nuit dans le cœur[104].
Et lorsque, seul, on marche à travers cette solitude, lorsqu’on entend le bruit de ses pas répété derrière soi par d’invisibles voix, s’affaiblissant par degrés et s’éteignant dans l’ombre, alors on croirait presque avoir perdu le sentiment de son existence, et on s’écrie comme le poëte anglais : « Je ne suis plus que l’ombre de moi-même »[105]. Et quand on est jeune surtout, quand longtemps on a vécu au milieu du tumulte et des agitations de la vie, quand le cœur, encore plein d’émotions diverses, ne fuit que le repos, ne craint au monde que le vide, la première soirée d’hiver, passée ainsi dans un village inconnu, laisse à la mémoire une éternelle empreinte de deuil et de tristesse. Le silence et la solitude vieillissent plus que les années, et ceux-là sont toujours jeunes, qui n’ont jamais écouté la nuit les battements de leur cœur.
Peut-être Arthur Raimbaut comprenait-il, sans les sentir, les émotions que nous indiquons. C’était un de ces hommes qui semblent frappés de stérilité, et ne vivent plus que par l’intelligence et le souvenir. Pour lui, la nuit n’avait plus de voix ; le silence, plus de mélancolie ; il n’existait que pour lui et par lui. Les objets extérieurs n’avaient plus avec son âme de rapports sympathiques ; le secret et la raison de son existence étaient en lui-même, en lui seul. Quelquefois pourtant, il s’arrêtait subitement, comme si le ressort de sa vie se fût tout d’un coup détendu, et il se prenait à lever les yeux vers le ciel brumeux et sombre qui se déroulait au-dessus de sa tête. Une petite pluie fine filtrait lentement à travers les couches de l’atmosphère, et mouillait le pavé des rues ; son chapeau à la main, Arthur présentait son front aux atteintes du brouillard glacé, et semblait se complaire à sentir l’humidité tomber comme une couronne funèbre sur sa tête chauve. Quelquefois aussi, il pressait le pas d’un air de résolution violente ; on eût dit qu’il se reprochait déjà son court moment de torpeur, et qu’il voulait, par un redoublement d’activité, paralyser l’influence d’un instinct amollissant[106].
Au coin de la rue principale, dans une espèce de carrefour formé par les angles saillants de deux chaumières, Arthur Raimbaut s’arrêta encore ; des voix criardes, mêlées de bruits confus et de joyeuses exclamations avaient frappé son oreille ; il s’avança dans l’obscurité du carrefour, cherchant à démêler à travers les ombres épaisses quelque interstice de jour, quelque jet de lumière révélateur ; mais le bruit continuait toujours et l’obscurité demeurait la même. Arthur Raimbaut, du reste, était depuis trop longtemps initié aux habitudes des campagnes pour ne pas reconnaître la cause de ce mouvement ; et il pensa que c’était la veillée villageoise. Soit par curiosité, soit par une de ces secrètes prévisions dont certains hommes gardent toujours la science en eux-mêmes, il se dirigea à petit bruit dans la direction probable d’où provenaient ces symptômes d’hilarité nocturne, et il s’arrêta enfin auprès d’une petite porte basse et cintrée, percée dans un mur épais et assise sur une mauvaise dalle usée par le frottement, et déjà noire de vétusté. Les sons lui vinrent alors plus distincts ; peu à peu, des voix de jeunes filles, claires et perçantes, se détachèrent sur le fond harmonique du grossier concert, comme les accents de la musette sur un chœur de voix sourdes et avinées. De temps en temps aussi, il se faisait silence, et l’on entendait la voix nasillarde de quelque vieille femme racontant les anecdotes du temps passé du ton doctoral d’un orateur presbytérien ; puis, le bruit recommençait, les éclats de rire suivaient le soliloque de la conteuse, et le tutti campagnard couvrait les dernières réflexions de sa morale ; enfin, au milieu de tout cela, les rouets des travailleuses ronflaient, semblables à un accompagnement de contrebasse, et prolongeaient, malgré les variations infinies de l’orchestre, leur harmonie uniforme[107].
D’un revers de sa main, Arthur Raimbaut poussa la porte de l’étable, et en descendit lentement les degrés.
La veillée est le point de centre où convergent tous les intérêts et toutes les passions d’un village. C’est là que les mariages se projettent et quelquefois s’ébauchent ; c’est là que se fabriquent les nouvelles quotidiennes qui, chaque matin, alimentent les lavoirs des blanchisseuses et les ateliers des tisserands. Entre les quatre murs d’une étable enfumée se nouent et se déroulent tous ces drames mystérieux qui composent l’existence des jeunes filles ; et si jamais vous apprenez une histoire d’amour ou de scandale, soyez sûr que c’est dans quelque veillée d’hiver longue et froide qu’elle aura commencé. À la veillée, tous les âges et toutes les positions ont leurs représentants ; la jeunesse, la beauté, la vieillesse, l’opulence même s’y rencontrent ; autour de la maigre chandelle, que chaque veilleuse fournit à tour de rôle, se presse tout ce qui a vie en la commune : les vieilles femmes y filent, les jeunes filles y causent entre elles, et vers les neuf heures du soir, on est sûr d’y voir arriver des bandes de garçons, tous parlant haut, tous prêts à rire, à déranger les travailleuses ; et c’est alors le beau moment de la soirée, c’est alors que les jeunes filles, jusque-là distraites, relèvent la tête et cessent de prêter l’oreille aux discours des vieilles femmes. Alors, elles ont à la veillée un intérêt actif ; à elles maintenant le premier rôle.
Oh ! si quelque grande dame parisienne, perdue dans quelque village enfoui dans les terres, pouvait se décider à poser son soulier de satin sur les marches boueuses du salon campagnard, quel étonnement la prendrait de voir cette parodie grossière de la comédie qui se joue dans nos salons élégants ! Comme elle tremblerait en contemplant tous ces amours qui se croisent, qui crient, qui tous marchent la tête haute et l’œil en feu ! Et les tailles des demoiselles entourées par des bras vigoureux ; et les étreintes de ces mains calleuses pressant des mains dociles, et ces baisers retentissant dans l’ombre, et les rires aigus des vieilles femmes qui semblent les juges du camp, et les patronnes des amoureux ; quel tableau ! Mettez une pièce de vin au milieu de la veillée, et vous aurez l’orgie de Rubens[108].
Ce serait vraiment un spectacle étrange que celui-là, pour une de ces frêles et maladives beautés qui ont appris les premiers préceptes de l’amour dans les loges grillées de l’Opéra, et sous les charmilles d’un parc anglais. Où sont, ô mon Dieu, les œillades discrètes, les frôlements d’une main timide qui recule en interrogeant la main qui lui répond ? Que sont devenus les billets parfumés qu’on cache si bien sous la mantille ? et les fleurs, et les bagues en cheveux, et les rendez-vous qu’on donne le matin dans l’allée de Madrid, et les grands voiles qui cachent si bien toutes les fautes et toutes les rougeurs ? Au lieu de tout cela, les instincts naïfs de la nature, un amour de grande route qui dédaigne les faux-fuyants et les petits sentiers, des caresses qui déchirent, des baisers qui écorchent. Retournez, madame, dans votre boudoir ; confiez à la discrétion de votre gynécée vos amours fragiles et vos mystères de cœur, semblables à ces fleurs qui ne croissent qu’en serre chaude et qu’un souffle de la brise flétrit et tue ! Fuyez ces lieux, l’air y est trop chaud et vous étoufferait[109] !
Le samedi est spécialement consacré au plaisir dans les veillées, c’est un à-compte sur le dimanche ; le samedi, les rouets cessent de tourner dès huit heures, et les jeux commencent ; les veillées ont aussi leurs jeux innocents. C’est là que se déploie toute la gaieté villageoise ; quelquefois même on ne se quitte pas sans faire collation : une galette de pâte ferme et des châtaignes cuites à l’eau composent le joyeux festin ; les jours où cela arrive sont de grands jours ; la veillée se prolonge jusqu’à minuit, et les rires ne cessent pas un instant, pas un instant vous ne verriez l’ennui, ce pâle fantôme des réunions aristocratiques, se glisser dans ces réunions champêtres.
Lorsque Arthur Raimbaut parut au milieu du cercle, il se fit un silence général. Les fileuses suspendirent leur travail, et les jeunes filles, par un de ces mouvements de pudeur instinctive mêlée de curiosité, baissèrent les yeux pour mieux le regarder. La veillée était assez nombreuse ce soir-là ; assises sur des escabeaux de bois, trois ou quatre vieilles femmes semblaient présider l’assemblée, et une seule chandelle, appliquée sur les parois noircies de l’étable, projetait sa douteuse clarté sur leurs figures hâlées, sur leurs traits ridés et en saillie, sur les lambeaux mal appareillés de leur toilette empreinte d’un remarquable caractère de pauvreté. Sur la paille étaient étendus par couples deux ou trois jeunes garçons et autant de jeunes filles, qui, les mains entrelacées, et visage contre visage, devisaient entre eux et se lutinaient dans l’obscurité[110]. Au fond de la salle apparaissaient deux vaches brunes qui semblaient faire partie intégrante de ce tableau, et faisaient ombre au maigre filet de lumière qui se jouait autour de leurs têtes et glissait sur leur croupe. Il était dix heures du soir, et au milieu du silence produit dans l’intérieur par l’arrivée d’Arthur Raimbaut[111], on entendait distinctement le bruit de la pluie qui battait la porte d’entrée, et le souffle du vent qui en ébranlait les ais[112] mal attachés. Peut-être un peintre flamand, un de ces vieux maîtres consciencieux qui se sont complu dans les détails de la vie rustique, eut-il trouvé là un motif de tableau, et son pinceau se fût inspiré à la contemplation de tous ces accessoires mélangés d’ombre et de lumière, et de ces personnages si pittoresquement groupés[113]. À l’aspect d’Arthur Raimbaut, dont la silhouette imposante se découpait sur un fond obscur, comme une incrustation de diamant sur une marqueterie d’ébène, une sorte de stupeur s’était peinte sur tous les visages, et sa chaîne d’or, qui chatoyait sous le rayon tremblant de la lumière, apparaissait comme quelque broderie brillante sur une étoffe usée et terne ; l’or a des effets prestigieux qu’on ne saurait expliquer, et en certains moments, on croirait presque à cette mystérieuse fascination que la sombre poésie d’Hoffmann[114] a rendue populaire[115].
La figure d’Arthur Raimbaut était immobile et calme ; d’un seul coup d’œil il avait embrassé tous les détails du tableau que nous avons essayé d’esquisser. Pourtant une sorte d’étonnement se manifesta dans ses traits, lorsque, dans un des angles obscurs de l’étable, il aperçut un jeune homme et une jeune femme assis côte à côte, et qui fixaient sur lui des yeux étonnés.
— Est-ce donc vous, Henri ? dit-il en s’avançant vers le jeune homme qui se leva en tressaillant. Vous, ici ? j’avoue que si je m’attendais à une rencontre, ce n’était assurément pas à celle-là ! »
La jeune femme assise à côté d’Henri s’était levée à son tour. Il y avait dans sa toilette une coquetterie plus facile à sentir qu’à exprimer ; encadrés par un double bandeau de cheveux noirs et lissés, les tons chauds de son front se détachaient avec vigueur sous les papillons blancs de son bonnet rond qui retombaient derrière le cou, et se jouaient sur le fond rouge d’un mouchoir à palmes attaché en cœur sur la poitrine. Ses yeux noirs s’abaissaient sous la double ligne d’un sourcil luisant, dont la courbe gracieuse atteignait la naissance des tempes et faisait ressortir la correction d’un ovale finement modelé. Sa bouche était petite, doucement pincée vers les angles, avec cette expression de fierté tempérée, d’orgueil à demi brisé, qui donne à la beauté villageoise le caractère d’une royauté malheureuse et déchue. Sous un corsage de drap noir et à trois rangs de boutons sur le devant comme une amazone, la taille de la jeune femme rebondissait vers les hanches ; et son pied, étroitement contenu dans un petit sabot noir effilé par le bout, débordait capricieusement l’extrémité d’une jupe courte qui s’arrêtait à la cheville. Dans ce type[116], il y avait à la fois de l’élégance et de la vigueur ; sans être frêle et délicat, le cou était flexible et heureusement coupé par une nervure déliée dont les différents linéaments s’agençaient avec grâce ; et les formes arrondies de la gorge attestaient cette chaleur de sang, cette plénitude d’existence que les artistes de l’école vénitienne ont excellé à reproduire[117].
À la vue d’Arthur Raimbaut, une rougeur presque imperceptible avait couru sur son visage ; immobile, elle le contemplait avec cette sorte d’étonnement d’une femme naïve et qui cherche le sens d’un spectacle incompris, le dernier mot d’un mystérieux roman. Celui-ci fixa un instant les yeux sur elle, et s’inclinant respectueusement :
— Madame, dit-il, j’ai des remerciements à vous faire.
La fermière entendant ces mots balança le cou par un mouvement significatif ; et posant, par une nonchalance affectée, comme elle l’avait fait déjà dans la scène de la prairie, l’index sur ses lèvres fermées :
— Silence, lui répéta-t-elle dans son langage muet.
Arthur Raimbaut s’étonna de la discrétion qu’on lui imposait avec tant d’opiniâtreté. Une seconde fois il leva les yeux sur madame Évon, et les reporta aussitôt sur Henri :
— Eh bien ! jeune homme, dit-il à la fin, me direz-vous ce que vous faisiez ici ?
— Ce que vous y faites vous-même, murmura Henri, qui pour la première fois rompait son silence obstiné. Comme vous, j’ai entendu en passant du bruit à cette porte, et j’ai voulu contempler le spectacle que vous contemplez maintenant.
En disant ces mots, il avait jeté sur la fermière un regard oblique et timide ; c’était, pour ainsi dire, le regard d’une femme en présence et sous la domination d’un mari[118] ; regard curieux, rêveur et craintif à la fois, où se reflète une espérance à demi cachée sous un voile de doute et d’incertitude, ainsi qu’un pâle rayon de soleil sous une enveloppe de brouillard. La veillée avait changé de face ; un intérêt silencieux et concentré se peignait sur toutes les figures ; tous les spectateurs considéraient avec une expression différente, mais tous avec une avidité intense, les trois personnages qui se trouvaient subitement mis en contact, comme si de ce rapport forcé, de cette situation imprévue, ils eussent espéré voir sortir un de ces drames saisissants que la foule, toujours avide d’émotions, attend avec bonheur[119]. Arthur Raimbaut comprit peut-être cette prédisposition inquiète, car d’un mot il en arrêta l’essor en ramenant tous les esprits au sentiment d’une position plus naturelle. Il prit un escabeau, et s’asseyant au centre de l’étable, en face d’une vieille femme qui dans sa surprise faisait machinalement tourner son rouet et avait renversé sa quenouille :
— Eh bien ! la mère, dit-il, est-ce ma présence qui interrompt vos travaux et vos jeux ?
La vieille femme releva la tête ; c’était un de ces types qu’on ne rencontre guère que dans les villages ; son front était jaune et plissé ; des mèches de cheveux grisonnants tombaient sur ses tempes et se retroussaient sur des oreilles droites et tendues par les habitudes constantes d’une active curiosité. Sa figure s’allongeait par le bas et s’effilait, comme on dit, en lame de couteau ; et si vous ajoutiez à cela cette espèce de clignotement dans les yeux qui donne aux vieilles femmes de nos campagnes un air malicieux et railleur, peut-être comprendrez-vous pourquoi Arthur Raimbaut lui avait adressé la parole de préférence à tout autre.
Ainsi interpellée, la mère Simone essaya de prendre ce ton dégagé qui, dans toutes les assemblées, atteste la supériorité de certains personnages.
— Êtes-vous venu, monsieur, pour veiller avec nous ?
— Oui, la mère, dit Arthur Raimbaut sans hésiter. Je veux être de tous vos plaisirs.
— À la bonne heure ! dit la mère Simone, voilà parler ! Vous n’êtes pas un de ces godelureaux parisiens qui viennent ici pour se moquer de nous et faire des gorges chaudes à nos dépens[120] ! Allons, mes enfants, plus de travail pour aujourd’hui, et en place pour les jeux.
Ces paroles effacèrent complètement l’impression de froideur, produite dans tous les esprits par l’arrivée inattendue d’Arthur Raimbaut. Les jeux commencèrent et la gaieté éclata bientôt en folles exclamations et en gaudrioles salées. Les jeux d’une veillée sont nombreux et variés. Plus l’imagination est simple, plus elle est féconde ; et qui ne sait d’ailleurs comment, dans un petit cercle d’hommes, les souvenirs se perpétuent d’âge en âge et de bouche en bouche ?
Au signal donné, tout le monde s’assit en rond sur la paille autour de la mère Simone ; et de main en main, on commença à se passer un sabot en répétant, avec le plus grand flegme du monde, ces mots : Portez la mouche au porche sans rire ni parler[121]. Et quand par hasard un des joueurs se laissait aller à son hilarité, quand un mot entrouvrait ses lèvres, quand un soupçon de sourire pinçait sa bouche, alors la mère Simone, un sabot à la main, caressait rudement les genoux du délinquant, et tout le monde de rire aux éclats.
Arthur Raimbaut était assis auprès de la fermière ; et chaque fois que le sabot décrivait son cercle, il sentait l’extrémité d’une main potelée et ferme effleurer sa main ; chaque fois qu’à son tour il répétait à sa voisine le mot sacramentel : Portez la mouche au porche sans rire ni parler, il se plaisait à contempler ce doux et éclatant visage qui se découpait en relief au milieu de tous ces visages vulgaires et grossièrement dessinés. Il y a, dans les joies naïves, dans les distractions les plus puériles, un charme trivial mais réel, auquel peut-être Arthur Raimbaut n’était pas insensible.
Pour Henri, placé vis-à-vis d’Arthur Raimbaut, il semblait plongé dans une rêverie profonde, et regardait sans voir ce qui se passait devant lui. Quelquefois seulement, il fixait les yeux sur la jeune fermière avec une expression d’incertitude à la fois et d’extase, comme s’il eût essayé, à l’aide d’une superposition mentale, de recomposer une image à demi effacée, à l’aide de quelques traits distincts et caractéristiques, et de rattacher les deux bouts d’une chaîne brisée[122]. C’était lui qui faisait en grande partie les frais de la gaieté publique ; son air était si empêché, ses gaucheries si nombreuses, que la mère Simone n’était occupée qu’à lui donner des avertissements et des corrections.
— Savez-vous, dit la vieille femme à Arthur Raimbaut, que pour un monsieur, vous entendez le jeu aussi bien que pas un de nous !
— On n’oublie jamais, dit Arthur, ce qu’on a appris dans l’enfance. Je suis un enfant de la Normandie, voyez-vous ; et la Normandie, c’est le pays des pommes et des jeux innocents.
Arthur avait dit ces mots avec ce laisser-aller et cette aisance familière qu’il affectait quelquefois.
— Vous êtes Normand, monsieur ? demanda madame Évon d’une voix basse et presque émue.
C’étaient les premiers mots que la fermière prononçait. Les yeux d’Arthur Raimbaut et de Henri se portèrent en même temps sur elle, comme pour chercher, dans la disposition de ses traits, la signification précise de la question qu’elle venait de faire. Mais la mère Simone, qui voyait avec regret le rôle principal qu’elle s’était fait prêt à lui échapper, ne laissa pas à Arthur le temps d’engager plus avant la conversation.
— Jouons à un autre jeu ! dit-elle en donnant à sa voix l’expression de triomphe d’un orateur qui lance à la foule une proposition capitale.
Un cri unanime suivit ces mots, et du conflit des exclamations mêlées jaillirent à la fin ces paroles qui résumaient les vœux de l’assemblée : Jouons à taratata, qu’est-ce qui baisera ça ?
Alors une jeune fille joufflue et colorée, dont les grands yeux bleus reflétaient une joie expansive, s’assit sur un escabeau et désignant le plus jeune gars du cercle, lui mit la tête sur ses genoux et le couvrit de son tablier.
— Taratata, qu’est-ce qui baisera ça ? dit la mère Simone en caressant avec sa main le cou nerveux d’une des vaches qui grignotait paisiblement à son râtelier quelque brin de luzerne.
— Monsieur Henri, dit le jeune garçon sans hésiter.
Un éclat de rire crispa toutes les figures, et fit tressaillir les voûtes mansardées de la vieille masure. Les deux vaches levèrent simultanément la tête, et jetèrent sur l’assemblée bruyante un regard hébété et fixe, comme si ce bruit insolite les eût réveillées de leur apathie.
— Allons, monsieur Henri, dit la mère Simone en riant, voilà votre amoureuse qui vous appelle[123] !
Le jeune homme ne répondit pas. Ainsi qu’une jeune fille innocente et douce qui se trouverait tout d’un coup transportée, au sortir de son virginal et frais appartement, dans un de ces routs[124] bruyants où les pieds heurtent les pieds, où les mains pressent les mains, où les haleines se confondent, où les regards audacieux effrayent de toutes parts les regards timides, il était troublé, rougissant, et sa physionomie inquiète interrogeait la physionomie d’Arthur Raimbaut, comme pour en obtenir conseil ou assistance.
— Je demande grâce pour lui ! dit celui-ci. C’est un apprenti, et il serait injuste de lui faire payer trop cher son apprentissage.
Le jeu recommença, et ce fut Henri qui, cette fois, la tête couverte du tablier, attendit la question qu’on allait lui faire.
— Taratata, qu’est-ce qui baisera ça ? dit encore la mère Simone en effleurant du plat de ses doigts la joue veloutée de madame Évon.
— Monsieur Raimbaut, dit Henri, et il se retourna.
La jeune fermière avait rougi ; par un tressaillement involontaire, les veines de son cou s’étaient légèrement gonflées, comme si le sang eût afflué au cœur et remonté au visage. Ses yeux se promenaient avec une sorte d’égarement dans l’espace, semblables à ceux d’une biche effarouchée qui entend au loin le joyeux hallali des chasseurs. Henri comprit en la regardant la cause de son trouble, et par une commotion sympathique, la rougeur de la jeune femme passa sur le front du jeune homme. En le voyant immobile et presque tremblant, on eût pu croire à ces effets du magnétisme qui relie deux âmes sœurs par un nœud invisible, et transmet subitement à l’une les affections de l’autre[125].
Arthur s’approcha de la fermière, lui prit la main, et lui posant ses deux lèvres au front :
— Un baiser en échange de la vie, c’est bien peu, lui dit-il à voix basse.
Il y avait dans cette double scène un charme doux et mélancolique qui contrastait avec les couleurs tranchées et l’encadrement général du tableau ; que si parfois, au milieu d’une orgie, vous avez entendu les sons fugitifs d’une mélodie invisible, vous comprendrez le contraste que nous renonçons à analyser ! que si, sur un refrain de bacchanale, vous tous êtes complu à suivre le dessin gracieux d’une fraîche villanelle[126], vous sentirez tout ce qu’il y avait d’émotion intime, de charmante et naïve poésie dans ce drame naissant qui se développait au milieu des cris et des rires forcés d’un plaisir inintelligent et grossier. La grâce résulte quelquefois de certaines discordances, aussi bien que de l’harmonie des accessoires et des prestiges bien assortis d’un ensemble habilement ménagé[127].
Quand le moment fut venu de tirer les gages, l’intérêt devint plus vif encore qu’il n’avait été jusque-là. Henri, comme le plus maladroit, avait apporté la plus large part à la masse, et ce fut lui qui eut à subir les plus nombreuses pénitences. Alors ce furent des baisers sans nombre, tantôt retentissants et clairs, tantôt mystérieux et doux. Henri lui seul n’embrassa pas madame Évon.
La fermière avait été constituée trésorière, et c’était à elle de rendre à chacun les gages déposés.
— À qui cela ? demanda-t-elle en tirant de la poche de son tablier une chaîne d’or fin dont les mailles tailladées scintillaient sous les rayons de la lumière.
Tous les assistants répondirent à la fois du geste et du regard, et comme attirés par l’éclat de l’or, se pressèrent autour de la fermière pour contempler le magnifique et prestigieux spectacle.
Arthur prit la chaîne des mains de la fermière, et la lui posant autour du cou :
— Elle vous irait mieux qu’à moi ! dit-il, gardez-la en mémoire du service que vous m’avez rendu ; gardez-la comme un gage de reconnaissance[128] !
Les joues de madame Évon étaient devenues pourprées, et sa gorge en se gonflant faisait capricieusement chatoyer les rayons lumineux de la spirale d’or.
En ce moment une voix rude et enrouée se fit entendre :
— Marguerite, dit un homme debout sur les marches qui descendaient au niveau du sol, faut-il que je vous vienne chercher à minuit comme un maître d’école son élève ?
Arthur Raimbaut se retourna, et aperçut la figure sévère du fermier Guillaume Évon.
Celui-ci descendit une marche de plus, et fixant un regard inquiet et investigateur sur la belle et rougissante figure de la fermière :
— Marguerite, ajouta-t-il, finissez-en ! aussi bien c’est une mauvaise comédie que vous jouez là, et avec votre chaîne au cou, vous avez l’air d’une de ces danseuses que nous avons vues, l’an dernier, à la foire de Corbeil !
Madame Évon, de rouge qu’elle était, devint pâle ; une secrète indignation, déguisée sous l’apparence d’une docilité muette, crispa un instant les angles de sa bouche et veina la surface unie de son front.
— Monsieur, dit-elle d’une voix émue en remettant la chaîne à Arthur, je vous rends votre gage !
Et comme si elle eût craint qu’on ne se méprit sur le sens de ses paroles, elle ajouta :
— Vous le voyez, je n’ai pas le temps de vous infliger une pénitence.
Quand elle fut sortie, Henri s’approcha de la mère Simone :
— Madame, lui dit-il à voix basse, savez-vous comment celle qu’on nomme maintenant madame Évon, se nommait avant son mariage ?
— Marguerite Tiphaine, dit la vieille femme en donnant sa voix une expression narquoise ; et, voulez-vous que je vous dise, mon petit, vous en êtes amoureux !
Henri passa la main sur son front, comme pour en écarter la trace d’une idée trop visible, et un instant après il quitta la veillée avec Arthur Raimbaut[129].
VI.
Madame Évon avait vingt ans ; fille d’un riche herbager[130] de la Normandie, elle était, depuis deux ans, la femme du fermier Guillaume. Son éducation, développée sans méthode, avait nourri en elle ces germes funestes qui contribuent le plus souvent à précipiter les femmes dans l’abîme des fautes et des douleurs ; elle se complaisait à ces lectures, échauffantes parce qu’elles sont vides, qui surexcitent l’imagination sans la fortifier et mettent en relief ses dangereuses saillies. Dans sa vie ordinaire, elle conservait toujours cet air de puissance humiliée et de résignation souffrante où l’orgueil, peut-être, tient plus de place que la sensibilité ; et il était aisé de deviner, à son langage, qu’elle croyait sa carrière manquée, son existence gâtée et perdue. Au milieu de ces occupation journalières, de ces travaux d’intérieur qui absorbent les femmes de la campagne, et, à force d’agitation physique, annihilent l’agitation de la pensée, elle semblait, par ses façons réservées et hautaines, protester à chaque instant contre un sort injuste, et accuser le hasard qui l’avait jetée hors de ses légitimes voies. Elle se rappelait sans cesse, avec un charme attendrissant et mélancolique, le petit pensionnat de Lisieux où s’étaient passées les premières années de sa jeunesse, ses amies dont elle s’était vue séparée, ses promenades le soir aux environs de la ville, ses lectures mystérieuses qui avaient laissé en elle des traces si profondes, surtout ses rêveries dans le silence du dortoir, lorsque la veilleuse venait à s’éteindre, et qu’à travers les rideaux des hautes croisées la lune glissait ses pâles rayons[131].
Comme depuis ce temps elle n’avait vu du monde qu’un horizon étroit et borné, elle avait conservé, dans leur fraîcheur et leur vivacité primitives, ses impressions premières et ses illusions du jeune âge. Sous le toit de la fermière, elle était restée, comme auparavant, une petite pensionnaire un peu guindée, très rêveuse, et son esprit aventureux suivait toujours les mêmes sentiers qu’il avait suivis autrefois. La monotonie de son existence uniforme fatiguait son âme et la révoltait ; cette jeune imagination, ainsi refoulée dans le cercle d’une réalité triviale, avait besoin de pâture, et le repos l’accablait. Souvent elle allait dans la prairie, sous les peupliers, un livre à la main ; et là, assise entre les hautes herbes, elle éprouvait un étrange plaisir à parcourir les espaces d’un monde imaginaire, à évoquer les images du passé, à interroger les secrets désirés de l’avenir. Comme toutes les jeunes filles, elle se plaisait à se croire opprimée et malheureuse, elle aimait à se répéter qu’elle était une pauvre victime, une femme mal assortie à la vulgarité de sa condition, et chaque fois qu’il arrivait qu’on parlât devant elle d’un mariage forcé, d’une union disparate, elle hochait doucement la tête et souriait d’un air d’intelligence profonde et de tristesse intime.
Elle prenait au sérieux les romans qu’elle avait lus[132], comme certains estomacs blasés ne peuvent supporter les mets simples et naturels ; sa tête, échauffée au feu des fictions mensongères, fermentait en silence, et sa pensée n’était qu’une longue révolte contre cette existence tranquille et reposée qui lui ramenait tous les jours la même série de devoirs à remplir et d’heures à occuper. Il lui semblait parfois qu’elle était née pour une vie plus remplie et plus agitée, et avec la même ardeur que d’autres demandent le calme et l’oubli, elle demandait les fatigues et les bouleversements du cœur. La palme des grandes passions et des grandes douleurs avait pour elle d’irrésistibles séductions ; elle eût été heureuse de mourir martyre. Et cette disposition d’esprit que nous signalons n’est point une chimère inventée à plaisir[133], c’est dans notre époque surtout que ces caractères excentriques sont une réalité palpable. Qui n’a pas touché du doigt cette plaie que peut-être on ne cicatrisera jamais ? Qui ne sait comment certaines imaginations, manquant entièrement de lest, se laissent entraîner à la dérive ? Barques fragiles qui errent à la merci des vagues sur une mer inconnue, et vont se briser aux récifs des falaises[134] !
Madame Évon n’aimait pas son mari, parce qu’elle se croyait supérieure à lui[135] ; elle le regardait comme un inutile et tyrannique compagnon de voyage auquel sa destinée se trouvait fatalement accouplée, et leur union lui semblait une lourde chaîne[136] qu’elle rongeait silencieusement, faute de pouvoir la briser. Dans ses rapports avec lui, elle était froide, réservée, dédaigneusement soumise comme l’esclave révolté qui maudit en son cœur la tyrannie de son maître, et proteste par son obéissance même contre le joug à lui imposé. Lorsque, par hasard, Guillaume Évon se laissait aller à ces emportements des natures grossières, sans cause et sans mesure, elle se sentait presque heureuse d’avoir le droit de l’accuser, et disposée qu’elle était à toujours se plaindre, elle bénissait l’injustice qui justifiait ses plaintes continuelles. Le ménage du fermier Évon était donc une de ces unions malheureuses où deux volontés contradictoires se combattent en secret et luttent avec acharnement dans l’ombre, comme deux ennemis couvrant leur ressentiment d’un masque, et cachant sous un manteau transparent la pointe de leurs poignards. Du reste, aux emportements de Guillaume et à ses accès de mauvaise humeur, Marguerite ne répondait jamais que par des mots entrecoupés, et ces réticences hautaines qui caractérisent l’orgueil blessé et le dédain d’une âme soi-disant supérieure. Quand Guillaume lui donnait impérieusement ses ordres, elle les exécutait en silence avec une fidélité scrupuleuse, et ce n’était que le soir, lorsque, retirée dans sa chambre, elle jetait un coup d’œil à la glace, que le gonflement de son cœur s’échappait en un long soupir.
Marguerite mêlait à ces apparences romanesques un fond de coquetterie réelle qui, dans cette sorte de caractère, s’allie assez naturellement aux inspirations fausses d’une imagination égarée. Sous cette enveloppe de pensionnaire poétique, la femme perçait quoiqu’elle en eût, et les reflets d’une nature colorée et active flairaient assez souvent ce voile de brouillard dont elle aimait à s’entourer. Le dimanche, lorsqu’elle allait à la messe, les paysans admiraient l’élégance qui présidait à sa toilette, et cet instinct de bon goût qui, chez certaines femmes, ressemble presque à du génie. Aussi, la réputation de madame Évon était-elle acceptée comme une réputation incontestable, et il était rare qu’on n’accompagnât pas son nom d’un sobriquet louangeur et d’un sourire d’admiration et de malice. Partout une sorte de déférence s’attache à la beauté, comme à toutes les supériorités de ce monde. On reconnaissait donc volontiers que la réputation de la belle fermière était jusque-là inattaquable, mais un geste d’incrédulité attestait ordinairement les doutes qu’il était permis de concevoir sur son avenir. À Corbeil même, madame Évon était connue de tous les jeunes gens, et les femmes ne parlaient d’elle qu’avec cette ironie qui contient implicitement le plus bel éloge. On l’avait vue figurer dans plusieurs fêtes de village, et toujours elle avait repoussé avec une froideur désespérante les hommages qui lui étaient adressés, quoique pourtant on l’accusât de les rechercher quelquefois. Peut-être les adorations d’une petite ville lui paraissaient-elles un trop faible tribut, et à cette réserve elle avait gagné d’inspirer cet intérêt mystérieux qui s’attache toujours aux secrets irrévélés, aux énigmes incomprises[137].
Il y avait, dans l’intérieur de la ferme, une petite chambre spécialement destinée à madame Évon et où la jeune femme se renfermait pendant des heures entières ; c’était là, pour ainsi dire, son sanctuaire, et les gens de la maison se gardaient avec une déférence respectueuse d’en troubler la solitude. L’aspect de cette petite chambre formait un contraste singulier avec l’extérieur rustique des salles de service ; c’était une sorte de boudoir, mi-partie campagnard, mi-partie mondain, où tous les secrets instincts de la fermière se trouvaient représentés : un tapis de moquette à carreaux nuancé de diverses couleurs en couvrait le parquet et absorbait les bruits extérieurs comme pour protéger le sommeil d’une jeune fille, ou procurer à la pensée le silence dont elle avait besoin. Le papier qui en tapissait les parois était d’un bleu tendre et velouté, dont la nuance reproduisait assez bien l’azur du ciel, et n’apportait à l’œil que des teintes molles et adoucies. Dans le fond d’une alcôve dont les ondulations d’une mousseline à fleurs formaient l’encadrement, apparaissait une glace plus large que haute, et qui, avec sa bordure d’or, scintillait sous les rayons du soleil et renvoyait en tous sens sur les dessins du tapis, sur le velours du papier, ses chatoyants reflets. En face du lit, un canapé couvert en soie bleue se dessinait entre deux fauteuils comme une riante anomalie au milieu de cette vie toute rustique, comme un signe de repos élégant, de coquetterie paresseuse, comme une promesse de bonheur volé aux réalités d’une existence laborieuse et pleine. Dans un coin de la chambre, s’enfonçait une toilette d’acajou à dessus de marbre avec tous ces accessoires qui parfument si harmonieusement la chambre d’une femme ; seulement le gracieux rideau qui se jouait capricieusement à la flèche de la croisée, en cachait à demi la vue, comme si l’habitante d’un pareil séjour eût craint de choquer des yeux prévenus, et de manquer à des obligations consenties à regret. Sur une console soutenue par deux pieds de sphinx, deux vases de porcelaine présentaient avec un mystérieux éclat leurs couronnes de fleurs à demi fanées, et derrière eux, se montraient à peine deux ou trois petites boîtes pleines de bagues, d’anneaux et de ces mille riens brillants, luxe des jeunes filles. Vis-à-vis de la console, sur un casier appendu à la muraille, vous eussiez vu une cinquantaine de petits volumes rangés avec symétrie, et étalant avec art leurs reliures dépareillées. Enfin, derrière le lit, une guitare accrochée à un clou complétait l’ensemble de ce tableau, et lui donnait cette physionomie enfantine dont la vue des peintures de Van Ostade et de Mieris[138] empreint nos rêves[139].
La clef de cette chambre n’était jamais confiée à personne, et madame Évon la conservait avec une attention jalouse, tant telle redoutait de voir troubler par les profanes la paix de ce petit empire. Là, en effet, elle se créait un monde à son gré, et ses meubles, ses joyaux, les fleurs de sa console étaient pour elle autant de sujets dévoués qui écoutaient secrètement ses confidences, et ne les trahissaient pas. Elle s’était fait une telle habitude des plus menus détails de cette retraite choisie, qu’elle les associait, pour ainsi dire, à ses pensées, à ses rêves, à sa vie tout entière ; et peut-être, en contemplant les cordes toujours détendues de la guitare silencieuse, un poëte eût-il cru y voir l’image de cette jeune femme elle-même, dont le cœur incompris n’avait plus qu’à se taire[140].
Le soir, quand elle n’allait pas à la veillée (et elle y allait rarement), pendant que Guillaume se délassait au cabaret voisin des rudes travaux du jour, et absorbait toute son intelligence dans les combinaisons monotones de la triomphe [141], jeu primitif et patriarcal ! madame Évon se renfermait dans sa chambre et en ôtait la clef comme pour se séparer le plus complètement possible d’un monde qui la blessait ; alors elle ouvrait la croisée qui donnait sur la plaine, et se laissait aller, en regardant filer les nuages, à ces rêveries où l’on prend la mémoire pour l’imagination et où on se souvient quand on croit inventer. Souvent, lorsqu’à force d’échauffement elle avait perdu la trace de la réalité, il lui arrivait de se créer des positions aimées, de se forger des aventures, et sur ce théâtre qu’elle bâtissait elle-même, elle se mettait en scène et jouait son rôle après l’avoir composé.
Quelquefois, par un de ces caprices féminins dont la psychologie ne peut expliquer l’étrange mobilité, elle se prenait à essayer, pour elle seule et dans le secret de son appartement, ses plus belles parures et ses plus voluptueuses séductions. Seule ainsi devant sa glace, elle semblait sourire à une image inaperçue, et répondre à une voix mystérieuse qui lui disait : « Vous êtes belle[142] ».
Le lendemain de la veillée elle eut un caprice de cette nature. Vers les huit heures du soir, lorsque Guillaume Évon fut sorti, selon son habitude elle s’enferma dans sa chambre, et accoudée sur l’appui de la croisée ouverte, longtemps elle contempla la voûte du ciel ; puis fermant subitement la fenêtre, elle tira avec précaution d’une armoire pratiquée dans le mur une robe de percale blanche, et l’étala complaisamment sur le couvre-pied de son lit ; enfin, comme une femme qui s’apprête aux délices d’un bal, elle passa dans les tresses de ses cheveux noirs les dents d’un peigne d’écaille ; les épingles qui attachaient son fichu furent enlevées successivement ; et lorsque ses doigts agiles eurent fait tomber la robe noire de la veille, elle se para en souriant de sa robe nouvelle, ainsi qu’une jeune mariée, heureuse et fière de quitter ses vêtements journaliers pour une éclatante quoique fugitive parure. Quand sa toilette fut achevée, quand elle eut placé sous la garniture tuyautée de son bonnet deux boutons de rose naturels, coquetterie des champs, alors elle se posa devant sa glace, prit dans une boite toutes les bagues qu’elle contenait, et se les mit aux doigts. Seulement une pensée de désappointement plissa sa bouche, lorsqu’elle passa la main sur son col ; avait-elle un regret ? s’apercevait-elle qu’il manquait une chaîne à sa parure[143] ?
Il est dans la physiologie féminine des traces si fugitives que l’écrivain est impuissant à les reproduire et à les expliquer[144], pensées rapides qui effleurent l’âme comme le vol d’un oiseau la surface des flots, comme l’aile d’un papillon le calice des fleurs ; ombres légères qui s’évanouissent ainsi que le chant d’un rossignol dans les bois ; éclairs spontanés qui disparaissent au moment même où le regard cherche à en fixer l’image. Une pensée de cette nature avait-elle sillonné l’âme de madame Évon, je ne sais ; mais un moment elle demeura pensive, tourmentant machinalement du doigt l’échancrure de sa robe, comme un musicien rêveur qui laisse courir sa main distraite sur les touches du clavier sonore. En ce moment, trois coups frappés à la porte la réveillèrent en sursaut, et la ramenèrent au sentiment réel de sa position[145]. Par un mouvement de pudeur irréfléchie, elle prit un fichu et le croisa sur sa poitrine nue, semblable à la Suzanne surprise au bain[146]. Le son d’une voix rude et enrouée la fit tressaillir de nouveau.
— Marguerite, dit en dehors Guillaume Évon, ouvrez-moi donc, et ne me faites pas ainsi rester à la porte !
La fermière jeta sur sa toilette un de ces regards qui expriment le doute de l’âme, et ces inquiétudes vagues qui troublent certaines femmes à l’approche d’un orage[147].
— Ne pouvez-vous pas me laisser dormir, Guillaume ? dit-elle d’une voix douce et presque suppliante ; il était tard, et je me suis couchée.
— Relevez-vous et venez m’ouvrir ! dit Guillaume.
La voix du fermier s’enflait par degrés comme le grognement d’un chien, pendant la nuit, à l’approche d’un danger qui menace la maison de son maître.
— Ouvrez-moi donc ! répéta-t-il.
La jeune femme comprit alors que toute résistance était inutile, et cachant son dépit, et sa terreur peut-être, sous l’apparence froide et réservée qui lui était habituelle, elle se décida à introduire Guillaume Évon dans sa chambre[148].
Celui-ci avait cet air soucieux, symptôme ordinaire de mauvaise humeur que Marguerite distinguait au premier coup d’œil, ainsi que les matelots distinguent à l’horizon le point noir qui signale la bourrasque. Sa bouche était pincée et comme tendue par l’irritation des nerfs, son œil enfin affectait ces clignotements de la colère contenue encore, et qui cherche, avant d’éclater, à déjouer toutes les prévisions.
— Vous n’étiez donc pas couchée ? dit-il en se jetant sur un fauteuil.
— Non, répondit Marguerite ; mais je suis indisposée, j’ai besoin de repos, et je voulais être seule.
— Vous êtes malade ? dit le fermier en se levant, et d’une voix plus douce et plus émue qu’il ne l’aurait désiré peut-être ; çà, qu’avez- vous, Marguerite ? Voulez-vous que j’envoie chercher un médecin à Corbeil !
— Non pas, reprit vivement la fermière ; mais, je vous en prie, mon bon Guillaume, laissez-moi seule !
Pour la première fois, le regard du fermier s’arrêta sur le visage de sa femme, il la vit pâle et émue ; puis son regard redescendit peu à peu, et lorsque, par un coup d’œil rapide, il eut toisé de la tête aux pieds Marguerite, élégante et parée, quand il eut saisi l’ensemble de cette fraîche toilette qui lui apparaissait à pareille heure comme une anomalie choquante, ou pour peindre ces sensations par un langage qui leur est propre, comme un mauvais rêve, sa maigre figure se rembrunit de mécontentement, un éclair de dépit illumina le fond terne de ses yeux, et brilla sous le voile de ses cils grisonnants ; il s’assit de nouveau, et allongeant ses jambes sur le tapis avec un calme affecté :
— Est-ce que vous comptiez aller au bal ce soir ? demanda-t-il à la jeune femme qui, debout et immobile devant lui, baissait obstinément la vue. Voici deux heures que je vous ai quittée, et vous n’aviez pas alors de si beaux atours ! Savez-vous bien qu’on vous prendrait pour une grande dame ainsi parée, et non pas pour la femme d’un paysan comme moi ?
Guillaume Évon avait prononcé ces paroles du ton le plus propre à provoquer une réponse. Il en est de la colère comme de l’incendie qui s’éteint faute d’aliments ; Guillaume cherchait des aliments à sa colère.
Marguerite se taisait toujours. Sa figure était pâle, mais sans être altérée ; il y avait à la fois, dans l’expression de ses traits, de la résignation et du dédain. Décidée qu’elle était à n’opposer aux efforts actifs de Guillaume qu’une résistance passive et une force d’inertie elle gardait intrépidement le silence et attendait.
— Tenez, Marguerite, continua Guillaume en adoucissant un peu le son de sa voix, il faut que je vous dise la vérité : vous prenez une mauvaise route, l’état de fermière ne vous convient pas, et vous seriez mieux placée dans quelque beau salon de Paris que dans la cuisine d’une ferme. Et voilà ce que c’est que d’élever les enfants comme des poupées ! On leur apprend à écrire en anglaise, à réciter des vers, à danser, à pincer de la guitare, et au lieu de bonnes ménagères, on en fait de petites mijaurées propres tout au plus à lire et à rêvasser à l’ombre des peupliers ! Ce que je dis là n’est-il pas vrai, Marguerite ? Voilà-t-il pas de beaux talents pour une femme de savoir se broder des fichus, lire un tas de balivernes qui n’ont pas un seul brin de raison, chanter des romances au clair de la lune, et donner plus de temps à sa glace qu’à sa basse-cour ou à sa bergerie ! Croyez-vous pas qu’il soit agréable pour un honnête homme qui veut faire honneur à ses affaires et payer, comme il convient, son loyer tous les six mois, d’avoir devant soi une petite image toujours parée comme une bonne vierge et enfermée dans sa chambre comme dans une châsse ? Au lieu de mettre de belles robes et des pompons dans ses cheveux, ne vaudrait-il pas mieux faire la soupe aux moissonneurs et aux charretiers ? Mais non, on a peur de noircir ses mains, de gâter ses habits ! On se ménage, on s’attife comme une petite-maîtresse qui a des valets à faire enrager et un trésor à dissiper[149] !
Guillaume s’échauffait en parlant, et le mouvement convulsif de son pied accentuait par intervalle ses paroles avec une impatience croissante. Le silence opiniâtre de Marguerite augmentait son irritation, et comme s’il eût craint de voir son éloquence se perdre dans le vide :
— Voyons, ajouta-t-il d’une voix retentissante, tout cela n’est-il pas la vérité ? Parlez ! mais parlez donc[150] !
— Vous avez raison, dit la fermière sans lever les yeux, et d’une voix doucement vibrante qui ressemblait aux accents d’un écho affaibli.
— Oui, j’ai raison ! reprit Guillaume ; et songez-y bien, je vous parle autant dans votre intérêt que dans le mien ; je n’ai pas envie, moi, de me tuer le corps et l’âme pour subvenir aux frais de votre toilette ! Quand l’homme travaille, il faut que la femme travaille aussi ; et il n’est pas juste que l’un ait tout le mal et l’autre tout le plaisir !
— Ai-je donc, jusqu’à présent, objecta Marguerite, manqué à mes devoirs ? Quels reproches fondés avez-vous à me faire ? Quelles obligations ai-je oublié de remplir ? Quelles occupations ai-je tant négligées ?
À cette interpellation, Guillaume hésita un instant, comme un homme surpris et qui craint de tomber dans un piège.
— Vous voilà bien, dit-il, avec votre voix mielleuse et vos belles phrases ! Je ne fais pas de phrases, moi, mais je dis ce qui est.
— Guillaume, répondit la jeune femme, il est tard et j’ai besoin de repos ; vous savez que demain il faut être sur pied de bonne heure ?
— C’est cela, dit le fermier, tâchez de me donner le change. Vous savez bien où je veux en venir, et voilà ce qui vous effraye[151] ! Pourquoi cette toilette ce soir ? Répondez !
La jeune femme redressa pour la première fois la tête ; sur son visage reparut cette expression de fierté dédaigneuse qu’elle avait un moment dissimulée. Ses grands yeux noirs se fixaient sur ceux de Guillaume afin de sonder le fond de sa pensée et d’en explorer les plus secrets replis. Les femmes ont, en de certains instants, un instinct d’assurance que rien ne saurait troubler ; comme tous les êtres faibles, leur énergie n’éclate que par soubresauts, et leurs accès de courage ressemblent à ces éclairs qui déchirent, dans les ténèbres, les sombres voiles des cieux.
— Ne puis-je pas, dit-elle d’une voix ferme, mettre la robe qui me plaît ? Et suis-je tellement enchaînée que je doive vous rendre compte de mes actions les plus insignifiantes ? Êtes-vous un juge, un espion ?
Guillaume ne comprit qu’à moitié le sens de cette réponse, et, comme il arrive ordinairement aux esprits incultes, ce fut plutôt la consonance des mots qui le frappa que leur signification.
— Un espion, répéta-t-il avec véhémence, un espion ! Avez-vous jamais ouï dire que Guillaume Évon ait mangé de ce pain-là ? Il faut que vous sachiez que j’ai toujours eu la tête haute et la parole claire : les cachotteries ne me vont pas ! Quand j’ai quelque chose sur le cœur, je m’en débarrasse, et voilà ! Mais pour m’abaisser jusqu’à l’espionnage, pour faire comme le loup qui s’embusque dans nos bois et attend le troupeau, c’est un rôle que je ne jouerai jamais.
Guillaume s’était levé ; il y avait dans son attitude, dans le froncement significatif de ses sourcils, cette sorte de dignité roide que les hommes du commun prennent pour de la majesté ; il se souvenait sans doute que tous ses voisins lui parlaient chapeau bas et l’appelaient M. le maire.
À cette sortie bruyante, Marguerite se contenta de répondre par un hochement de tête ; et peut-être, dans l’angle de sa bouche, eût-on pu découvrir la trace d’un sourire. Elle comprenait en ce moment toute sa supériorité relative et s’en glorifiait dans son cœur.
— Mais vous ne me ferez pas croire, reprit Guillaume, qu’une femme mette ses plus beaux atours, le soir, pour rester seule dans sa chambre et deviser avec son miroir ! Quand on s’habille, c’est qu’on veut aller à la messe et entendre dire derrière soi : Voilà une femme bien tournée ! Ou encore, c’est qu’on va à une fête, à une assemblée, à un bal ! Ou enfin…
Guillaume s’arrêta. Il venait de tourner longtemps autour de la difficulté, et au moment de la trancher, il hésitait encore. Sous des apparences brusques, il cachait un fond de faiblesse naturelle qui paralysait ses efforts et enchaînait sa volonté.
— Eh bien ! que voulez-vous dire ? demanda Marguerite.
Cette question, faite avec assurance, réveilla l’énergie accidentelle du fermier.
— Vous attendiez quelqu’un ! dit-il en éclatant.
Marguerite resta impassible ; sur son front pur et posé, cette accusation, lancée à bout portant, n’amena pas un seul pli, ne creusa pas une seule ride. Peut-être, sous les emportements de Guillaume Évon, avait-elle pressenti depuis longtemps l’idée fixe qui se manifestait à la fin ; et, comme un guerrier qui prévoit toutes les chances d’une bataille, elle les acceptait toutes sans trembler.
— Dites-moi donc que vous n’attendiez personne ! continua Guillaume ; voyons, soutenez la pariure jusqu’au bout[152] ! Je vous croirai si vous me le dites une bonne fois, quoique la chose soit difficile à croire ! mais enfin, les femmes ont de si singuliers caprices !
Le sourire qui avait à peine paru sur les lèvres de la fermière se dessina alors plus nettement. Et comme si elle eût répondu elle-même à sa pensée, elle se contenta de baisser la tête en signe de muet assentiment. Ce sourire n’échappa pas à Guillaume, et comme il n’en comprit pas le sens, son mécontentement s’en augmenta.
— Rire n’est pas répondre ! dit-il furieux et hors des gonds ; je vous le répète, vous attendiez quelqu’un !
— Ne vous êtes-vous pas aperçu, dit froidement Marguerite, que la porte de ma chambre était fermée ?
— Il s’agit bien de porte ! dit Guillaume qui commençait à perdre la tête, et ne pesait plus la valeur de ses mots ; ne peut-on entrer que par la porte[153] ?
— C’est vrai, dit la fermière, j’oubliais la fenêtre.
L’ironie perçait sur la figure et dans les paroles de Marguerite ; sa bouche avait cette expression railleuse de la puissance qui se joue d’un être faible ; c’était elle à son tour qui avait pris la position supérieure. Seulement, elle s’aperçut que peut-être il serait dangereux de continuer son manège ; quand on les pousse à bout, les hommes tels que Guillaume ne connaissent plus ni mesure ni frein : on ne contient pas la rage aveugle.
— Et qui pouvais-je attendre à cette heure ? dit Marguerite d’une voix adoucie.
— Que sais-je, moi ! dit Guillaume ; cet intrigant qui vient d’acheter le château de Saintry, ce beau monsieur qui vous passait hier soir une chaîne d’or au cou, Arthur Raimbaut enfin[154].
En entendant prononcer ce nom, la fermière, jusque-là digne et fière, sentit un nuage passer sur sa vue. Ce nom avait-il réveillé dans les profondeurs de son âme un écho assoupi, une pensée à peine formulée ? Les pommettes de ses joues se veinèrent de filets rouges dont l’incarnat fit ressortir la fixité terne de son regard. Elle demeura longtemps sans voix, et ce ne fut qu’avec peine qu’elle retrouva la conscience de l’injuste accusation qui pesait sur elle. Mais alors sa fierté s’irrita d’autant plus qu’elle en avait perdu d’abord le sentiment.
— Voilà bien de vos soupçons ! dit-elle à Guillaume, et je reconnais là votre délicatesse accoutumée. J’attendais, n’est-ce pas, ici, dans ma chambre, un homme que je n’ai jamais vu qu’une fois ! Ah ! monsieur, vous me faites rougir pour vous !
Pendant qu’elle prononçait ces mots, une grosse larme roula lentement le long de sa joue et y traça un sillon. La colère de Guillaume tomba à cet aspect ; sa figure tendue jusque-là, se dérida tout d’un coup, et prenant la voix caressante d’un enfant qui veut se faire pardonner une faute :
— Allons, voilà qu’elle pleure à présent ! dit-il. Voyons, Marguerite, ne peux-tu pas me répondre sans t’emporter et pleurer ainsi ? Mes soupçons sont injustes, je le veux, et je suis parfois un peu bourru ; mais au fond, tu sais bien que je t’aime, et que je souffre quand tu souffres !
Chose singulière que les larmes d’une femme produisent même sur les natures les plus grossières une réaction subite, et fassent succéder à l’irritation la plus intense l’amollissement et la faiblesse. Guillaume avait pris une attitude suppliante, et implorait du regard le pardon de sa femme ; quant à elle, à demi couchée sur le coussin du canapé, pâle et les yeux fermés, elle ressemblait à une de ces belles créations de Paul Cagliari [155], où la vie apparaît encore ardente et chaude sous un voile de discrétion et de retenue. Déroulés au hasard, ses cheveux ruisselaient sur ses joues et les encadraient de leurs festons [156] luisants ; débarrassée de son fichu, sa gorge rebondissait sous la percale et haletait avec effort[157].
Guillaume s’approcha d’elle et la contempla pendant quelque temps d’un air d’admiration silencieuse. Entraîné par une irrésistible attraction, il se pencha lentement sur son visage, et lui dit :
— Sais-tu que tu es belle, Marguerite ? Voyons, ne me fais pas la moue et pardonne-moi ! Veux-tu me pardonner ?
En même temps, il passa son bras autour de sa taille, comme pour la soulever vers lui.
La jeune femme tressaillit de tout son corps, et se levant avec la précipitation d’un ressort subitement tendu, d’un seul bond elle se trouva à deux pas de Guillaume qui la regardait d’un air étonné.
— Là, là, dit le fermier en l’apaisant de la main comme on apaise un enfant mutiné ; ne soyez pas si méchante, Marguerite, on ne veut plus troubler votre repos. S’il est vrai que vous êtes indisposée, souffrante, je vais vous laisser seule, car je ne veux que votre bien, moi.
La jeune femme récompensa cette soumission, inespérée peut-être, par un signe d’adieu gracieux et souriant.
— Allons, dors bien, petite ! dit Guillaume en lui prenant la main ; bonsoir[158].
VII.
Rien ne ressemble plus à l’occupation militaire d’une ville que le morcellement en permanence d’une grande propriété[159]. Le château offrait l’aspect d’une place de guerre nouvellement emportée d’assaut : dans la salle à manger étaient dressées toute la journée des tables servies, et chaque paysan qui venait pour traiter d’affaires y trouvait son couvert mis et un domestique à ses ordres. C’était un spectacle assez bizarre que cette longue procession de spéculateurs en blouse et en gros souliers qui s’asseyaient tour à tour à la table commune, et se voyaient, pour la première fois de leur vie, traités en grands seigneurs et en maîtres souverains. Cette manière d’agir gagnait bien des esprits rebelles, conciliait bien des dissidences secrètes ; il était rare qu’un de ceux qui venaient demander cette hospitalité généreuse à Arthur Raimbaut se retirât sans emporter un lopin de terre et lui laisser un sac d’argent. L’opposition de Guillaume Évon était débordée ; dans cette lutte entre deux puissances, l’une acquise et de résistance, l’autre nouvelle et d’envahissement, la victoire restait à la dernière ; le spéculateur audacieux triomphait du fermier craintif et opiniâtre.
Le morcellement de la propriété du général était donc en pleine activité. Arthur Raimbaut, comme un chef d’armée sur le champ de bataille [160], qui pourvoit à tous les besoins, pare à toutes les difficultés, se pliait aux détails les plus minimes, et trouvait chaque jour dans son esprit une nouvelle ressource. C’était lui seul qui parlait aux paysans et les amenait malgré leur résistance à des résultats désirés. Sans être fier avec eux, il était bref, concis, clair dans ses paroles, prompt dans ses déterminations : pour être à leur portée, il se rapetissait et entrait avec eux dans ces spéculations de ménage dont les hommes médiocres ne soupçonnent pas l’importance ; il disait à chacun le mot qui lui était propre, et prenait part à leurs affaires avec une intelligence et une sagacité merveilleuses [161]. Du reste, par un de ces contrastes que nous avons déjà indiqués, il semblait se vouer exclusivement à une opération commerciale, sans restriction, sans arrière-pensée, comme un homme qui ne verrait comme but final de toutes choses qu’une fortune à conquérir, une importante partie à gagner. Différent en ceci des joueurs qui comptent toujours beaucoup sur le hasard, il ne comptait pour réussir que sur lui-même et sur la science qu’il avait des hommes ; le chiffre des passions qu’il maniait était la base de tous ses calculs ; il appliquait aux affaires la certitude mathématique des probabilités. Il n’avait pas d’ailleurs renoncé à vaincre l’obstination de Guillaume Évon lui-même ; et chaque fois qu’on lui parlait de la résistance que celui-ci opposait, il se contentait de répondre en hochant la tête : « Laissez-le faire, il y viendra ».
Le dimanche surtout, un mouvement étrange et inaccoutumé régnait au château. Tous ceux que des travaux avaient absorbés pendant le cours de la semaine s’y rendaient, les uns avec des intentions formelles, les autres par curiosité et par désœuvrement. Tous étaient les bienvenus et prenaient également part aux joies de ce bivouac de nouvelle espèce qu’Arthur Raimbaut avait organisé. Vers midi, la cloche donnait le signal du déjeuner, et, autour de la table chargée à profusion, se pressaient pêle-mêle les gens du château et ceux du dehors : le notaire et ses clercs, les géomètres chargés de lever des plans et de tracer la division des lots, et les acheteurs enfin qui préludaient à la conclusion de leur traité en buvant les différentes sortes de vin qu’on leur prodiguait. L’ordre manquait au repas, mais non l’abondance ; le champagne y moussait, et les volailles du pays y jouaient largement leur rôle ; pas d’étiquette d’ailleurs, liberté à tous [162] de parler, de rire, de témoigner par des éclats leur contentement. Au milieu de la table, Arthur Raimbaut, souriant et posé, s’occupait avec un soin égal de tous ses convives ; à celui-ci, il parlait de l’engrais des terres, de la culture des betteraves, du rendement[163] probable des colzas ; à celui-là, il demandait des nouvelles de sa femme, de ses enfants, de sa famille ; et tous ces braves gens, dont l’amour-propre est plus tendre à la flatterie en raison même de leur ignorance, contemplaient avec une sorte d’admiration l’homme étrange qui sympathisait si bien avec leurs pensées, et accommodait son esprit aux petitesses du leur.
On était quelquefois trente à table ; les places n’étaient pas marquées [164], on entrait et on s’asseyait quand on voulait et où l’on voulait ; on eût dit que la propriété d’Arthur Raimbaut était devenue une propriété banale, et que chacun en pouvait réclamer sa part. Seulement au bout d’une heure, Arthur Raimbaut se levait et emmenait avec lui son cortège de subalternes ; les clercs de notaires et les géomètres se rendaient silencieusement à leurs postes comme des militaires, qui, au sortir d’une fête oublient en un instant leurs impressions récentes et leurs émotions encore vives pour se soumettre de nouveau aux règles exigeantes de la discipline. Dans cette vie tumultueuse et pourtant régulière, il y avait quelque chose de la ponctualité soldatesque[165] ; les moments étaient comptés, les heures fixées avec une précision rigoureuse ; à la volonté du maître toutes les fantaisies individuelles s’annihilaient sans murmures ; un ordre de lui faisait loi, et tous les intérêts divergents qui se ralliaient à lui semblaient se fondre en un seul, l’instinct de l’obéissance.
Vers la fin du mois de novembre, par une de ces belles gelées d’hiver qui donnent à la nature un aspect de solennité grave et de magnifique sévérité, Arthur Raimbaut avait organisé une fête[166]. Tous les paysans des alentours y avaient été conviés par lettre, avec leurs femmes, leurs enfants, leur parenté ; la journée tout entière devait être consacrée à la joie ; déjeuner, dîner, bal, tous les plaisirs s’enchaîneraient les uns aux autres : le maître témoignait à ses sujets sa satisfaction, Arthur Raimbaut était content. Dès le matin les portes du château s’ouvrirent et le vieux Jérôme mit, quoiqu’en murmurant, son plus bel habit pour faire les honneurs d’une réception solennelle à ces hôtes nouveaux et passagers du château. Dès le matin donc on vit arriver, par tous les sentiers de la plaine, par tous les chemins qui aboutissent au village de Saintry, de nombreuses troupes de paysans, tons parés de leurs vêtements de fête, et conduisant sous le bras leurs femmes endimanchées. Malgré la rigueur du froid piquant, les garçons reluisaient aux rayons du pâle soleil d’automne avec leurs pantalons blancs, leurs gilets ouverts, et laissant voir les plis roides d’une chemise empesée. Jamais assemblée de village n’avait attiré tant de monde ; et au fait, il y avait quelque chose de féerique dans cette journée de plaisir offerte par un marchand de terre [167], comme on disait, à toutes ses pratiques. Le nom d’Arthur Raimbaut circulait dans toutes les bouches, accompagné de ces mille commentaires que l’imagination du peuple aime tant à pousser jusqu’à l’absurde. Il fallait, disait-on, que cet homme eût d’immenses trésors à jeter au vent ; pour certain, il n’était pas seul, et il ne fallait voir en lui qu’un prête-nom qui cachait une vaste et nombreuse association ; puis, en disant ou en écoutant ces choses, les vieillards hochaient la tête comme pour expliquer qu’au-delà de ces prévisions communes, leur expérience entrevoyait quelque grave mystère, quelque énigme inexpliquée.
Quant à la jeunesse, insouciante et rieuse qu’elle est toujours, elle ne comprenait en tout cela que les séduisantes promesses d’une journée de plaisir, et remerciait Arthur Raimbaut de sa générosité, sans en pénétrer le motif. À chaque instant des bandes de demoiselles, parées et court-vêtues, envahissaient en chantant les avenues du château ; leurs joues étaient colorées et fraîches, et les teintes blafardes du froid disparaissaient sous l’incarnat naïf de leur bonheur. Dans les appartements du château se pressait une foule avide et bruyante ; de tous côtés éclataient ces exclamations confuses, ces cris discordants qui signalent les joies populaires[168] ; on s’interpellait les uns les autres avec cette franchise expansive d’hommes accoutumés à reproduire tous leurs sentiments au dehors, et qui ne comprennent pas plus l’importance de leurs paroles que la portée de leur silence. À l’étage supérieur, une fanfare d’instruments en cuivre mêlait son harmonie à ces harmonies diverses, et la note aiguë des trombones dominait de temps en temps toutes les voix, ainsi que par une mer houleuse le sifflet du contremaître domine le bruissement des flots et les emportements de la tempête. Déjà bien des figures se coloraient d’une teinte pourprée, bien des jambes s’avinaient, bien des voix se faisaient chevrotantes.
Au milieu de ce tumulte, Arthur Raimbaut se promenait de groupe en groupe, se mêlant à toutes les conversations, et, au besoin, faisant sa partie dans ce concert de plaisanteries grivoises et de bons mots à moitié ivres. Il était depuis quelque temps au milieu d’un cercle plus bruyant que les autres, lorsque le notaire de Saintry vint le tirer doucement par le bras, en lui disant à voix basse : « J’ai à vous parler. » Maître Paquis avait l’air encore plus roide et plus compassé qu’à l’ordinaire ; comme pour se grandir en raison de son importance, il se haussait sur la pointe des pieds et faisait pirouetter son regard de droite et de gauche avec cette agitation inquiète des hommes médiocres qui se trouvent par hasard jetés dans une position plus haute que leur taille[169]. Ses cheveux ébouriffés sur son front lui donnaient cette apparence sautillante qui ressemble au mouvement continuel d’une branche d’arbre agitée par le vent.
— J’ai à vous parler d’une chose sérieuse ! répéta-t-il en se penchant à l’oreille d’Arthur Raimbaut qui l’écoutait à peine.
— Ne pouvons-nous remettre à demain les choses sérieuses ? dit Arthur de ce ton dégagé qui tranchait en certaines circonstances avec la gravité ordinairement triste de son maintien.
— Il faut que je vous parle à l’instant même ! dit le petit homme en appuyant sur chacune de ses paroles.
Arthur prit, sans répondre, le bras de maître Paquis, et descendit avec lui les marches du péristyle.
— Grande nouvelle ! dit celui-ci en éclatant, lorsqu’ils furent à une centaine de pas du château, grande et bonne nouvelle ! J’ai un acheteur pour le château.
— Vraiment, dit Arthur, c’est affaire à vous, monsieur le notaire, de mener les choses rondement, et j’ai toujours compté en ceci sur votre haute sagacité !
Sous le coup de la flatterie, maître Paquis se redressa d’un air de satisfaction inénarrable et d’orgueilleuse modestie[170] ; et en cadençant ses mots avec un soin et une délicatesse merveilleux :
— Peut-être me sera-t-il permis de dire, répondit-il, que ma longue expérience des affaires ne vous aura pas été inutile ; j’ai trouvé dans ma nombreuse clientèle des ressources qui, peut-être, auraient échappé à tout autre.
— Bien vrai, dit Arthur, et vous pouvez affirmer cela sans vous vanter, monsieur le notaire ! C’est à vos soins que mon opération devra en grande partie son succès ! Mais quel est cet acheteur dont vous me parlez, le connaissez-vous ?
Maître Paquis hésita un peu avant de répondre ; le laconisme d’Arthur Raimbaut avait toujours produit sur lui un effet presque mortifiant. Dans le cours de sa carrière bavarde, il n’était pas habitué à ce qu’on résumât toutes choses par des points d’interrogation.
— Je ne puis, dit-il, me vanter de le connaître personnellement, quoique par mes relations j’aie sur lui tous les renseignements désirables.
— L’avez-vous vu ? demanda Arthur.
— Sans nul doute, dit maître Paquis, caressant minutieusement les contours de sa phrase, puisque c’est lui-même qui m’a porté ses propositions.
— Et que me propose-t-il?
— Avec l’habitude que vous avez des affaires, dit maître Paquis, vous devez savoir, monsieur qu’on ne se livre jamais à une première entrevue ; vous savez qu’il est de règle de rester boutonné le plus longtemps possible afin de voir venir, et s’il m’est permis de raisonner par comparaison, sur le terrain on ne se découvre jamais à la première botte [171].
— Au fait, au fait, monsieur le notaire, dit Arthur ; s’il vous a fait des propositions, donc il propose quelque chose. Eh bien, que me propose-t-il ?
Le notaire royal[172] était encore une fois désarçonné ; l’insistance concise d’Arthur Raimbaut s’acharnait sur ses paroles comme une hache toujours prête à trancher le fil de ses prétentions oratoires [173].
— Il me propose deux cent mille francs ! dit-il d’un ton sec, et où perçait le mécontentement de l’amour-propre blessé.
— Deux cent mille francs pour le château et le parc, ce n’est pas assez.
— Mais je crois, reprit le notaire, que ce n’est pas là son dernier mot, et si vous vouliez me laisser conduire cette affaire…
Maître Paquis allait encore s’abandonner à son instinct bavard, lorsqu’Arthur l’interrompit d’une voix brusque :
— Comment se nomme cet homme ? demanda-t-il en employant sa forme favorite de l’interrogation.
— De Noï [174].
— C’est un noble ?
— J’ai tout lieu de présumer que sa noblesse ne date pas de bien loin[175], et qu’on en retrouverait les titres dans quelque secrétariat d’ambassade.
— Un diplomate, dit Arthur en souriant, c’est la finesse brevetée ! M. de Talleyrand[176] n’est-il pas un grand homme[177] ?
— Oui, sans doute, murmura le notaire ; et si vous vouliez confier à ma vieille expérience…
Maître Paquis jouait de malheur ; chaque fois qu’il essayait de renouer la trame de ses idées interrompues, une interruption nouvelle comprimait subitement son essor.
— Monsieur le notaire, dit Arthur, promettez-moi de répondre catégoriquement à toutes les questions que je vais vous faire. Ce M. de Noï est-il jeune ?
— Trente ou quarante ans.
— Bien. Quelle est sa mise ?
— Élégante et riche, des bagues aux doigts, des boutons en diamants à sa chemise.
— J’irai le trouver moi-même, dit Arthur ; je me charge de tout. Mais vous, monsieur le notaire, qui devez connaître les traits de la physionomie humaine, avez-vous étudié la sienne ? Quel est son caractère[178] ?
Le notaire recula d’un pas, semblable à un coursier chétif qui voit tout d’un coup se dresser devant lui une infranchissable barrière. Il avait peine à comprendre la signification et la portée d’une semblable question, et comme un homme fasciné par une puissance occulte, il se débattait sous le joug d’une supériorité incontestable et pourtant inexpliquée.
— Il ne m’est pas donné, répondit-il à la fin, de deviner la pensée et d’interpréter les lignes du visage [179] ; tout ce que je puis vous dire, c’est que celui dont nous parlons, a l’air souffrant et maladif ; sa figure est maigre, ses joues sont tirées, ses pommettes saillantes ; pour ma part, et quoique par la nature de mes études je sois demeuré étranger à la science médicale, je croirais volontiers qu’il est poitrinaire[180].
Arthur Raimbaut garda quelque temps le silence, comme si cette dernière explication eut soulevé en lui des réflexions sérieuses.
— M. le notaire, dit-il gravement, à quelle heure un poitrinaire doit-il être le mieux disposé ?
Maître Paquis recula d’un pas en pivotant sur son talon, ainsi qu’un papillon qui tourne autour d’une lumière perfide dont l’éclat aveugle ses yeux. La question d’Arthur Raimbaut lui paraissait une énigme inexplicable, et il ne savait trop s’il devait la prendre au sérieux.
— À quelle heure est-il venu vous trouver ? demanda Arthur, du même ton dogmatique qu’il imprimait depuis quelques instants à ses paroles.
— Il était une heure après midi, dit le notaire.
— Après déjeuner, c’est bien ; j’irai le trouver demain après une heure. À propos ! quelle est son adresse ?
— Rue du Helder, 26 [181].
Les deux interlocuteurs, après une assez longue déambulation à travers les sentiers du parc, étaient revenus à leur point de départ ; ils se trouvaient dans la grande avenue du château, lorsqu’un bruit nouveau et comme un mélange de clameurs confuses vint interrompre leur conversation. À la grille d’entrée, on apercevait un groupe de paysans empressés qui semblaient adresser à quelque supériorité locale leurs félicitations et leurs hommages.
— Allons donc voir ! dit Arthur en entraînant maître Paquis après lui.
Au milieu du groupe, Arthur, en approchant, aperçut un petit homme qui, d’un air important, semblait donner des conseils ou des remontrances à ceux qui l’entouraient ; c’était le fermier Évon. Il y avait dans sa toilette cette prétention grotesque qui caractérise si bien le ridicule d’un amour-propre enflé par les circonstances : il portait un habit noir dont les revers rétrécis s’allongeaient en pointe sur la poitrine ; les mèches de ses cheveux grisonnants, ramenées avec soin : sur les tempes, s’arrondissaient suivant la mode antique en ailes de pigeon, et pointaient inégalement sur les larges bords d’un chapeau de feutre gris ; une ceinture tricolore partait de l’épaule pour descendre sur la hanche et rehaussait l’aspect vulgaire de sa personne.
Lorsqu’Arthur Raimbaut s’approcha de lui, à peine l’orgueilleux maire daigna-t-il lui accorder une de ces inclinations de tête qui expriment à la fois le sentiment de la supériorité et du mécontentement contenu. Arthur lui tendit la main en s’inclinant, et acceptant volontiers la position inférieure qu’on lui faisait :
— M. le maire, dit-il, ce m’est un grand honneur de vous recevoir aujourd’hui.
— Ma présence était nécessaire, dit Guillaume ; les devoirs de ma place m’appelaient ici ; toute fête peut entraîner du désordre, et c’est dans l’intérêt de la tranquillité que je suis venu.
Guillaume avait prononcé ces mots d’un ton fier et avec cette solennité sacramentelle d’un homme que le pouvoir enivre, précisément parce qu’il est au-dessous du pouvoir[182].
Arthur Raimbaut était parvenu à isoler le fermier, et le groupe qui l’environnait s’était dissipé peu à peu. Maître Paquis restait seul, placé entre les deux interlocuteurs, ainsi qu’un conciliateur nécessaire ; il se croyait le point de centre où les intérêts opposés et les passions rivales devaient se fondre ; et fort de lui-même, il adressa librement la parole à Guillaume Évon.
— Eh bien ! Guillaume, dit-il (vous me permettrez, à moi votre vieille connaissance, de vous donner ce nom), êtes-vous donc décidé à ne pas faire affaire avec nous ? C’est pourtant là une belle occasion de vous arrondir !
— Ne parlons pas de cela, dit Guillaume d’un ton sec. D’ailleurs, je n’ai pas d’argent.
— Vrai ! dit Arthur avec une nonchalance affectée ; on me l’avait affirmé sans que je voulusse le croire,
Cette insinuation produisit sur Guillaume un effet qu’il ne dissimula même pas.
— Qui vous a dit cela ? murmura-t-il sans se soucier beaucoup de la contradiction qui se manifestait dans ses paroles. Des envieux ! des jaloux ! Un Jacques Poneau[183] mon voisin, qui n’a pas seulement de quoi payer les colifichets de sa femme, et veut trancher du grand propriétaire ! Belle caution, ma foi, que celle-là ! Sachez-le bien, messieurs, Guillaume Évon n’est pas encore réduit à la mendicité, et quand il voudra, il trouvera assez de gros sous pour acheter soixante arpents de terre !
En ce moment, une volée de cloche retentissante interrompit la conversation qui commençait à s’échauffer.
— C’est le signal du déjeuner, dit Arthur Raimbaut. Allons, monsieur le maire, à demain les affaires sérieuses, aujourd’hui ne songeons qu’au plaisir.
Au rez-de-chaussée du château, des tables étaient dressées sur toute la longueur des appartements, et une foule nombreuse circulait d’une salle dans l’autre, contemplant d’un air avide les apprêts de ce festin quasi royal [184]. Les hommes, formés en groupe, et déjà échauffés par les fréquentes libations de la journée, laissaient échapper leur joie en rires bruyants et en exclamations de toute nature ; les femmes, toujours plus modestes et plus retenues, causaient entre elles à voix basse, et à l’expression oblique de leurs regards, au mouvement mystérieux de leurs lèvres, il était aisé de voir que la médisance et la jalousie avaient une assez large part dans ce club féminin[185]. Une femme, entre autres, attirait l’attention générale, et concentrait sur elle tous les yeux comme les rayons convergents d’un prisme ; c’était madame Évon. Debout dans l’embrasure d’une croisée, elle semblait assister à la fête comme à un spectacle indifférent ; son beau front accusait cette préoccupation rêveuse d’une âme qui, se trouvant isolée au milieu de la foule, et perdue dans un désert tumultueux, cherche vainement un appui où se prendre. À quelques pas d’elle, Henri, seul et pensif, la contemplait en silence, comme un enfant distrait qui s’occupe à suivre dans l’espace le tableau mouvant du kaléidoscope céleste, et qui croit entendre au loin les sons affaiblis d’une musique inconnue. La toilette de madame Évon n’était remarquable que par sa simplicité ; elle portait la robe noire de la veillée, et n’eussent été le bas blanc et le petit soulier qui dessinait la forme effilée du pied et la chute arrondie de la jambe, on aurait pu croire qu’elle était venue au château sans aucune arrière-pensée de coquetterie[186], et en femme qui craint d’afficher un luxe déplacé au milieu d’une assemblée indigne d’elle.
Lorsque Guillaume Évon entra dans la salle à manger, la fanfare du premier étage entonna avec un redoublement de vigueur cet air fameux qui nous rappelle tant de souvenirs différents : Où peut-on être mieux qu’au sein de sa famille[187] ; une orgueilleuse satisfaction rayonna sur la figure du dignitaire villageois, qui, pour la première fois, adressa la parole à Arthur sans trop de morgue et de froideur.
— Oh ! vraiment, dit-il, vous me faites trop d’honneur !
— Vous voyez bien, dit celui-ci en faisant allusion, sans doute, au sobriquet d’homme de la Bande noire qu’on ajoutait à son nom ; vous voyez que nous ne sommes pas si diables qu’on nous fait noirs[188] ! Nous savons respecter ce qui est respectable !
En disant ces mots, Arthur tourna la tête dans la direction où il avait aperçu madame Évon, et la salua discrètement du regard.
Que si nous avions à cœur de déployer les richesses descriptives de notre style[189], l’occasion ne nous manquerait pas en ce moment ; nous pourrions, entassant les épithètes sur les épithètes et les images sur les images, vous faire asseoir avec nous [190] à toutes ces tables d’un aspect si étrange, et vous promener à travers ce rout d’une nouvelle espèce, où le bruit des verres se mêlait au bruit de deux cents voix glapissantes. Les malins propos, les commentaires bavards, les gaudrioles salées, nous vous raconterions tout cela ! Et les clignements d’yeux des jeunes filles, et l’audace croissante des garçons, et le choc des intérêts, des amours-propres, des passions en contact, et cet inévitable crescendo [191] d’un dîner qui, calme et reposé d’abord, se fait bientôt incandescent et tumultueux, et s’absorbe triomphalement en un tutti[192] universel, que la rougeur des figures et l’animation des gestes semblent accompagner, pareils aux cadences d’une pantomime expressive se mariant aux modulations d’un vigoureux orchestre. Certes, un pareil tableau ne serait dénué ni d’intérêt, ni de nouveauté ; les plaisirs du peuple ont ceci de remarquable, que leur naïveté les sauve du ridicule [193] ; il n’y a que les petits esprits pour rire des instincts naturels et sincères.
Madame Évon était placée au bout d’une table, et la noblesse de ses traits contrastait avec les physionomies grossières qui l’encadraient ; selon sa coutume, elle parlait peu et se repliait en elle-même, comme si elle eût craint de trahir par des signes extérieurs le fond de sa pensée ; quelquefois seulement, son regard inquiet plongeait dans la foule rieuse, mais aussitôt qu’un regard étranger avait rencontré le sien, elle baissait la tête pour échapper à cette investigation jalouse dont elle se sentait l’objet. Vers la fin du dîner, au moment où tous les convives échauffés et subissant la fascination de la table s’absorbaient entièrement en une personnalité bavarde, elle aperçut une main qui glissait rapidement auprès d’elle un papier roulé, et assez semblable à la feuille d’une rose desséchée au soleil ; elle tourna vivement la tête et n’aperçut autour d’elle que des visages tout entiers à leurs plaisirs. Une vive rougeur avait coloré ses joues, et un tressaillement électrique avait fait vibrer les cordes [194] les plus cachées de son âme. D’abord, comme un oiseau effarouché qui craint les embûches des panneauteurs[195], sa tête oscilla dans tous les sens et son corps se rejeta en arrière, ainsi qu’à la vue de quelque dangereuse amorce ; longtemps par un mouvement alternatif de curiosité et de faiblesse, sa main avança et recula tour à tour sur la nappe damassée, on eût dit que ses doigts interrogeaient les touches douteuses d’un clavier, et qu’elle essayait d’en deviner d’avance la secrète harmonie. À la fin, pourtant, elle se décida, et posant sa main sur le papier mystérieux [196], elle l’attira rapidement et demeura quelques instants immobile, de même qu’un écolier qui, tout palpitant de l’émotion d’un larcin furtif, tremble et ferme les yeux pour ne pas voir le danger qui le menace.
Depuis ce moment, la préoccupation de madame Évon devint plus intense, et à sa distraction ordinaire se mêla une vive agitation fiévreuse. À la fin du dîner, et après avoir regardé une dernière fois autour d’elle, elle s’échappa et traversa silencieusement la foule.
Le parc était illuminé, et à travers les branches rabougries des arbres, des guirlandes de feux projetaient leur clarté scintillante ; quand elle fut assez éloignée du château, elle déroula en tremblant le billet déjà froissé par les crispations de ses doigts, et elle y déchiffra ces quelques mots tracés au crayon :
« Vous êtes au bord d’un abîme, prenez garde d’y tomber. [197] »
VIII.
La fête continuait : le bal[198] était dans tout son éclat, non pas cet éclat réservé et discret qui distingue nos bals aristocratiques, mais un éclat tranché, bruyant, sans mesure et sans contrainte. Dans tous les appartements du rez-de-chaussée, les quadrilles s’étaient formés, et la danse emportait dans son tourbillon toutes les têtes et tous les cœurs. C’est véritablement dans les réunions villageoises que le magnétisme de la danse semble se révéler ; c’est là que la danse dévoile son pouvoir occulte[199] et sa toute-puissante souveraineté. Qui n’a vu un bal campagnard, ne sait pas jusqu’à quel point, au signal de l’orchestre, les pieds peuvent s’agiter, les mains se presser, les poitrines bondir ! On n’imaginera jamais, à moins d’avoir assisté à un pareil spectacle, jusqu’où on peut pousser la rage de la danse, et combien les sens trouvent de stimulants et d’attraits dans ce mouvement cadencé, dans ces passes continuelles, dans ces tours de main qui font tourbillonner les danseuses à perdre haleine. Dans le monde, un bal n’a de séduction qu’une séduction secrète, et c’est le mystère seul qui lui donne du prix. Un bal est une sorte de duel entre la jalousie d’une part, et la coquetterie de l’autre ; c’est un terrain neutre où les parties belligérantes se couvrent d’un voile, et combattent avec un masque sur la figure ; dans un salon, chaque regard a sa signification, chaque mot sa portée ; un serrement de main discret est le plus grand événement qui s’y produise ; un consentement tacite, donné des yeux et sans parler, est la dernière faveur qu’une femme puisse accorder à celui qu’elle préfère ; et dans ce feu croisé d’intrigues muettes et de coups portés dans l’ombre, il serait impossible à l’observateur le plus intelligent de compter les blessures et de marquer les vaincus.
À la campagne, au contraire, un bal est une mêlée générale, où les intérêts particuliers et les passions de chacun s’effacent en s’absorbant dans l’entraînement et le tumulte général. Là, l’instinct du plaisir éclate sans retenue et quelquefois sans objet ; là, pourvu qu’on presse des mains, pourvu qu’on bondisse en liberté dans cette atmosphère échauffée, pourvu qu’on éparpille ses regards sur un horizon de têtes animées, peu importe qu’on rencontre une autre main que la main préférée, un autre regard que le regard bien-aimé ; au bal toutes les femmes sont belles, tous les hommes sont des hommes, et comme, dans l’ivresse, les sens échauffés n’ont plus le libre arbitre de la conscience et le sentiment de la volonté, on dirait, à voir tous les danseurs se confondre, et se mêler sans distinction et sans préférence, que chacun d’eux a abdiqué sa personnalité pour ajouter sa joie au total de la joie commune ; le plaisir seul est le roi de l’assemblée, et chacun n’est qu’un anneau détaché[200] de l’immense chaîne qui se déroule en cadence.
Peut-être Arthur Raimbaut avait-il voulu, en donnant sa fête, se ménager le plaisir d’un pareil spectacle. Pour les hommes qui ont vécu vite et savent à quel prix il faut estimer les biens de ce monde, c’est une distraction intéressante de se mêler aux fêtes naïves[201] du peuple, comme pour certains vieillards de regarder dans un coin des enfants jouer au soleil. Dans le renfoncement d’une croisée, debout et seul, il contemplait, les bras croisés, la foule qui tourbillonnait autour de lui, sans regrets de la veille, sans soucis du lendemain. Sa figure était froide et calme comme d’ordinaire ; seulement de temps en temps un sourire franc et sincère s’épanouissait sur ses lèvres, car la gaieté naïve a ce privilège de réagir sur ceux-là même qui sont le moins disposés à la partager. Dans l’intervalle d’une contredanse à l’autre, il aperçut Henri qui parcourait silencieusement les salons et traînait en tous sens sa préoccupation rêveuse ; la blonde figure du jeune homme se détachait pure et douce sur un fond de lumière, au milieu de toutes ces figures ardentes et crispées qui jetaient toute leur âme au plaisir, comme par un beau jour d’été un essaim de frelons étourdis et bruyants.
Arthur l’appela du geste. Le jeune homme s’avança à pas lents, et, sous le regard d’Arthur, il baissa le regard. Il y avait dans ses yeux, habituellement insouciants et vagabonds, une sorte d’hésitation involontaire et de crainte combattue qui donnait à ses traits une expression pénible et douloureusement inquiète ; on l’eût cru tiraillé en sens contraire par deux pensées contradictoires également puissantes, la lutte du cœur se reproduisait à l’extérieur comme un rayon brisé dans le miroir mouvant des eaux.
— Vous ne dansez pas, Henri ? dit Arthur ; et cependant, mon ami, la danse, c’est de votre âge. Heureux ceux qui se laissent aller au courant des plaisirs, et acceptent le présent sans interroger l’avenir ! Heureux[202] ceux qui ne descendent pas trop souvent dans leur âme, et respectent les instincts que la nature y a jetés ! La science est un mal qui dessèche et flétrit ! Vous êtes jeune, vous, Henri !
Le jeune homme ne répondit pas. Ainsi qu’un poëte qui se replie en lui-même, et, tout entier aux secrets avertissements de son cœur, ferme l’oreille aux bruits du dehors, il secouait vaguement la tête et marquait machinalement la mesure de la contredanse. Les paroles d’Arthur glissaient à la surface de sa pensée sans même l’effleurer ; il se parlait à lui-même et se répondait intérieurement.
— Voyez-vous ces braves gens ? dit Arthur en étendant la main, comme pour embrasser toute l’assemblée dans son geste, ils sont heureux, Henri !
— Véritablement heureux, dit le jeune homme avec une expression d’indicible mélancolie.
— Pourquoi ne l’êtes-vous pas comme eux ? demanda Arthur.
Une ombre passa subitement sur le front du jeune homme, et il mit la main sur sa poitrine comme pour retenir un secret qui menaçait de lui échapper.
— Pourquoi ! pourquoi ! répondit-il lentement, qui le sait, hormis Dieu ?
— Enfant ! dit Arthur, oh ! je donnerais tous les jours que j’ai encore à vivre pour revenir un seul instant à votre âge ! pour me sentir encore une fois dans le cœur ces fraîches illusions de la jeunesse, qui s’effeuillent si vite et ne refleurissent plus ! pour avoir au front votre couronne d’enfant que vous foulez aux pieds maintenant, et que vous pleurerez un jour ! Oh ! vous êtes jeune, vous ! Vous n’avez pas encore déchiré vos pieds aux ronces de la vie ; soyez heureux, vous devez l’être, vous qui ne riez pas au mot d’amour !
Arthur Raimbaut avait prononcé ces paroles d’une voix grave, ainsi qu’un prêtre qui, après de longues années de privation sévère et de méditation profonde, jette encore un regard attendri sur les jours écoulés de sa jeunesse et remonte, par la pensée, les sentiers fleuris qui n’ont pas gardé la trace de ses pas[203].
Henri, à son tour, le contempla avec un vague étonnement, et semblable an voyageur penché sur le bord d’un abîme dont il n’entrevoit qu’à peine la profondeur.
— Avez-vous donc jamais aimé, demanda-t-il, vous, Arthur ?
À cette question, malgré l’empire absolu qu’il avait sur lui-même, Arthur tressaillit, de même que si un mystérieux écho eût murmuré les harmonies intimes de son âme. Mais ce trouble ne dura qu’un moment ; un sourire dédaigneux plissa encore une fois ses lèvres, et effleurant légèrement avec la paume de sa main la joue de son interlocuteur :
— Henri, dit-il, vous êtes réellement un enfant.
La figure du jeune homme, qui s’était épanouie un instant, s’attrista de nouveau et se ternit comme une glace sous le souffle d’un vent froid ; ses lèvres, à moitié entr’ouvertes, se refermèrent ; et semblable à la sensitive qui se replie sur elle-même au plus léger contact, son âme se resserra de nouveau et contint ses épanchements prêts à déborder. Il y a, dans certaines paroles, une puissance négative qui pèse douloureusement sur la volonté des natures tendres et jeunes ; et avec Arthur Raimbaut, Henri se trouvait souvent dans cet état de doute où l’on se tait malgré soi quand on aurait besoin de parler, où l’on refoule silencieusement les aveux qui ne demandaient qu’à sortir.
— Vous avez raison, dit Henri, je suis réellement un enfant ; et pourquoi me rappelez-vous sans cesse que je suis jeune et que vous êtes vieux ? Pourquoi souriez-vous toujours, quand moi je suis tout prêt à pleurer ?
— Henri, dit Arthur, vous me faites des questions auxquelles je ne puis pas, je ne veux pas répondre. Peut-être un jour vous sera-t-il donné de connaître le secret de ma vie[204], et alors au lieu de m’accuser, vous me plaindrez. Vous comprendrez alors qu’il est des sourires plus tristes que des larmes ! Quant à vous, mon enfant, mon frère, ayez foi en votre jeunesse, et prenez votre part du bonheur accordé à tous ; car Dieu ne vous a pas déshérité, et un fils ne doit pas rejeter l’héritage de son père !
Henri sembla encore une fois oublier son mécontentement personnel et suspendre son attention tout entière aux graves paroles qu’il venait d’entendre. Mais Arthur ne lui donna pas le temps de provoquer ses confidences par une question nouvelle, et reprenant un ton leste et presque étourdi :
— Çà, Henri, dit-il, secouez donc un peu votre nature poétique ! Ne vous apercevez-vous pas que c’est folie de vivre continuellement dans les images, et qu’il faut à l’homme un terrain plus solide où poser le pied ? Voyons, allez-moi inviter un peu[205] une de ces grosses paysannes que je vois là-bas rouges comme des cerises et brûlantes comme des tisons ! Voilà de bonnes créatures ! Mais ne leur demandez pas, comme à moi, si elles ont jamais aimé, car elles vous prendraient pour un fou, Henri, et peut-être auraient-elles raison.
Henri garda le silence. Comme il aperçut le fermier Guillaume Évon qui se dirigeait vers Arthur en appelant déjà son attention du regard, il s’éloigna et disparut dans la foule.
— Ah ! vous voilà, mon cher M. Raimbaut, dit-il en prenant familièrement le bras d’Arthur ; il y a une heure au moins que je vous cherche à travers cette cohue ; votre fête est bien belle, savez-vous ! Et quoique par ma position je me sois trouvé à même de voir bien des cérémonies[206], je vous avoue que je n’en ai jamais vu de plus magnifique que celle-là. Allons, je suis content ; c’est bien faire les choses.
— Avez-vous pris un verre de punch ? demanda Arthur.
— J’en ai pris trois, dit le fermier. Tenez, M. Raimbaut, je suis un homme franc, moi, et je veux vous dire toute ma façon de penser. Je vous ai vu arriver ici d’un mauvais œil, c’est vrai ; que voulez-vous ! On a ses habitudes ; on tient à ses propriétaires ; et puis on m’avait parlé de vous comme d’un intrigant, d’un démolisseur de châteaux, d’un révolutionnaire qui voulait ruiner tout le monde, les grands et les petits.
— Je ruine, dit Arthur, ceux qui veulent bien se laisser ruiner, et j’enrichis ceux qui veulent s’enrichir.
— Je le vois maintenant, dit Guillaume, et je crois que nous finirions par nous entendre.
— Entendons-nous, dit Arthur qui avait repris le ton bref et serré qui caractérisait ses conversations d’affaires. Voyons, M. Évon, je vous vends la ferme que vous occupez ; ça vous va-t-il ?
À cette proposition inattendue, le fermier bondit sur ses jarrets et passa la main sur son front comme pour en écarter les nuages.
— La ferme tout entière ? demanda-t-il ; mais savez-vous qu’elle contient trois cents arpents ?
— Eh bien ? dit Arthur.
— Eh bien ! répéta le fermier, il faut payer ce qu’on achète.
— Ne vous occupez donc pas du payement ; à vous, monsieur Évon, je vous vendrais mille arpents, et sans exiger d’autres garanties que votre parole.
Un sourire d’orgueilleuse satisfaction couvrit, toute la face du fermier, et courut de fibre en fibre, depuis la naissance du front jusqu’aux méplats des narines et des lèvres.
— À dire la vérité, répondit-il, ma parole vaut du papier dans le pays, et je ne serais peut-être pas embarrassé de trouver une somme ronde sur ma signature.
— Est-ce une affaire terminée ? demanda Arthur en l’interrompant.
— Diable ! M. Raimbaut, dit le fermier, on m’avait bien dit que vous vous entendiez à bloquer les affaires ! Mais il ne faudrait pourtant pas, comme dit cet autre, aller plus vite que les violons [207].
— Les violons iront aussi vite que nous, voilà tout. Est-ce conclu ?
Le fermier était à moitié vaincu ; le clignotement de ses yeux trahissait cette indécision qui précède la défaite.
— Est-ce conclu ? répéta Arthur.
— Il y a une difficulté, dit le fermier avec embarras, que j’étais loin de prévoir ; j’avais déjà envisagé l’affaire dont vous me parlez, et j’en ai tout à l’heure, en passant, touché deux mots à ma femme. Croiriez-vous une chose ? Elle refuse obstinément de traiter avec vous. Il y a mieux, tout à l’heure elle voulait sortir du bal, quitter la fête, et si je ne m’étais pas montré, elle vous faisait impolitesse [208].
Arthur avait accordé aux paroles du fermier plus d’attention qu’on n’eût été en droit d’en attendre de lui. Pour un homme habitué à voir plier toutes les volontés sous la sienne, c’était un mystère bizarre[209] que cet obstacle qui surgissait tout à coup devant lui et lui barrait le chemin. Peut-être aussi, en dehors de ses calculs, le nom de madame Évon avait-il éveillé d’intimes souvenirs et une succession de pensées contraires ! Peut-être se rappelait-il la scène de la veillée, et se demandait-il compte de la soudaine révolution de sentiment qui le frappait en ce moment !
— Tenez, regardez-la donc, dit Guillaume Évon en détournant le regard d’Arthur dans la direction de sa main étendue ; croiriez-vous, M. Raimbaut, qu’elle est ma femme depuis deux ans, et je ne la connais pas encore[210] ?
À vrai dire, la résistance que la fermière avait opposée au projet de son mari avait causé à celui-ci un secret plaisir, en ceci qu’elle avait fait tomber tout d’un coup ses soupçons antérieurs et détruit l’échafaudage que sa jalousie s’était plu à bâtir. Comme il arrive d’ordinaire aux hommes de cette sorte de passer d’un excès à l’autre, rassuré sur le passé, il était tout prêt, par une confiance aveugle, à compromettre l’avenir.
— M. Raimbaut, ajouta-t-il, allez donc lui parler[211], peut-être la déciderez-vous à faire ce que nous voulons.
Madame Évon était assise ; et sa figure immobile et pâle ressemblait à quelque buste de marbre sans animation et sans vie ; son regard fixe errait au hasard, comme si elle eût assisté machinalement à un spectacle incompris et cherché vainement le sens d’une obscure vision. Quelquefois seulement, les veines de son col tressaillaient électriquement ainsi que les cordes d’une harpe au souffle de la brise. Arthur arriva en face d’elle sans en être aperçu, et la regarda quelque temps en silence.
— Madame, dit-il en s’inclinant, voulez-vous danser avec moi ?
La fermière, en entendant cette voix, fit un mouvement en arrière et ne répondit pas. Debout devant elle, Arthur la sollicitait du regard, et semblait par un hochement de tête expressif lui adresser cette question : « Pourquoi souffrez-vous ? »
En ce moment l’orchestre donna le signal de la contredanse, et Arthur prit résolument la main de la fermière qui tremblait dans la sienne.
Le bal était plus bruyant que jamais. De tous côtés des voix criardes s’entre-choquaient dans la salle encombrée ; tous les yeux étaient brillants, toutes les mains hardies, toutes les tailles complaisantes et abandonnées ; on ne dansait plus, on se ruait sur le parquet avec cette énergie désordonnée, fébrile, qui ressemble plutôt au délire de la joie qu’à un délassement naïf et raisonnable. Ce fut un contraste frappant de voir, au milieu de cette orgie dansante[212], se dessiner les deux graves figures d’Arthur Raimbaut et de Marguerite Évon ; tous deux étaient silencieux et roides, comme si chacun eût craint de trahir un secret et d’appeler sur lui une lumière redoutée.
Tous les regards se portèrent simultanément sur le nouveau couple [213], et l’embarras de la fermière s’en augmentait d’autant ; il ne lui arriva pas une seule fois de tourner les yeux vers son danseur, et à la roideur de ses mouvements à la rigueur de son attitude et de son visage, on eût pu la prendre pour une victime, ramassant ses forces avant d’aller à l’autel pour faire bon visage et tomber noblement.
Arthur Raimbaut se tourna un instant vers elle, et lui adressant la parole, sans hésitation, mais non sans effort :
— Vous étiez plus gaie à la veillée qu’ici, dit-il en souriant, avez-vous donc quelques motifs de chagrins ou d’ennuis ?
— Je suis mal portante, répondit doucement le fermière.
Arthur la regarda attentivement comme pour démêler, à travers l’hypocrisie de ses paroles, l’intime et profonde douleur qu’elle essayait de dissimuler ; mais la figure de la jeune femme demeura si froide et si impassible sous son regard, que sa pénétration ordinaire se brisa contre cette inertie désespérante.
Quand la contredanse fut finie, Arthur prit de nouveau la main de la fermière.
— Il fait trop chaud ici, dit-il à voix basse ; sortons.
— Je reste, dit la fermière en tremblant et sans avoir la force de dégager sa main, comme si sa volonté eût été fascinée par une volonté supérieure contre laquelle elle essayait vainement de se débattre. Arthur l’entraîna ainsi à sa suite jusqu’au bas du péristyle, et là il s’arrêta droit devant elle pour la regarder.
Le ciel était clair et brillant comme le cristal d’un miroir ; la lune, en se glissant à travers les cimes découronnées des ormes, brisait ses rayons au front du château et en auréolait le faîte ; les étoiles scintillaient dans l’espace ainsi que des lames d’or sur un manteau de roi, et leurs reflets doraient au loin les petits nuages blancs qui couraient sur le fond bleu du ciel, comme des flocons d’écume sur la plaine azurée des flots. Tout était calme et silence dans cette nuit d’hiver ; tout était harmonie et lumière ; l’air, qui soufflait au visage, rajeunissait le sang et semblait raffermir la vie : nuit de pensées douces et tristes ! nuit de mélancoliques amours ! [214]
L’hiver a, pour le vulgaire, moins de charme que l’été ; ses beautés sont moins banales et plaisent moins de prime abord ; la verdure, le chant des oiseaux, les prés et les jardins émaillés de fleurs, les arbres chargés de fruits, voilà les harmonies que tout le monde comprend et admire. Mais l’hiver avec son cortège de feuilles jaunies, de fleurs desséchées, d’arbres rabougris, l’hiver avec son aspect de deuil et de tristesse empreint quelquefois d’un si mystérieux éclat, l’hiver avec sa couronne de neige et la splendide magnificence de ses nuits diaphanes, c’est un ami superbe et dédaigneux, qui n’accorde ses largesses et ne livre ses secrets qu’à certaines âmes privilégiées, découronnées comme lui de leur verdure, dépouillées et majestueuses comme lui.[215]
Arthur Raimbaut et madame Évon marchaient côte à côte dans une allée sablée au-dessus de laquelle une double rangée de tilleuls arrondissait son couvert de branches desséchées ; les bruits de la fête n’arrivaient plus à leurs oreilles que comme un murmure confus tamisé par l’espace, comme une de ces harmonies lointaines que les nuits d’hiver semblent augmenter encore par leur mystérieuse poésie.
— Et maintenant, dit Arthur d’une voix grave, me direz-vous le secret de vos souffrances ? me direz-vous pourquoi votre regard évite mon regard ? pourquoi votre main fuit la mienne, quand la mienne cherche la vôtre[216] ?
Éclairée d’un jour douteux, la figure d’Arthur se revêtait d’éclat et de majesté, ses yeux, ternes et gris d’ordinaire, lançaient par intervalle un de ces rayons éclatants et furtifs que le poëte anglais a prêtés à l’ange déchu [217] ; son front accusait une de ces luttes intérieures, où les sentiments les plus opposés se heurtent et se succèdent, où l’on croirait entendre à la fois les cris de triomphe du vainqueur et les cris de détresse du vaincu.
— Je n’ai rien à vous dire, répondit lentement madame Évon ; pourquoi, seulement, suis-je ici avec vous ? laissez-moi fuir et ne me revoyez jamais !
En prononçant ces mots, la fermière n’avait même pas essayé de faire un pas en arrière. Dominée par une puissance maudite, elle n’avait pas la force de mettre ses actions d’accord avec ses paroles, et elle sentait, avec effroi, son cœur défaillir.
Arthur lui prit la main et la pressa.
— Grâce ! murmura la jeune femme, d’une voix brisée.
Et on entendit, dans le silence de la nuit, le battement précipité de son cœur.
— Oh ! pourquoi voulez-vous me tromper ? reprit-elle avec une indicible émotion ; pourquoi vous obstinez-vous à creuser un abîme sous mes pas ? vous me devez pourtant la vie, à moi [218] !
Il y avait eu dans ces dernières paroles un tel accent de tendresse et de désespoir, qu’Arthur tressaillit et retira sa main, qui, jusque-là, pressait la main de la fermière.
Celle-ci le regarda pour la première fois.
— S’il est vrai, dit-elle, que vous me gardiez quelque reconnaissance, promettez-moi de ne plus me parler ! seulement, en échange de la vie que je vous ai conservée, oh ! laissez-moi un souvenir de vous, un gage[219] dernier qui ne me quittera jamais.
Madame Évon avait essayé de prononcer ces paroles avec une voix forte et dégagée ; mais sa faiblesse la trahit encore une fois, et sous la pâle clarté de la lune, une larme apparut brillante sur sa joue.
— Je ne veux de vous, dit-elle, qu’un modeste souvenir, cet anneau que vous avez au doigt, donnez-le-moi !
Ce fut Arthur qui tressaillit à son tour, et ses regards se levèrent vers le ciel comme pour le prendre à témoin de ses souvenirs et de ses regrets.
— Cet anneau, dit-il d’une voix étouffée ; oh ! jamais ![220]
Il se fit un silence ; et en ce moment l’ombre d’un homme traversa l’allée.
— Quelqu’un nous voit, dit madame Évon avec effroi.
Et tous les deux rentrèrent à pas lents au château.
IX.
Une des fatalités les plus déplorables de la vie est cette séparation que la société ou le sort impose aux âmes qui ont besoin l’une de l’autre pour se compléter [221]. Qui n’a eu à gémir sur ces rigueurs du destin qui nous éloigne à jamais de ceux qui auraient sympathisé avec nous, pour nous rapprocher misérablement de ceux qui nous seront toujours étrangers par les sentiments aussi bien que par les intérêts ? Que de rencontres étranges deviennent d’insupportables amitiés ! Que de hasards fortuits unissent inséparablement des êtres dont les caractères sont antipathiques, et les goûts contraires ! Il semblerait qu’une divinité, amante des contradictions, se plaise à brouiller tous les fils de nos existences, à frapper de mort nos espérances à mesure qu’elles éclosent, à jeter, aux mains du plus grossier malotru, la fleur la plus suave, la plus délicate et la plus parfumée ?
Les femmes ne sont pas les seules qui aient à souffrir de ces caprices de la destinée, les hommes aussi ont mille occasions de s’en plaindre, et surtout, parmi les hommes, ceux dont l’âme est candide et le cœur nourri d’illusions.
Henri était un de ces derniers[222]. Dès l’âge de quinze ans, il avait rêvé un bonheur idéal, un accomplissement magnifique des espérances de son cœur ; et à mesure qu’un des fleurons de sa couronne poétique se détachait au frôlement de la vie réelle, il pleurait ce dépouillement de ses richesses intimes comme un avare pleure la perte d’une partie de son trésor[223]. Ainsi s’explique la douleur qu’il éprouvait à voir Marguerite toute prête à se mettre à la merci d’Arthur Raimbaut, Marguerite qu’il aurait voulu entourer de sa protection généreuse avançant vers l’abîme sans qu’il pût la retenir ! Eh quoi ! elle n’avait donc point compris l’avertissement qu’il lui avait donné [224] ! elle méprisait donc ses conseils, elle ne voulait point de son dévouement ! Qu’allait-il faire ? Devait-il s’abandonner à son désespoir sans chercher de nouveau à sauver Marguerite ? Fallait-il au contraire marcher jusqu’au bout dans sa voie d’abnégation personnelle, et sacrifier sans cesse son bonheur au bonheur de celle qu’il aimait d’un amour si pur et si passionné à la fois ? Ces doutes furent cependant levés dans son âme, et après de longues souffrances solitaires, il écrivit à Marguerite la lettre suivante :
Madame[225],
J’ignore quelle faute je commets en vous écrivant, je ne sais si j’aurai tort à vos yeux, ou si j’ai tort aux miens, mais ce que j’affirme, c’est que je ne puis me taire davantage, c’est que, si je ne vous apprends pas toutes les pensées qui troublent ma raison et me torturent le cœur, j’en souffrirai à en mourir. Et aussi, si vous ne trouvez dans votre âme aucune pitié pour un malheureux ; oh ! alors, dans l’un et l’autre cas, je suis coupable, et votre dédain n’est plus qu’une justice.
Toutefois, madame, la lettre que je vous adresse n’est pas aussi insolite qu’elle peut vous le paraître. Je vous connais depuis quelques années, vous étiez bien jeune que j’avais déjà placé en vous tout mon bonheur et toutes mes espérances. C’était un bien que je m’étais créé, un bien que je disputais aux jeunes gens de mon âge ; c’était un plaisir à moi seul connu, un mystère dont je ne devais compte qu’à moi. Vous n’avez pas oublié sans doute la ville de Lisieux[226] et la pension de la rue des Prés, trop peu de jours vous en séparent ; et puis, toute jeune femme ne se souvient-elle pas avec bonheur de la retraite où se sont écoulées ses premières années, où s’est gardée religieusement la virginité de ses innocentes pensées, où tous ses sentiments se bornaient à l’amitié et à la reconnaissance.
Vous étiez jeune et folâtre alors, le jeu était pour vous le jeu [227], et quand je vous voyais si ardente à ces naïfs plaisirs dont vous ignoriez tout le danger, moi, je souffrais déjà ; car je savais comprendre tout le prix que j’attachais à tenir votre main dans la mienne, car je sentais un frisson parcourir tous mes membres, lorsque le sort vous condamnait à embrasser un autre que moi. Que de fois, joyeux ou triste, confiant ou jaloux, heureux ou misérable, j’ai voulu vous éclairer sur les mille dangers qui vous entouraient ; combien de fois, j’ai voulu me plaindre à vous de vous-même, et vous reprocher votre légèreté, mais je ne sais quelle honte de ternir tant d’innocence m’arrêtait. Je me suis tu, et je vous ai laissé votre ignorance ; je me suis tu, sans en avoir le mérite auprès de vous, sans que vous ayez deviné tous les combats qui se livraient pour vous dans mon cœur. Ai-je jamais su seulement si vous m’aviez remarqué ; et si, dans cette foule si empressée de plaire à la charmante jeune fille, du plus obscur vous aviez conservé le moindre souvenir ?
Mais que dis-je ! dans quel espoir mon cœur s’égare-t-il ! qu’ai-je besoin de vous rappeler le passé ! Malheureux que je suis, le passé n’existe que pour moi : ne vous en a-t-on pas séparée à jamais ; ne vous a-t-on pas donnée à un homme à qui vous devez compte de tous vos souvenirs ? Vous le connaissiez à peine, vous l’aimiez encore moins ; mais votre famille s’est dit : « Marguerite sera riche, Marguerite sera considérée » ; et elle a conclu. Que lui importait le fond de cette grave question ? Ne doit-on pas être heureux lorsqu’on a de la fortune ? Qu’est-ce que les sympathies, qu’est-ce que les jouissances d’une organisation délicate ? Un homme qui fait honneur à ses engagements, qui entretient la prospérité de sa maison, qui en édifie les bases sur l’ordre et l’économie, cet homme n’est-il point prédestiné à assurer le bonheur d’une femme ?
Si elle a une éducation supérieure à la sienne, si elle est douée d’une imagination vive mais mobile, d’un cœur tendre mais facile, d’un bon mais faible caractère, il ne la comprendra point ; qu’importe ! il faudrait veiller sur cette jeune plante, il faudrait entretenir les bonnes dispositions de cette âme candide, et empêcher que le mal ne prit sa source dans le bien ; il faudrait qu’une organisation forte dominât cette belle quoique molle organisation, et rien de tout cela… Son mari va à ses affaires, et ne la voit qu’à ses heures perdues ; il l’aime assez peut-être pour se trouver heureux auprès d’elle, elle est si jeune et si jolie, mais son amour grossier ne saisit rien au-delà ; où vont ses pensées en son absence, d’où viennent-elles ? ce sont des questions que jamais il ne s’adressera. Et si, d’aventure, il lui vient quelques doutes sur le bonheur dont jouit sa femme,… la confiance dans sa position, l’abondance qui règne dans son intérieur, l’estime dont on l’entoure, toutes ces considérations ne sont-elles pas de nature à repousser ces doutes absurdes selon lui ? aussi, cet examen terminé, il sourit en se disant : « Ma femme doit être heureuse, donc elle l’est. »
Mais je m’arrête, effrayé du tableau que j’ai présenté à vos yeux ; je m’arrête, confus de mon audace ; je m’arrête tout tremblant sous la sévérité de votre regard ! Sais-je si je ne vous ai point mortellement offensée ? Je vous en supplie, madame, ne laissez pas mon front courbé sous le poids de votre colère ; c’est à vos genoux que j’implore le pardon d’un fou, c’est à vos yeux que je demande quelques lueurs de pitié pour un insensé qui s’accuse autant qu’il vous justifie.
Et puis, si je vous demande indulgence c’est que je sens en moi les moyens de me faire pardonner ! Ne croyez pas que ce soit l’assurance d’un homme présomptueux qui a calculé et établi d’avance toutes ses chances de succès ; c’est, au contraire, la confiance que donne un amour naïf, mais pur, qui a accepté d’avance tous les sacrifices ; c’est le désintéressement d’un cœur libre, qui n’a aucun souvenir à retrancher de sa vie, et qui ne demande point au présent de plaider pour lui contre le passé. Son avenir d’ailleurs est tout entier dans l’espérance, et c’est à vous, madame, qu’il la demande. Ah ! dites-lui que vous acceptez le dévouement de son amour, dites-lui que vous lui pardonnez ; et que la honte de son aveu trouvera un refuge dans la bonté de votre cœur.
Mais si vous étiez sans pitié, si vous n’accueilliez qu’avec indifférence et dédain l’expression de mon amour, si je vous avais déjà rendue coupable en vous faisant mépriser vos devoirs rigoureux mais sacrés ; malheureux ! j’aurais mérité votre malédiction, car j’aurais éveillé en vous des pensées criminelles, et je ne les partagerais pas pour vous éloigner du danger ; car j’aurais éclairé votre cœur, et ce serait stérilement pour moi ; car j’aurais troublé votre raison, et cet adorable délire me serait inconnu ! Ah ! madame, songez à toute la tristesse de cette position ! Et si ce n’est pour moi, songez-y pour vous. Il faut à votre âme naïve et belle de tendres et douces sympathies, il faut à votre existence manquée la consolation d’un cœur passionné et fort à la fois ; il ne faut pas plus que votre sensibilité exquise vienne se briser contre l’esprit stupide d’un paysan, que se heurter à l’égoïsme d’un homme qui ne vous parlerait que pour vous perdre, qui ne vous aimerait que pour vous entraîner dans l’abîme.
Et maintenant, madame, pour comprendre les dernières paroles que j’ai à vous dire, vous devez interroger votre conscience, vous devez rappeler tous vos souvenirs. Il y a trois mois, il vint dans votre village un homme qui vous parut aussi grand par le cœur que par l’esprit, et tel qu’il m’a toujours paru à moi-même. Cet homme, vous l’avez sauvé d’un danger imminent ; et comme il vous en montrait une reconnaissance pleine de tendresse, vous avez cru, dans votre candeur, que c’était lui qui serait l’appui que vous cherchiez, que c’était lui qui deviendrait votre consolation et votre sauve-garde. Oh ! madame, je ne sais comment avoir le courage de vous désabuser, je ne sais comment vous dire que votre espoir est une illusion décevante dont il faut vous garder comme d’un piège. Croyez-moi : cet homme a une âme noble en effet, mais sceptique et désenchantée, cet homme possède à un trop haut degré l’expérience des vanités de ce monde pour s’abandonner encore à des sentiments doux et purs ; et déjà, hélas ! je crains que vous ne vous soyez trop confiée sur lui du soin de votre bonheur. N’avez-vous pas vu sur ses traits combien son cœur était froid, et incapable à l’avenir de toute exaltation ? N’avez-vous pas aperçu sur son front la trace de doutes inguérissables ? N’avez-vous pas reconnu, dans les rides précoces dont sa figure est traversée, que désormais il ne pouvait rien croire, rien aimer [228] ? Oh ! je le connais, moi ! je sais tout ce que son âme a dû perdre d’illusions et d’espérances, pour en venir à cette indifférence profonde qui l’entoure comme de ténèbres épaisses ; je sais que pour toujours l’incrédulité est son partage.
Résistez donc, résistez, je vous en conjure, à l’entraînement que vous éprouvez pour lui : il y va de votre honneur, il y va de votre vie peut-être ! Si vous saviez ce qu’il m’en coûte de vous apprendre le danger qui vous menace, vous comprendriez que la prière que je vous fais, que le conseil que je vous donne vient du cœur le plus dévoué. La conduite que je m’impose serait infâme, si elle n’avait pour but votre bonheur auquel je dois sacrifier l’estime de moi-même. Mais je ne veux rien ajouter, madame, je crains déjà de vous avoir fatiguée de mes plaintes, de mes accusations et de mon amour ; j’attends votre réponse, je l’attends avec toute l’angoisse qui saisit un malheureux sous le doute d’une condamnation ou d’un triomphe, je l’attends avec impatience mais aussi avec résignation ; et quelle que soit votre décision, la culpabilité de ma conduite se trouvera rachetée dans votre esprit, je l’espère, par le dévouement désintéressé que je vous ai voué pour toujours.
Henri[229].
En écrivant cette lettre, Henri avait l’agitation de la fièvre, sa main volait comme ses pensées ; mais quand il eut tout dit, la fièvre disparut, et fit place à un abattement profond. Le jeune homme se renversa sur son siège, les bras pendants et les yeux fixés, avec une expression indéfinissable, sur les pages qu’il venait de remplir. Arthur était son ami, son protecteur au milieu d’un monde qu’il haïssait et qu’il méprisait déjà ; Arthur avait distingué Henri, lui avait voué une affection toute paternelle, et, en retour, Henri venait de s’élever contre lui en dénonciateur ; il avait abusé de sa confiance, il avait révélé ce qu’Arthur lui avait laissé voir du secret de son âme, il s’en était servi pour éloigner de lui une femme qu’Arthur aimait peut-être. La jalousie la plus basse eût-elle agi autrement ? et pourtant ce sentiment était loin de son âme généreuse ; son affection pour Arthur avait fléchi sous une affection plus forte, et dans un combat inégal Henri voulait tendre au faible une main secourable. Oui, si Marguerite avait pu trouver le bonheur dans cet amour, si l’âme d’Arthur eût été de nature à s’amollir sous cette douce influence, Henri eût souffert volontiers, et pas un mot de plainte, pas un mot d’accusation ne serait sorti de sa bouche.
Il eut donc besoin de rappeler tout son courage pour mener jusqu’au bout la tâche de dévouement qu’il avait entreprise ; cependant, résolu de remettre lui-même la lettre à Marguerite, il partit pour la ferme de Guillaume Évon, sachant qu’il n’y trouverait pas celui-ci, appelé à Corbeil par ses fonctions municipales. Il marchait précipitamment, faisant craquer sous ses pieds la couche de glace qui couvrait la terre ; le ciel était couvert d’un brouillard lourd et impénétrable ; de temps en temps quelques flocons de neige venaient frapper la figure de Henri ; et l’impression de froid, qui pour lui en était la suite, rendait du calme à son âme, tout en ébranlant sa résolution. Cependant une puissance à laquelle il ne pouvait résister, l’entraînait toujours vers Marguerite ; il fallait qu’il la vit, et, s’il ne se sentait pas la hardiesse de lui parler, qu’au moins il lui remit la lettre. Il allait donc fatalement vers la ferme, et si on avait aperçu ainsi, par une nuit sombre, fuyant à travers champs, dans la direction du village, on l’eût prit à coup sûr pour quelque malfaiteur poussé au crime par le vice ou par la faim. Mais personne ne le rencontra ; et le vent qui sifflait entre les branches des arbres, la rafale qui s’engouffrait dans les taillis, les oiseaux de nuit qui poussaient leurs cris sinistres dans la tempête, étaient les seuls bruits qui fissent diversion au tumulte de ses pensées.
Quoi qu’il en soit, ces avertissements que le ciel semblait lui donner dans sa colère, ces retards que la nature bouleversée imprimait à ses pas, rien ne put l’arrêter ; et plus les tourbillons se précipitaient contre lui avec rage, plus il activait sa démarche en s’affermissant sur le sol glacé de la prairie[230].
Quand il parvint au village, toutes les portes étaient closes, toutes les lumières éteintes, l’obscurité la plus profonde enveloppait chaque maison, et n’eût été le vent qui, resserré dans des espaces étroits, augmentait de sonorité et d’énergie, on eût pu penser que la mort plutôt que le repos régnait sur ces lieux[231].
Marguerite veillait encore ; Henri n’en fut point étonné, mais il tressaillit, et fut obligé de s’arrêter quelques instants dans la cour de la ferme, oppressé par les battements de son cœur.
— Si je l’ose, dit-il, en s’avançant vers la porte, je parlerai, je lui révélerai moi-même ce que cette lettre devait lui apprendre, et il me semble que ma conduite, pour être plus franche, en sera moins odieuse.
Mais quand la porte lui eut été ouverte, quand il fut arrivé auprès de Marguerite, cette résolution s’évanouit. À cette simple question : « Qui vous amène ? » prononcée d’une voix calme et tranquille, Henri sentit une rougeur cruelle lui monter au visage, comme si Marguerite avait pu deviner le motif qui le conduisait près d’elle à cette heure. Il n’avait point la force de parler, quelques mots inarticulés tombaient un à un de ses lèvres ; enfin la compression physique qu’il éprouvait fut telle que, malgré sa résolution, il ne put que donner la lettre à Marguerite en lui disant :
— Madame, rappelez-vous le billet qui vous fut remis hier ; c’était moi qui vous l’avais écrit, et je vous en apporte aujourd’hui l’explication.
En terminant ces mots, qu’il avait prononcés avec peine, tant son émotion était vive, tant sa honte était insurmontable, Henri, sans attendre la réponse de la fermière, se retira brusquement.
Marguerite, restée seule, lut deux fois la lettre de Henri, mais elle ne le plaignit point, elle ne comprit pas son amour, ses sacrifices, ses douleurs, surtout elle ne crut point au danger qui la menaçait ; c’en était fait : elle aimait Arthur [232] !
X.
Il y a, dans la vie de certaines femmes, un moment terrible qui décide assez ordinairement de leur avenir tout entier. Il arrive une heure fatale ou les plus fières oublient leur fierté, où les plus indifférentes oublient leur indifférence, où, la tête penchée sur l’abîme qui va les engloutir, elles éprouvent un secret plaisir à en sonder la profondeur, à écouter les bruits étranges qui grondent au-dessous de leurs pieds. Les femmes obéissent toutes, qui plus, qui moins, à cet instinct aventureux qui les pousse sans relâche vers des horizons inconnus ; et quand l’amour vient briller à leurs yeux comme l’éclair éblouissant d’une épée, le vertige les prend, leur raison s’égare, elles entendent pendant la nuit des voix secrètes qui murmurent à leurs oreilles des mots inouïs, leur cœur se remplit de pensées décevantes[233] et de désirs tumultueux. Un sang plus chaud circule dans leurs veines et fait battre leurs artères ; elles éprouvent vers les tempes ces élancements de la fièvre et ces bouillonnements intérieurs qui ressemblent aux ébullitions d’une eau sulfureuse ; de même que la nature dans ses moments de convulsion et d’orage, leur organisation se trouble et se détraque ; elles ressentent par tout le corps des tressaillements inconnus empreints d’une ardente volupté ; leur âme se remue au fond, et une inquiétude toujours renaissante les pousse en tous sens ; ainsi que les soldats téméraires qui devancent le signal du combat et se précipitent d’eux-mêmes au milieu d’une foule d’ennemis, elles appellent le danger avec des frémissements d’impatience, et leur cœur se soulève comme les flots de la mer sous le souffle des vents orageux. Quelquefois, au sortir de ces échauffements solitaires, elles tombent en de mélancoliques rêveries ; leurs yeux s’humectent de larmes, sans qu’elles puissent dire pourquoi ces larmes sont venues. Les fleurs qui les entourent, leurs parures les plus chéries, leurs bijoux préférés, tous ces objets qui, dans la vie d’une femme, forment une seconde vie, leur deviennent insuffisants et onéreux. La soie les écrase, les voiles leur pèsent, l’air manque à leurs poumons brûlants, et elles cherchent de tous côtés le dictame[234] souverain qui guérit les malaises du cœur sans le trouver jamais, et sans le désirer peut-être[235].
Alors toutes les préoccupations disparaissent devant une préoccupation exclusive ; sans cesse tourmentées du mal mystérieux qui les dévore, elles portent incessamment leur regard de la terre au ciel et du ciel à la terre, et errent à la dérive, comme un de ces mondes tourbillonnants qui cherchent un appui dans l’espace et tournent perpétuellement dans un cercle mille fois décrit. Une grande lassitude de cœur s’empare d’elles et les oppresse :; le soleil se couvre à leurs yeux d’un nuage, et la nature n’a plus pour elles que des reflets incertains et ternes. Elles ressentent un âpre bonheur à souffrir de la sorte, et ne demandent que le prolongement de leurs souffrances ; leur imagination se revêt de teintes brillantes qui ternissent l’éclat du ciel et des étoiles ; elles pleurent et elles sont heureuses ; maudit serait celui qui viendrait leur arracher le voile dangereux dont elles enveloppent leurs pensées ! À la sagesse qui les conseille, elles répondent souvent, comme le malade désespéré qui s’incline vers la tombe : « Oh ! laissez-moi mourir ! »
Que si un ami ingénu vient à leur dire : « Oh ! prenez garde ! Vous êtes sur la pente d’une montagne qu’on ne remonte jamais ! L’abîme est là sous vos pas, prêt à vous dévorer ! N’entendez-vous pas d’ici les ricanements du démon qui vous appelle, et secoue ses ailes en signe de triomphe ? Ne voyez-vous pas l’éclair qui brille dans la nue, et présage les affreux déchirements de la tempête ? Le ciel est sombre, les nuages s’amoncellent à l’horizon, la nature est pleine d’avertissements sinistres et de terreurs ; prenez garde ! prenez garde ! les fleurs de la vallée sont flétries, les branches des jeunes bouleaux crient et se brisent, les ombres s’épaississent au sommet de la montagne, les anges du mal, cachés dans les profondeurs des rochers, chantent la chute des âmes imprudentes et la dernière heure des illusions perdues ! » Vaines remontrances, conseils inutiles ! Celle que vous voudriez sauver du malheur ne vous écoute pas ! Son cœur se ferme à votre voix, et vos paroles se perdent dans le bruit lointain de la vallée ! Déjà sa main échappe à votre main qui la presse, le fil qui la retenait suspendue au bord de l’abîme va se briser ! Tout entière à ses pensées fascinatrices, elle écoute dans le lointain la voix mystérieuse de son cœur, qui lui crie : « Marche, marche ! » Et du sein d’une harmonie[236] confuse, un invisible écho lui répète incessamment : « Aime, aime ! »
Aimer ! oh ! comment expliquer la mystérieuse puissance de ce mot magique ! Comment analyser cette absorption complète de toutes les facultés ! Comment atteindre à ce sommet magnifique qui s’illumine dans la nuit des clartés célestes et resplendit sous son auréole de nuages ! Pouvoir occulte et fatal, qui subjugue les femmes et les entraîne, à travers les cailloux et les ronces, dans le pays enchanté des songes ! qu’est-ce donc, mon Dieu, que l’amour[237]?
Le bruit des pas s’était éteint dans la nuit. Sous l’impression de l’avertissement qu’elle venait de recevoir, Marguerite était encore frémissante et brisée ; semblable à un malade rêveur qui, au milieu de ses hallucinations fébriles, repousserait de toute son énergie le remède salutaire qui devrait le rendre à la santé, et fermerait les yeux pour rentrer dans ses songes, un seul mot, une seule pensée lui restait au fond de l’âme, comme un glaive opiniâtre qui s’attache au flanc et le déchire ; les paroles de Henri, les souvenirs d’enfance qu’il avait rappelés à sa mémoire oublieuse, et ces protestations de dévouement empreintes de tant d’élévation et de franchise, tout était effacé. La distraction humide de ses yeux, les tressaillements involontaires de sa main crispée, les attitudes demi-penchées de sa taille, l’éclat morbide de son front qui resplendissait sous le double encadrement de ses cheveux noirs, ses lèvres à demi murmurantes qui s’entrouvraient discrètement comme le calice des fleurs, tous ces symptômes étaient autant de voix qui redisaient ce refrain des anges dans le ciel et des femmes sur la terre : « J’aime. »
Elle était étendue sur le canapé bleu de son boudoir, et les formes de son beau corps, accusées par la courbe de sa pose, se détachaient avec un éclat vigoureux sur le fond obscur de la petite chambre. Dégagées de tout voile importun, les veinures de son cou saillaient en relief dans un mélange d’ombre et de lumière qui en faisait ressortir le dessin pittoresque et les gracieux embranchements. Un ruban de velours étroitement noué autour du cou, descendait jusqu’à la naissance de la gorge et en dessinait l’harmonieuse séparation. À demi relevée par les ondulations de son attitude, sa jupe noire traçait une ligne inégale, un peu au-dessus de la cheville, comme les franges d’une draperie au bas d’une statue antique. Toute sa personne était empreinte de cette impatience ardente, de cette volonté dégagée d’entraves, de cette surexcitation fiévreuse dont la Phèdre des Grecs nous a transmis le type inimitable[238]. Ainsi qu’un athlète robuste, elle appelait, sans pâlir et sans détourner la vue, l’heure du combat ; elle aimait à haute voix, et elle était prête.
Ce n’était plus la petite pensionnaire de Lisieux, promenant les caprices de sa mémoire puérile en des mondes imaginaires, et dressant, comme font les enfants, un autel de rubans et de fleurs à ses innocents désirs : toutes ses pensées d’autrefois, tous ses rêves de jeunesse se coloraient d’un éclat sauvage ; son amour n’était plus une de ces gracieuses images que les petites filles se plaisent à embellir et à parer comme une jeune sœur blonde et souriante : c’était une grande et éblouissante figure qui répandait à l’entour d’elle des myriades de lueurs et des jets d’une incomparable vigueur ; elle était vaincue, absorbée, presque haletante sous le choc d’une invasion terrible ; l’heure était venue, la fatalité d’aimer l’avait prise[239] !
C’est la loi de ce monde, qu’à un instant donné, les sentiments longtemps contenus et refoulés éclatent et fassent irruption au dehors ; le présent s’enrichit aux dépens du passé.
Un léger coup frappé à la porte d’entrée réveilla la fermière de son extase[240], et un frémissement involontaire passa subitement sur sa figure, ainsi que la brise sur le cristal d’un lac[241]. Était-ce Guillaume Évon qui venait l’arracher encore une fois à ses rêves chéris ? Avait-elle menti à Henri en le menaçant du retour de son mari[242] ? Était-elle donc déjà si avancée dans la carrière qu’elle pût, sans rougir, recourir à la perfidie et au mensonge ? Par un mouvement presque électrique, elle se leva droite et pâle et ouvrit doucement la porte de sa chambre ; Arthur Raimbaut mit le pied sur le seuil et poussa la porte derrière lui.
Sa figure conservait encore son caractère ordinaire de froideur et d’immobilité ; son regard avait cette expression de fixité qui le rendait si redoutable et si perçant ; sa mise était recherchée, mais plutôt riche que de bon goût[243] ; à son doigt brillait l’anneau mystérieux qu’il avait refusé aux prières de Marguerite, comme un symbole du bonheur évanoui, des illusions envolée. Sur son gilet de satin noir, la chaîne d’or de la veillée dessinait une raie lumineuse, et quand il entra dans la modeste chambre de la fermière, une gerbe éclatante s’en détacha et courut en scintillant du parquet au plafond[244].
Il ne fit ni un mouvement, ni un geste en regardant Marguerite. Sa face était pâle et comme étonnée ; et, de sa main droite, il tint longtemps encore le bouton de la porte, comme s’il eût craint de s’engager trop tôt et de s’imposer un irrévocable dénoûment[245]. Marguerite baissait les yeux ; elle était immobile comme lui, et n’eussent été les palpitations de son cœur, on aurait pu croire que la violence de ses sensations en avait paralysé les signes extérieurs.
À la fin, Arthur lui prit la main, et assourdissant l’accent de sa voix :
— Marguerite, il faut que je vous le dise : j’ai failli ne pas venir au rendez-vous que je vous avais demandé ; en traversant les solitudes de la plaine, je me suis senti le cœur pris d’une invincible inquiétude, j’éprouvais presque du remords. Tenez, Marguerite, mieux vaut pour vous et pour moi que je parte et que je ne vous revoie plus ! Ma destinée est mauvaise, et je crains de verser sur la vôtre le malheur qui s’y attache ! Vous êtes crédule, vous vous livrez sans défiance à un amour dont votre raison ne vous rend pas compte ! Votre imagination vous embellit la route, et vous vous y jetez naïvement ! Vous ne savez pas quels malheurs vous attendent au bout de la carrière, et tout entière au présent qui vous occupe, vous ne regardez pas devant vous ! Écoutez-moi bien, vous êtes jeune et vous ne savez encore rien de la vie ; vos yeux, à peine ouverts à la lumière, n’entrevoient que des horizons dorés et des perspectives fleuries ; mais derrière ces horizons menteurs, vous ne savez pas ce que le destin vous garde de désenchantement et de douleur ! En songeant à vous, en pensant combien vous étiez belle, jeune, et digne d’être heureuse, vous le dirai-je ? une sorte de pitié m’a pris, et j’ai eu peur pour vous ! Croyez-moi, rompons ce lien à peine formé, quittons-nous, Marguerite, et laissez-moi partir !
Marguerite avait écouté Arthur sans essayer une seule fois de l’interrompre. Comme sur un clavier mobile[246], toutes les harmonies de la douleur avaient passé sur ses traits ; ses lèvres s’étaient teintes de ces couleurs violettes qui accusent les abattements de l’âme et ses pénibles étonnements. Les paroles d’Arthur avaient produit en elle une de ces révolutions[247] poignantes qui resserrent le cœur et le contractent amèrement. Tout son échafaudage[248] d’ardents désirs et d’amour venait de crouler tout d’un coup comme ces derniers palais de nuages qui meurent avec le soleil ; à peine se trouvait-elle la force de chercher à comprendre les paroles qu’elle venait d’entendre, et de regarder en face la clarté funeste qui jaillissait devant elle. Il lui semblait qu’on venait de mettre de la glace sur sa tête, et que le sang de ses veines s’était figé sous une mortelle étreinte.
— Remords, peur, pitié, murmura-t-elle ; ô mon Dieu ! que voulez-vous me dire ? Quel est le secret contenu dans vos paroles ? pourquoi êtes- vous venu et pourquoi me parlez-vous ainsi ?
Arthur fixait son regard sur celui de la jeune femme, comme un homme qui hésite entre deux pensées contradictoires ; il semblait chercher une réponse et se demander dans quelle route il fallait entrer.
— Allons, dit-il, j’ai tort ; ce n’est point ainsi que je devais vous parler ! Vous êtes bien belle, savez-vous ! Belle à enivrer l’imagination et à faire bondir le cœur dans la poitrine ! Que votre front est pur ! Que vos cheveux sont doux et brillants ! Que vos yeux expriment bien la pensée de votre âme ! Vrai, Marguerite, maintenant que je vous regarde, maintenant que mes mauvaises craintes sont dissipées, je vous trouve belle, oh ! bien belle[249] !
Arthur fit un pas en arrière comme pour mieux détailler la jeune femme qui, debout devant lui, ressemblait à un coupable attendant l’arrêt de son juge[250].
— Oui, reprit-il, c’est un grand bonheur d’aimer ! Quand la nuit est sombre comme aujourd’hui, quand les étoiles pâles brillent au ciel, et qu’on n’entend dans l’espace que le murmure du vent qui bruit à travers les feuillées lointaines, c’est un bonheur de s’asseoir seul, en silence, auprès d’une femme jeune et belle comme vous, de baiser ses cheveux, de respirer son haleine, de lui prendre la main et de lui dire : « Je vous aime ».
Arthur s’arrêta. Sa figure grave et soucieuse était contractée par un imperceptible sourire, comme si un souffle ennemi eût empoisonné ses paroles.
— Marguerite, continua-t-il, je vous aime.
Les couleurs de la vie revinrent subitement au front de la jeune femme.
— Oh ! à la bonne heure, dit-elle en tendant la main à Arthur, oh ! merci.
Celui-ci serra un instant la main qu’on lui tendait ; il souriait toujours.
— Oui, n’est-ce pas? c’est ainsi qu’il faut vous parler, voilà les choses que vous aimez à entendre ?
Il s’arrêta encore. Les muscles de ses traits exprimaient une agitation intérieure ; tout d’un coup il quitta vivement la main de Marguerite, et d’une voix basse et glacée[251] :
— Marguerite, dit-il, et si je ne vous aimais pas, si je ne pouvais pas vous aimer ! Il est des souvenirs qui pèsent sur toute l’existence et absorbent la pensée ; il est des jours qu’on n’oublie jamais, et que Dieu ne compte qu’une fois à l’homme. Le chêne frappé de mort ne reverdit plus ; une fois desséchées, les fleurs de la vallée ne relèvent plus la tête, et les rayons du soleil se brisent sur leur tige sans la réchauffer. Ainsi de notre cœur : l’amour n’y fleurit qu’une fois ; et lorsqu’une fois on a bu sa rosée, lorsqu’on a respiré ses enivrantes émanations, on peut mourir alors, car on n’aimera plus !
Arthur parlait d’une voix grave et triste ; on eut dit que l’ange des souvenirs l’emportait sur ses ailes, et que le regret des jours écoulés stigmatisait son front d’un emblème fatal. Debout et le regard empreint d’une vague rêverie, il semblait suivre dans l’ombre une perspective à demi évanouie, et essayait de renouer les fils d’un songe effacé.
— Oui, continua-t-il, on n’aime véritablement qu’une fois dans la vie ; le premier amour absorbe tout ce que nous avons d’énergie et de tendresse à dépenser ! En lui se confondent notre passé, notre présent, notre avenir, comme les fleuves dans l’immense réservoir de l’Océan ; si bien que plus tard notre âme se flétrit et se décolore, que notre imagination s’enveloppe d’un voile ténébreux et d’un manteau de brouillard funèbre. Ce que nous prenons pour les éclairs de la passion, ne sont que les pâles reflets de notre soleil du printemps, ou des feux errants qui brillent et meurent sans laisser de trace ; le passé annule l’avenir, et au moment même où nous croyons nous reprendre à la vie, au moment où notre œil égaré semble entrevoir un horizon nouveau, une invisible main est là qui nous arrête ; et quand nous croyons rêver, nous ne faisons que nous souvenir. Oh ! croyez-moi, ceux-là sont bien heureux qui peuvent oublier ! L’oubli, remède à toutes les douleurs, baume consolateur qui adoucit toutes les blessures et ferme toutes les plaies, seul bien véritable que le Ciel ait donné aux hommes, seule chose au monde qui puisse remplacer ce grand mensonge qu’on a nommé le bonheur ! Ô mon Dieu, que je voudrais oublier !
Il y avait dans l’accent d’Arthur cette vibration douloureuse qui ressemble au cri d’un aigle frappé mortellement ; une émotion intime et longtemps concentrée débordait dans ses paroles. Sous le voile de ses demi-confidences et de ses aveux incomplets, on sentait surgir, comme autant d’aspérités rocailleuses, les pointes acérées de mille douleurs, et les saillies étouffées des illusions perdues, des espérances trompées. En vain s’efforçait-il de cacher sous la froideur de son sourire l’émotion profonde qui le débordait et de dire comme le stoïcien : Ô douleur, je n’avouerai jamais que tu es un mal ! Malgré lui, sa voix sortait faible et souffrante, et, sur son front chauve, l’aile des bonheurs effeuillés projetait son ombre. Dans son âme, se déroulait ce drame éternel de la volonté aux prises avec la souffrance, de l’esprit humain oppressé et haletant sous le joug de fer de la fatalité ; il essayait de rire, mais eût voulu pleurer[252].
Il est des attitudes et des paroles qui produisent sur l’agitation nerveuse des femmes un ébranlement irrésistible et profond. Lorsqu’elles en sont venues, oubliant leur pudeur native à franchir certaines limites, à braver certaines convenances, les obstacles qu’elles rencontrent les irritent au lieu de les arrêter ; semblables aux jets de l’incendie, les saillies de leur imagination s’élancent au-devant des barrières pour les dévorer ; et la voix de la raison a beau leur crier : « en arrière », elles brûlent au contraire de se précipiter en avant et de se frayer une route, quelle qu’elle soit, à travers l’espace[253]. Il y avait d’ailleurs, dans la franchise d’Arthur, ce caractère de grandeur et de souffrance réprimée qui plait toujours à l’esprit des femmes, et l’impressionne cent fois plus que ne le pourraient faire les serments les plus ardents et le laisser-aller le plus oublieux et le plus volontaire. Marguerite, pour la première fois, avait osé lever les yeux sur Arthur et le regarder en face ; son regard était plein en même temps de supplication et d’ardeur ; elle essayait, avec une incomparable énergie de volonté, de percer le mystère dont Arthur couvrait son passé ; il lui semblait que son amour en ce moment était assez fort pour conjurer toutes les influences, anéantir tous les regrets ; elle eût voulu croire à l’efficacité souveraine de ses paroles, et dire à Arthur, avec cette autorité que donne la foi : « Ne souffrez plus et aimez-moi ! » Mais, malgré elle, la figure mélancolique de celui-ci, son accent voilé et grave, son geste impérieux et plaintif l’étonnaient encore et l’épouvantaient presque ; les mots venus du cœur y refluaient, et elle cherchait, comme toutes les volontés faibles devant une volonté supérieure ou au-devant d’une puissance incomprise, par quel art il lui serait donné de suppléer à la vérité et de découvrir sa pensée sans trop la trahir.
— Monsieur, dit-elle à Arthur d’une voix qui, sous l’apparence d’une fermeté factice, accusait l’émotion, je n’ai pas le droit de vous interroger et peut-être n’aurai-je pas la force de vous répondre ; seulement, cette question que vous adressiez en venant ici, je me l’adresse maintenant à mon tour : Pourquoi êtes-vous venu ? Pourquoi, quand votre cœur vous conseillait de retourner en arrière, n’avez-vous pas suivi ses conseils ? Sentiez-vous donc en vous un si grand besoin d’affliger une pauvre femme par vos paroles plus que ne l’aurait fait votre absence ? Partez ! monsieur ; je ne vous retiens pas ; seulement, je vous le redirai encore : Pourquoi donc êtes-vous venu ?
Les derniers mots de Marguerite s’étaient éteints ; sa voix n’avait plus de force et de ses lèvres contractées s’échappait avec peine ce souffle glacé qui précède les larmes ; les veines de son cou se gonflaient par saccades douloureuses, comme il arrive aux femmes chaque fois que l’émotion les déborde, et qu’elles sentent leur courage faiblir au moment où elles essayent le plus énergiquement de le retenir[254] ; elle détourna la tête et demeura quelque temps immobile, comme si elle eût craint qu’un mouvement de son corps, un geste de sa main ne dénonçât trop haut le drame orageux qui se passait dans son cœur[255]. Arthur se taisait ; soit alors qu’un pareil silence pesât trop à Marguerite, soit qu’elle sentît ses sanglots trop longtemps étouffés se faire jour à travers sa poitrine, elle recula vers la fenêtre et l’ouvrit avec cette précipitation d’une femme qui se sent arriver aux termes de sa contrainte et cherche un refuge où se cacher.
Elle était appuyée sur la barre en fer qui servait de garde-fou, et, la tête penchée, semblait regarder fixement au-dessous d’elle, comme si elle eût sondé la profondeur d’un abîme entr’ouvert. Arthur s’approcha et se plaça à son côté.
— Vous n’êtes pas parti ? dit-elle en frémissant[256]. Oh ! partez, partez ! Vous le vouliez tout à l’heure, je vous en prie maintenant. Partez ! si vous n’êtes pas le plus cruel des hommes, si vous ne voulez pas être témoin de toute ma honte et de toute ma douleur !
En disant ces mots, un long sanglot souleva sa poitrine, et elle se prit à pleurer amèrement. Arthur écouta longtemps sans mot dire le bruit de ses larmes qui ruisselaient sur ses joues, et rejaillissaient sur la barre d’appui, ainsi que des gouttes de pluie par une journée d’hiver. Il lui prit la main qu’elle laissa dans la sienne :
— Oh ! reprit-elle, on me l’avait bien dit que votre amour était fatal, et qu’il empoisonnerait ma vie ! On m’avait prévenu de ne pas vous donner mon cœur parce que vous le repousseriez, et moi j’ai cru, parce que je donnais beaucoup, recevoir beaucoup ; encore une fois, partez !
En entendant ces paroles, une sorte de contraction nerveuse plissa les traits d’Arthur ; son âme, bercée et comme endormie au refrain amollissant de cette mélodie de l’amour qui retentissait à son oreille, se réveilla en sursaut sous le coup de cette allégation positive[257], et devant le mystère qu’elle renfermait il s’arrêta curieux et préoccupé. Quelle intelligence avait donc prévu la sienne ? En s’adressant ces questions, l’énergie despotique de son âme reprit le dessus ; il y avait lutte, l’homme se retrouvait.
— Marguerite, dit-il, promettez-moi d’être franche, de répondre nettement à ce que je vais vous demander ; me le promettez-vous ?
— Je vous le promets, dit Marguerite, subjuguée[258] par l’autorité imposante qu’Arthur avait prise.
— Qui vous a parlé, Marguerite ? qui vous a dit ces choses ? Répondez !
— Celui que vous nommez Henri, dit Marguerite.
— Henri ! répéta Arthur en tressaillant involontairement, et il baissa la tête sur sa poitrine. À voir l’anxiété distraite de son regard, on eût dit qu’il cherchait à distinguer à travers un voile de brouillard quelque mystérieuse lumière, et que sa main appelait, sans le saisir, un fil caché qui pût le conduire et assurer ses pas. Par intervalle, il relevait la tête ainsi qu’un homme qui essaye de rassembler des idées éparses, et d’en saisir les différents rapports si éloignés et si imperceptibles qu’ils puissent être.
— Henri ! répéta-t-il encore une fois ; et il ne vous a rien dit de plus, Marguerite ?
— Rien, répondit celle-ci.
Il se fit un silence de quelques instants ; Arthur s’était reculé de deux pas, et contemplait la jeune femme, dont les brunes épaules apparaissaient veloutées et blanches sous un rayon de la lune.
— Adieu ! dit-il en lui tendant la main.
La jeune femme se retourna, et roidissant tout son corps comme pour rappeler par la tension de ses nerfs le courage qu’elle avait perdu :
— Adieu ! dit-elle en lui donnant sa main.
Arthur fit deux pas en avant pour sortir, mais en jetant un dernier regard sur Marguerite, il la vit chanceler et pâlir ; il se rapprocha d’elle :
— Marguerite ! dit-il, ne faut-il pas que je parte ?
La fermière s’était laissée tomber sur le canapé bleu qui décorait sa petite chambre. De grosses larmes coulaient lentement le long de ses joues et suivaient à travers les veines de son col leur marche inégale, comme des gouttes de rosée sur les feuilles d’un tremble.
— Oh ! ne partez pas ! dit-elle avec un inexprimable accent de désespoir.
Arthur la regarda ainsi penchée sur les coussins ; sa tête était retombée en arrière, et ses longs cheveux noirs dénoués formaient autour de son visage un voile magnifique.
— Vous êtes belle ainsi ! dit Arthur, et vous avez raison, il n’y a qu’un mot au monde : l’amour ; le passé n’est rien, le passé contient et dévore tout, espérances et regrets ; oublions, oublions, Marguerite !
Arthur avait dans la voix des vibrations inconnues ; ce n’était plus cet accent noble et calme qui lui était habituel ; c’était presque l’accent du désir et de la fièvre. En même temps, penchant sa tête vers celle de Marguerite, toujours abattue et pâle, il la baisa lentement au front[259].
XI.
Dans la pièce du château qui servait de cabinet de travail, Arthur et Henri étaient assis aux deux extrémités du tapis vert ; la figure du premier était soucieuse et réfléchie comme celle de certains hommes le lendemain des jours de plaisir ; car, parmi ceux qui semblent poursuivre un même but et rechercher à outrance l’étourdissement de la dissipation et de la folie, il en est plus d’un qui, ainsi que les Italiens dans leurs nuits de fête, cache sous le masque rieur des traits contractés par la douleur, une âme appauvrie et froide ; sous le même drapeau, combattent et meurent bien des soldats rassemblés au hasard et parlant des langues différentes ; comme la fumée du canon, la fumée de la débauche couvre de son brouillard d’impénétrables contrastes et d’effrayantes oppositions. Il est donné à un petit nombre d’hommes d’apercevoir les fils secrets qui font mouvoir chaque acteur sur cette vaste scène du monde[260], et Byron[261] n’est que la reproduction éclatante d’un millier de types obscurs qui emportent avec eux dans la tombe le secret de leur existence. Henri était, comme toujours, mélancolique et doux, avec une expression plus plaintive dans le regard, et comme une arrière-pensée de deuil ; la tête baissée sur un gros registre couvert en basane[262] verte, on l’aurait cru exclusivement occupé à grouper des chiffres et à additionner des colonnes, n’eût été le mouvement oscillatoire de son col, et la distraction oublieuse de sa main. Quelquefois lorsqu’Arthur concentrait son attention à lire un des nombreux papiers épars sur la table, le jeune homme levait les yeux sur lui comme pour interroger sa physionomie et lui demander compte de sa pensée intime. Il se passe ainsi dans le monde plus d’une de ces scènes ébauchées qui ne se produisent jamais à la superficie et meurent dans le cœur de celui qui les a vues naître. Henri avait besoin de parler, et pourtant il gardait le silence ; peut-être attendait-il, comme la plupart des hommes, que l’occasion ou le courage lui vînt.
— Avez-vous fini votre compte, Henri ? demanda Arthur ; et que vous semble de notre opération ?
— Parfaitement belle ! dit Henri avec un demi-sourire ; en admettant qu’on doive mesurer la beauté des actions humaines à l’argent qu’elle rapporte ; je suis du reste très-mauvais juge en ceci, car je n’ai jamais compris la valeur de la chose que vous appelez la fortune, et je ne sais pas au juste ce que pèse un louis dans la balance de nos destinées.
— Toujours poëte ! dit Arthur en souriant à son tour ; il faut, mon ami, que vous ayez une imagination bien richement dotée, ou une mémoire bien abondamment fournie, pour que vous vous complaisiez ainsi dans vos idées de désintéressement et de bonheur pastoral. Croyez-vous au bonheur, Henri ?
Le jeune homme tressaillit sur sa chaise à cette dernière parole, et baissa la tête en rougissant.
— Y croyez-vous ? répéta Arthur.
— J’y ai cru, dit le jeune homme avec l’expression ardente d’un catéchumène qui s’apprête à proclamer la vraie religion.
Arthur le regarda quelque temps d’un air de compassion et d’affectueuse pitié.
— Et qu’est-ce que le bonheur ? dit-il.
— L’amour ! dit Henri d’une voix ferme.
Arthur ne répondit pas. Il y a des mots qui exercent sur tous les hommes, quels qu’ils soient, une sainte et magnétique influence ; il y a des convictions qui imposent le respect aux cœurs les plus ruinés, aux croyances les plus vacillantes, au scepticisme le plus vieux et le plus sûr de lui-même. Arthur avait repris dans sa main une lettre déjà lue et qu’il avait déposée sur le tapis ; on n’entendait aucun bruit extérieur, et la lampe qui éclairait l’appartement projetait sur la physionomie des deux acteurs de cette scène ces reflets changeants qui prêtent aux détails d’intérieur une poésie si réelle et si mystérieuse à la fois.
— Vous avez raison, dit Arthur en frappant du doigt la lettre décachetée ; nous avons fait, je crois, une belle opération, et voici une lettre qui m’en donne la certitude.
— De qui cette lettre ? demanda Henri avec insouciance.
— Écoutez ! dit Arthur ; je vais vous donner connaissance du texte en son entier.
« Monsieur,
« J’ai de graves raisons pour désirer vivement l’acquisition de votre château ; je ne veux donc pas vous tenir plus longtemps en échec quant au prix. J’ai été désolé de ne pas me trouver chez moi lors de votre visite[263], mais je vais vous faire par écrit la réponse que je n’ai pu vous faire de vive voix. Je prendrai pour deux cent cinquante mille francs le château et le parc que vous me proposez[264] ; ainsi donc c’est une affaire conclue entre nous. »
— Est-ce tout ? demanda Henri qui avait écouté sans intérêt la lecture qui lui avait été faite.
— Il y a un post-scriptum, dit Arthur ; et le voici :
« On dit que vous êtes un homme adroit, et j’aurais besoin, pour terminer l’affaire, de toute votre adresse. Il s’agirait de déterminer ma femme à quitter Paris et à se confiner dans une campagne. Les difficultés de l’entreprise sont grandes, je ne vous le dissimule pas ; je vous les expliquerai plus au long à notre première entrevue qui, je crois, sera prochaine. Sachez seulement, qu’outre une belle affaire à terminer, vous avez un immense service à me rendre. »
— Signé ?… dit Henri après un instant de silence, et semblable à un acteur qui s’aperçoit que le moment de sa réplique est venu.
— De Noï[265], dit Arthur en riant ; un diplomate, un de ces hommes qui doivent être fins par état ; singulière finesse que celle-là ! Passer sa vie à pacifier le ménage des nations entre elles, et ne pouvoir pas forcer une femme à prendre l’air de la campagne, qui, j’en suis sûr, lui convient fort !
Arthur avait parlé avec cette espèce de gaieté qui le prenait de temps en temps et par accès, et qui ressemble aux boutades [266] des Anglais atteints du spleen.
— Vous connaissez cette femme ? demanda Henri.
— Pas plus que toi, mon enfant [267].
Henri n’insista pas. La conversation, de nouveau reprise, fut interrompue de nouveau ; en vain « s’efforçaient-ils tous deux d’attacher de la gravité et de donner de l’importance à leurs paroles ; il était aisé de voir qu’aucun d’eux ne trahissait le fond de sa pensée, et qu’ils n’évoquaient sur leurs lèvres des semblants de conversations banales que pour servir de prétexte à leur mutuelle dissimulation. Henri avait repris sa plume, et parcourait encore une fois de l’œil les colonnes de chiffres déjà plusieurs fois parcourues ; il était redevenu insouciant, avec l’air de distraction qui lui était habituel. Quant à Arthur, il s’était remis à lire et à feuilleter les papiers épars devant lui, plutôt pour se donner une contenance et dans un but d’affectation, que par un intérêt réel et vivement senti.
Le silence dura quelques instants ; Arthur à la fin relevant la tête et comme s’il eût suivi une succession d’idées non interrompue dans son cœur !
— Et pourquoi, demanda-t-il, ne croyez-vous plus au bonheur, enfant ?
— Pourquoi ! dit Henri sans s’étonner de cette question qu’il pressentait peut-être malgré sa brusquerie apparente. Je vous dirai cela plus tard ; mais auparavant, j’ai à vous parler sérieusement.
Le jeune homme s’était levé, et son attitude, molle et distraite d’ordinaire, était devenue digne et presque solennelle[268] ; son regard interrogeait hardiment le regard d’Arthur comme pour en défier la puissance. Cette âme faible trouvait sans doute dans ses inspirations secrètes la force et l’énergie qui paraissaient lui manquer dans les circonstances ordinaires de la vie, et semblable à un novice qui s’apprête pour la première fois au combat, il ramassait ses forces et roidissait ses nerfs pour entrer en lutte contre une volonté supérieure et une autorité avouée. Et quand celui-ci lui demanda en souriant où il voulait en venir après un si magnifique début, il se contenta de lui répondre : « Écoutez-moi ! » Et il commença :
— Vous m’avez souvent parlé de votre amitié, Arthur ! vous m’avez souvent dit que je pouvais compter sur vous comme un enfant sur son frère, comme un fils sur son père.
— Oui certes, dit Arthur, sérieusement cette fois et sans sourire ; oui, je vous ai dit tout cela, et je suis prêt aujourd’hui, comme hier, à tenir ma parole. Malheur à moi ! Henri, si vous doutiez de ma sincérité. Tous nos parents[269] sont morts, notre famille est éteinte ; il ne reste que vous et moi de tous ceux que la nature avait faits nos amis ! Dans le désert de ce monde, je ne sais qu’un nom qui réveille en mon cœur des souvenirs et des échos assoupis, je ne sais qu’une main que ma main presse avec bonheur : ce nom est le tien, Henri ! cette main, c’est la tienne. Tu es pour moi l’ombre dernière des jours évanouis, et en te regardant, il me semble revoir, comme en un miroir fidèle, tout un monde d’espérances et d’illusions perdues[270] ! quand j’écoute ta voix, une puissance mystérieuse me ramène aux premiers jours de mon enfance, jours trop courts, hélas ! et les seuls que je voudrais compter dans ma vie ! Je revois la chaumière de mon père fraternellement accoudée à la chaumière du tien [271] ! Le vent m’apporte comme autrefois les fraîches émanations du chèvrefeuille qui formait un berceau au-dessus du banc de bois, où, tout petit, j’allais m’asseoir ! Toi seul me rends l’image de tout ce bonheur d’autrefois que je regrette, toi seul m’empêches de tout oublier ! Quelquefois, vois-tu, au milieu de cette agitation que je me suis faite, il me prend des regrets et presque des remords il me semble qu’on ne doit bien mourir qu’au lieu où l’on est né ! Je me retrace en songe cette belle vallée d’Auge où nous avons vécu tous deux, et j’éprouve un ardent désir d’aller y ensevelir le reste de mes jours [272], et attendre la mort les bras croisés sur le même banc où je me suis assis tant de fois ! Dans ma folie, les détails les plus minutieux du passé me reviennent en mémoire comme s’ils étaient devant moi ! je suis tous les sentiers de la prairie, je reconnais les buissons de buis où les mésanges et les fauvettes aiment à déposer leurs nids ! J’explore les bords sinueux du ru [273], qui cache sa pente insensible sous le manteau vert de nos gras pâturages ! je compte les brins de mousse qui garnissent le chaume de notre toit ! je contemple avec délices les rayons du soleil se brisant à la surface de la devanture noire et blanche, qui se détache d’une façon si riante sur un fond de verdure et de fleurs ! Un jour, Henri, quand je serai las du monde, je rejetterai ce calice d’amertume que le sort nous fait, et j’irai dans ma vallée d’Auge, à dix lieues de Lisieux, finir dans la maisonnette où a fini mon père.
Henri n’avait pas essayé d’interrompre Arthur pendant qu’il parlait. De tous ces souvenirs d’enfance que celui-ci évoquait, on eût dit qu’il en prenait la moitié, tant, sur sa figure, les émotions qu’Arthur peignait avec tant de bonheur se reproduisaient avec complaisance ; il y avait entre eux un invisible accord, et on eût dit un chant plaintif et doux commencé dans la vallée, et renvoyé plus doux encore par l’écho lointain de la montagne.
— Poëte aussi, dit Henri d’une voix affectueuse en tendant la main à son ami ; poëte comme moi, et plus malheureux, peut-être[274] !
— Bien malheureux ! dit Arthur ; car, pour retrouver le bonheur, même en songe, j’ai bien des jours à remonter. Et depuis que je n’ai plus foi en lui, vingt fois les feuilles de nos pommiers sont tombées, et mon front s’est fait chauve[275]. Nous sommes, Henri, les jouets d’une destinée moqueuse[276]; il nous arrive à tous d’entrevoir un jour[277] à travers les nuages d’une image enchanteresse, et le reste de notre vie se consume à pleurer l’image que nous avons entrevue. Pour l’oublier, c’est en vain que nous appelons à notre aide toutes les distractions et les étourdissements du monde ! Nous nous croyons guéris parce que nous cachons avec soin sous un manteau de fête les plaies cachées de notre poitrine ! Insensés, nous croyons bâtir de nouveaux palais, et nous ne faisons que crépir de vieilles tombes !
Henri tenait toujours la main d’Arthur dans la sienne.
— Vous avez aimé[278] ? s’écria-t-il vivement ; oh ! tant mieux, vous me comprendrez maintenant.
Ces dernières paroles produisirent sur Arthur un effet qu’on eût été loin d’attendre. Il était de ces hommes qu’une secousse violente rappelle subitement au sentiment de leur position ou du rôle qu’ils se sont imposé.
— Aimé ! dit-il en donnant à sa voix une expression de badinage affecté. Ai-je dit cela ? En vérité, on a eu raison d’appeler l’imagination la folle du logis [279], car elle nous fait dire parfois d’étranges sottises. Mais voyons, Henri, vous aviez à me parler ? Parlez-moi donc, et souvenez-vous seulement que vous pouvez compter sur moi en toutes choses.
— Je vous crois, dit Henri. Il ne m’appartient pas d’interroger votre âme et de vous demander compte du mystère dont vous enveloppez vos pensées, mais il y a en vous un secret que je pressens sans me l’expliquer ; vous dites vrai, nous sommes frères.
— Traitez-moi donc en frère ! dit Arthur.
— J’ai, dit Henri en reprenant le ton grave qu’il avait adopté dès le début de cette conversation, j’ai une prière à vous faire, et peut-être un sacrifice à vous demander. Mais, avant tout, il faut que j’avoue mes torts ; j’ai sur la conscience un poids qui m’étouffe, et je veux m’en délivrer. Vous connaissez la femme du fermier Guillaume Évon, Arthur ?
— Marguerite ! dit celui-ci avec plus d’émotion qu’il n’en eût voulu montrer.
— Oui, Marguerite ; vous savez son nom aussi bien que moi, et pourtant c’est un nom que je n’oublierai jamais, car mon enfance a ses souvenirs comme la vôtre, et ce nom-là fait partie de mes plus doux souvenirs.
— Que voulez-vous dire[280] ? demanda Arthur.
— Pourquoi je m’intéresse au sort de cette femme, vous le saurez. Mais je m’y intéresse de telle sorte que, pour elle, j’ai manqué à la franchise que je vous devais. Marguerite vous aime[281] !
La figure d’Arthur exprimait une anxiété profonde ; à chaque parole de son interlocuteur, vous eussiez vu courir, à travers les muscles de son front, un de ces frissonnements étranges qui décèlent les orages de la pensée ; à la manière dont il regardait Henri, on eût dit un coupable prévoyant l’arrêt de son juge et tremblant devant lui, plutôt qu’un athlète longtemps éprouvé, ramassant ses forces pour emporter de haute lutte une dernière victoire.
— Comment savez-vous cela ? demanda-t-il à voix basse et en hésitant.
— Je le sais, dit Henri ; et moi, votre ami, votre frère, j’ai osé m’armer contre vous ; et, comme un lâche, j’ai porté les coups dans l’ombre. J’ai eu tort, oh ! bien tort ! car, si j’étais venu vous dire : « Arthur, mon bonheur dépend de vous ; promettez-moi de ne plus parler à cette femme », vous m’auriez tendu la main, n’est-ce pas ? et vous m’auriez dit : « Frère, soyez satisfait, je ne lui parlerai plus ». Mais au lieu d’aller droit mon chemin, tête haute, j’ai voulu, et c’est là ce qui m’afflige, prendre des chemins détournés ; j’ai eu recours à l’adresse au lieu de faire appel à votre loyauté. C’est là le tort que je me reproche ; pardonnez-moi !
Pendant qu’Henri parlait, Arthur avait passé à plusieurs reprises sa main sur son front, comme pour en écarter un souvenir importun.
— Henri ! dit-il en éclatant, tu aimes Marguerite ?
— Ce tort que je me reprochais, continua le jeune homme, j’ai voulu le réparer ; et aujourd’hui, je viens vous tendre la main et vous dire : Arthur, promettez-moi de ne plus parler à cette femme.
— Tu l’aimes ! répéta une seconde fois Arthur avec un inexprimable accent de désespoir.
— Je l’aime, dit Henri ; et quand vous me parliez tout à l’heure de vos rêves d’enfance, de cette image enchanteresse qu’on n’entrevoit qu’une fois pour la perdre à toujours, j’ai cru que vous lisiez dans ma pensée, et que vous faisiez mon histoire. Je l’aime ! car elle se rattache à mes songes les plus doux, à mes jours les plus heureux ; car je l’ai vue pour la première fois dans cette vallée d’Auge que vous aimez tant, et il me semble que la verdure de nos prairies est sa sœur.
— Tu l’aimes, dit Arthur ; tu l’aimes !
— Et maintenant, ce que je vous ai demandé, me le promettez-vous ?
— Henri, Henri, dit Arthur avec angoisse ; malheureux enfant ! mais moins malheureux que moi !
Henri était pâle ; sa figure juvénile s’était empreinte subitement d’un cachet de ruine et de décrépitude ; on eût dit que le soleil s’était retiré tout d’un coup de cette nature ardente et vivace ; l’enfant devenait un vieillard [282]. Il regarda longtemps Arthur en silence, comme si le trop plein de son cœur eût paralysé le passage de sa voix.
— Tout est-il donc irréparable ? dit-il.
— Irréparable, murmura Arthur.
— Ô mon Dieu ! dit le jeune homme en comprimant un sanglot, pourquoi m’avez-vous refusé ma part de bonheur en ce monde ?
Il est des scènes muettes dont il faut renoncer à décrire les phases et à peindre la douloureuse énergie. Il se fit un long silence ; à la fin, Henri releva la tête, et regardant en face son interlocuteur.
— Arthur, dit-il ; répondez-moi franchement : l’aimez-vous ?
— Je l’aime, dit Arthur en hésitant, et presque dominé par le ton d’autorité et de commandement que le jeune homme avait donné à ses paroles.
— C’est un grand engagement que vous prenez là, dit Henri en se dressant de toute sa hauteur ; car je vous demanderai compte de son bonheur. Et maintenant, ne me parlez plus de la vallée d’Auge, ni de la chaumière de votre père ; c’est ici et non là-bas, c’est près d’elle que vous devez mourir.[283]
FIN DU PREMIER VOLUME.
Tome II
I.
Il y a dans le cœur humain bien des landes inexplorées qu’on ne prend pas la peine d’observer et de décrire. La vie parisienne[1] cache sous sa surface d’agitation et de bruit mille sentiments limoneux, mille douleurs concentrées et stagnantes que les écrivains modernes, pressés qu’ils sont de mettre au jour les ébauches faciles d’un talent prématuré, n’ont pas la patience de sonder dans leurs replis intimes et de suivre jusqu’au bout dans leur marche capricieuse et dans leurs convulsions souterraines. On ne voit de la société que ce qui en jaillit au premier abord : tandis qu’on étudie minutieusement ses superfétations et ses excroissances, on néglige ces plaies rentrantes et aigries qui, semblables à la lame d’un poignard, cachent leur pointe empoisonnée au plus profond des entrailles humaines. Peu de gens ont assez de courage pour creuser jusqu’au tuf [2] cet immense désert du monde qui, sillonné en tous sens, reste pourtant en jachère ; on lève des plans sans étudier le terrain, on veut bâtir sans avoir préparé les fondations de l’édifice, on élève le couronnement avant d’avoir fouillé les caves. Qu’on pardonne donc à l’auteur de ce livre, si la moralité de l’œuvre qu’il a entreprise n’apparait pas encore dans tout son éclat ; il diffère en ceci de ceux qui consacrent un temple sans l’avoir achevé ; il veut, avant de donner un nom à sa pensée, que le monument soit debout tout entier, avec les colonnes qui doivent soutenir son péristyle, et la frise qui doit encadrer son sommet. Peut-être alors, alors seulement, sur le fronton inaugurera-t-il un signe de régénération sociale[3]. Que le lecteur lui permette maintenant de continuer son récit comme il l’a commencé, fatalement pour ainsi dire, et ainsi qu’un historien qui raconte sans conclure.
Nous n’avons choisi, pour point de départ, la vente en détail d’un vaste domaine qu’afin de mieux saisir les traits divers, les passions et les intérêts contradictoires qui se rattachent à la propriété, ce grand et unique pivot autour duquel toutes les sociétés modernes semblent vouloir invariablement tourner [4]. Nous avons pris sur le fait, et reproduit, quoique imparfaitement peut-être, cette avidité croissante du vassal empiétant chaque jour sur l’antique terrain de la suzeraineté. Mais jusqu’à présent, et nous l’avons fait à dessein, notre pensée ne s’est produite que sous l’une de ses faces ; il nous reste la moitié de notre tâche à accomplir, et nous aurons soin qu’à travers le tissu de la fable, l’intention finale de l’écrivain grandisse successivement et se fasse jour par degrés jusqu’à son expression la plus complète, si bien que la formule de nos conclusions vienne d’elle-même à nos lecteurs.
Comme nous avons à cœur que tous les éléments qui doivent concourir à l’ensemble de cet ouvrage soient connus et appréciés à l’avance, comme nous ne voulons pas mêler les fils sans expliquer tout d’abord les secrets de leurs entrelacements, il devient nécessaire de nous occuper d’un personnage nouveau, qui n’a fait que glisser dans la première partie de ce livre, et qui doit maintenant se montrer au grand jour. M. de Noï, dont nous avons déjà prononcé le nom[5], était un homme de quarante ans à peu près, qui jusqu’à la Révolution de 1830 avait passé sa vie au milieu des plaisirs, des intrigues et de l’agitation contenue et sourde d’une ambassade. Tout jeune, la Restauration, capricieuse comme toutes les puissances vieillies, l’avait poussé au delà du but le plus brillant que les plus ambitieux ou les plus méritants puissent espérer. À vingt-huit ans, il était premier secrétaire d’ambassade. Soit instinct, soit que les nécessités de la carrière qu’il avait embrassée eussent assoupli et emprisonné sa nature, M. de Noï s’était fait une loi, en tout temps, de la réserve et du silence. Sa jeunesse avait passé inaperçue et mystérieuse entre une double haie d’obligations mondaines et de préjugés sociaux. Dans son passé, vous eussiez vainement cherché une seule de ces actions excentriques, un seul de ces scandales qui abondent dans certaines existences. Il avait constamment suivi la même ligne, et ne s’était jamais écarté de ce niveau qui règle l’étiquette des cours et les relations de souverain à souverain. Il était un des plus fervents sectateurs de ce système négatif qui consiste à cacher le mérite réel qu’on peut avoir, et à ne faire exactement que ce que font les autres hommes. Comme plan de vie intérieure, peut-être s’était-il contenté de mettre à profit ce mot de M. de Talleyrand[6] : « Défions-nous toujours du premier mouvement, fût-il bon ! » Pendant dix ans son existence avait été invariablement la même, toujours calculée dans ses phases culminantes, comme dans ses détails les plus minutieux. Pendant dix ans ses yeux n’avaient pas laissé échapper, un regard, sa bouche un sourire qui n’eût été médité d’avance, consciencieusement pesé, soumis aux procédés d’appréciation les plus sévères et les plus infaillibles[7]. Sa vie extérieure, comme la vie extérieure des nations, se réglait par protocoles : dans les cercles diplomatiques, dans les salons qu’il fréquentait, on faisait de lui le plus grand éloge qu’on puisse faire d’un pareil homme ; on ne disait pas : « Il a de l’esprit « ; on disait : « Il a de la tenue ». Toutes ses paroles, en effet, tous ses gestes, tous ses mouvements formaient un ensemble si complet, un accord si harmonieux ; à quelque moment, dans quelques circonstances qu’on le prît, on le trouvait toujours si sûr de lui, sans solution de continuité, sans dérangement aucun, qu’on eût pu dire de lui, comme d’une horloge merveilleusement organisée : « il va admirablement bien ». Si le génie des grandes choses lui manquait, il avait au moins poussé jusqu’à ses derniers raffinements cette intelligence des petites choses qui souvent tient lieu d’une plus haute qualité. Il savait avec certitude, sans se tromper d’une seconde, à quel moment il fallait parler, à quel moment se taire. Il disait des riens, mais ces riens venaient toujours à point avec une précision mathématique ; et ses lieux communs les plus trivials [sic] prenaient de l’importance par cela seulement qu’ils n’étaient jamais ni en avance ni en retard. Enfin, il possédait au suprême degré cette qualité si rare et si hautement estimée qui peut se résumer ainsi : savoir entrer et sortir[8].
Sa toilette était pour lui l’objet d’un examen sérieux [9], d’une investigation continuelle, et obéissait au même régime de ménagement et de réserve que sa conduite. La coupe de ses habits ressemblait à une espèce de compromis entre la mode de la veille et celle du lendemain. Il se tenait à une égale distance de la vieillerie et de la nouveauté ; une élégance risquée eût nui à la réputation de mesure et de gravité qu’il s’efforçait de conserver ; un laisser-aller trop insoucieux l’eût compromis auprès de certaines femmes qui décidaient sans appel de l’avenir de tous les apprentis diplomates par un seul mot, mais un mot dont tous ceux qui sont initiés aux secrets d’un certain monde comprendront l’importance : « Il est bon ton » ; ou : « il est mauvaise compagnie » . Il s’aventurait même, et ç’avait été là un des accidents les plus remarquables de sa vie, à tourner légèrement en ridicule les jeunes gens osés qui fixaient sur eux l’attention par l’excentricité de leur toilette. Les excès en tout genre, disait-il, sont de mauvais goût ; un homme de bon ton ne doit jamais être ni en deçà, ni au-delà de la mode ; Georges Brummel[10] était fou aussi bien que Rousseau-l’Arménien[11].
Avec une conduite aussi méticuleusement étudiée, M. de Noï avait son public à lui dont il était idolâtré. Les jeunes femmes le trouvaient un peu roide et guindé, sans oser pourtant contester l’excellence irréprochable de ses manières ; mais toutes ces femmes qui, passé quarante ans, n’ont plus d’âge, et veulent remplacer le charme fugitif de la jeunesse par une maturité éclatante, le proclamaient hautement comme un type de cette courtoisie sévère, de cette élégance grave, aussi supérieure, disaient-elles, à certains airs évaporés, que la désinvolture[12] d’un Lauzun [13] aux manières dégagées et grotesques d’un Mascarille[14] ou d’un Jodelet [15]. M. de Noï était donc parfaitement posé [16] dans le monde ; et lorsqu’il rentrait le soir, après avoir joué le rôle de la journée, il se souriait intérieurement, et s’endormait ambassadeur.
Vers 1829, un mariage brillant avait encore consolidé cette position si savamment établie, M. de Noï, quoique sans fortune personnelle, était devenu l’époux d’une des plus riches héritières du faubourg Saint-Germain [17] ; tous ses plans réussissaient, toutes ses combinaisons atteignaient leur résultat, lorsqu’un coup de main de trois jours[18] vint renverser toutes ces illusions si légitimes, toutes ces espérances si chèrement couvées. Depuis cette époque, M. de Noï avait fait comme toutes les puissances déchues, il était rentré dans la vie ordinaire, en la maudissant. D’abord, il avait pris à cœur de protester par une retraite éclatante contre un gouvernement qui, par le fait de son avènement, l’avait blessé dans ses intérêts les plus chers. Il voulait se renfermer dans un vaste hôtel du faubourg Saint-Germain, et y pleurer à loisir la légitimité déchue ; mais quand il s’aperçut que sa bouderie ne le menait à rien et que ses conspirations quotidiennes, au coin du feu, n’ébranlaient pas le nouveau trône, il prit bravement son parti, et renonçant à ses projets de solitude légitimiste, il reparut de nouveau au milieu du monde, dans le but, disait-il, d’y faire de la propagande active. Il s’était donc établi rue Saint-Georges, dans un hôtel délicieux, en plein Paris, et, dès ce moment même, il s’opéra en lui une inconcevable révolution [19] ; lui, qui jusqu’alors avait muré sa vie, et en avait protégé l’entrée par un double rempart de réserve et de silence, se jeta tout d’un coup dans la dissipation, et afficha sa conduite. On le vit marcher front levé au milieu des plaisirs de toute sorte, et demander au monde des distractions et du bruit. La vie active lui paraissait-elle douce, et voulait-il regagner le temps perdu ? ou bien, comme ces malades [20] sans cesse altérés, qui cherchent vainement à éteindre le feu de leur poitrine, cherchait-il dans cette potion enivrante du plaisir, un rafraîchissement salutaire ? Ses plus intimes amis hésitaient, incertains entre ces deux suppositions. Quoi qu’il en soit, sa santé, jusque-là si florissante et si verte, commença à décliner visiblement. Son front se fit pâle, ses tempes se dégarnirent de cheveux, et des rides prématurées y imprimèrent leur pli cruellement significatif ; ses joues se creusèrent peu à peu, et leurs pommettes se colorèrent de ces teintes fébriles qui accusent un mal intérieur et les convulsions d’un sang échauffé dans les artères. Dans ses yeux brillait une flamme sinistre ; ses mouvements, jusque-là si réguliers, et composés avec tant d’art, devinrent brusques et saccadés ; les mèches de ses cheveux blanchirent et tombèrent ; on eût dit qu’une influence émétisante [21] altérait en lui les sources de la vie, et en viciait les organes. Il était sujet à ces bizarres transitions d’humeur, à ces saillies d’imagination contradictoires, qui attestent dans la machine humaine un ébranlement dangereux. Tantôt sa voix était vibrante et aiguë, tantôt sourde et rauque comme les notes basses d’un ophicléide [22] ; quelquefois il se livrait avec une sorte de rage à une gaieté bruyante, à un bavardage sans mesure ; et, au sortir de ces échauffements factices, il tombait en un morne abattement, et son silence ressemblait au triste silence d’un bois dépouillé de ses feuilles, d’un vieil édifice enseveli sous la mousse et le lierre. Dans le monde, on le disait poitrinaire ; et cette idée s’était tellement accréditée, que d’un jour à l’autre on s’attendait à le voir s’éteindre au retour d’une soirée ou d’une fête[23].
M. de Noï n’avait pas d’enfants[24], et on s’étonnait de cette singularité, car madame de Noï[25] passait pour une des plus jolies femmes de cette société parisienne, espèce de club privilégié qui ne connaît personne en dehors d’un certain cercle, et ne pose la couronne de la beauté que sur le front de ses affiliés ; dans cet aristocratic club[26] madame de Noï était une puissance et presque une royauté. Elle comptait parmi le petit nombre de ces femmes qui fixent sur elles l’attention, et ont le droit d’imposer leur volonté à la mode même, cette souveraine si capricieuse et si arbitraire ; autour d’elle se groupaient assez d’hommages et d’enthousiasmes masculins, assez de dépits et de jalousies féminines pour que son nom fût une autorité, pour que sa personne fût un continuel objet de remarques louangeuses ou malignes ; elle partageait avec toutes les supériorités et toutes les gloires de ce monde cette faculté, si enviée de quelques uns, d’avoir des ennemis. Elle avait enfin cette célébrité que ne donne pas toujours la beauté ; on savait huit jours d’avance dans quel salon elle irait, et la dame de maison, assez heureuse pour obtenir sa parole, ne manquait pas de dire avec la fierté d’un avare qui étale ses richesses : « J’aurai madame de Noï ». Elle avait sa loge aux Bouffes [27], et n’allait jamais à l’Opéra ; mais aux Bouffes, sa loge était mieux connue que la loge royale, et quand elle y paraissait, superbe et radieuse, tous les regards des hommes de sa société l’admiraient de loin, sans oser la convoiter, tant les plus intrépides se sentaient petits et indignes devant une si haute renommée. Il y a tout au plus, dans Paris, dix femmes de cette nature, et, rien que pour elles, il faudrait mettre en lumière un mot magnifiquement trouvé par nos pères, et qui tombe en désuétude parmi nous, faute d’application possible : Grande coquette [28] !
De l’aveu de tous (ce qui est la plus grande preuve de supériorité que puisse donner une femme), madame de Noï avait une mise à elle[29] ; elle n’était pas modelée sur ces types vulgaires qui ressemblent à des gravures du journal des modes animées ; on sentait le charme et la distinction de sa toilette sans pouvoir en analyser les secrets ; les autres femmes portaient les mêmes robes et les mêmes chapeaux qu’elle, mais seule elle savait en relever la forme, en accidenter la monotonie par un de ces riens gracieux qui échappent aux femmes médiocres, et que les femmes supérieures trouvent dans leur imagination. Un nœud bien choisi, une passe inclinée d’une certaine façon, la nuance d’un ruban habilement combinée avec la nuance des cheveux et de la peau lui suffisaient pour donner à ses plus simples parures un cachet d’élégance royale et de grâce inimitable. Sa mise se distinguait moins encore par la richesse que par la perfection et le fini. Il y avait en elle ce je ne sais quoi de poli et de parachevé qu’on pourrait comparer au chant du rossignol, avec un attrait de plus, l’attrait si puissant de l’imprévu. Ceux qui l’avaient admirée la veille s’étonnaient de la trouver nouvelle le lendemain. On eût dit qu’elle s’enrichissait de ses pertes et que chacune de ses créations, au lieu d’appauvrir son imagination, la rendait plus féconde et plus merveilleuse encore. Le don de la coquetterie, porté à un aussi haut degré, n’est plus un instinct, mais un art ; c’est même une science qui a, comme toutes les sciences, ses découvertes et ses prodiges d’application.
Des femmes semblables à madame de Noï ne vivent qu’en public, et nul ne pénètre dans le laboratoire discret où s’ébauchent tant de miracles, où se préparent tant d’adroites et éblouissantes combinaisons. Dans le jour, on ne la voyait jamais, et elle ne recevait personne ; peut-être, par un effet de cette seconde vue que possèdent toutes les natures supérieurement douées, avait-elle compris que toutes les suprématies ont besoin d’une auréole de mystère et de silence[30] ; que pour captiver l’admiration il ne faut pas livrer aux profanes les secrets du sanctuaire, et qu’on est bien près de briser l’idole quand on connaît l’intérieur du tabernacle. Comme certaines fleurs, elle avait peur des rayons du soleil, et ne s’épanouissait que vers le soir ; elle ne prodiguait qu’à certains moments ses parfums et son éclat, moments fugitifs qui disparaissaient sous une nuée diaphane, et s’éteignaient dans un silence embaumé ; et lorsque l’heure était venue, la fleur se refermait[31], enfermant dans son calice tous les insectes curieux et avides qui avaient bourdonné autour de sa tige.
L’existence de madame de Noï était donc une représentation continuelle de luxe et d’apparat. Elle ne vivait pas, elle trônait[32] ; le même éclat mystérieux et redoutable qui entoure certains mythes incompris de la fable, entourait sa personne, semblable à ce voile d’Isis que nul œil humain n’a jamais soulevé [33]. On la contemplait en silence comme quelque magnifique statue empreinte d’un sceau divin ; une sorte d’admiration respectueuse et muette sanctifiait sa personne et symbolisait son nom.
M. de Noï accompagnait rarement sa femme aux Bouffes et dans les soirées où elle allait. Les deux époux tournaient chacun dans un cercle différent. Ce n’était qu’à un moment consacré par les traditions conjugales qu’ils se rencontraient au moment du dîner. Le dîner était pour eux une espèce de rendez-vous d’honneur, de centre commun, où ils ne pouvaient pas se dispenser de se rendre. Cette concession faite, chacun rentrait dans son indépendance. M. de Noï sortait d’ordinaire immédiatement après le dîner ; pour madame, elle s’occupait alors de la grande affaire de sa vie ; elle s’enfermait seule avec sa camériste dans son cabinet de toilette, et vers neuf ou dix heures du soir, une vieille dame, nommée madame de Montmirau, venait l’enlever à sa solitude pour la lancer dans le monde. Tante de madame de Noï, cette madame de Montmirau servait de chaperon à sa nièce. C’était elle qui portait son éventail et rajustait de temps en temps les boucles de ses cheveux. Il y a dans le monde beaucoup de ces vieilles femmes qui s’attachent à la beauté, comme si dans ce magnifique concert d’éloges qu’on lui donne, elles espéraient accaparer quelque chose.
Tel était le couple avec lequel Arthur Raimbaut [34] allait se trouver accidentellement en relation. La lettre de M. de Noï [35], avec son post-scriptum mystérieux, n’avait pas laissé que de piquer sa curiosité, si blasée et assoupie qu’elle fût. Chez certains hommes, l’intelligence ne meurt jamais, et, semblable aux flots, il ne faut à l’instinct d’activité qui les pousse que le choc d’un caillou pour en soulever la surface et en faire jaillir l’écume endormie. Arthur était de ces hommes. En vain affectait-il une insouciance profonde et une incurie de toutes choses, un vague besoin de sentir et de voir l’agitait au fond ; en vain essayait-il de se faire complètement oublieux et désintéressé, derrière chaque promesse de la vie qu’il s’efforçait d’effacer surgissait une promesse nouvelle aussi active et aussi décevante. Il voulait se persuader que la vie lui avait dit son dernier mot, et au moindre événement humain son imagination s’éveillait involontairement, comme si à travers les brumes de l’avenir elle eût entrevu quelque attrayante perspective. En ce moment, il avait oublié toutes les incertitudes de sa position personnelle et toutes les nécessités de son rôle pour ne se souvenir que de l’appât offert à sa curiosité. Il espérait un mystère à découvrir, une énigme à deviner[36], et dans le vide de son cœur, cet appel fait à son imagination retentissait avec une incompréhensible sonorité.
Avant de se diriger vers la rue Saint-Georges, il était entré chez un des tailleurs qui garnissent les arcades du Palais-Royal, afin, comme il le disait en riant, de remonter sa garde-robe. C’était là une des nécessités de sa vie nomade de vivre au jour le jour, et de laisser à la merci du hasard ces soins de toilette qui préoccupent à un si haut degré les hommes dont l’existence est casanière et rangée. Pour Arthur, la parure était toujours un bloc, il s’habillait d’un coup selon les circonstances qui se présentaient. Image peut-être fidèle de sa vie aventureuse, sa garde-robe n’avait ni passé ni avenir. Ainsi que font les voyageurs qui laissent à chaque étape leur défroque de la veille pour une enveloppe nouvelle qu’ils laisseront demain ; ainsi faisait Arthur. Il avait donc endossé chez le tailleur dont nous venons de parler, tout un costume complet, aussi fashionable que possible. Sous les basques pincées d’un habit noir, il avait redressé sa taille haute et flexible, comme pour mettre d’accord sa personne avec son nouveau costume [37]. Sa main blanche et effilée se dessinait élégamment sous un gant jaune étroitement collé sur la peau, et les teintes brunes de sa figure s’éclaircissaient aux reflets lustrés d’un gilet de soie et d’un col de satin noir à bouts tombants. Son pied, enfin, apparaissait plus effilé sous le cuir verni d’une paire de bottes choisie le jour même dans l’atelier de Sakoski [38]. Par contre-coup, ses manières aussi avaient subi un notable changement ; sur les plis de ses lèvres, amèrement contractées d’ordinaire, errait le demi-sourire qui accuse une arrière-pensée d’amabilité et de séduction. Le spéculateur avait fait peau neuve ; la chrysalide s’était transformée ; il ressemblait presque à un de ces hommes qu’on est convenu d’appeler, dans la phraséologie mondaine, un homme comme il faut[39]. De ses attributs journaliers, deux seulement lui restaient, la chaîne d’or qui avait jeté de si éblouissantes clartés sur le fond obscur de la veillée de village[40] et dans l’âme de Marguerite Évon, et l’anneau mystérieux[41] qui encerclait la seconde phalange de son index comme un souvenir des temps évanouis et de ses espérances envolées.
Quand il fut arrivé à l’hôtel de M. de Noï, il monta lentement l’escalier qui conduisait au premier étage, et sonna doucement avec une discrétion affectée, en homme qui craint de trahir au premier abord son origine roturière et ses manières bourgeoises.
— M. de Noï !… dit-il au domestique en livrée qui vint lui ouvrir ; je me nomme Arthur Raimbaut.
II
Dans une petite pièce à bibliothèque, où d’épais rideaux tamisaient le jour, M. de Noï était assis auprès d’une cheminée à la Bronsac [42], dont les parois de cuivre poli renvoyaient aux dessins du tapis les reflets rouges et changeants du foyer. Chaudement enveloppé dans une robe de chambre ouatée [43], il penchait sa tête sur le dossier recourbé d’un large fauteuil, dans l’attitude d’une somnolence paresseuse ou d’un far niente[44] maladif. Sous les ondulations d’un bonnet de velours à la grecque[45], se détachaient quelques mèches de cheveux grisonnantes, qui se confondaient dans une teinte uniforme avec la peau amollie et ridée de ses tempes. Au bruit que fit la porte en s’ouvrant, il inclina légèrement la tête, et salua d’un coup d’œil seulement le nouveau venu, plutôt en forme d’interrogation que de reconnaissance.
— Je suis Arthur Raimbaut, dit celui-ci avec la politesse froide qui lui était habituelle.
— Ah ! enfin !… dit M. de Noï avec un accent d’impatience, et en montrant du doigt un fauteuil au spéculateur, soyez le bienvenu, monsieur ; mais je vous croyais plus d’activité et d’exactitude : voici quinze jours que je vous attends.
Par suite de ses anciennes habitudes diplomatiques, M. de Noï en parlant, avait fixé les yeux sur le visage d’Arthur comme pour deviner, par certains signes physiognomoniques à lui connus, à quel homme il avait affaire, et établir par induction son plan de conversation et de conduite ; mais la figure d’Arthur était de celles qui déjouent toutes les suppositions, et arrêtent au passage les regards des plus habiles observateurs.
— Monsieur, continua le diplomate, ma lettre vous aura déjà fait entrevoir la double nature de nos relations, il ne s’agit point ici d’un contrat ordinaire, où la volonté de l’acheteur et celle du vendeur pèsent seules dans les deux plateaux d’une balance ; nous avons un problème plus embarrassant à résoudre, une difficulté grave à trancher ; je vous ai promis ma confiance, et je tiendrai ma parole. Vous dînez avec moi, n’est-ce pas ?
Arthur fit un mouvement d’hésitation, et M. de Noï reprit aussitôt.
— Rassurez-vous, nous ne dînerons pas ici. La nature des confidences que j’ai à vous faire exige un lieu plus sûr. Nous dînerons seuls, tous deux, tête à tête ; on ne saurait trop craindre les échos de la maison conjugale.
M. de Noï avait prononcé ces mots en baissant les yeux, et avec l’expression d’humilité feinte ou réelle d’un novice qui s’apprête à confesser quelque gros péché qui charge sa conscience[46].
— Je vous remercie, monsieur, de vos offres obligeantes, répondit Arthur, et je vous prie de considérer ma visite comme une visite de politesse plutôt que d’intérêt. Je n’ai pas l’intention de vendre le château.
— Le prix que je vous en ai offert ne vous convient pas, reprit M. de Noï avec la vivacité d’un homme qui comprend de prime abord la nature des obstacles qu’on lui oppose, et se croit sûr de les surmonter. Eh bien ! nous ferons un sacrifice, nous irons jusqu’à trois cent mille francs.
— Je ne veux pas vendre, répéta Arthur.
Quoique la réponse fût assez péremptoire, M. de Noï ne voulut pas croire à sa sincérité[47]; comme tous les hommes habitués à compter sur leur perspicacité, il ne se tenait pour battu qu’à la dernière extrémité, et les obstacles doublaient encore son opiniâtreté ordinaire, en intéressant sa vanité.
— Allons donc, dit-il en regardant une seconde fois Arthur Raimbaut, qui, les pieds étendus, semblait occupé à considérer la flamme pétillante du foyer avec l’apparence d’une insouciance extrême ou d’une résolution inébranlable, voyez-vous donc dans les affaires autre chose que de l’argent à gagner ; n’appartenez-vous pas à la Bande-noire[48] ?
Arthur releva la tête, et regardant l’ancien diplomate avec ce demi-sourire des gens supérieurs en présence d’une curiosité ou d’un égoïsme subalterne dont ils suivent tous les détours et aperçoivent tous les fils :
— Monsieur, dit-il, pour vous épargner de nouvelles questions et des frais d’imagination inutiles, je vais tout vous dire : je suis las des affaires, j’ai besoin de repos, et je garde pour moi le château dont vous avez envie ; le pays où il est situé me convient, et s’il plaît à Dieu, j’y mourrai.
— Mais trois cent mille francs, monsieur…
— Mais le repos !…
— Mais la fortune !…
— Mais le bonheur !…
— Allons !… je vois bien qu’il n’y a rien à gagner avec vous, reprit M. de Noï après un instant de silence, et dissimulant sous un air de résignation jouée une arrière-pensée opiniâtre qui perçait encore en dépit de ses efforts :
— Au moins, vous ne me refuserez pas la seconde partie de ma requête : nous dînerons ensemble, n’est-il pas vrai ?
Sur un signe d’assentiment d’Arthur, il se leva alors, et offrit sa personne à l’investigation du spéculateur[49]. M. de Noï était grand et mince, sa figure, cave et rentrante vers le milieu, s’allongeait toute en profil, et offrait une vague ressemblance avec la lame évidée d’un sabre. Parallèlement au bras, sa poitrine formait une ligne étroite et creuse qui fuyait pareille à un entonnoir. Ses épaules, en saillie, empiétaient irrégulièrement sur l’embauchement du col, et s’arrondissaient en cercle sur le devant, comme pour ôter passage à l’air. Un médecin eût reconnu dans cet homme tous les symptômes de la phthisie[50]. Dans ces vaisseaux trop étroits le sang devait circuler avec peine, et ces membres en désaccord étaient nécessairement sujets à l’atrophie. Quoique peu initié aux secrets de la pathologie anatomique, Arthur possédait à un trop haut degré l’instinct des rapports physiques, ses données précédentes sur M. de Noï étaient d’ailleurs trop en harmonie avec le résultat de ses inductions, pour qu’il pût échapper à cette inévitable et terrible conclusion : poitrinaire [51] !…
— Un quart d’heure, et je suis à vous, dit le diplomate en descendant des hauteurs de sa supériorité de convention, pour prendre le ton familier d’un homme qui se plie de bonne grâce aux nécessités de la vie ordinaire.
Arthur resta seul, et une fois lancé dans le champ de l’analyse hypothétique, il ne s’arrêta plus. Tous les meubles de l’appartement où il se trouvait devinrent successivement l’objet de son investigation rigoureuse[52]. Il examina les couleurs du tapis, la disposition des rideaux ; il alambiqua[53], pour ainsi dire, le luxe extérieur de cet appartement fashionable [54], pour en extraire la signification cachée, pour en dégager l’esprit. Il y avait dans le salon dont nous parlons un mélange de sévérité et de recherche voluptueuse assez remarquable : la tenture en était sombre, et on eût dit que le plus grand soin du décorateur avait été de ménager des organes malades et des sens affaiblis. La lumière n’y avait pas droit d’asile. Le gros mobilier se composait seulement d’une bibliothèque et d’un bureau dont les teintes brunes se mariaient avec le ton général de l’appartement, et semblaient là, comme en certains tableaux de Rembrand [sic], pour épaissir les ombres. Mais, par un caprice singulier du maître, les mêmes ornements contrastaient remarquablement avec cette position première. Au lieu des gravures sévères qu’il eût été raisonnable de trouver dans une pièce ainsi arrangée, de petites aquarelles roses et fleuries couraient le long de la tenture, et présentaient à l’œil des profils de jeunes femmes, des étoffes chatoyantes, et ces reflets dorés que le pinceau de Devéria [55] a mis à la mode. Dans le choix de ces fantaisies perçait un instinct voluptueux à la fois et comprimé, comme est l’instinct des vieux libertins qui se complaisent, avec une ardeur croissante, à la représentation des plaisirs qu’ils ne goûtent plus, et des images qui les fuient. Il y avait, dans les aquarelles, de ces poses bizarres qui fouettent l’imagination et allument le sang. Elles retraçaient presque toutes quelques-unes de ces situations engageantes que les jeunes gens se figurent dans leurs rêves : c’étaient des yeux levés et trempés de larmes, une gorge à demi soulevée par un souvenir ou par une espérance ; des inclinaisons de taille pleines de cette morbidesse qui attire ; des serrements de mains, le soir, dans l’ombre ; des sofas au fond de tous les intérieurs, des médaillons suspendus au col, et de noirs cheveux retombant en désordre sur des épaules d’albâtre. Si, par un côté, le salon de M. de Noï ressemblait à la chambre d’un malade, par l’autre elle reproduisait les signes généraux de certains boudoirs, où les peintures fardées de M. Dubufe [56] sont devenues une nécessité.
Ainsi que le gros mobilier, les ornements de la cheminée étaient empreints de sévérité, comme pour signifier plus clairement que dans cet appartement la volupté ne tenait qu’une place furtive et honteuse, et que semblable aux coquettes [57], qui concilient la décence des manières avec l’abandon du cœur, elle ne pouvait se montrer que sous un masque de rigueurs. Mais entre des candélabres dorés et couronnés de bougies diaphanes, Arthur aperçut trois ou quatre de ces bagatelles qu’on trouve toujours éparses sur la cheminée d’un célibataire[58] tant soit peu initié aux secrets de la vie parisienne : c’étaient d’abord des gants blancs froissés et déchirés vers l’entournure du pouce, puis un porte-cigare en argent à demi couvert par les feuilles d’une rose de bengale fanée, puis quelques pièces d’or qui scintillaient par intervalles, pareilles aux yeux d’un chat dans la nuit. Arthur approcha et examina une à une toutes les pièces de cet inventaire désordonné ; il prenait délicatement la tige de la rose effeuillée, lorsqu’une espèce de carte jaune et ébréchée roula sous son doigt. En la regardant, une lueur subite parcourut son visage, il avait reconnu une de ces cartes qui servent de jalons aux joueurs sur la route du hasard, et qu’on nomme une ponte[59]. Il suivit de l’œil les nombreux coups d’épingles qui la traversaient, et la reposant sur la cheminée, il s’assit silencieusement avec cet air convaincu d’un homme qui vient de trouver la solution d’un problème, et comme il avait conclu : poitrinaire… il conclut : joueur !…
— Me voilà prêt, dit M. de Noï en rentrant, partons-nous ?
L’ancien diplomate attendait une réponse, lorsque, de l’autre côté du salon, une voix de femme lui répondit par ces mots :
— Monsieur, ne paraitrez-vous pas aujourd’hui au dîner ?
Au son de cette voix, Arthur se leva vivement, et se prit à détailler celle qui venait de parler. C’était une femme fraîche et jeune, mais avec cet éclat et ce poli d’une beauté qui se connaît et se cultive. Elle portait un peignoir d’étoffe laineuse qui ceignait sa taille sans l’emprisonner, et tombait mollement sur l’extrémité d’une pantoufle brodée en soie, qui accusait merveilleusement la finesse du pied ; ses cheveux, relevés vers le sommet de la tête et séparés des deux côtés par deux raies blanches, avaient cette transparence et ce lustre d’une glace qu’on craindrait de ternir par un souffle. Sa figure ressemblait à ces figures d’ivoires que les artistes de la Renaissance ont léguées à notre culte, tant les lignes en étaient harmonieuses et pures, tant par une imperceptible dégradation tous les traits se fondaient merveilleusement dans un ovale régulier ; seulement, c’était une de ces beautés trop parfaites pour qu’involontairement on n’y reconnût pas les traces du travail. On devait se dire, en la voyant, que la nature ne pouvait pas enfanter une création aussi complète, et malgré soi on songeait à ce mythe poétique de la beauté égoïste et préparant elle-même, et pour elle, un magnifique piédestal. Le seul caractère de cette figure était une sorte d’idolâtrie personnelle, de supériorité froide et dédaigneuse qui excluait toute idée de sympathie. On sentait instinctivement qu’une pareille femme était trop haut placée par son orgueil pour qu’aucun désir humain pût parvenir à monter jusqu’à elle[60]. Quoique sa toilette fût ce qu’on appelle un négligé[61], on y apercevait ce fini de l’artiste supérieur qui se révèle dans les fantaisies de son imagination comme dans les œuvres les plus hautes de sa pensée. Sous l’humilité du gynécée [62] perçait l’orgueil de la pourpre impériale.
En contemplant cette éblouissante image, Arthur Raimbaut était demeuré immobile et pensif, ainsi qu’un homme qui cherche à se rappeler les notes confuses d’une cantilène[63] presque oubliée, et à renouer les fils d’une tradition interrompue. Malgré l’étonnement qui l’avait saisi, son regard exprimait plutôt une attente interrogatrice qu’une muette et aveugle admiration. À cette belle idole qui posait devant lui, il ne disait pas : je vous adore, mais il demandait : Qui êtes-vous ?..
— Je dîne en ville, dit M. de Noï en prenant le bras d’Arthur.
Et ils sortirent tous deux.
Arthur marchait en silence. La vision qui venait de l’éblouir avait jeté dans son âme un ébranlement profond assez semblable aux secousses de la machine électrique[64]. M. de Noï parla le premier.
— Croiriez-vous, dit-il, que la femme que vous avez vue a passé sa jeunesse à la campagne ?
— Où ? demanda Arthur.
— Dans un château près de Lisieux, entre un vieillard et une vieille femme, son père et sa tante.
L’espèce de nuage qui couvrait le front d’Arthur se dissipa au souffle de ces paroles, et son regard terni et rêveur reprit sa lucidité habituelle. On eût dit que tout d’un coup le malaise intérieur qui semblait absorber sa pensée s’était dissipé sous un rayon de soleil, et que les brouillards qui voilaient son imagination avaient laissé tomber leur voile[65].
— Dans un château près de Lisieux, murmura-t-il, entre un vieillard et une vieille femme ?..
— Oui, dit M. de Noï avec un accent de plainte orgueilleuse, depuis ce temps l’oiseau a brisé sa coque, l’aigle a conquis son empire.
La conversation tomba de nouveau. Ils marchaient tous deux côte à côte, sans trop se soucier du but apparent où leurs pas et non leurs pensées tendaient. Seulement M. de Noï interrogeait de temps en temps la physionomie redevenue impassible de son compagnon, comme pour calculer d’avance les chances d’une tentative longuement préparée.
— Où voulez-vous dîner ? dit encore M. de Noï impatienté du résultat négatif de son investigation obstinée.
— Où vous voudrez, répondit Arthur ; pour causer affaires, on est bien partout.
Cette dernière phrase, lancée à dessein, annonçait chez ce dernier une résolution contraire à ses précédentes résolutions.
— Nous causerons donc affaires ? dit M. de Noï avec cette finesse inamovible de la diplomatie qui d’ordinaire cache dans le coin d’un post-scriptum le mot important d’une question.
— N’est-ce pas votre intention ? dit froidement Arthur.
M. de Noï entraîna alors son compagnon avec un empressement remarquable vers le premier restaurant qui s’offrit à sa vue, et tous deux s’assirent face à face, dans l’embrasure d’une croisée. Après de si longs détours, une explication nette et positive était enfin devenue inévitable. Arthur l’attendait avec ce demi-sourire de la perspicacité sûre d’elle-même, qui prévoit d’avance toutes les ruses et pressent toutes les embûches[66]. M. de Noï s’y préparait en silence, et couvait dans la méditation ses plans d’ouverture et ses moyens d’attaque. Il y a en toutes choses une stratégie mondaine que les esprits grossiers ne comprennent pas, et que les esprits fins gâtent en l’exagérant ; pour vouloir la tourner, on manque l’occasion. Dans le monde, comme à la guerre, la fusillade n’avance rien ; il faut du canon et des masses. Les hommes vraiment habiles sont ceux qui savent se tenir également à distance des deux excès contraires. On se perd aussi bien à marcher trop vite qu’à marcher trop lentement[67].
— Êtes-vous réellement décidé, dit M. de Noï, à ne pas vendre votre château ?
Arthur se tut un instant, comme s’il eût cherché une transition habile entre deux pensées contradictoires, et redouté de laisser entrevoir le motif de sa fluctuation.
— Écoutez, monsieur, dit-il d’un ton grave et solennel, je ne voudrais pourtant pas refuser votre proposition avant de vous avoir entendu ; comme service à vous rendre, peut-être l’accepterai-je.
— Monsieur, répondit le diplomate en baissant la voix, j’ai une confidence sérieuse à vous faire. Je vous la ferai franchement, sans déguisement, sans détour : une fatale passion, qui me maîtrise, m’entraîne à ma ruine ; je suis joueur, monsieur !
M. de Noï s’arrêta, semblable à un acteur qui attend l’effet d’un mot sur lequel il compte. Arthur demeura immobile et muet.
— Tout ce que tous pouvez me dire à ce sujet, continua celui-ci, je le sais d’avance. Le jeu est la plus mauvaise et la plus fatale des passions ; mais, monsieur, c’est par cela même qu’elle nous domine. Il est des maux qu’on ressent et qu’on juge sans pouvoir s’en guérir, il est des habitudes funestes qui nous suivent jusqu’au tombeau. On voit l’abime et on ne saurait fuir ; la voix de la raison vous crie vainement : « Arrête ! » une autre voix fatale et irrésistible vous crie : « Marche ! » et l’on marche ; on marche toujours jusqu’à ce qu’à la fin le pied vous glisse dans la fange ou dans le sang, jusqu’à ce qu’on tombe déshonoré ou mort. C’est une terrible chose, monsieur, que la passion du jeu !
M. de Noï avait prononcé ces mots avec cette sorte d’affectation théâtrale plus contraire à la vérité que la monotonie du débit le plus froidement accentué ; en l’écoutant, on eût dit plutôt un rhéteur s’échauffant à froid sur une matière à dissertation philosophique, qu’un homme aux prises avec la passion qui le déborde ; il reprit :
— Pour vaincre cette passion, monsieur, j’ai tout fait ; j’ai appelé à mon aide les conseils de la raison et de l’honneur. Chaque fois que j’essayais de remonter la pente fatale, un bras invincible me repoussait malgré moi, et la plus terrible chute était toujours la dernière.
— Enfin, monsieur ? dit Arthur du ton sec d’un médecin impatient de tâter du doigt la plaie et d’en sonder la profondeur.
M. de Noï se recueillit un instant, et mit la main sur ses yeux, comme pour écarter les terribles images qui s’offraient à sa vue.
— Ma fortune, dit-il à voix basse, est cruellement compromise, me comprenez-vous maintenant ?
— Pas encore, dit Arthur.
— Vous ne comprenez pas, reprit M. de Noï qui s’était levé et entraînait Arthur hors du restaurant, qu’il ne m’est plus possible de soutenir le train de vie que nous menons à Paris, qu’il faut que je vende mes chevaux, mon hôtel peut-être, qu’il faut que j’entraîne ma femme loin d’un séjour terrible que ma faiblesse, instruite par le passé, redoute pour l’avenir !
— Je comprends, dit Arthur en fixant les yeux sur ceux de M. de Noï ; vous voulez que je sois l’intermédiaire entre le coupable et le juge, que je vous épargne la honte d’un aveu, que je dise à votre femme : Madame, il faut renoncer au luxe qui vous environne, aux plaisirs qui vous assiègent ; vous pouviez être heureuse hier, vous ne le pouvez plus aujourd’hui ; vous étiez riche, le jeu vous a fait pauvre. C’est bien cela, n’est-ce pas ?
— Oui, s’écria M. de Noï en serrant la main d’Arthur qui s’était reculé d’un pas, comme pour terminer par une brusque séparation un entretien qui le fatiguait peut-être. Oui, vous m’avez compris, et que ferez-vous ?…
— Nous verrons, dit Arthur.
— Me quittez-vous déjà ? demanda M. de Noï.
— Mes affaires m’appellent, dit Arthur s’inclinant à peine ; et en s’éloignant il murmura : cet homme n’est pas un joueur, il a menti[68] !…
III.
Arthur Raimbaut habitait un hôtel de la rue Vivienne [69], et du milieu de sa chambre ses yeux pouvaient plonger sous l’entrée de cette galerie, dont la construction irrégulière et sans goût est rachetée par le luxe et l’activité qui la vivifient. À cette heure, le bruit des voix et le roulement incessant des voitures formaient un concert discordant à travers lequel perçait par intervalle le cri de quelques enfants, comme le sifflet du contre-maître[70]perce à travers les mugissements de la tempête. Cependant les pensées d’Arthur, se pressant en tumulte dans son esprit, semblaient l’avoir isolé de toute sensation extérieure ; il se tenait assis, immobile devant un feu brillant, les coudes appuyés sur les bras de son fauteuil, et soutenait à deux mains son front appesanti.
— Oui, cet homme a menti, répétait-il avec impatience, et s’il croit avoir menti avec adresse, je le désabuserai ! Mais pourquoi m’a-t-il trompé ? quelle passion plus forte, quel intérêt plus puissant dois-je substituer à la passion du jeu, au désir de s’y soustraire ? Je le saurai. Cet homme n’est plus maintenant un étranger pour moi ; ses actions, ses pensées m’intéressent, il me semble qu’il m’en doit compte. Le hasard nous a poussés l’un vers l’autre ; je suis venu chez lui avec une volonté aussi ferme que bien arrêtée, celle de rompre une affaire, et une apparition, et une évocation subite du passé[71] s’est jetée entre nous et le but que je croyais toucher ! M. de Noï n’a vu dans mon refus que cette finesse grossière qu’emploient les spéculateurs ; il a pensé que je faisais de la diplomatie commerciale, et, à cette heure, il en est plus persuadé que jamais. Oh ! pourquoi ce fil que je croyais rompu pour toujours s’est-il renoué tout à coup ! j’ai tout fait pour éloigner ma barque de cet écueil fatal [72] qui avait brisé mon bonheur, et d’un coup de vent la destinée m’y ramène ; j’ai dépensé toute mon énergie dans ces vains efforts, je me sens incapable d’une nouvelle lutte, et il me faut marcher les yeux fermés vers un dénoûment que je ne saurais prévoir.
Arthur voulait faire diversion à ces pensées, où les regrets, la perplexité, l’orgueil s’entrechoquaient violemment ; sa figure s’était contractée sous la pression convulsive de ses doigts, la sueur coulait de son front, ses lèvres tantôt se serraient avec force l’une contre l’autre, tantôt s’entrouvraient pour donner passage à un amer sourire.
Il prit un livre, l’ouvrit, et y jeta les yeux quelques instants, puis le referma avec impatience ; car il ne pouvait pas même réussir à y concentrer sa vue.
En dépit de lui-même, son âme inquiète interrogeait l’avenir, ou cherchait tout au moins à pressentir le lendemain ; mais aucune lueur distincte ne venait l’éclairer dans cette route nouvelle où il s’était jeté, il n’apercevait aucun point de repère auquel il pût attacher ses pensées ; seulement un vague instinct lui disait que l’issue de tout cela était prochaine, puisque tous les événements de sa destinée se trouvaient maintenant réunis.
Arthur se reportait alors à Saintry ; l’image de Marguerite lui apparaissait plus belle, mais plus triste que jamais, et son cœur se serrait péniblement. L’existence de cette femme s’était attachée fatalement à la sienne, comme une planète est attachée à une planète plus puissante[73], et se meut incessamment autour d’elle. En suivant son destin, Arthur entraînait irrésistiblement Marguerite ; il fallait qu’elle prît part au dénoûment qui se préparait, il fallait que cette tendre fleur s’inclinât sur sa tige au souffle de l’orage. Était-ce là ce qu’il avait promis à Henri, qui s’était reposé sur lui du bonheur de Marguerite ? encore une âme qu’il allait briser, encore un homme qui allait le mépriser et le haïr.
Ces réflexions devinrent trop poignantes pour qu’Arthur pût y résister plus longtemps, il se leva impétueusement, se promena à grands pas dans sa chambre, et se plaça à la fenêtre qu’il tint entr’ouverte ; un air vif rafraîchit son front, sa figure reprit un peu de calme, et il put considérer le spectacle qu’il avait devant les yeux.
Au commencement de la nuit, rien ne porte à la mélancolie comme l’aspect d’une des rues les plus actives et les plus tumultueuses de la capitale, lorsque vous assistez, sans vous y mêler, à ce tumulte et à cette activité. Tous ces êtres qui se succèdent si rapidement sous vos yeux, les uns préoccupés et à la démarche inquiète, les autres insouciants et à l’allure tranquille ; ceux-ci quittant un plaisir pour aller à un autre, ceux-là sachant à peine s’ils trouveront un gîte jusqu’au lendemain ; le riche blasé qui passe avec dédain devant les magnifiques étalages de l’industrie, le pauvre affamé qui s’arrête à toutes les boutiques et convoite toutes les richesses ; l’artisan satisfait de sa journée qui retourne à son repos et vers sa famille, le désœuvré qui se traîne à pas lents vers une nouvelle débauche : tous ces contrastes n’excitent-ils pas dans l’esprit de tristes réflexions sur les vanités de la vie humaine ?
Arthur n’accordait à ce panorama[74] mouvant qu’une attention banale, lorsqu’au milieu de cette foule, il reconnut l’homme dont sa pensée s’occupait encore, celui qu’il venait de quitter, M. de Noï.
Poussé par un de ces instinctifs mouvements de curiosité, dont les plus forts entre les hommes ont peine à se défendre, Arthur descendit précipitamment, et à trente pas devant lui, il aperçut l’ombre de M. de Noï, rasant la ligne obscure des maisons. De temps en temps un pâle rayon de lune illuminait mystérieusement sa haute stature et en faisait ressortir le profil maladif et les anguleuses inégalités.
La démarche de M. de Noï était vive et saccadée comme celle d’un homme en proie à une agitation intérieure, ou dominé par quelque pensée fascinatrice. Il allait tête baissée, tout d’une pièce, s’effaçant dans l’ombre de chaque renfoncement, pressant le pas devant chaque saillie. Dans cette espèce de course nocturne, dont il était difficile de prévoir le but, il y avait quelque chose de fiévreux, et, pour ainsi parler, de fatal, qui frappa l’esprit d’Arthur et lui souffla de folles et bizarres pensées. Cet homme ainsi pressé et haletant sous le poids de quelque caprice bâtard, fils de la nuit, ténébreux comme sa mère, n’était-il pas la plus complète image de l’humanité tout entière, se hâtant, convulsive, vers un but éloigné et obscur, et tressaillant à chaque pas de son voyage, sous le fouet de plomb de la destinée ?[75]
Un instant, les anciennes suppositions d’Arthur lui revinrent à l’esprit, et il eut envie de croire que M. de Noï était réellement un joueur ; car il n’y a au monde que deux passions qui impriment à l’allure d’un homme ce caractère d’agitation nerveuse et de précipitation inquiète : l’amour honteux, incandescent, rêvant l’assouvissement de ses désirs ; cet amour qui ressemble à une ardente sécheresse, à une soif inextinguible, et qui cause des nuits si cruelles et de si terribles insomnies ; et cette rage féconde en tourments toujours nouveaux, qui survit à toutes les ruines, domine toutes les émotions, absorbe à son profit tous les sentiments et les fond à son creuset comme l’or dans une fournaise : maladie dévorante qui ne laisse à l’âme ni merci, ni trêve, et la dévaste d’un souffle, la passion du jeu !
Il était à peu près onze heures du soir, et dans les rues que suivaient M. de Noï et Arthur après lui, les passants devenaient rares, et les lumières s’éteignaient peu à peu.
Après avoir traversé la Neuve-des-Petits-Champs[76], M. de Noï s’était jeté vivement dans la rue Sainte-Anne [77], rue silencieuse au milieu du bruit, rue obscure qui semble toucher à la lumière sans y participer, et qu’on prendrait pour un long corridor aboutissant à travers les ombres à un double foyer de clartés et de mouvements : le boulevard, avec son bruit toujours nouveau et ses perpétuelles ondulations de promeneurs ; le Palais-Royal, grand foyer parisien , où toutes les dorures, toutes les passions, tous les vices, et tous les provinciaux semblent se donner rendez-vous chaque soir.
En pénétrant dans la rue que nous décrivons, M. de Noï tourna presque imperceptiblement la tête, comme si, derrière lui, il eût laissé une inquiétude ou craint une surveillance vigilante. Puis, après ce court moment d’hésitation qui ne dura même pas le temps que nous mettons à le signaler, son pas se rassura, et il continua sa course, rasant toujours les maisons, augmentant ou diminuant de vitesse selon les répartitions de la lumière ou de l’ombre.
Arthur le suivait toujours ; cette course dont il essayait en vain de pénétrer le secret, et dont il ignorait le but, avait pour lui un attrait de curiosité et de mystérieuse obscurité qui l’attirait involontairement et échauffait par degrés son esprit. À voir ces deux hommes marchant ainsi à la clarté de la lune, vous eussiez cru voir ces deux personnages éternels du drame humain qui se complètent l’un par l’autre, et sont les deux bouts de cette chaîne qui se perdra peut-être où elle a commencé, dans une nuit profonde : la passion qui sent et souffre, et la science qui analyse, explique, commente, et le scalpel à la main cherche dans les entrailles fumantes des victimes le mot de ses énigmes, la solution de ses problèmes.
Vers le milieu de la rue Sainte-Anne, et à peu près à égale distance de la rue des Petits-Champs et de la rue Saint-Honoré, M. de Noï s’arrêta subitement comme sous la pression d’un ressort. La maison devant laquelle il demeurait immobile était à demi-enfoncée, et, pour parler le langage technique, effacée entre deux grands bâtiments, lourdes constructions où l’industrie et le commerce s’établissent à flots pressés d’étage en étage, comme un casernement de soldats ou une ruche d’abeilles. C’était une de ces petites maisons étriquées, sombres, chétives, comme un enfant débile [78], et qui semblent à peine tenir au sol. Il y a dans certaines rues de Paris, une prodigieuse quantité de ces maisons à mine équivoque, comme certains hommes [79], et qui produisent sur la vue et l’imagination je ne sais quelle impression de froid et presque de terreur involontaire[80].
Les fenêtres qui entrecoupent la façade de ces maisons sont généralement basses, rapprochées les unes des autres et fissurées vers leurs encadrements. La porte, qui sert d’entrée, n’est ni haute, ni brillamment vernie comme ces nobles portes des hôtels du grand faubourg, qui semblent porter à leur front un brillant écusson, et appeler hautement le soleil. C’est ordinairement une porte obscure, rentrante, et comme étouffée sous les planchers qui la surplombent. Entre M. de Noï, l’homme de mœurs élégantes, de dissipations mondaines, de manières distinguées et aristocratiques, et cette maison de si laide apparence, quel rapport pouvait-il donc exister ? Par quel lien le diplomate habile et compassé de la restauration était-il uni[81], fut-ce pour un moment, à cette habitation ignoble et devant laquelle il s’était arrêté ? en s’adressant à lui-même cette question, Arthur Raimbaut se sentit étonné et comme étourdi, lui qui depuis si longtemps se croyait au-dessus de tous les étonnements. Il y avait en tout ceci un mystère dont le mot lui manquait. Il entrevoyait les détails sans en pouvoir toucher du doigt le point culminant ; à l’édifice de suppositions qu’il bâtissait dans son esprit, il ne fallait plus qu’un point de départ, et pour ainsi dire, une clef de voûte.
La halte de M. de Noï fut de courte durée. Il frappa doucement à la porte, et par un mouvement machinal, Arthur s’avança comme pour entrer en même temps que lui ; mais la porte roula assez rapidement sur ses gonds et se referma presque sans bruit. La curiosité d’Arthur Raimbaut s’irrita par cet obstacle. Sans préméditation, presque sans arrière-pensée, sans se demander même ce qu’il répondrait à cette question de tous les portiers : « où allez-vous ? » il frappa à son tour, se trouva devant un escalier assez mal éclairé par une lumière venue d’en haut, et il entendit le bruit des pas de M. de Noï, qui le précédait d’un étage. Il s’arrêta un instant dans la crainte d’éveiller les soupçons du diplomate, puis il se remit en marche, se glissant le long du mur en tâtonnant et s’enveloppant d’obscurité. Il passa sans mot dire devant une loge petite et basse où une vieille femme, assise dans un grand fauteuil, semblait ensevelie [82] dans une sorte d’extase idiote et immobile, qui semblait participer de la joie, de l’ivresse et du sommeil ; la vieille femme le regarda en clignotant, et laissa tomber sa tête. Arthur n’eut donc pas besoin de répondre au qui-vive ordinaire, qu’il n’avait pas prévu.
M. de Noï montait toujours, et à mesure que l’escalier s’avançait vers le faîte de la maison, son obscurité devenait plus profonde. Arrivé au troisième étage, M. de Noï frappa à une petite porte qui donnait sur une espèce de palier où aboutissaient plusieurs sorties.
— Qui est là, dit une voix enrouée et comme éteinte ?
— Ouvrez ! dit le diplomate à voix basse.
Il y a certaines impressions dont les natures les plus fortes et les plus habituées à se dompter ont peine à se défendre. En entendant ces quelques mots échangés à voix basse et dans l’ombre, Arthur Raimbaut frissonna en reculant, il eut l’idée de fuir ; mais, après un moment d’incertitude, la curiosité, plus forte que le dégoût, le retint, il resta et franchit à son tour le troisième étage.
D’abord il demeura indécis entre les quatre ou cinq portes qui se croisaient ; mais bientôt un faible bruit fixa son attention et il approcha son oreille de la porte qui s’était ouverte quelques moments auparavant.
Arthur Raimbaut, en écoutant, se reprochait intérieurement sa faiblesse, et condamnait sa curiosité, à peu près comme un écolier qui se sent en faute et redoute le regard du maître. Les contradictions de sa nature l’étonnaient sans qu’il pût les vaincre, il se sentait faible avec la volonté d’être fort ; lui qui toute la vie s’était imposé un rôle et avait essayé d’imprimer à son masque la rigueur du fer, il succombait maintenant à la mollesse d’une âme irrésolue et mal apprise aux événements de la vie humaine. Pourquoi s’efforçait-il à cette heure, comme un vil espion, de saisir les murmures confus de quelque scène honteuse ? L’homme est ainsi fait que la plupart du temps ses actions donnent un démenti formel à ses paroles, à ses principes de conduite, et que bien souvent il se trouve en désaccord dans la pratique avec les maximes les mieux arrêtées dans la théorie.
Malgré son attention, Arthur ne put saisir qu’un bruit sourd et des paroles indistinctes. Et que voulait-il donc apprendre ? quel intérêt si direct le poussait ainsi et le ravalait à des démarches indignes de son caractère ? en était-il venu à cette époque critique qui marque toutes les existences, époque de relâchement et de faiblesse, où les caractères les plus résolus s’affaissent ? Une échappée de lumière furtive, en éclairant le palier, le tira de sa misérable préoccupation. En regardant au-dessous de lui, il aperçut, à l’étage inférieur, une femme parée comme pour un théâtre, qui montait, une chandelle à la main, et en fredonnant un refrain des rues[83] ; elle avait un chapeau rose qui projetait des reflets crus et faux sur un double bandeau de cheveux noirs et luisants ; sa figure aurait pu paraître remarquable sans l’expression de vulgarité qui la déparait ; son front était haut et lisse ; son nez, légèrement aquilin, aurait assez volontiers exprimé le dédain inné de la beauté qui se connaît, n’eût été le gonflement des narines qui en détruisaient l’harmonie générale et en paralysait l’effet ; ses lèvres étaient grossières, sans grâce et presque sans pensée. Cette femme passa devant Arthur, tenant toujours sa chandelle à la main, le regarda d’un air moitié curieux, moitié hébété, et monta lentement à l’étage supérieur sans tourner la tête.
Cette vision avait distrait Arthur en même temps qu’elle avait jeté dans son esprit une étrange lueur ; jusque là, son imagination n’avait pas osé aller aussi loin. Mais alors les contrastes qui l’avaient frappé dans l’appartement de M. de Noï, lui revinrent à la mémoire ; il se rappela toutes ces peintures agaçantes qu’on aurait dû trouver chez quelque vieux libertin plutôt que chez un homme jeune encore, et vivant, comme l’ancien secrétaire d’ambassade, dans une atmosphère de luxe, d’élégance et d’intrigue ; mais dans toutes ces représentations de la passion la plus grossière, encore trouvait-on ce vernis d’élégance, de bon goût, de distinction innée qui ne doit jamais manquer aux hommes d’un certain monde ; or il y avait là un désaccord, une solution de continuité dont Arthur ne se rendait pas compte. Puis, par une pente assez naturelle, il se trouva amené à se représenter la femme du diplomate, il revit cette éblouissante image de la beauté égoïste et parée, ces traits si fins, si purs et à la fois empreints de froideur et de dureté , cette pose gracieuse et théâtrale[84], ce geste impérieux et dominateur, tout ce magnifique ensemble où rien ne manquait, excepté peut-être une imperfection qui le rendît plus touchante, et, pour ainsi dire, plus sympathique.
Partie d’un pareil point de départ, quel cours suivit la pensée d’Arthur ? nous ne saurions le dire, mais peu à peu, il sembla oublier tout ; et appuyant sa tête sur la rampe de fer de l’escalier, il demeura enseveli dans une de ces profondes rêveries [85] qui semblent tracer autour de l’âme humaine un cercle infranchissable.
Tout à coup, un bruit de porte résonna à son oreille, et il se trouva face à face avec M. de Noï, qu’une femme éclairait en souriant.
À l’aspect d’Arthur, le diplomate ne put dissimuler une sorte de frémissement nerveux ; puis, par un mouvement rapide, lui saisissant le bras sans mot dire, il l’entraîna vivement d’étage en étage jusqu’à la porte de la rue, qui se referma sur eux.
Quand ils furent sortis :
— Vous m’avez suivi, dit M. de Noï.
— Oui, dit Arthur.
— Quel intérêt avez-vous donc, monsieur, à espionner ma conduite ?
M. de Noï avait prononcé ces mots avec une hauteur menaçante qui n’était pas dans ses habitudes de politesse dédaigneuse et d’insolence habilement ménagée ; au ton arrogant qu’il prenait, il était aisé de voir que la scène étrange qui venait de se passer l’avait irrité outre mesure.
— Monsieur, dit froidement Arthur, vous manquez en ce moment à la règle de prudence et de prévision qui a dirigé votre vie. De quelque façon que je possède votre secret, toujours est-il que je le possède, et, à moins que vous n’ayez, comme les Italiens, un poignard à votre service, je ne vois d’autre moyen de vous tirer d’affaire que d’être franc et, comme nous disons, nous autres gens du peuple, bon enfant[86].
M. de Noï s’arrêta, il était tremblant et évidemment agité par de terribles pensées. Il prit convulsivement la main froide d’Arthur, et la pressant dans sa main brûlante :
— Monsieur, dit-il d’une voix étouffée et sourde, n’épousez jamais une coquette !…
Il y avait eu dans l’accent de M.de Noï quelque chose de si profondément pénétré, de si fatalement douloureux, que le cœur d’Arthur vibra péniblement comme sous un courant électrique.
Ce mot, n’épousez pas une coquette, encadré comme il l’était par tous ces détails qu’Arthur avait successivement analysés, était gros de douleurs comprimées et inouïes peut-être. C’était comme le résumé de toute une existence vouée à d’indicibles souffrances.
Les lèvres de M. de Noï s’agitaient, comme s’il se fût parlé à lui-même ; il était dans un de ces moments de crise où les organisations les plus sensées sont confondues et bouleversées. Son esprit avait rompu toutes les digues, il ne se souvenait plus, il ne raisonnait plus, il souffrait, il était fou.
Il serra la main d’Arthur avec un redoublement d’énergie.
— On s’étonne dans le monde, ajouta-t-il, qu’elle ne soit pas mère, elle n’est pas même épouse !
Et il s’enfuit en disant ces mots[87].
IV.
Les confidences de M. de Noï avaient provoqué dans l’âme d’Arthur cette espèce d’étourdissement fébrile qui suit d’ordinaire certains rêves bizarres, certaines hallucinations maladives. Ce type de femme, qu’il avait entrevu d’abord à travers les explications de l’ancien diplomate, s’était complété dans son imagination, et lui apparaissait dans toute sa sécheresse orgueilleuse, dans toute sa monstrueuse grandeur[88]. L’instinct de la coquetterie, ainsi dégagé de tout sentiment étranger et de toute faiblesse humaine, prenait devant ses yeux l’aspect d’une de ces cristallisations qu’on trouve pendantes aux dentelures des rochers de la Norwége [89], et il en résultait pour lui une insurmontable impression de resserrement et de froid.
Où trouver le mobile de cette passion égoïste ? [90]
Comment expliquer cette tension continuelle de l’esprit vers un but vide, vers un résultat négatif ? cette déification de soi-même roide et décolorée, cette image d’une vanité s’enfermant dans sa pompe, comme un colimaçon [91] dans sa carapace, et traçant autour d’elle un cercle de feu, moins la lumière et la vie ? Par quelle série d’idées, par quelle suite d’événements cette femme en était-elle venue à ce point de rigorisme étrange, de stoïcisme obstiné qui méprise tout au monde, hommes et choses, et se fait un manteau de roi de son indifférence ? Le cœur de cette femme s’était-il pétrifié au contact de la vie, comme certaines végétations au contact de la rosée incessamment filtrante ? Le sang ne coulait-il plus dans ses artères ? le regard s’était-il retiré de ses yeux ? cette merveilleuse enveloppe d’une beauté idéale n’était-elle qu’un affreux mensonge qui cachait, sous un voile pompeux, une nature morte, un squelette d’âme, une statue de pierre ou de marbre[92] ? En interrogeant ainsi cette destinée fatale et mystérieuse Arthur se sentait saisi d’un dégoût inexplicable à la fois et d’une ardente curiosité[93]. Semblable à un voyageur, qui, penché sur le bord d’un abîme, écoute avec un mélange de secret plaisir et d’horreur instinctive les bruits étranges qui montent à son oreille, il ne pouvait se détacher de l’image qui le poursuivait, et il regardait en tremblant au fond de l’abîme. Un moment, il se souvint de cette froide statue qui éteint dans sa main de pierre la main chaude de don Juan[94], et il se sentit trembler ; c’est qu’il se passait dans son esprit une horrible métamorphose. Le vieux commandeur était devenu une femme, jeune, belle, avec tous les dehors de la vie et du bonheur ; et pourtant, comme le vieillard, la jeune femme était une froide statue, et, comme les mains du commandeur, ses mains étaient de pierre[95].
Dans la muette contemplation d’Arthur, peut-être aussi le souvenir avait-il sa part ? Madame de Noï était-elle donc, pour lui, autre chose qu’une inconnue ? tenait-il déjà quelques anneaux de cette chaîne qui venait d’aboutir à un si bizarre dénoûment [96] ? La grande coquette avait-elle laissé dans la mémoire du spéculateur quelques jours de son passé, quelques traces fugitives de son existence antérieure ? Il est permis de le croire ; Arthur n’était pas de ces hommes qui observent pour observer, et font de l’analyse le but unique de leur vie. Comment expliquer sa curiosité et les agitations de son esprit, sans penser que déjà sa vie, au moins par la pensée, s’était mêlée à la vie de madame de Noï, et, qu’en la retrouvant, il avait retrouvé des espérances ou des regrets vivants encore sous un voile d’oubli ? Qui sait même si le nom de cette femme n’avait pas rempli peut-être toutes les lacunes de cette vie inexpliquée, et soulevé les plus ardentes aspirations de ce cœur, qui s’était fait vieux et glacé avant l’âge ? Qui sait si ce n’était pas là le mot de cette énigme, si souvent pressentie par Henri dans ses conversations avec Arthur, et que celui-ci dissimulait sous l’ironie d’un sourire étudié ? Il y a presque toujours dans le cœur de l’homme, un coin inaperçu, un repli mystérieux qui se cache à tous les regards et défie toutes les ruses de l’observation. Chaque existence a son secret, qu’elle cache soigneusement sous les plis d’un manteau, comme le jeune Spartiate le renard qui lui dévorait la poitrine[97]. Pareille à certains échos de la vallée qui ne se révèlent qu’à certains moments, et sous le coup d’un choc électrique, cette portion de l’âme humaine reste ensevelie dans la nuit et dans le silence jusqu’au jour où la main du destin vient déchirer le voile qui la couvre, et remuer la flamme intérieure qui la consume. Ces masques vénitiens, qui cachent sous un air de fête toutes les passions et toutes les douleurs, sont une image assez fidèle de la vie : le sourire à la surface, les larmes au fond [98].
Un incident qui, sous une apparence banale, cachait un résultat profond, et, pour ainsi parler, une pointe acérée, vint encore mêler une agitation de plus aux agitations d’Arthur. Il reçut de Henri la lettre suivante.[99]
Il existe entre nous deux un engagement d’honneur que vous n’ignorez pas. Vous m’avez ravi l’amour de Marguerite, et je n’ai pas murmuré. Sous le coup qui me frappait, je me suis incliné sans me plaindre, et j’ai accepté courageusement mon sort ; mais j’exige de vous, et j’en ai le droit, que vous ajoutiez à la part qui lui revient, la part de bonheur que vous m’avez prise. Vous êtes responsable de son sort non-seulement [sic] devant elle, mais devant moi. Tout ce que j’aurais fait pour elle, il faut que vous le fassiez aussi. Il faut que vous l’aimiez comme je l’aurais aimée moi-même, afin que je n’accuse pas les arrêts de Dieu, et que je ne sois pas forcé de vous maudire. Songez-y bien, Arthur, votre vie est enchaînée, et si faible que soit ma main, jamais je ne laisserai échapper le bout de la chaîne. Si vous vous écartez de la route, je serai là pour vous y faire rentrer. Ma destinée est invinciblement unie à la destinée de Marguerite, et si vous brisez l’une, il faudra briser l’autre…[99]
Que faites-vous, à Paris ?… Elle vous attend et souffre. Revenez donc.
Arthur était assis dans une petite chambre sans feu, dont les meubles vieux et usés portaient l’empreinte particulière aux meubles des hôtels garnis ; sur un canapé couvert en velours jaune à rosaces, les habits de la veille gisaient éparpillés, et déjà fripés et sans lustre. Sur le marbre de la cheminée brillaient en serpentant les mailles de sa chaîne d’or ternies, et comme recouvertes d’un enduit de cendre et de poudre ; les draps du lit en désordre, et rejetés vers l’extrémité d’une couchette en bois de noyer, accusaient l’inégale pression d’un sommeil agité et nerveux[100]. On eût dit la chambre d’un joueur haletant entre les émotions de la veille et les émotions du lendemain. On eût dit un bivouac en temps de guerre, une halte de soldat. À la lecture de cette lettre, le front d’Arthur se couvrit d’un nuage de tristesse, et, s’appuyant sur les bras du fauteuil où il s’était assis, sa tête retomba lentement sur sa poitrine. Il demeura quelque temps ainsi, immobile et silencieux ; puis, peu à peu, ses yeux s’humectèrent, et, sur sa joue cave une larme tomba lentement, traçant à travers les rides du visage un terne sillon[101].
— Marguerite !… Henri !… murmura-t-il en accouplant ces deux noms comme les deux faces d’une pensée homogène, ou les pointes d’un double glaive !
À la fin, il se leva, et passant la main sur son front :
— J’ai promis, s’écria-t-il ; sur mon âme, je tiendrai ma promesse ; quoiqu’il m’en coûte, j’accomplirai mon devoir. Marguerite ! je ne t’oublierai pas. Fuyez donc, vains rêves du passé ; fuyez, trompeuse illusion de ma jeunesse ! Cette femme, Marguerite, cette image qui plane encore sur ma vie[102] à te rendre jalouse, si je la revois, que ce soit pour lui dire un éternel adieu !
Arthur marchait à grands pas. Comme il arrive dans l’enfantement des résolutions extrêmes, des gouttes de sueur avaient remplacé les larmes sur sa joue. En ce moment, cet homme, si fort en apparence, montait la route de son calvaire, et le fardeau de sa croix l’accablait[103].
Il s’habilla alors précipitamment, avec le calme mortel d’un homme qui veut en finir avec la vie[104], et s’achemina vers l’hôtel de Noï. Il était midi.
L’hôtel de l’ancien diplomate était muet ; on y sentait ce zèle de discrétion et de réserve que les habitudes des maîtres imposent nécessairement à leurs serviteurs. Toutes les portes étaient fermées, et le soleil de janvier, qui commençait à poindre à travers le brouillard, entrecoupait de ses pâles rayons de teinte grise des contre-volets soigneusement rabattus à toutes les fenêtres. À peine si deux ou trois domestiques interrompaient, du bruit de leurs pas, le morne silence de la cour d’entrée. Arthur monta l’escalier d’un pas ferme ; et, arrivé devant une petite porte qui conduisait aux appartements de madame, sonna sans hésiter. Au bout de quelques instants, la porte s’ouvrit à petit bruit, et une femme de chambre jeta sur Arthur un regard impertinent et curieux, en lui demandant à voix basse :
— Que voulez-vous ?
— Je veux parler à votre maîtresse, dit Arthur.
La femme de chambre recula d’un pas, poussant un petit cri d’effroi semblable au cri d’un oiseau qui se sent pris au trébuchet[105].
— Parler à madame ! à cette heure ?
— Ne craignez rien, dit Arthur en souriant ; votre maîtresse peut se montrer à moi sans danger : dites-lui que je suis un spéculateur, un homme d’affaires, un peu moins que son coiffeur.
Arthur était entré dans une antichambre complètement obscure, et attendit quelque temps encore, jusqu’au moment où une échappée d’air l’avertit du retour de la camériste.
— Venez, monsieur, dit-elle toujours à voix basse ; madame vous recevra dans son cabinet de toilette.
Après avoir traversé plusieurs pièces aussi obscures que l’antichambre, Arthur aperçut enfin une petite porte entre-bâillée, dont s’échappait un pâle rayon de jour.
La femme de chambre s’arrêta, avec l’expression du respect religieux d’un prêtre qui s’apprêterait à introduire un novice dans le redoutable tabernacle [106], et étendant l’index avec un tremblement craintif :
— C’est là, dit-elle.[107]
Le cabinet de madame de Noï était une petite pièce carrée que rapetissait encore la variété des objets dont il était encombré. Un demi-jour, semblable au rayonnement confus du crépuscule, prêtait à tout cet attirail de toilette, que les Romains appelaient si ingénieusement mundus muliebris [108], ces teintes idéales, cette physionomie fantastique que le mélange de la lumière et des ombres prête aux détails de la nature. Dans ce sanctuaire étrange, vous eussiez vainement cherché un meuble sans utilité, une bagatelle indifférente et seulement consacrée au luxe. Malgré l’encombrement apparent des objets, ils étaient tous groupés avec ordre, arrangés avec cette symétrie méticuleuse d’un enfouisseur, qui chaque jour apporte le même soin à l’arrangement de ses trésors, ou d’un bibliophile qui consacre ses veilles au gouvernement de ses livres. Ce qui d’abord frappait l’œil en entrant, c’était cette sorte d’éclat brisé qui jaillit d’un lustre à facettes et scintille en tous sens comme les rayons de la lune à la surface d’un lac. On eût dit une mosaïque de porcelaine et de verroterie tournoyant dans un cercle mouvant, et éparpillant en tous sens les reflets de son centre éblouissant. Après le premier coup d’œil, et quand on en venait au détail, une impression grotesque était la suite nécessaire d’une observation attentive, pareille à celle qu’on éprouve à l’aspect d’une de ces boutiques où les juifs étalent tous ces brimborions [109] dépareillés, tous ces riens que la fantaisie de quelques-uns déifient, et qu’on est convenu d’appeler des curiosités. C’était en effet le même luxe d’objets dépareillés et contrastants entre eux : des plateaux en porcelaine avec leur couvercle, des pots de toutes formes, des bouteilles soigneusement bouchées, comme les compositions de quelque alchimiste[110] du vieux temps, des coffrets en marqueterie, arsenaux toujours fermés qui ne s’ouvrent qu’à certaines heures, et dont les caméristes les plus initiées ignorent elles-mêmes le contenu. Il y avait là bien des secrets de femme irrévélés, et quiconque eût su faire de ce cabinet de toilette un inventaire intelligent et complet, eût été effrayé de cette supériorité si chèrement acquise, qu’on nomme la beauté. Au-dessus d’une toilette en acajou s’étendait une double rangée de boîtes qui trahissaient à l’odorat les parfums des savons de toutes sortes, et de ces poudres dentifrices que le charlatanisme renouvelle chaque jour. Puis c’étaient des pommades, des eaux balsamiques [111], des compositions étranges que certaines femmes du grand monde vont chercher seules, à pied, le matin, qu’elles cachent dans les plis de leurs manteaux, et conservent dans les meubles les plus discrets, dans les recoins les plus inaperçus de leurs appartements. Là chaque détail de la beauté avait son cortége [sic] à lui propre. En fouillant ce musée [112] tout féminin, on eût appris par quels procédés on peut rehausser la vivacité des yeux, et donner à la peau cet éclat et ce velouté qui se marient si harmonieusement le soir, à l’éclat des bougies ; comment on prévient cette couperose mortelle qui glisse sur le satin des joues, comme un ver rongeur sur des feuilles de rose ; comment on fait saillir l’azur des veines du cou[113], et ressortir la teinte purpurine d’une lèvre fatiguée. Tout était là ; à la lumière de ces mille détails, l’instinct de la coquetterie apparaissait splendide, et complet à faire peur.
Sur le dessus de la toilette se voyait une espèce de masque où se découpait seulement la place des yeux, enduit d’une couche blanchâtre et accusant encore l’empreinte chaude du visage ; et auprès une houppe[114] en plumes de cygne, qui servait à enlever l’enduit gras que le masque laissait après lui. C’était là une combinaison nouvelle, un de ces essais que la coquetterie risque chaque jour. Sur un pot en porcelaine ; on lisait ces mots : Baume d’Osman iglou[115] !… baume oriental, récemment mis à la mode, et qui doit détrôner tous les cosmétiques des parfumeurs parisiens. Plus loin, parmi des épingles noires, accessoire obligé de la coiffure, vous eussiez remarqué une sorte de pâte faite avec l’essence du coing, qui sert à fixer les cheveux en corrigeant toutes les inégalités de leur surface, et qu’on nomme la bandeline. Enfin, appendue à un clou et dans un des angles du cabinet, une calotte en cuir faisait ombre sur la tenture, préservatif obligé que trois ou quatre femmes ont imaginé pour garantir leur chevelure des atteintes trop corrosives d’un bain aromatisé.
Peut-être notre description pourrait-elle s’étendre loin encore, car notre science n’est pas à bout, mais nous ne voulons pas qu’on nous accuse de trahir tous les secrets d’un art si puéril aux yeux de certains hommes, si important, quoique à différents degrés d’application, aux yeux de toutes les femmes. Ce serait d’ailleurs une erreur de croire que le soin de la toilette est mort parmi nous ; seulement d’ostensible qu’il était, il s’est fait discret et hypocrite, comme presque toutes les passions et les croyances de cette époque. Les femmes n’admettent plus les hommes à leur petit lever, mais le fard et les eaux de senteur n’y manquent pas plus qu’autrefois.
En contemplant cet indescriptible tableau[116], Arthur éprouva ce frisson qu’on éprouve du contact d’un air humide et délétère, ou à la vue d’un tigre fixant sur vous sa prunelle ardente. La sensation de resserrement et comme d’oppression qu’il avait déjà ressentie augmenta d’intensité, il était atteint de cette trépidation maladive que le frottement de la soie, ou le déchirement aigu d’une lime communique aux natures impressionnables et nerveuses. Il se sentait effrayé à la fois et agacé, les dents lui grinçaient.
En apercevant Arthur, madame de Noï ne fit ni mouvement ni geste. Soit à dessein, soit par mégarde, elle était assise dans la partie la plus obscure du salon, et son profil diaphane se dessinait dans l’ombre avec l’indécision d’une silhouette. Celui-ci avança instinctivement vers elle comme pour la saisir et l’étreindre.
— Que me voulez-vous ? demanda madame de Noï en regardant Arthur avec ce dédain d’une supériorité qui se connaît et se proclame, et en donnant à l’accent de sa voix une acutesse[117] presque métallique.
Arthur s’assit sans répondre, et se tint immobile, avec un demi-sourire, semblable à un homme robuste qui brave la colère d’un enfant.
— J’aurais pu m’éviter cette question, reprit sèchement madame de Noï, car je sais pourquoi vous venez ; mais vous ne connaissez guère, monsieur, les convenances d’un certain monde (elle appuya sur ces deux mots), car vous devriez savoir qu’à midi une femme n’est jamais visible.
— J’ai déjà présenté à madame une excuse assez plausible, dit Arthur avec une politesse affectée, et en employant à dessein la formule d’une domesticité obséquieuse : un vendeur de maisons n’est pas plus homme [118] qu’un coiffeur.
— Est-ce bien là de l’humilité ? Demanda madame de Noï qui détaillait les traits d’Arthur avec un insolent sang-froid.
— Rien que de l’humilité.
Madame de Noï fit un mouvement en arrière, comme si le ton et l’attitude d’Arthur eussent laissé des doutes en son esprit ; peut-être s’étonnait-elle de ne pouvoir sonder d’un coup dans l’âme de celui qui posait devant elle ; peut-être pressentait-elle déjà, sans pouvoir se l’expliquer, cette influence que la supériorité exerce en dépit même de ceux qui en ressentent les effets ? Elle rapprocha d’un pas son fauteuil, et reprit ainsi :
— Vous venez ici, n’est-ce pas, comme intermédiaire de mon mari, me proposer l’acquisition d’un château à la campagne ? Eh bien ! monsieur, dites à celui qui vous envoie que je ne veux ni habiter la campagne, ni acheter un château ; j’aime Paris, et j’y resterai : ceci est clair.
— Très-clair, dit Arthur. Est-ce là le dernier mot de madame ?
— Véritablement mon dernier mot : je ne surfais[119] jamais.
Il y avait dans l’expression de madame de Noï, et dans la manière dont elle avait accentué la phrase empruntée aux usages commerciaux qu’elle venait de prononcer, une arrière-pensée d’ironie écrasante, et cette hauteur d’une reine qui souffre et se plaint d’être contrainte à traîner son manteau dans la fange populaire. Seulement, le dépit fit place à l’orgueil lorsqu’elle vit Arthur Raimbaut demeurer, en l’écoutant, impassible et presque souriant.
— Ce résultat, continua-t-elle, m’afflige pour vous, qui espériez sans doute recueillir un honnête bénéfice de cette affaire ; mais enfin, mon parti est pris, et ma décision irrévocable. Seulement, M. de Noï est trop juste pour ne pas vous payer de vos peines ; parlez-lui de cela.
Jusqu’alors, Arthur s’était tenu la tête baissée, dans une attitude d’humilité servile et de terreur révérencieuse ; tout à coup, il se leva et se redressa sur sa chaise, et arrêtant sur madame de Noï son regard lucide et plein d’une dignité dédaigneuse :
— Madame, dit-il, regardez-moi bien en face : ai-je l’air d’un laquais qu’on a le droit d’injurier pourvu qu’on le paye ? Vous n’êtes pas physionomiste, madame, car si votre œil était plus exercé, vous ne vous seriez pas méprise de la sorte. Vous êtes belle, madame, et il faut que les flatteries de vos courtisans aient bien faussé votre esprit, pour que vous vous croyiez le privilège de blesser sans mesure ceux même que vous ne connaissez pas.
La figure d’Arthur Raimbaut avait une expression de hauteur et d’énergie telle, que madame de Noï elle-même en fut troublée. Elle essaya pourtant de maintenir son regard au niveau de la supériorité railleuse qu’elle avait montrée, mais l’hésitation de sa voix trahit, en dépit d’elle-même, son émotion ; elle eût voulu paraître ironique et digne dans sa réponse, elle parut déconcertée.
— Je vous demande pardon, monsieur, d’avoir cru qu’un spéculateur spéculait, qu’un marchand tenait à vendre sa marchandise, qu’un courtier devait tenir au payement de son courtage[120]. Je vous ai fait injure, monsieur ; mais alors expliquez-moi pourquoi vous faites le métier que vous faites. Vendez-vous des châteaux, comme on dit, en amateur ?
— Ceci est une question, dit Arthur en adoucissant pourtant la rigueur de sa voix, et vous n’avez pas été assez polie, madame, pour que je me croie obligé d’y répondre. Ma mission est maintenant remplie ; vous m’avez donné votre réponse ; je n’ai plus rien à faire ici.
En disant ces mots, Arthur se leva pour sortir.
Par quelle révolution[121]réservée par laquelle il venait de terminer une conversation si bizarrement nuancée, quoique si brève, tout cela avait-il remué les ressorts d’une organisation débile, comme toutes les organisations féminines, malgré son extérieur roide et ses apparences anguleuses ? Peut-être sera-t-il permis à ceux qui ont étudié tant soit peu les péripéties du cœur humain, de se livrer, non sans quelque fondement, à de pareilles hypothèses.
Quoi qu’il en soit, sa physionomie changea subitement, comme si un souffle amollissant en eût détendu les muscles, sa voix elle-même descendit de l’octave aigre et sifflante où elle s’était tenue jusque-là à une octave harmonieuse et douce qu’on ne lui aurait pas supposée. La curiosité avait pris pour un instant le dessus sur l’orgueil, le tigre endormait sa proie pour la déchirer peut-être.
— Si je vous ai blessé, dit-elle, blessé dans votre honneur, j’en suis fâchée sincèrement, monsieur ; ne voulez-vous pas me pardonner ? mais, en vérité, je suis plus fâchée encore de voir un homme comme vous exercer un métier qui, après tout, n’est ni brillant ni honorable.
Arthur était occupé à contempler madame de Noï. Malgré lui, ces traits si purs, cette bouche si fraîche et si finement modelée, ces cheveux qui, dans le demi-désordre du matin, s’enroulaient autour du front en boucles capricieuses avec une grâce qui manque à la plus désespérante perfection, cette noblesse d’une taille souple qui n’avait pas encore pris sa roideur solennelle et ses poses de représentation, ce son de voix qui remuait si doucement les nerfs, sinon le cœur, cette espèce d’amende honorable faite avec tant d’art qu’on eût pu la croire naturelle et franche, tout cet ensemble de grâce inimitable et d’égoïsme, de roideur froide et de royale beauté, produisit sur Arthur l’effet magnétique de ces liqueurs fermentées qui brûlent et rafraîchissent à la fois la poitrine. Il éprouvait cette espèce d’âcre plaisir que les poëtes éprouvent à l’aspect d’une belle atrocité [122].
— Un métier ni brillant ni honorable ! dit Arthur en se rasseyant. Devriez-vous donc juger les hommes sans connaître le mobile qui les fait agir ? Quand on ignore les causes, est-il permis de blâmer les effets[123] ? User sa vie en de misérables intrigues, en de pauvres spéculations d’argent, saisir au passage les caprices de la fortune et les exploiter à son profit, comme un joueur qui calcule, autour d’un tapis vert, les chances probables du hasard, oui, sans doute, c’est là un misérable métier ; mais si au bout de ces calculs mesquins vous mettez une passion à assouvir, une vengeance à satisfaire, le métier devient sinon louable, du moins grand. Eh bien ! moi, je me venge, madame[124] ! Contribuer pour sa part à démolir pièce à pièce toutes ces aristocraties orgueilleuses qui pullulent sur le sol, humilier ces grands de la terre, qui mettraient volontiers le pied sur les petits pour se servir d’eux comme de marchepied, se faire l’instrument d’une œuvre de destruction et de ruine au profit du pauvre contre le puissant, assister aux dernières luttes de la fortune qui tombe, de l’orgueil qui s’éteint, mettre à son tour le pied sur la tête du noble insolent qui la veille vous regardait en pitié, c’est là un plaisir qui ne le cède à aucun autre, et ce plaisir est le mien[125] ! Oui, chaque fois qu’un de ces magnifiques domaines, qui semblent insulter à la misère du peuple, me tombe entre les mains, il me semble remplir, en le détruisant, une mission de justice et d’expiation ; il me semble que le haut propriétaire s’incarne dans sa propriété, et qu’en démembrant l’une, c’est l’autre que je déchire. Quand je pose mon pied, taché de boue, sur les dalles de quelque salon aristocratique, une indicible joie me monte au cœur ; je me sens fier, heureux ; je crois tenir en mes mains un maître détesté que je terrasse en l’insultant. Voilà pourquoi je fais le métier… [126] que je fais ; voilà pourquoi je me suis résigné à subir toutes les humiliations, à dévorer toutes les injures, à boire tous les calices. Qu’importe ! pourvu que mon œuvre s’accomplisse ; qu’importe ! pourvu qu’un jour, en contemplant les solitudes d’un noble château, je puisse me dire : « Encore un soleil qui tombe, encore un grand nom qui s’éteint ! » Et voilà dix ans, madame, que ma vie est enchaînée à cette pensée unique ; voilà dix ans que je porte sans rougir, sur mon front, cet écriteau qui vous fait sourire de mépris, vous autres gens titrés, gens de cour et de salon : la Bande noire[127]. Riez donc ! mais prenez-y garde, cette Bande noire, à peine digne de vos sarcasmes, représente un instinct terrible et général, un instinct de haine et d’empiétement ; la Bande noire, c’est le peuple qui, las de donner pour rien ses secours à ceux qui possèdent, veut posséder à son tour ; c’est la bête de somme qui, fatiguée de ses travaux du jour, se rebute et regimbe ; c’est l’esclave qui mord sa chaîne en attendant qu’il puisse la briser. La société, c’est un vieux théâtre de foire, et les acteurs subalternes veulent à leur tour jouer le premier rôle. Le paysan souffre sous son mauvais sarrau[128] de toile, et demande aussi des paillettes à son habit et des plumes à son chapeau. Tous ceux qui ont faim veulent avoir part au festin. L’intelligence ébranle incessamment cette insurmontable barrière, qui établit entre les hommes ces injustes et dérisoires distances que vous nommez, je crois, des mésalliances, vous autres. Prenez garde ! l’orage menace, chaque jour apporte sa vague, et demain, peut-être, le torrent envahira tout, hommes et titres[129] !
Arthur avait dans la voix des vibrations aiguës, semblables aux déchirements de la scie ; sa pâle figure s’était colorée de teintes rouges, son œil brillait avec l’expression fougueuse d’un tribun, son geste accusait cette violence saccadée et brève d’une nature nerveuse qui s’est longtemps contenue, et qui éclate à la fin sans ménagement et sans mesure ; la rage d’une illusion perdue[130], d’un bonheur manqué débordait en lui ; l’anathème avait succédé à la plainte ; il ne gémissait plus, il maudissait. Madame de Noï l’avait écouté avec cette sorte d’attention indifférente qu’on accorde, au théâtre, à ces scènes exagérées qui étonnent sans émouvoir ; elle le regarda en souriant :
— Vous détestez donc bien ceux que vous nommez les grands de la terre ? ou, pour me servir d’une expression déjà fameuse, les aristocrates[131] ?
— Je les déteste, dit Arthur avec un frémissement étrange.
— Détester les hommes !… dit madame de Noï ; c’est trop : les mépriser, à la bonne heure !…
Madame de Noï avait prononcé ces mots avec ce calme du scepticisme qui se joue de toutes les croyances, avec cette froideur d’une conviction sèche et railleuse, qui domine toutes les passions. Sa voix ressemblait au souffle d’un aspic qui glace le sang avant de le boire [132]. Le mot de mépris, en passant par sa bouche, avait la puissance engourdissante de la torpille[133].
Un frisson mortel figea le sang dans les veines d’Arthur, comme si on lui eût appliqué sur le cœur la lame froide d’une épée ; il sentait combien le mépris de cette femme dominait sa haine, et l’écrasait. Cette impression de froid ne fut pas de longue durée. Arrêté dans son cœur, le sang se précipita de nouveau avec une violence concentrée, et sans rejaillir au dehors. La colère, qui enflait ses veines, n’était plus une colère éclatante et active, c’était comme un levain aigri qui fermentait silencieusement au fond de ses entrailles. Par un seul mot, madame de Noï avait, en les comprimant, ravivé ses blessures, et sur elle seule il accumulait tous ses ressentiments.
— Et d’où vous vient cette grande haine ? dit madame de Noï avec le même accent calme et presque somnolent qu’elle avait pris.
La figure d’Arthur était redevenue paisible, et il souriait à son tour.
— Ceci est mon secret, dit-il, et madame de Noï a-t-elle le droit de m’adresser une semblable question ? La grande dame est toujours la même que la petite fille, et les salons de Paris, à ce qu’il paraît, n’ont pas changé les habitudes du château de Saint-Vallier[134] : toujours du mépris et de la curiosité.
— Me connaissez-vous donc, monsieur ? demanda madame de Noï étonnée.
— Non, dit Arthur négligemment ; et d’ailleurs, ce n’est pas de cela qu’il s’agit ; permettez-moi de replacer la conversation sur son véritable terrain. Je suis ici l’agent de votre mari : souffrez que je vous parle en ce nom. Si je vous disais : « Madame, il faut renoncer à tout ce luxe qui vous environne, à cette pompe de tous les jours dont vous vous êtes fait une habitude ; il faut dire adieu à tous ces triomphes de l’orgueil satisfait qui, à défaut de bonheur réel, remplissent votre vie ; il faut vivre dans un château, à la campagne, sans entourage, sans courtisans, sans flatteurs ; il faut redescendre du trône où vous êtes assise, et rentrer dans les humbles limites d’une vie obscure ; il faut abdiquer la couronne, et la laisser passer aux mains d’une plus digne ou d’une plus heureuse » ; si je vous disais : « Votre règne est passé, madame ; la fatalité vous a prise et va vous soumettre à son niveau de fer… » Eh bien ! madame !…
— Je ne vous comprends pas, dit madame de Noï.
— Vous allez me comprendre. Je vous parlais tout à l’heure de ces fortunes qui s’éparpillent, de ces grands noms qui s’éteignent ? Votre fortune, madame, n’existe plus ; votre mari est joueur, et il a perdu.
Pour la première fois, madame de Noï changea d’attitude, et sur sa figure courut cette espèce de tressaillement nerveux, symptôme des émotions profondes. Elle regarda longtemps celui qui parlait, comme pour comparer sa figure avec son langage, et tirer de cette comparaison une solution favorable.
— Dois-je vous croire, monsieur ? dit-elle à la fin ; ce que vous dites est-il vrai ? n’est-ce pas un piège que vous me tendez ? n’est-ce pas encore en ce moment une œuvre de vengeance que vous accomplissez ?
— Ce que je dis est vrai, et maintenant c’est vous qui êtes troublée à votre tour. Ah ! je conçois qu’une pareille nouvelle vous afflige. Il est dur, quand on ne vit que par l’orgueil, de renoncer aux jouissances de l’orgueil ; il est dur de perdre, d’un seul coup, toutes les adorations impuissantes de ces hommes que vous méprisez.
Arthur semblait prendre un étrange plaisir à prolonger l’accentuation de ses phrases, comme pour les enfoncer plus avant dans le cœur de la grande coquette. Dans cette lutte de deux natures obstinées et fortes, la chance avait tourné, et c’était le vaincu qui écrasait à son tour le vainqueur. Il reprit ainsi. :
— Et savez-vous pourquoi vous méprisez tant les hommes ? je vais vous le dire, moi. C’est que, jusqu’à présent, un homme seul vous rendit votre mépris, et que cet homme existe ; écoutez-moi, j’ai une histoire à vous raconter.
Madame de Noï était interdite et muette ; elle voyait confusément passer devant ses yeux d’inexplicables visions. Arthur continua.
— Il y a quelque dix ans, vivait, dans un château près de Lisieux [135], une jeune fille de grande maison, toute jeune et toute belle, aussi belle que vous ; un petit pâtre, un gardeur de moutons (sauf votre respect), s’était épris de la belle demoiselle, et, comme il convenait à un pauvre enfant sans fortune et sans avenir, il aimait respectueusement et en silence. Un jour le petit pâtre trouva, dans un buisson, un anneau qui appartenait à la jeune fille, et il alla bien vite le lui porter.
— « Combien veux-tu pour ta peine ? lui dit-elle avec ce ton de mépris[136] ordinaire aux demoiselles de bonne maison.
— Rien, dit le petit pâtre, mais je garde l’anneau. » Il l’a gardé toujours.
Arthur s’arrêta, et tirant de son doigt un anneau d’or qu’il présenta à madame de Noï :
— Cet anneau, le voilà, reprit-il ; le petit pâtre s’est fait homme, et cet homme vous méprise autant que vous méprisez les hommes. [137]
En finissant, Arthur se leva, et jetant sur la grande coquette un dernier regard, il s’inclina et sortit.
V.
Depuis l’entrevue que nous venons de décrire, deux mois s’étaient écoulés [138]. Retiré au château, Arthur n’en sortait plus ; il n’avait pas cherché à revoir madame de Noï. Il affectait dans son humeur, dans son langage de tous les jours, cette indifférence stoïque, cette résignation victorieuse d’un homme qui vient de rompre avec ses souvenirs, et renie courageusement son passé. Dans ses entretiens avec Henri, il était toujours affectueux et bon, mais sans épanchement et sans confiance ; on eût dit que cette âme, longtemps combattue et agitée, s’était repliée sur elle-même, comme la pierre d’un tombeau, et que le dernier rayon de vie qui, quelque temps auparavant, en colorait encore la surface, avait disparu sans retour, perdu dans la nuit du doute et d’un découragement sans bornes. Ainsi qu’un solitaire des anciens jours, il avait tiré le voile sur sa face ; le sphinx n’avait plus ni voix ni regard ; l’énigme de cette vie, un moment entrevue, était murée désormais, et la lumière brisait ses rayons impuissants sur une statue de granit. Sur ce fond obscur et triste, Marguerite seule se détachait, ombre splendide, quoique déjà ternie par les larmes, et à demi cachée sous le pâle nuage des douleurs. Assez souvent, le matin, on la voyait traverser silencieusement la grande avenue du château, un panier au bras, et non plus comme autrefois rayonnante et fière, mais humble et pensive, la tête baissée, regardant obliquement autour d’elle, comme si à travers les rameaux desséchés des arbres elle eût aperçu de menaçants fantômes. Ce luxe de beauté et d’ardente énergie, qui la caractérisait naguère, s’était déjà évanoui avec ses songes du premier âge. Les tons chauds de son front s’étaient fondus et amollis, comme les lèvres d’un jeune homme sous les premières atteintes des voluptés mordantes de l’amour. Son regard, si puissant et si plein d’ardents appels, se faisait inquiet et mélancolique. Sa démarche même se ressentait de cet abattement qui accablait son cœur. À la voir ainsi, l’idée fût venue à un poëte de quelque majesté déchue et découronnée ; et quand parfois son œil lançait un éclair, c’était plutôt une de ces clartés froides et sans chaleur, qui se font jour à travers les glaces du pôle, qu’une de ces franches échappées de flammes qui, pendant l’été, couronnent les montagnes, inondent les vallées. Marguerite n’était pas restée longtemps debout sur ce magnifique sommet qu’elle avait entrevu dans ses rêves. La main de fer de la réalité avait déjà nivelé cruellement les dangereuses saillies de son imagination hâtive. Un moment ravie au ciel, sur des ailes de feu, elle avait subitement retourné la tête, et elle avait eu peur. À chaque instant cette exclamation des illusions perdues, des regrets naissants était prête à s’échapper de sa bouche : Ô bonheur ! pourquoi m’as-tu trompée !…
Les femmes subissent toutes les angoisses de cette chute terrible, de cette commotion mortelle, qui les précipite en un moment des hauteurs du ciel aux profondeurs de la terre. Toutes sentent le pied leur glisser sur cette pente de l’amour, si perfide et si glissante. Demandez-leur si elles ont aimé : et si elles n’en rient pas, soyez sûres qu’elles en pleureront. Marguerite en était aux larmes. Bien qu’Arthur employât toute l’énergie de sa volonté à l’affermir et à la consoler, bien qu’il essayât, avec l’ardeur que donne le sentiment du devoir, de la retenir dans sa chute, bien qu’il lui tendît la main en souriant, et l’arrêtât au bord de l’abîme, Marguerite comprenait instinctivement que le dévouement n’est pas de l’amour, et sous les caresses et les tendres paroles d’Arthur, elle sentait percer les efforts du sacrifice, et la douloureuse contention d’une volonté qui s’immole. Alors, au milieu de sa tristesse, il lui venait par intervalle une amère irritation, et cette colère de l’orgueil, derniers vestiges de sa première nature. Ainsi qu’un naufragé qui lutte contre les flots, et essaye de se reprendre à la vie, sa main se crispait comme pour atteindre une ombre fugitive, une insaisissable espérance.
Au milieu de ces agitations continuelles, de cette lutte constante, quoique étouffée, Henri seul demeurait le même ; toujours attentif, dévoué, énergique ; dans le silence de la résignation et de l’attente, il comptait en lui-même les larmes de Marguerite, et souffrait de ses douleurs pour le présent et pour l’avenir, car il entrevoyait clairement le dénoûment de ce triste drame, qui, malgré lui, s’était noué si vite et l’avait enveloppé dans ses replis. Avec Arthur, il était silencieux, mais non plus troublé et timide. Son attitude était plutôt celle d’un juge qui sonde du regard la conscience du coupable, que celle d’un ami discret, qui respecte les secrets d’un ami, et baisse la tête en signe d’infériorité. Chose singulière, et pourtant facile à expliquer : cette âme de poëte, si mélancolique naguère, et si doucement naïve, avait grandi et s’était fortifiée. La douleur lui avait mis sur les épaules sa robe virile ; il s’était fait homme en devenant martyr. C’est là d’ailleurs un phénomène, depuis longtemps révélé, que les larmes nous vieillissent avant les années, et que parmi les hommes les plus vieux furent les moins souffrants. Quelquefois, lorsque Marguerite passait furtivement devant lui, Henri la regardait aller, en hochant tristement la tête, comme pour dire : « Vous que j’ai aimée, êtes-vous heureuse sans moi ? » Jamais, du reste, il ne lui parlait, et il évitait même de se montrer à elle. Comme un ange invisible, il se contentait de veiller mystérieusement sur cette vie menacée dans ses plus chères illusions. Il était le protecteur et le gardien de cette femme, à son insu, et malgré elle peut-être.
Telle était la situation des principaux personnages de cette histoire, lorsqu’un incident nouveau vint imprimer à cette vie active au fond, quoique inerte en apparence, un redoublement de vivacité et de mouvement[139]. Par un dimanche du mois de mars, une calèche s’arrêta devant la grille du château. Quelques nuages d’azur, éphémères avant-coureurs du printemps, se détachaient sur un ciel gris et pluvieux. C’était une de ces journées mêlées de pluie et de soleil, qui semblent participer à la joie des mauvais jours qui s’éloignent et des beaux jours qui vont commencer. Dans la campagne, quelques rares bourgeons de verdure accidentaient déjà la perspective, et les jeunes bouleaux se revêtaient hâtivement de leur robe blanche et lissée. À côté des vieux chênes mornes encore et grisâtres, comme des vieillards au front chauve, surgissaient de rares touffes de genêts verdoyants, et, sous la mousse humide, la violette cachait en tremblant ses frileux trésors. La nature avait cet aspect d’enfance chétive, de force naissante et peureuse qu’on pourrait comparer à la physionomie frêle et rougissante d’une jeune malade, moitié épanouie, moitié mourante, et qui hésite entre les invitations séduisantes de la vie et les appels irrésistibles du tombeau. Dans le village que la calèche avait traversé, ce symbole d’opulence inattendu avait produit une de ces sensations profondes dont les voyageurs sont si souvent la cause et les témoins. Jamais d’ailleurs, les habitants de Saintry n’avaient été si bien disposés à ces impressions de curiosité naïve, que l’amour du merveilleux et de l’imprévu fait naître dans les imaginations inactives d’ordinaire. Il y avait assemblée dans le village ; c’est-à-dire que tous les hommes, au lieu de vaquer à leurs travaux journaliers, avaient empli, dès le matin, les cabarets ; et les femmes, parées de leurs plus beaux atours, s’étaient rendues à l’église, ce rendez-vous de la dévotion et de la coquetterie, les jours de fête. Dès que l’élégante voiture eut traversé, au galop retentissant des chevaux, la grande rue du village, des groupes curieux s’étaient formés sur son passage, et tous les regards avaient avidement contemplé le lustre aristocratique d’une caisse légère et nouvellement vernie, les livrées galonnées des valets, et le brillant des harnais garnis d’argent. Seulement, la curiosité n’avait pas pu pénétrer plus loin. Tendus par l’humidité, les stores cachaient aux yeux l’intérieur de la voiture, et tout au plus apercevait-on, sur la surface trouble du verre, se dessiner deux ombres indécises, semblables aux silhouettes d’une fantasmagorie mal éclairée.
Les deux personnages qui occupaient l’intérieur de la calèche, descendirent ensemble devant la grille, et s’acheminèrent vers le château ; c’était M. de Noï, et sa femme, ce type de coquetterie royale que nous nous sommes complu à décrire minutieusement. M. de Noï, quoique les rigueurs de l’hiver se fussent déjà sensiblement adoucies, était enveloppé d’une grosse redingote garnie de fourrure et ouatée ; mais, malgré cette apparence frileuse et maladive, sa figure s’épanouissait plus gaie que de coutume, et sur son front rayonnait ce contentement d’un projet réalisé, d’une espérance longtemps comprimée, et qui se fait jour au-dehors ; sa démarche, pesante d’ordinaire, et roide comme celle d’un soldat prussien façonné au joug et rompu aux exigences de la parade royale, était devenue légère et presque sautillante, comme celle d’un écolier qui, au sortir de la classe, respire joyeusement l’air libre et pur des champs. Lorsque, un pied appuyé sur le marchepied, il présenta la main à sa femme, il la salua d’une de ces gracieuses inclinations de tête qui ressemblent au remerciement d’un courtisan, ou à l’invitation timide d’un amoureux. Il y avait, dans toute sa personne, quelque chose d’heureux et comme d’allégé [140] ; on eût dit que le fardeau qui déprimait sa poitrine devenait moins lourd et plus supportable. Pour madame de Noï, un grand changement s’était aussi opéré en elle, et il eût été facile, à un observateur, de reconnaître au premier coup d’œil les modifications qu’elle avait subies, sinon d’en deviner la cause. Les signes extérieurs, après tout, ne sont pas aussi futiles que quelques-uns voudraient le faire croire. On pourrait dire de la toilette, ce que les Italiens disent de la physionomie, qu’elle est le miroir de l’âme. La mise de madame de Noï, quoique élégante et riche, n’avait ni cet apparat, ni ce fini qu’on eût été en droit d’attendre d’elle. Cette négligence, qu’on pourrait appeler la morbidezza [141] de la toilette, s’y faisait remarquer, et un peintre y eût trouvé ce quelque chose de lâché qu’on nomme, je crois, dans les ateliers, le flou [142]. Cette sorte de laisser aller rendait madame de Noï plus belle, en la présentant sous un aspect nouveau. Un grand cachemire noir, attaché sur la poitrine, encadrait la naissance du col et en faisait ressortir l’éblouissante blancheur ; un chapeau de velours noir, relevé vers la passe, et évasé par le haut, se prêtait merveilleusement au développement du front, qui se déroulait sous un double bandeau de cheveux blonds, pareil à une source argentée entre deux plates-bandes de pâquerettes. Une robe de soie onduleuse descendait mollement jusqu’à la cheville, et couronnait, comme d’une frange mobile, un brodequin de satin noir enfermé dans de petites pantoufles garnies de martre [143]. Dans ce choix d’ornements, c’était, contre l’habitude de madame de Noï, l’effet pittoresque qui avait remplacé l’effet théâtral. La reine avait abdiqué [144] ; la femme reparaissait ; sa physionomie elle-même se ressentait de cet abandon et de cette désinvolture[145] anormale. La courbe aquiline de son nez semblait avoir perdu de sa raideur empesée, sa bouche, tendue d’ordinaire, et orgueilleusement railleuse, était prête à se façonner aux charmes d’un sourire indulgent et facile ; et dans ses yeux, fiers encore, un de ces rayons humides, qui ressemblent à la transparence demi-voilée d’une glace, scintillait par intervalles comme un diamant sous un voile de gaze[146].
Lorsque M. et madame de Noï eurent monté les degrés du péristyle qui conduisait au château, ils furent étonnés du silence et du vide qui régnaient dans les appartements. Ils traversèrent plusieurs salles désertes et froides, et s’arrêtèrent à la fin devant une petite porte à deux battants, qui semblait donner entrée dans un appartement réservé.
— Peut-être trouverons-nous quelqu’un ici, dit M. de Noï en frappant légèrement à la porte.
Arthur Raimbaut se présenta devant lui. À la vue des hôtes inattendus qui venaient le visiter, Arthur ne put réprimer un mouvement de surprise, prompt comme un éclair, et qui disparut aussi vite. Reprenant alors son calme et sa froideur polie, il introduisit M. de Noï et sa femme dans un petit cabinet à peine meublé, et où se trouvaient seulement, près du feu, trois ou quatre fauteuils à dossier courbé, nécessité première d’un cabinet de réception et de travail.
— Mon cher monsieur Arthur, dit M. de Noï d’un ton délibéré, et avec ce dégagement de manières qui trahit le dégagement du cœur, nous venons, madame et moi, vous demander à dîner.
Arthur regarda M. de Noï en face, comme pour sonder sa pensée et scruter la signification de ses paroles.
— Soyez les bienvenus, dit-il ; seulement, madame se rappellera que nous sommes ici à la campagne, et que la campagne est un lieu d’exil pour les royautés déchues et les fronts découronnés [147].
— Point de précautions oratoires, dit M. de Noï, c’est Amélia[148] elle-même qui m’a engagé à venir ici.
Pour la première fois Arthur étudia la physionomie de la jeune femme. Il fut frappé de la révolution[149] extérieure qui s’était opérée en elle, et dont nous avons décrit les symptômes. Madame de Noï baissait les yeux, et balançait doucement le cou, avec cette coquetterie naïve d’un oiseau qui essaye ses ailes. Sur ses lèvres, légèrement bleuies par le contact inaccoutumé de l’air, errait un demi sourire, moitié timide, moitié satisfait, semblable à l’expression indécise d’une jeune fille qui vient de faire le premier aveu de son amour et s’effraye déjà de son audace. Arthur remarqua avec une curiosité croissante toutes les nuances que nous avons indiquées, le long châle croisé négligemment sur sa poitrine, la forme irrégulière des bandeaux dont le niveau uni laissait échapper çà et là quelques cheveux qui voltigeaient sur les tempes, les ondulations molles et sans apprêt de la soie qui chatoyaient en sens divers sous les reflets du foyer, la teinte un peu passée des gants, qui accusait en madame de Noï une incompréhensible distraction, et surtout le laisser aller de cette physionomie, jadis si compassée et si glaciale, qui semblait s’être amollie et fondue au souffle d’un air amollissant[150]. Cet aspect, si peu prévu, l’avait jeté dans une sorte d’extase dont il avait peine à déterminer les causes, et à apprécier les effets. Un esprit, plus disposé aux impressions poétiques que le sien, se fût cru sous l’empire de quelque hallucination surnaturelle, tant l’image de madame de Noï lui apparaissait maintenant tout autre qu’elle ne lui avait apparu ; tant cette femme, ainsi tombée volontairement ou malgré elle de son piédestal [151], avait gagné de grâce et de suavité en perdant de sa hauteur ; tant pour paraître moins parfaite aux regards de l’analyse rigoureuse, elle paraissait plus belle aux yeux de l’instinct humain, et du sentiment intime[152].
Madame de Noï leva les yeux, et jouant avec son pied sur le parquet :
— Ne voulez-vous pas, dit-elle à Arthur, nous donner à dîner ?
Arthur garda encore quelques instants le silence. La voix de madame de Noï venait de lui révéler un nouvel accord qui comblait cet ensemble d’harmonie à moitié entrevu, quoique encore incompris ; son accentuation n’avait plus cette sécheresse et cette rigueur d’intonation qui pénétrait dans le cœur comme la lame froide d’un poignard ; les paroles qu’elle avait prononcées donnaient un démenti à tout son passé, et reniaient pour ainsi dire ses aïeux. Elle avait parlé d’un ton simple, naturel, ou mieux, ainsi qu’un ami qui parle à un ami, une sœur qui s’entretient avec son frère, une femme douce et sympathique qui cherche un écho à sa voix.
Arthur portait alternativement ses regards sur M. de Noï et sur celle qui, jusque-là, s’était offerte si opiniâtrement à son esprit, sous l’aspect d’une grande coquette ; ses idées étaient bouleversées ; sa logique, d’ordinaire si ferme, s’embarrassait dans un réseau de conjectures et de folles suppositions ; un jeune homme, hésitant entre la crainte et l’espérance, aux genoux de sa première maîtresse, tantôt repoussé par un regard sévère, tantôt attiré par une pose excitante, un geste encourageant, n’est pas plus vacillant et plus incertain.
— Permettez alors, dit Arthur, que j’aille donner mes ordres.
— Des ordres ! dit madame de Noï ; mais vous voulez donc traiter à la campagne comme on traiterait à Paris ? Nous sommes des campagnards, de vrais campagnards, je vous en préviens : du beurre et du lait, voilà tout ce qu’il nous faut.
M. de Noï écoutait sa femme avec ravissement, et se complaisait à ce spirituel enjouement d’une grande dame qui se met à son aise ; c’était pour lui comme le spectacle d’une reine à sa toilette ; et, sous les inspirations secrètes qui lui venaient du cœur, sa figure s’épanouissait doucement, et son front se dilatait dans une atmosphère de sérénité et de bonheur.
— Venez-donc avec moi, dit Arthur à celui-ci, vous qui connaissez les intentions de madame, vous me les apprendrez, afin que je m’y conforme.
En même temps, Arthur prit le bras du diplomate, et l’entraîna avec lui, en ajoutant :
— Madame nous pardonnera de la laisser seule ; nous sommes à la campagne, partant point de gêne.
Lorsque la porte du cabinet se fut refermée, M. de Noï prit la main d’Arthur, et la pressant dans la sienne avec une affection expansive :
— Monsieur, lui dit-il, permettez que je vous remercie sincèrement ; je vous dois le bonheur que j’éprouve : vous avez agi loyalement ; vous avez noblement servi ma confiance ; merci ! encore une fois.
En écoutant ces énergiques remercîments [sic], Arthur était froid et impassible ; le mot de l’énigme, qu’il cherchait, était encore un secret pour lui, et, en emmenant M. de Noï avec lui, son but unique était de le lui arracher ; aussi procéda-t-il par la voie la moins détournée, celle de l’interrogation.
— Madame de Noï est-elle donc décidée à renoncer à Paris, à ses pompes et à ses œuvres ? demanda-t-il avec un demi-sourire qui jouait l’indifférence.
— Oui, oui, dit le diplomate ; c’est une affaire conclue, arrêtée ; nous vivrons à la campagne, tous deux, tout seuls.
— Vraiment ! dit Arthur qui roulait en son esprit toutes les combinaisons possibles pour arriver à la solution du problème. Elle est déterminée à quitter Paris ? elle aime la campagne ?
M. de Noï se contenta de répéter longuement les détails qu’il venait d’effleurer ; la résolution de sa femme étant venue subitement, sans effort, sans provocation, c’était à Arthur qu’il fallait en attribuer l’honneur.
Arthur hochait silencieusement la tête ; enfin, après une heure de questions et d’explications inutiles, il rentra avec M. de Noï dans le cabinet, et se contenta de dire, en s’inclinant respectueusement devant la grande coquette [153] :
— Madame est servie !
VI.
Lorsque les convives retournèrent dans le cabinet d’Arthur, le soleil n’avait pas encore quitté l’horizon ; son disque était voilé, par des vapeurs rougeâtres, mais des gerbes brillantes perçaient victorieusement ce rideau, et, frappant sur les vitres et les ardoises, semblaient en faire jaillir des étincelles de feu. Un vent tiède rasait la terre, et son souffle agitait à peine les branches inférieures des arbres ; l’atmosphère était lourde comme en un soir du mois d’août, le ciel se montrait tacheté par d’innombrables nuages, et plus d’un laboureur hochait la tête à ces signes infaillibles d’un lendemain pluvieux[154]. Mais enfin la soirée était belle, et les sons aigres d’un violon, qui parvenaient par intervalles jusqu’aux fenêtres du château, annonçaient que les habitants de Saintry la mettaient à profit.
M. de Noï, après avoir fait l’éloge du temps et comparé la pureté vivifiante de l’air qu’il respirait avec les miasmes de la capitale, proposa à sa femme, du ton le plus aimable, d’aller prendre part aux danses du village.
— Je suis charmé, dit Arthur Raimbaut, que M. de Noï m’ait prévenu ; j’hésitais à faire cette proposition, et pourtant je sentais combien un simple cabinet de travail est un triste salon de réception.
Madame de Noï était assise devant la croisée, et ne paraissait que médiocrement occupée de ce qui se passait autour d’elle ; elle se leva machinalement, et se disposa à sortir sans appuyer d’un seul mot son assentiment. Arthur la jeta, pour ainsi dire, au bras de Henri, et s’empara vivement de celui de M. de Noï. Il ralentit alors sa marche de manière à laisser assez d’avance aux deux premiers pour que ses paroles ne pussent arriver distinctement à leurs oreilles. Arthur avait compris que le moment était venu de frapper le coup décisif ; pas un mot d’affaire n’avait été échangé entre lui et M. de Noï depuis l’arrivée de celui-ci au château, mais cette visite spontanée annonçait hautement que le combat ne serait pas long, et que l’issue n’en était pas douteuse. Aussi, quand ils arrivèrent à la salle de danse, M. de Noï disait à Arthur en dégageant son bras.
— Eh bien ! donc, que tout soit fait comme vous l’entendez, et terminons le plus tôt possible.
Mais vainement on aurait cherché dans les yeux d’Arthur une nuance de satisfaction, et sur ses lèvres un sourire de triomphe. Ses espérances étaient pourtant réalisées, la grande pièce du morcellement avait trouvé son acquéreur, la partie était gagnée, et, quelques jours plus tôt, cette chance si favorable eût rencontré moins de froideur dans l’âme d’Arthur Raimbaut. Une réaction violente et imprévue s’était opérée chez cet homme ; la fièvre de spéculation était la révulsion d’une autre fièvre [155] ; il avait appliqué là toute l’énergie de ses facultés, comme un médecin emploie les remèdes les plus violents pour appeler au dehors le feu qui menace de dévorer l’intérieur du corps. Mais le mal réel avait reparu, et son intensité s’était accrue des efforts faits pendant longtemps pour le comprimer. Arthur, suivant jusqu’au bout la route que ses calculs avaient ouverte, que son habileté avait aplanie, et parvenant au but avec un bonheur et une promptitude merveilleuse, n’était pas plus touché que s’il se fût agi de l’intérêt d’un étranger, que s’il eût exécuté et vu réussir les projets conçus par une autre pensée que la sienne. M. de Noï fut frappé du flegme incroyable avec lequel Arthur Raimbaut accueillit son acquiescement aux conditions de la vente, mais il le compara au sang-froid du joueur consommé, qui ramasse son or sans sourire, comme il l’aurait vu sans sourciller disparaître sous le râteau du banquier. Entre sa noble existence et l’existence de cet inconnu, il ne voyait pas encore d’autre point de contact que la négociation d’une affaire.
La salle du bal[156] se composait simplement d’un toit appuyé par une de ses extrémités contre un mur, et soutenu à l’autre extrémité par deux poteaux. Une base grossièrement équarrie, et la partie supérieure de ces poteaux tournée avec non moins d’art, attestaient que le charpentier avait eu la prétention d’en faire des colonnes. Au fond, une planche posée sur des tréteaux servait de trône au ménétrier [157], dont le pied, frappant vigoureusement la mesure, mettait à l’épreuve la sonorité et la solidité de cet échafaudage. Les sons qu’il tirait de son instrument n’eussent pas été des plus agréables pour une oreille chatouilleuse, et pourtant, la danse était plus animée dans la grange que jamais elle ne le fut dans un salon de Paris, aux accords de l’orchestre le plus harmonieux[158]. Le jour était alors près de finir, mais des appliques en fer-blanc suspendues au mur et aux poteaux promettaient que les plaisirs ne finiraient pas avec lui.
L’entrée des nouveaux venus causa une légère sensation, mais le mouvement de curiosité, qui avait détourné plus d’une tête, fit place en un instant à une indifférence qui n’était pas exempte d’affectation. Le peuple des campagnes est jaloux, cent fois plus jaloux que le peuple des villes, de protester contre la supériorité des classes élevées ; et tant que son intérêt n’exige pas rigoureusement de lui une conduite différente, il pousse ses protestations jusqu’à la grossièreté. Il était bien évident pour tous les paysans, réunis dans la grange, que l’homme opulent arrivé le matin dans un brillant équipage était déjà, ou allait devenir propriétaire du château de Saintry. Mais, dans l’ensemble de la vente, le château était le lot de pierre, comme il y avait eu le lot de bois, le lot de pré ; l’un était pour l’homme de luxe, les autres pour l’homme de labeur, et celui-ci devait se trouver l’égal du premier.
Le murmure des voix et le bruit des verres n’avaient donc subi qu’une légère et presque imperceptible suspension ; un seul individu continuait à examiner Arthur Raimbaut et M. de Noï, jetant sur le premier un regard de méfiance, sur l’autre, un regard de curiosité : cet individu était le fermier Guillaume Évon[159] ; il avait mis dans son costume tout l’appareil convenable à sa dignité, et la ceinture tricolore flottait majestueusement à son côté.
— Monsieur de Noï, dit Arthur en s’approchant vivement de Guillaume Évon, permettez-moi de vous présenter M. le maire de la commune de Saintry ; vous êtes désormais au nombre de ses administrés.
Arthur pallia par un coup d’œil ce que sa phrase pouvait avoir de choquant pour la vanité de M. de Noï, et celui-ci prouva par un demi-sourire qu’il ne s’en trouvait nullement offensé ; en même temps il salua le maire, mais avec un air de protection que Guillaume Évon lui rendit assez gauchement.
— Je ne vois pas madame Évon, reprit Arthur, quelle raison peut l’empêcher de prendre part à vos plaisirs ?
— Madame Évon est une capricieuse qui a passé deux heures à sa toilette, et cela pour aller se planter sur une chaise dans le coin le plus obscur de la salle ; j’ai toujours vu sa tête travaillée par d’étranges lubies, mais depuis quelque temps les accès deviennent si fréquents et si singuliers, qu’ils commencent à m’inquiéter sérieusement.
Arthur ne fit pas grande attention au ton concentré qu’avait pris la voix de Guillaume Évon en prononçant ces dernières paroles ; mais, suivant l’indication de son doigt, il vit en effet Marguerite assise à quelque distance, derrière un des piliers. Jusqu’au moment où la voix d’Arthur avait frappé son oreille, elle avait paru absorbée dans ses réflexions ; à cet instant seulement elle releva vivement sa jolie tête, et sans l’ombre que répandait sur elle la projection du poteau, on aurait pu remarquer l’éclair de rougeur qui colora ses joues.
Pour elle, comme pour lui, Arthur eut voulu ne point rencontrer Marguerite au bal.
— Quelle est cette femme ? lui demandait quelques instants après madame de Noï, tandis qu’Arthur Raimbaut s’excusait auprès de ses hôtes de les avoir laissés seuls si longtemps.
— C’est madame Évon, la femme du maire de Saintry.
— Sa figure est charmante, dit M. de Noï, elle se dessine au milieu des autres femmes du village comme une rose parmi des fleurs d’églantier.
Madame de Noï ne revint pas sur ces éloges pompeux, tant elle avait la conscience de sa supériorité sur Marguerite ; et en quelques minutes, l’idée comme l’image de la fermière étaient loin de la grande dame.
Mais lorsque, plus tard, Arthur Raimbaut figura dans un quadrille à côté de madame Évon, et vis-à-vis de madame de Noï, ce fut au tour de Marguerite à l’interroger et à lui dire.
— Arthur, quelle est cette dame ?
— Celle qui désormais habitera le château de Saintry.
— Dites-moi pourquoi sa présence me fait mal.
— Parce que l’imagination, opiniâtrement fixée sur un seul point, finit par y découvrir des fantômes.
— Non, non, Arthur, cette femme était connue de vous ; elle vous regarde comme souvent je me surprends à vous regarder moi-même[160].
— Marguerite, en vérité, vous agissez comme un enfant, votre main tremble et ce tremblement sera sensible pour le premier qui la touchera ; vos traits sont agités par le trouble, et vous ne songez pas que le moindre de vos gestes est exposé aux yeux de la foule qui nous entoure.
— Eh bien ! je serai calme, je renfermerai dans mon cœur l’angoisse de mes pressentiments ; mais mon trouble est bien pardonnable : Arthur, jusqu’ici j’avais quelquefois pensé que vous ne m’aimiez pas, jamais que vous en aimiez une autre.
La fin de la contredanse dispensa Raimbaut de poursuivre cet entretien pénible ; il ramena Marguerite auprès du fermier, qui n’avait point cessé de les examiner tant qu’avait duré le quadrille.
— Je vois, monsieur Raimbaut, que vous n’avez pas réussi à rendre cette belle dame moins triste, dit Guillaume Évon ; je tâcherai d’être plus heureux et de connaître au moins la cause de ses chagrins.
Puis, quelques pas plus loin, Arthur rencontra Henri :
— Arthur, vous n’avez pas oublié sans doute la promesse sacrée que vous m’avez faite, et cependant j’ai vu des larmes dans les yeux de Marguerite !
Ainsi s’amoncelaient les éléments de l’orage prochain ; mais Arthur avait jeté le gant[161], il n’avait plus qu’à marcher devant lui. Une heure après, il regagnait le château donnant le bras à madame de Noï, et causant très-vivement avec elle.
VII.
Il était deux heures, et, contre ses habitudes d’activité, Arthur Raimbaut n’avait pas quitté la petite chambre qu’il occupait au premier étage du château. Enveloppé dans une longue redingote croisée sur la poitrine, et penché sur le dossier d’un fauteuil, il semblait oublier tous les intérêts de sa vie ordinaire, et laissait aller son esprit au courant de ces rêveries où la réalité a moins de part que l’imagination. Sa figure avait ce caractère de contentement inquiet, de satisfaction combattue qui indique les angoisses de l’attente mêlées aux douceurs de l’espérance, et cette espèce d’indécision qui arrête et glace l’âme au milieu même de ses plaisirs les plus violents, de ses plus chaudes émotions. Ainsi qu’un voyageur, près d’atteindre le sommet d’une montagne, s’arrête et jette un regard étonné sur la campagne qu’il vient de parcourir, sur la verte vallée qui étend au-dessous de lui son manteau bariolé, ainsi faisait Arthur prêt à s’élancer dans l’avenir [162]. Le souvenir du passé le retenait encore, et il entrevoyait dans l’ombre une barrière infranchissable à ses désirs. Au bruit que fit la porte de la petite chambre, en tournant sur ses gonds, il sortit enfin de son immobilité, et une légère rougeur colora sa joue lorsqu’il aperçut Henri debout devant lui[163]. Les traits du jeune homme étaient empreints de tristesse et de sévérité ; les lignes de sa physionomie juvénile ressortaient plus que de coutume ; les contours de son front, ordinairement arrondis comme la tête d’une jeune fille, se contractaient vers les tempes, et des touffes de cheveux, irrégulièrement éparpillées, y projetaient des ombres anguleuses. Jamais Henri n’avait subi une transformation si complète. Son regard, indécis d’ordinaire, et comme caché sous un voile de timidité craintive et d’enfantine irrésolution, s’arrêtait ferme et clair sur Arthur, sans affectation, sans effort. À voir ainsi ces deux personnages, l’un homme de volonté et d’énergie, devenu irrésolu et timide, l’autre enfant doux et soumis, devenu courageux et fort, on eût cru que, par une subite métamorphose, les rôles avaient changé. Henri atteignait la virilité, Arthur redescendait à l’enfance [164].
La chambre d’Arthur était sombre, et l’apparence de nudité qui la caractérisait donnait à cette entrevue un cachet de douleur et de resserrement ; le brouillard étendait son crêpe noir sur les croisées sans rideaux, où les arbres du parc projetaient leurs profils dépouillés comme autant de maigres squelettes ; dans l’encadrement en bois d’une alcôve apparaissait une modeste couchette, assez semblable à un lit de camp, dont les matelas, foulés en tous sens, attestaient une de ces insomnies douloureuses qui participent des agitations de la fièvre ; outre le fauteuil où Arthur était assis, trois ou quatre chaises de paille seulement complétaient l’ameublement. Cette chambre ressemblait à celle d’un soldat : c’était le même délabrement, la même incurie. Il y avait, dans Arthur, quelque chose de cette résignation militaire qui s’accoutume aux privations, plutôt par habitude et par apathie que par nécessité et par héroïsme. Comme tous les hommes qui consacrent leur vie au triomphe d’une idée bonne ou mauvaise, à une pensée de moralisation ou de vengeance, d’édification ou de ruine, il méprisait tous les accessoires du luxe, toutes ces fantaisies du bien-être qui ont tant de prise sur les âmes molles, sur les existences paresseuses et sans but. Cet aspect nu et austère contribuait à éclairer le contraste des deux figures que nous avons décrites ; et, dans un pareil cadre, il était impossible de placer des détails touchants, des sentiments affectueux et doux. La décoration indiquait déjà la scène. Ces croisées sans rideaux, ces murs sans ornements, cette cheminée sans feu, qui ne contenait plus qu’un amas de cendres froides, faisaient assez pressentir une de ces situations austères qui resserrent le cœur et contristent [165] l’imagination.
Henri était roide et immobile devant Arthur ; une de ses mains tombait le long de la cuisse, tandis que l’autre, cachée sous les parements d’une redingote croisée, tourmentait par intervalles sa poitrine à la hauteur du cœur [166].
— Je suis bien aise de vous voir, dit à la fin Arthur en indiquant du doigt une chaise au jeune homme, qui conserva obstinément son attitude immobile ; j’avais à vous parler, Henri, et j’aurais déjà été vous trouver, si j’étais moins paresseux et moins souffrant. Asseyez-vous donc.
À cette invitation précise, Henri ne jugea pas à propos d’opposer une plus longue résistance ; il s’assit en face d’Arthur, sans que sa figure eût rien perdu de sa fierté première et de son intensité d’observation.
— Vous êtes souffrant, monsieur[167] ? Demanda-t-il froidement et du ton d’un homme qui lutte contre ses affections et ses sympathies personnelles, pour n’écouter que la voix de fer d’un devoir rigoureux ; dites-moi alors ce que vous avez à me dire. J’avais aussi à vous parler : mon tour viendra plus tard.
L’accent impassible et froid du jeune homme échappa-t-il à Arthur ? ne remarqua-t-il pas cette étrange appellation de monsieur qui, pour la première fois, lui était adressée par Henri ? voulut-il abréger les détails d’une conversation pénible, et, sacrifiant les étrangetés de la forme, arriver plus vite, et sans détour, au fond ? Cette dernière supposition est peut-être la plus vraisemblable.
— Henri, reprit-il, des affaires importantes me forcent à quitter ce pays, pour un temps ; car, soyez-en sûr, j’y reviendrai : j’ai donc besoin, pour terminer ma liquidation, d’un ami sûr, d’un homme de confiance, d’un autre moi-même qui veille sur mes intérêts comme sur les siens, et me représente, moi absent, comme je me représenterais moi-même. Pour remplir cette mission, j’ai songé à vous, Henri ; ai-je bien fait ?
Henri garda quelques instants le silence, comme si, dans le secret de son cœur, il eût balancé les différentes chances d’une combinaison, et eût été contenu d’une part par la raison, et de l’autre par les tentations décevantes d’un premier mouvement.
— Et quelles sont, dit-il, les affaires pressantes qui vous forcent à partir ? Votre esprit est-il donc si remuant et si agité qu’il faille déjà lui préparer une pâture nouvelle ? avez-vous tellement peur du repos que vous ne puissiez supporter, sans mourir, une inaction de quelques jours ? votre vie est-elle condamnée à se mouvoir dans un cercle sans fin ? votre désir de locomotion et de mouvement est-il insatiable ? et, comme les condamnés[168], entendez-vous une voix qui crie à vos oreilles : « Toujours ! … toujours ? … » enfin, où voulez-vous aller ? …
La voix du jeune homme, grave d’abord, s’était accentuée sur la fin ; dans ses paroles, dans le pli imperceptible de sa lèvre inférieure, dans l’expression tristement dédaigneuse de ses regards, perçait je ne sais quelle muette ironie glaciale et écrasante, compatissante à la fois et acérée, comme l’ironie des vieillards. Arthur se sentit involontairement ému, et baissa la tête. Il fallait que, dans le cœur de cet homme, un orage bien violent eût soufflé, pour qu’il se laissât aller ainsi à ces signes d’abattement et de faiblesse. En le voyant, nul n’aurait pu se défendre de cette impression de mélancolie qui vous prend à l’aspect d’un vieil arbre dépouillé par la base, et jonchant le sol de ses débris.
— On m’écrit de Lyon qu’il y a, dans les environs de cette ville, une propriété à vendre ; je vais la visiter ; et ne voulez-vous pas, Henri, me remplacer ici pendant mon absence ? Soyez-en sûr, je vous récompenserai.
Arthur avait prononcé ces mots à voix basse, avec cette demi-assurance qui vient plutôt du sentiment d’un parti pris, et qu’on veut mener à sa fin, que d’une conviction profonde et solidement établie.
— Quelle récompense me donnerez-vous ? dit Henri.
— Henri, continua Arthur, vous êtes jeune, et vous n’avez pas encore de chemin tracé, de position faite dans le monde ; je veux vous tracer un chemin, je veux vous faire une position. L’affaire que nous venons de terminer ici a réussi au-delà même de mes espérances : nous partagerons le bénéfice par moitié, en frères.
— Nous ne sommes plus frères, dit Henri gravement et sans changer d’attitude.
— Qu’avez-vous ? Henri ?… Mon enfant, qu’avez-vous ? demanda Arthur en se levant avec un effroi véritable ; votre mère n’était-elle pas la sœur de mon frère ? n’avons-nous pas été élevés dans le même pays, dans cette vallée d’Auch [169] où mes plus riants souvenirs et les vôtres sont restés ? Ne vous souvient-il plus que ma main a soutenu vos premiers pas, et que j’ai promis à votre faiblesse l’appui de ma force et de mes conseils ? Oh ! parlez, parlez, Henri ; quittez avec moi, qui vous aime, cet air froid et sévère qui m’effraye ; redevenez mon ami, mon frère ! En quoi ai-je démérité de votre affection ? comment suis-je devenu coupable à vos yeux ? quel souffle mauvais a passé sur notre amitié ? quel mauvais génie a désuni nos existences liées au berceau ? Souvenez-vous, Henri, souvenez-vous ! …
Henri ne répondit pas ; seulement, celle de ses mains qu’il cachait sous sa redingote fit un de ces mouvements qui ressemblent à un sarcasme ou à une menace ; puis, se levant à son tour, il regarda Arthur fixement, et d’une voix sombre laissa tomber ces mots :
— Je me souviens. Mais vous, monsieur, vous souvenez-vous ?
C’était la seconde fois de sa vie que le jeune homme, en parlant à celui qu’il avait si longtemps considéré comme son père, se servait du mot monsieur. Cette fois, plus que la première, ce mot, étrange dans sa bouche, avait pris une signification accablante et dure ; on eût pu en comparer l’accentuation à celle du juge qui lit au prévenu son verdict de condamnation[170].
— Que signifient ces paroles ? demanda Arthur ; expliquez-vous.
— Ne me comprenez-vous pas ? reprit celui-ci lentement et en appuyant sur chaque mot ; il faut que votre mémoire soit bien troublée, ou votre intelligence bien obscurcie. Vous me faites pitié, Arthur ! car vous vous défendez vainement contre une pensée qui vous accable, contre une vérité qui vous menace malgré vous ; peut-être aurais-je dû vous épargner la peine de mentir ! Vous voulez partir !… vos affaires vous appellent loin d’ici, vous allez visiter une propriété qu’on vous a indiquée ; en tout ceci, une seule chose est vraie, c’est que vous voulez partir ; mais n’essayez donc pas de me donner le change : ce n’est pas un voyage que vous méditez, c’est une fuite. Ne niez pas ; le mensonge n’est pas dans votre caractère, et je rougis pour vous de la contrainte que vous vous êtes imposée. Le motif de votre départ, je le sais ; au besoin, je pourrais vous dire quel jour, à quelle heure et avec qui vous avez l’intention de partir : je sais tout, tout, vous dis-je. Ne me répondez pas ; je devine votre réponse et j’entends vos reproches. J’ai suivi vos pas, épié votre conduite, surpris vos plus intimes confidences, tout ce qu’il vous plaira ; accusez-moi, si vous voulez, d’avoir joué un rôle indigne de moi, indigne d’un honnête homme ; dites qu’écouter aux portes, le soir, dans l’ombre, est le propre, non d’un ennemi loyal, mais d’un traître, d’un misérable, d’un espion ; soit : je suis prêt à tout, résigné à tout. À vos injures, méritées ou non, je n’opposerai que mon silence, je supporterai vos accusations sans me plaindre, je boirai le calice jusqu’à la lie, sans pâlir et sans détourner la tête ; car, voyez-vous, quand on s’est imposé un devoir, il faut l’accomplir ; quand on s’est dévoué une fois, il faut pousser le dévouement jusqu’à ses dernières conséquences. Je me suis dévoué ; que m’importent donc les moyens, pourvu que ma mission s’accomplisse ! Oui, je vous ai épié, je me suis glissé comme un voleur jusqu’à la porte de votre chambre, j’ai appliqué mon oreille sur la serrure, pour mieux entendre tout ce qui s’y disait, et j’ai tout entendu[171]. Vous croyiez, n’est-ce pas, qu’il était facile de me tromper ; vous me preniez pour un enfant aveugle et faible qu’on pouvait gagner par la première caresse, apaiser par le premier mensonge : vous vous trompiez. Le jour où vous m’avez dit : « Marguerite est perdue pour toi », j’ai compris quelle était ma tâche ; je me suis senti dans le cœur une force et une résolution nouvelles. L’amour me rendait timide, le malheur m’a fait fort ; et, maintenant, entre nous deux, c’est une lutte d’homme à homme, et peut-être, de nous deux, est-ce vous qui faiblirez le premier. Quand vous m’avez dit : « Marguerite est à moi », la première pensée qui m’est venue est celle-ci : « Peut-être est-il plus digne que moi de son amour » ; et alors, dans l’affection que je vous portais, je me retraçais vos grandes et nobles qualités, et les grandissant encore, je me disais : il est bon, noble, généreux ; il ne voudra pas que son amour soit fatal à une pauvre femme qui l’a aimé tout d’abord, sans réflexion, sans réserve ; les engagements qu’il a pris, il les tiendra ; il lui donnera du bonheur en échange du mien qu’il a pris.
Ainsi pensais-je, Arthur, et, dans mon malheur, je me sentais heureux, qu’à défaut du mien, le cœur de Marguerite eût choisi un cœur comme le vôtre ; et, plein de l’admiration que je me sentais pour vous, j’osais à peine me plaindre, et je trouvais juste que le meilleur et le plus grand des deux eût la plus large part ; seulement, en justifiant le choix de Marguerite, je ne renonçais point à mes droits ; plus j’avais perdu, plus j’avais le droit d’être exigeant envers vous. En échange du sacrifice que je m’imposais, je m’étais acquis un privilège imprescriptible, le privilège que donne le martyre. Si vous rendiez Marguerite heureuse, je n’avais qu’une seule ressource, la résignation et le silence ; aussi, ne vous ai-je fait qu’une seule question : « L’aimez-vous ? »
— Oui, m’avez-vous répondu. C’en était assez ; vous acceptiez, vis-à-vis de moi, une responsabilité inaliénable ; sur les ruines de mon bonheur[172], vous vous engagiez à édifier le sien ; mes larmes garantissaient sa joie, mes douleurs cautionnaient son avenir. Vous me parliez tout à l’heure de cette riante vallée d’Auch où vous avez vu le jour, vous me retraciez les plaisirs de votre enfance, vous voudriez, disiez-vous, aller mourir aux lieux où fut votre berceau ; Arthur, c’est ici et non là-bas, c’est près de Marguerite qu’il faut mourir[173]. N’est-ce pas là ma réponse ? Arthur, vous en souvenez-vous ?
Henri s’était échauffé en parlant ; sa figure, pâle d’abord, s’était colorée peu à peu, dans ses yeux roulaient des pleurs comprimés qui mouillaient ses paupières, sa main droite tourmentait toujours sa poitrine comme si, par une compression puissante, il eût voulu arrêter les mouvements tumultueux de son cœur.
— Vous souvenez-vous ? répéta-t-il en regardant Arthur avec une indicible expression de sévérité et de tristesse tout ensemble.
— Je me souviens, balbutia celui-ci.
— Oui, c’est ici, près d’elle, que vous devez mourir, afin de réparer, s’il est possible, les maux que lui ont causés votre amour, reprit Henri avec cette énergie que donne une conviction profonde et le sentiment d’un long et douloureux sacrifice ; ce que j’aurais fait, vous qui avez pris ma place auprès d’elle, vous devez le faire. Tout bonheur impose des droits ; vous avez pris l’un, ne devez-vous pas accepter les autres ? Ce que j’exigeais de vous, ne me l’avez-vous pas promis par votre silence même ? ne m’avez-vous pas dit que vous l’aimiez ? et quel engagement pourrait valoir un engagement pareil ? Répondez donc, Arthur, répondez : défendez-vous, au moins.
En écoutant Henri, Arthur marchait à grands pas dans la chambre, personnifiant ainsi la fable antique[174] du coupable poursuivi par le remords. Lorsque le jeune homme, d’un ton de voix énergique et amer, lui cria de se défendre, il se retourna, et jetant sur lui un regard découragé :
— Henri, dit-il, je suis bien malheureux, et, au lieu de m’accuser, vous devriez me plaindre ; car, si vous étiez plus avancé dans la vie, si vous saviez un peu ce que sont les hommes, livrés aux caprices du hasard, vous maudiriez la fatalité qui m’a poussé, au lieu de vous en prendre à moi d’une destinée[175] que je n’ai pas cherchée.
Henri était trop monté au ton de la colère, son cœur était trop plein de l’indignation qui le débordait, pour que, même dans la bouche d’Arthur, de semblables paroles produisissent sur lui l’effet amollissant qu’elles devaient produire. L’âme humaine est ainsi faite, que les impressions ne s’effacent que par degrés et lentement, avant de faire place à d’autres ; et que, pour passer de la colère à l’attendrissement, nous parcourons invariablement toutes les phases des passions intermédiaires. La voix d’Arthur, et son inexprimable accent d’angoisse, se brisa donc impuissant devant la résolution du jeune homme, qui continua :
— Aujourd’hui, je vous l’ai dit, je ne suis plus votre frère, je ne suis plus votre ami ; je suis votre juge [176] ; je viens vous demander compte des engagements que vous avez pris et que vous êtes prêt à rompre ; je viens vous rappeler les promesses que vous m’avez faites et que vous êtes prêt à violer. Je ne vous parle pas de Marguerite, vous ne l’aimez pas ; et quand vous m’attestiez votre amour, vous mentiez alors, comme vous avez menti aujourd’hui ; mais, entre vous et moi, il existe un contrat que vous ne pouvez pas rompre plus que moi. Si vous ne lui devez pas votre vie, à elle, au nom de son amour, vous la lui devez au nom de son malheur ; et, pourtant, ne devez-vous pas partir ce soir, ce soir même, avec une autre femme ? Est-ce de la loyauté cela, dites ? est-ce de la fidélité aux serments ? est-ce de l’honneur ?
Il s’arrêta encore une fois pour regarder Arthur, puis, donnant à sa voix une profondeur d’intonation qu’elle n’avait pas eue jusque-là :
— Arthur, écoutez-moi, dit-il ; cette entrevue est grave, le jugement que je vais porter (je suis votre juge, ne l’oubliez pas) sera plus terrible que vous ne le pensez ; car c’est ici le jugement de Dieu[177]. Vous ne partirez pas, ou, si vous voulez partir, je vais vous dire à quelle condition.
Pendant qu’il parlait, Henri avait retiré lentement sa main droite de l’étroite ouverture où elle était enfermée, et ramenant avec elle deux pistolets de poche qu’il posa gravement sur la cheminée :
— Voilà ! dit-il ; vous ne partirez que moi mort !
Malgré le ton de gravité amère que Henri avait affecté dès le début de cette conversation, Arthur était loin de s’attendre à une conclusion aussi terrible. Jusque-là, il avait écouté les reproches du jeune homme avec cet abattement d’un homme qui se sent malheureux et coupable, et trouve à peine la force de se défendre contre les accusations de son propre cœur ; ce qui se passait dans son âme ressemblait assez à cette lutte du jour et de l’ombre, qui nous[178] étonne vers la fin des soirées d’été par ses accidents contradictoires. La passion, aux prises avec le sentiment du devoir, bouleversait sa pensée avec des alternatives égales de victoire et de défaite, il entrevoyait le bonheur, et pourtant le bonheur était prêt à lui échapper. Sa vie lui paraissait soumise à une de ces destinées invincibles qui dominent certaines existences et les soumettent impérieusement à leur volonté capricieuse. Pourquoi, entre lui et la réalisation de ses rêves, le passé venait-il interposer ses souvenirs et ses insurmontables obstacles ? Par quelle fatalité, si près du but, se trouvait-il subitement arrêté par une barrière infranchissable[179] ? Un génie moqueur s’était-il donc acharné à sa perte, en épaississant sans cesse devant lui des nuages menaçants, et en rivant plus durement ses chaînes à chaque effort qu’il faisait pour s’en affranchir ? Comment s’était-il laissé glisser sur cette pente perfide offerte à ses désirs ? N’était-ce pas là un jeu cruel du sort, de ne lui avoir montré l’abîme qu’au moment où il venait d’y tomber ? Pourquoi Marguerite, avec ses charmes si séduisants, et son débordement de passion longtemps comprimée, s’était-elle trouvée sur ses pas pour l’enlacer et le retenir ? En présence de tant de doutes, d’anxiétés et d’angoisses, Arthur était irrésolu, faible, vacillant ; sa volonté n’était plus qu’une flamme mobile qui scintillait dans tous les sens comme un perfide mirage. Il se sentait attiré et repoussé tour à tour par des lueurs contraires, qui ne brillaient un instant que pour rendre plus épaisses et plus affreuses les ténèbres de sa pensée. Les hommes sont ainsi faits, que les plus forts parmi eux deviennent, au contact des événements, les plus faibles et les plus indécis. Plus Arthur avait montré jadis d’énergie et de force, plus, au moment décisif de sa vie, l’énergie et la force lui manquaient. Semblable à un soldat qui use ses cartouches dans les escarmouches[180] d’avant-poste, au jour du combat, il se trouvait dépourvu et désarmé.
La parole ardente et sévère de Henri l’accablait et l’épouvantait presque, et, dans son émotion, il y avait à la fois de la tristesse et de la crainte. Henri était pour lui le représentant des douces affections et des sentiments immuables ; il comptait sur son amitié comme sur une ressource qui ne pouvait pas lui manquer. Longtemps il s’était senti porté vers lui par cet irrésistible besoin d’affection qui, par une sympathie presque magnétique, unit la force à la faiblesse, comme le chêne au lierre. Il aimait Henri sans égoïsme, sans calcul, avec l’entier désintéressement d’un père qui s’attache à un enfant chétif, en raison même de ses infirmités. La vie du jeune homme lui semblait admirablement enchaînée à la sienne : c’était là le côté tendre et malléable de cette âme de fer. Toutes ses illusions, il les avait reportées vers lui, et avait déplacé pour ainsi dire le centre de son existence, afin de lui en donner la meilleure part. Or, lorsque cette idée terrible surgit tout à coup devant lui : se battre avec Henri ! lorsque, sur le marbre grisâtre de la cheminée, il vit reluire la batterie cuivrée des pistolets, un nuage couvrit sa vue, son front se dilata sous un courant électrique comme si les muscles s’en fussent détendus, il sentit par tout le corps un frissonnement involontaire qui lui serra le cœur et fit trembler ses membres ; une pâleur livide couvrit son visage. Il eut peur ; il eut froid.
Et qu’on ne se méprenne pas à nos paroles : le mouvement d’effroi que nous signalons n’est pas le résultat de cette faiblesse vulgaire, de ce saisissement nerveux qui caractérise la lâcheté des hommes ordinaires, mais plutôt cette impression douloureuse qui déchire les cœurs les plus élevés au moment où la dernière espérance leur échappe, où le dernier bandeau, qui cachait à leurs yeux les amertumes de la réalité, tombe et se brise, emportant avec lui les décevantes promesses d’une illusion chérie. Et qui, dans sa vie, n’a pas ressenti cette sensation solennelle de découragement et de tristesse, alors que l’adieu d’une maîtresse adorée s’est éteint dans l’espace, comme le souffle de la brise au bord des mers, alors qu’une voix insensible et dure a jeté à son oreille cette parole qui glace d’épouvante les plus hardis et les plus insouciants : « Réveille-toi ! … » Ô vous qui tombez fleur à fleur, feuille à feuille ainsi que la verdoyante couronne des forêts, ô nos illusions de jeunesse, que devenez-vous en nous quittant ? dites-nous, au moins, où est creusée votre tombe, afin que nous allions y pleurer la perte de notre bonheur.
Un autre sentiment liait encore plus étroitement le fort au faible. Malgré la morgue attachée sur sa figure, Arthur trouvait dans son ami une confraternité de pensée et de nature qu’il avait reconnue dès le premier abord. Aux yeux d’Arthur, Henri apparaissait comme un miroir[181] qui lui reproduisait les traits de sa jeunesse et cette exubérance d’imagination qui se resserrait sans s’amoindrir, comme la sève d’un arbre qu’on élague pour le rendre plus fort. Henri était pour ainsi dire la continuation d’Arthur ; il reproduisait sa vie, ses souffrances, ses illusions mille fois comprimées et toujours vivaces ; il le recommençait tout entier. Comme un flot pousse un autre flot, Henri suivait Arthur pas à pas, et pressait du pied la trace de son pied ; c’était toujours le même bruit, la même fougue, la même action. Le sillon qu’en passant avait creusé Arthur, Henri y marchait à son tour ; l’un était le premier anneau de la chaîne, l’autre en était le second[182] ; il semblait que leur destinée fût commune, et que le ciel eût dit, en les créant : « Vous suivrez tous deux la même voie, vous frayerez le même sentier, les mêmes obstacles vous arrêteront, les mêmes épines vous déchireront la main ; l’un arrivera au même but que l’autre ; si l’un tombe, l’autre tombera ; vos chances sont égales, votre vie parallèle, et vous n’aurez pour vous deux qu’un calvaire. »
La destinée d’Arthur se débattait dans un cercle vicieux d’où il ne pouvait échapper ; il se sentait pressé de toutes parts entre les deux tranchants d’un dilemme impossible à vaincre. En proie à mille agitations, son âme pliait sous le choc, et au milieu des nuages qui obscurcissaient sa vie, il entrevoyait distinctement un point noir et menaçant.
Henri avait gardé quelque temps le silence, comme s’il eût voulu laisser à sa conclusion le temps de produire son effet ; sa figure était pâle, et son regard avait pris involontairement ce caractère de fierté douloureuse, symptôme des résolutions combattues.
— Partirez-vous, Arthur ? demanda-t-il à la fin d’une voix légèrement forcée.
Arthur se débattit encore un moment contre les pensées diverses qui l’obsédaient, et regardant son interrogateur avec cette tristesse d’une âme forte qui se sent faiblir :
— Henri ! Henri ! vous êtes bien cruel ! et vous me récompensez bien mal de l’amitié que je vous ai vouée. Quoi ! vous voulez que je me batte avec vous ? il faut que je vous tue, ou que je sois tué par vous ! Songez-vous bien à cela ? Votre main ajustera-t-elle, sans trembler, ma poitrine ? verrez-vous, sans pâlir, couler mon sang qui est le vôtre ? et si le ciel a marqué irrévocablement le terme de ma destinée, est-ce vous qui devez vous constituer l’instrument de ses décrets ? Vous me voyez faible, Henri, et vous m’accablez au lieu de me soutenir ; vous me voyez malheureux, et vous m’accusez au lieu de me consoler. Que vous ai-je donc fait, Henri, que vous soyez si injuste ? Je vous ai ravi votre bonheur ! Mais si le ravisseur avait plus souffert de son triomphe que la victime de sa défaite ; si cette victoire, que vous me reprochez avec tant d’amertume, je me l’étais reprochée à moi-même plus amèrement que vous ne pouvez le faire ; si une destinée mauvaise, plutôt que ma volonté[183], m’avait entraîné à consommer votre ruine ; si, en tout ceci, je n’avais été que le misérable jouet de cette puissance aveugle qui nous égare à sa suite, et nous cache l’abîme afin de nous y précipiter plus sûrement ; si vingt fois, détournant la tête vers le passé, je m’étais écrié : Henri, Henri, pourquoi m’as-tu parlé trop tard ? quand tu n’avais que la main à étendre pour me relever, pourquoi ne l’as-tu pas étendue ? pourquoi as-tu manqué de confiance envers moi, qui appelais ta confiance ? Si tout cela était vrai, serais-je donc si coupable ? aurais-je donc mérité la dureté que vous me montrez, et ne serais-je pas mille fois plus à plaindre qu’à blâmer ? Et tu veux, Henri, que nous nous battions ! Cela est-il vrai, dis ? peux-tu le vouloir ?
La voix d’Arthur était brisée ; tantôt il précipitait sa parole avec la rapidité d’un coupable qui veut tout d’un coup décharger sa conscience, et la montrer à nu aux yeux de son juge, tantôt il entrecoupait ses phrases avec un accent d’anxiété et d’angoisse.
— Si vous persistez à exécuter vos projets de fuite, dit Henri d’un ton grave, je vous le répète, il faudra nous battre : ma mort seule peut vous livrer passage.
— Je ne me battrai pourtant pas, reprit Arthur : sur mon honneur, je ne me battrai pas avec toi.
— Il le faut, dit Henri en prenant sur la cheminée un des deux pistolets et en le présentant à Arthur.
— Je ne me battrai pas, te dis-je, continua Arthur avec force ; plutôt subir toutes les humiliations, endurer toutes les tortures que d’accepter un pareil combat. Libre à toi, Henri, de presser la détente de ce pistolet et de l’appuyer contre ma poitrine ; je ne me détournerai pas, sois tranquille ; je ne reculerai pas devant la mort ; mais, pour me battre, non : mourir, à la bonne heure !
Arthur était au comble de l’agitation ; des gouttes de sueur inondaient son front et coulaient lentement sur ses joues, ses lèvres s’entrouvraient, comme si les convulsions intérieures de sa poitrine eussent sollicité un plus large passage à ses efforts, les tressaillements de ses muscles accusaient cette lutte désespérée de la volonté et de la force, qui se sentent subitement arrêtées par un obstacle insurmontable.
— Partirez-vous ? demanda Henri.
— Écoute-moi, dit Arthur en fermant les yeux pour recueillir ses sentiments confus, et les coordonner. Je vais tout te dire.[184] Quand tu m’auras entendu, tu prononceras sur mon sort ; je jure d’obéir à ta volonté, et d’accepter ton arrêt ; écoute-moi seulement. Un jour, il m’en souvient, tu m’as demandé, Henri, si j’avais aimé. Je me suis tu, alors. Aujourd’hui, je parlerai. Je te dévoilerai le mystère de mon âme, le secret de ma destinée. Henri, c’est l’amour qui m’a fait ce que je suis ; j’ai aimé comme toi ; plus que toi, peut-être, j’ai souffert. Soit orgueil, soit curiosité, j’étais tout jeune, que déjà mon imagination m’entraînait en des régions inconnues. Tous les jours, à seize ans, j’errais seul dans les riants détours de notre chère vallée[185], et tous les bruits de la nature prenaient une voix et jetaient à mon oreille d’irritantes paroles, le souffle du vent gémissant à travers les longues files de peupliers qui bordent le fleuve, les chants éloignés et plaintifs des pâtres, le petit cri joyeux de la mésange qui faisait son nid dans les buissons de nos halliers[186], tous ces murmures incomplets de la création, qui élèvent incessamment vers son auteur un hymne mystérieux, me jetaient en d’ineffables extases, en de longues et indéfinissables rêveries. Quelquefois, lorsque la nuit me surprenait dans la prairie, couché dans les hautes herbes, je sentais ma poitrine se gonfler, mes yeux se voiler, des pleurs stériles amollissaient ma paupière, et de bizarres visions voltigeaient devant moi comme des ombres dansantes. C’étaient de riants songes de femmes belles et parées, avec des éclairs dans les yeux, des reflets argentés sur les épaules, des mains effilées et attirantes, des paroles touchantes murmurées à voix basse, et semblables aux modulations fugitives de la brise matinale. Tout pâtre que j’étais, je m’élançais, par la pensée, dans le monde brillant des rêves ; comme le papillon qui brise sa chrysalide, je secouais la poudre de mes haillons, je me voyais beau, riche, éclatant, aimé. Oh ! aimé, surtout ; l’amour, c’était là le dernier sommet de toutes mes pensées, c’était le terme dernier de mon ambition d’enfant. Je rêvais un amour pur, à la fois plein d’abnégation et de désintéressement, un amour tel, qu’il n’a jamais existé peut-être que dans l’imagination d’un pauvre petit pâtre normand, entouré de tous les prestiges d’une opulente nature, comme un grain de sable enchâssé dans une bordure de brillants.
Un jour, une femme m’apparut, elle était belle, noble, riche, elle habitait un château. Je l’aimai. Une occasion me fut offerte de la voir, de lui parler, un mot de mépris d’elle décida de toute ma vie ; j’accusai le sort de ne m’avoir pas fait riche et noble comme elle ; et j’enveloppai dans un même sentiment de haine tous les nobles et tous les riches. Tu comprends maintenant, Henri, toutes mes actions, toutes mes jouissances. Non, ce n’est pas un vain amour de la fortune qui m’a jeté dans ces entreprises hasardées qui ont usé mon existence. Quand on me croyait avide, je n’étais qu’irrité et souffrant ; je ne voulais pas m’enrichir, mais me venger[187]. Voilà pourquoi j’éprouvais un sentiment de joie amère quand je faisais tomber une à une les pierres de quelque édifice élevé à grands frais par la noblesse et l’opulence. Voilà pourquoi j’accomplissais, avec tant de vigueur, cette œuvre de destruction que je m’étais imposée. C’était un défi que l’homme adressait à la destinée ; et dans ce combat inégal, je croyais avoir apporté assez d’énergie pour le supporter jusqu’au bout. Un moment, un seul moment, a encore bouleversé toutes mes résolutions et détruit cet échafaudage de vigueur factice. Cette femme qui, de pâtre, m’avait fait démolisseur de château, je l’ai revue, et je suis revenu à ma première nature ; le petit pâtre amoureux s’est retrouvé ; je l’aime encore, Henri, comme au premier jour où je la vis dans la vallée d’Auch, jeune et belle, avec une robe blanche flottant au vent et un bluet dans les cheveux. C’est que, pour moi, cette femme si fière s’est faite douce et bonne, c’est qu’elle a oublié toutes les orgueilleuses traditions de sa race pour mettre son cœur à la merci du mien, c’est qu’elle est descendue de toute sa hauteur pour venir à moi, à travers les préjugés du monde et ses impérieuses exigences, c’est que la distance des noms[188] a disparu entre nous, qu’elle me nomme Arthur, et que je la nomme Amélie[189], et cette femme, oh ! plains-moi, Henri, c’est avec elle que je voulais partir, cette femme se nomme madame de Noï !
Arthur s’arrêta, il était ému et tremblant. Sur le bord de sa paupière vous eussiez vu briller une larme qui, par un dernier effort de volonté hésitait avant de tomber, Henri le regarda longtemps ; et, dans cette muette contemplation, le front du jeune homme s’amollit par degré, comme un niveau de glace sous le souffle d’une brise d’été.
— Oui, cela est vrai, nos destinées se ressemblent ; comme moi vous avez aimé, comme moi vous avez souffert ; c’est le sort, Arthur. L’homme est tout entier au passé ou à l’avenir ; la vie se passe à se souvenir ou à espérer ; et entre ces deux extrémités, le présent n’est qu’un point imperceptible qui nous échappe.
— Me condamnez-vous, maintenant ?
— Je vous plains, dit Henri.
— Et que faut-il que je fasse ? demanda Arthur.
— Vous ferez votre devoir ; vous resterez.
Henri n’ajouta rien de plus. Le juge était aussi pâle que le coupable, et, comme lui, il se sentait prêt à pleurer.
— Et qui lui annoncera une pareille résolution ? demanda Arthur d’une voix éteinte.
— Il faut lui écrire, dit Henri.
Arthur, sans rien ajouter, traça quelques mots sur un papier qu’il plia, et qu’il remit à Henri[190].
VIII.
La faiblesse d’Arthur, ses hésitations, la détermination inexplicable de sa dernière résolution ne paraîtront étranges qu’à ceux qui n’ont pas assez profondément creusé les sentiments humains sous l’enveloppe qui les couvre[191], et ne savent pas encore que notre âme est tissue de contradictions, que les sentiments les plus opposés s’y mêlent et s’y heurtent, qu’en nous l’abattement du désespoir succède à la surexcitation de la fièvre, que toutes les nuances se confondent et s’entrechoquent, comme dans les peintures de Rubens[192], prodiges de richesses qui cachent sous un manteau de pourpre le secret de leur mécanisme et de leur pensée originelle. Presque toujours, ce qu’on nomme énergie dans les hommes, n’est qu’une vigueur factice prête à tomber au premier choc, comme on voit le ressort trop tendu d’une machine se briser en éclats. Toute la vie d’Arthur Raimbaut avait été ainsi couverte d’un nuage ; depuis dix ans, son impassibilité stoïque n’était qu’une lutte opiniâtre contre des sentiments primitifs, et une insurmontable tendresse de cœur. Semblable aux martyrs du vieux catholicisme, il s’était couvert d’un suaire pour imposer silence aux battements de son cœur, et les aiguillons des premières douleurs avaient laissé leurs traces dans ses flancs ; en vain, pour étouffer la voix secrète de ses désirs, avait-il essayé de demander à la vie active des spéculations, ses étourdissements et son ivresse ; en vain s’était-il imposé un rôle ; en vain avait-il voulu substituer un autre personnage[193] à la place du sien, et, comme font les acteurs, abdiquer, au profit d’une situation et d’un caractère convenu, sa situation propre et son propre caractère. L’apparition de madame de Noï, image enchanteresse qui, depuis son enfance, planait sur sa pensée et sur son existence, comme le soleil sur son horizon de brouillards, venait de tout remettre en question, et il se débattait maintenant entre deux sentiments différents tous deux, mais tous deux puissants, qui se personnifiaient à ses yeux, et prenaient deux visages, deux voix, deux noms de femme, Marguerite ! … et Amélie ! … Presque tous les hommes, d’ailleurs, sont ainsi pendant toute leur vie, pressés entre un double écueil, comme entre les deux tranchants d’un dilemme ; et il n’en est pas un, peut-être, qui ne se soit trouvé acculé entre ces deux barrières infranchissables, le présent et l’avenir.
Seulement, parmi ceux qu’un même destin assimile, les plus malheureux sont les meilleurs[194] ; et tandis que le vulgaire satisfait aisément aux appels de ses passions, les hommes d’élite[195] hésitent, tremblent, avancent vingt fois, et vingt fois reculent, toujours souffrants, toujours agités, et cherchent vainement le point d’appui qui doit leur servir de règle, et les jalons qui doivent leur montrer la route. Et pour ces hommes, ainsi placés, il n’est qu’un dénoûment possible, une fatale et terrible conclusion : le suicide [196] … Il n’y a que les esprits faibles qui supportent les positions mal définies et s’en accommodent. Les esprits droits et rigoureusement logiques, habitués qu’ils sont à pousser les principes jusqu’à leurs dernières conséquences, ont besoin de trancher tout d’un coup le nœud qui les embarrasse, et d’échapper d’un bond aux perplexités d’une situation contradictoire. Peut-être est-ce là la meilleure explication de ce grand problème mille fois débattu, et toujours à débattre. Peut-être est-ce là ce secret que tant de jeunes hommes, pleins d’espérances et d’avenir, ont enfoui avec eux dans la tombe ! …
Le lendemain, vers les six heures du matin, Arthur était encore dans sa petite chambre, assis et pensif comme la veille ; on eût dit que le temps ne marchait plus pour lui, et que sa vie était vouée désormais à une désespérante immobilité[197] ; il en était venu, à force de sensations contraires, à l’état de marasme où l’âme sommeille, et, n’attendant plus rien de la vie, anticipe sur le repos absolu de la mort. Son esprit ne saisissait plus que des idées confuses, semblables à ces vapeurs indécises qui accompagnent le crépuscule ; et, dans son abattement, il penchait douloureusement la tête, comme le voyageur, fatigué d’une longue route, qui s’asseoit sur le bord d’un fossé et se croise les bras.
Quelquefois, pourtant, son sang bouillonnait plus vite, son cœur battait avec violence, et une voix mystérieuse lui soufflait ces paroles puissantes : « Pourquoi souffres-tu qu’une influence puérile s’interpose entre toi et le bonheur ? N’es-tu pas maître[198] de ta destinée, et as-tu besoin de t’attendrir sur les malheurs d’une femme que tu n’as jamais aimée, et qui t’oubliera bientôt, comme toutes les femmes oublient ? Marguerite ! … Que t’importe son nom ?… que te veut-elle ? qu’accepte-elle de toi ? Est-ce un lien éternel qu’une distraction passagère ? et le bonheur est-il si peu de chose, que tu refuses de l’acheter au prix d’un si faible sacrifice ? et quel est l’homme, après tout, qui se laisserait enchaîner par un engagement pareil ? quel est celui qui, pour assurer son avenir, ne jetterait volontiers au vent la cendre de ces amours éteintes ? Réveille-toi, Arthur, rappelle-toi ton inflexible volonté ; sois homme, sois heureux ! … »
En écoutant cette inspiration, Arthur se sentait pris, pour un moment, d’une recrudescence d’énergie, et d’un irrésistible besoin d’action, qui remuaient son âme et l’agitaient en tous les sens. Il s’étonnait d’avoir cédé si facilement à la voix d’un enfant, et d’avoir timidement baissé la tête devant des reproches, qu’il avait prévus, et des terreurs qu’il aurait dû braver. Sa figure alors se colorait, et dans ses yeux brillait ce feu sauvage qui accuse les convulsions intérieures et les déterminations violentes de la volonté. Comme le corps d’un reptile, son corps se tordait sur le fauteuil où il était assis. Il était en proie à cette obsession cruelle des mauvaises pensées qui tiraillent l’esprit et le tiennent, pour ainsi dire, suffoqué et haletant. Puis, peu à peu, le délire s’affaiblissait, la surexcitation causée par le bouillonnement d’un sang trop ardent, se dissipait en fumée. Et une autre inspiration, succédant à la première, lui insinuait ces graves et sévères avertissements : « Que parles-tu de bonheur, le bonheur peut-il être là où la vertu n’est pas ? Tu as pris des engagements sacrés, oserais-tu les rompre ? tu t’es lié par serment, briseras-tu les liens du devoir, pour obéir aux caprices de ta passion ? Sois malheureux, mais reste honnête ; et à défaut de ces illusions menteuses qui t’attirent dans leurs pièges, tu auras au moins le calme de la conscience, et le sentiment du devoir accompli. »[199]
Et malgré lui, Arthur écoutait en silence cette voix douloureuse ; il se croisait les bras, résolu à se laisser emporter au courant des vagues, sans faire aucun effort pour gagner la rive, ou s’accrocher à une bouée de sauvetage. Une seule pensée résumait pour lui toutes les perplexités de cette situation : Il faut en finir ! et, la tête penchée, il regardait mélancoliquement le pistolet de Henri qui était resté sur le marbre de la cheminée.
La figure d’Arthur était devenue pâle, et dans ses yeux ne brillait plus qu’une flamme fauve et sinistre, semblable aux dernières lueurs d’un incendie qui s’éteint. Il se leva alors, et, debout devant la croisée, se prit à contempler l’immense étendue du parc qui se déroulait à ses pieds, et les premiers jets de verdure qui commençaient à poindre sous le couvert d’un ciel gris et nuageux. Déjà les chatons des jeunes bouleaux perçaient sous leur enveloppe blanche et luisante comme une peau de serpent, les premières pousses des grands tilleuls s’élançaient pleines de sève et dardaient leurs rameaux dans les nues, et, sous la mousse humide, les graminées étendaient leurs touffes rampantes ; la nature avait cet aspect moitié de contentement, moitié de tristesse, qui ressemble au demi-deuil d’une orpheline, ou à ces beaux sourires trempés de larmes que les poëtes prêtent à la mélancolie. Il y avait, dans ce spectacle, une puissance occulte et voilée qui, peu à peu, s’empara de l’âme d’Arthur, et émoussa les aiguillons les plus vifs de sa douleur. Ses sentiments les plus âcres prirent insensiblement une teinte moins vive, et l’incandescence de sa pensée, les agitations de son cœur, les pulsations violentes de ses artères firent place à une sorte de résignation terne, qui l’enveloppa tout entier dans son linceul. Ses yeux regardaient sans voir, des larmes mouillaient ses paupières. Il ressentit à peu près l’impression silencieuse que nous ressentons tous à l’aspect de quelque humble et obscur cimetière de village[200], dernier asile de ces modestes et simples existences qui s’écoulent sans bruit et s’effacent, ne laissant après elles d’autre trace et d’autre souvenir qu’une croix de bois sur une tombe de gazon. Par un mouvement instinctif, il frappa du bout des doigts sur les vitres de la croisée, qui tintèrent sourdement, et renvoyèrent aux échos de la petite chambre leurs accords monotones. Triste harmonie qui s’accordait merveilleusement avec la tristesse et la monotonie de la scène.
Tout à coup, au milieu de ce calme silencieux, de ce muet oubli de toutes choses, une impression aiguë fit tressaillir les muscles de son front et frémir les cils de ses yeux, comme si, à l’aspect d’une apparition inattendue et terrible, toute son âme se fût émue. Il recula d’un pas, et son regard s’arrêta avec une fixité maladive sur une ombre de femme[201] qui se dessinait à l’extrémité de la grande allée.
— Marguerite ! murmura-t-il avec angoisse.
C’était Marguerite, en effet, qui venait de pousser la grille d’entrée et s’avançait d’un pas rapide vers le château. Tout éloignée qu’elle était, on pouvait déjà distinguer, dans son allure, cette précipitation saccadée, cette irrégularité fiévreuse qui, chez les femmes, trahit les préoccupations de l’esprit et le trouble précurseur des situations hasardeuses. Quand Arthur la vit approcher, et franchir d’un pas ferme les degrés du péristyle, il ne put se défendre d’un involontaire mouvement d’effroi, et tous les souvenirs de son cœur lui jetèrent à l’oreille cette fatale question qui résumait toutes ses craintes, et les formulait d’un seul mot :
— Que me veut-elle ?
Puis, il se dirigea vers la porte de sa chambre[202], comme si, par une intuition claire et spontanée, il eût deviné les intentions de Marguerite, et calculé, à coup sûr, la marche et les effets de sa passion.
— Ouvrez-moi, monsieur, dit une voix étouffée et presque éteinte, ouvrez-moi vite.
Arthur pressa vivement le bouton de la serrure, et la fermière apparut devant lui, haletante et les yeux hagards. Tout en elle accusait le désordre d’un esprit bouleversé, et le trouble d’une raison jetée violemment hors de ses gonds. Sa toilette [203], si soignée d’ordinaire, et si gracieusement compassée, manquait d’ordonnance et de tenue ; son canezou[204] de drap noir, à trois rangées de boutons, le même qu’elle portait à la veillée[205] où Arthur l’avait rencontrée, était désagrafé par le haut, et laissait voir les extrémités d’un mouchoir à carreaux, enfoncé au hasard plutôt que croisé sur la poitrine. Mal emboîtée dans l’échancrure du corsage, son épaule droite apparaissait nue, et se gonflait par intervalles avec ce boursoufflement des chairs et cette plénitude extraordinaire que les artistes admirent comme le symbole de la passion. Ses cheveux, toujours lisses et polis comme la surface d’un lac, se découpaient sur son front en lignes inégales, et s’échappaient en mèches capricieuses ; une rougeur ardente colorait la pommette de ses joues, et montait jusqu’aux tempes, en s’empreignant, vers l’angle de l’œil, d’une teinte sanglante ; sur ses souliers, des traces de poussière et d’humidité ; dans sa main fermée, des gants flétris et déchirés en mille endroits, complétaient cet ensemble désordonné, et lui donnaient cet aspect sauvage et inculte de l’amour ou de la colère, que l’éducation peut dissimuler sans l’effacer jamais.
En voyant tant de beautés poétiques et vigoureuses aux prises avec une émotion accablante, et se colorant aux reflets de la passion, comme un beau paysage sous les teintes ardentes d’un soleil d’été[206], Arthur demeura un instant immobile, comme si le sentiment de sa position personnelle se fût un instant effacé pour ne laisser place qu’à l’enthousiasme d’un spectateur désintéressé. Une fois cette première émotion calmée, il avança lentement un fauteuil auprès de Marguerite, et l’invita d’un geste à s’asseoir. La fermière se laissa tomber tout d’une pièce sur le fauteuil qu’on lui présentait, ses lèvres s’entr’ouvrirent pour parler, mais l’émotion qui la suffoquait ne put livrer passage qu’à des sons inarticulés et à des mots sans suite. Elle baissa la tête, et prit sa poitrine à deux mains pour en contenir les ardentes palpitations.
Arthur eut peur.
— Qu’avez-vous, Marguerite ? demanda-t-il à voix basse, avec un mélange de compassion et de crainte.
Pour toute réponse, la fermière appliqua plus fortement ses deux mains sur sa gorge, comme pour dire :
— Attendez !
Arthur s’appuya sur le dossier de son fauteuil, et pencha sa tête sur l’épaule nue de Marguerite avec une expression d’anxiété douloureuse. Tout à coup, elle se leva, et, se posant par un bond vis-à-vis d’Arthur, qui eut à peine le temps de relever la tête :
— Arthur, dit-elle en lui jetant un regard tout de feu, m’aimez-vous ?
Ce brusque début, cette voix saccadée, ce coup d’œil interrogatif et ardent à la fois, produisirent, sur les nerfs d’Arthur, un effet semblable à celui d’une commotion électrique ; un frisson parcourut son corps, et il passa sa main dans ses cheveux, comme pour chasser de son cerveau le vertige qui l’envahissait.
— M’aimez-vous ? répéta Marguerite avec un sang-froid glacial, qui contrastait horriblement avec l’agitation qu’elle avait montrée jusque-là ; et, sans donner d’autre signe d’émotion, qu’une espèce de frémissement sourd, semblable au bruit d’un fer rouge qu’on plonge dans l’eau froide :
— Je vous aime, dit Arthur. Que voulez-vous de moi ?…
Marguerite le regarda quelque temps en silence, pour s’assurer, en scrutant sa physionomie[207], de la vérité de ses paroles. Elle se balança un instant sur ses jambes, avec l’impatience mal déguisée d’un captif qui s’apprête à briser ses fers et à prendre possession de sa liberté. Puis, sa voix, de sourde qu’elle était, devint sonore et éclatante, son visage resplendit d’un éclat insolite, ses pieds se fixèrent au sol avec une énergie épileptique.
— Faites de moi ce qu’il vous plaira, dit-elle ; je suis à vous, à vous seul. Gardez-moi avec vous ; emmenez-moi. Prenez-moi pour votre servante ou pour votre maîtresse, peu m’importe, pourvu que vous ne me chassiez pas, pourvu que vous me gardiez. Mais surtout ! oh ! surtout, évitez-moi l’affront de vos conseils, de votre raison, de votre sagesse, que vous nommerez du désintéressement. Ne me dites pas que je me perds, que j’engage mon honneur, mon avenir, mon bonheur peut-être ; que je suis folle, insensée, que le monde me blâmera, qu’il imprimera sur mon front un cachet d’infamie. Mépris, malheur, infamie, je sais tout cela ; je brave tout cela. Gardez-moi, ou chassez-moi, voilà tout ; mais sans phrases, sans hésitation. Tout est prévu, tout est calculé. Voulez-vous me sauver, oui ou non ?[208] …
À ces esprits timorés, qui n’aperçoivent les femmes qu’à travers un voile de circonlocution et de réticence, et qui pourraient blâmer le langage que nous prêtons en ce moment à Marguerite, nous répondrons que, dans le monde, dans les salons, où la passion est emprisonnée dans une triple ceinture de préjugés, de convenances et de craintes superstitieuses, il est possible que les femmes ne franchissent jamais les limites de la parole, que l’hypocrisie des conventions sociales leur impose ; mais les âmes vierges, et longtemps solitaires, se soumettent-elles volontiers à ces lois rigoureuses qui compriment les âmes malléables et usées au frottement de la civilisation ? nous ne le croyons pas ; il y a, d’ailleurs, des situations où l’éducation elle-même devient impuissante. Devant la passion arrivée à son dernier terme, les convenances disparaissent, les préjugés s’effacent. Quand l’incendie envahit un palais, que devient la grâce du portique et la symétrie des alignements ?
À cette allocution rapide et passionnée, Arthur ne trouvait pas de réponse en son cœur. Il était muet, pâle, immobile ; semblable à un homme qui assiste, sans le comprendre, à quelque grand bouleversement de la nature, il chancelait[209].
— Si vous ne m’aimez plus, continua Marguerite, si mon amour n’était pour vous qu’une distraction passagère, un caprice de quelques instants, dites-le-moi franchement, hardiment, sans détour ; car, avant tout, je veux de la franchise, et si je dois mourir, je veux mourir d’un seul coup. Voyons, répondez-moi donc ; réponds-moi. Dis-moi : « j’ai assez de toi, va-t’en » et je m’en irai, et je ne te ferai pas de reproches, et je ne pleurerai pas ; je te le promets, je ne pleurerai pas ; mais réponds-moi ?
En disant ces mots, Marguerite avait rejeté sa tête en arrière, les veines de son cou s’étaient gonflées. Un moment, ses yeux offrirent ces clignotements de la fièvre qui précèdent le frisson. Tout à coup, de grosses larmes s’en échappèrent avec abondance et ruisselèrent sur ses joues. Arthur s’avança vers elle, et lui prit les mains avec l’affection inquiète d’un père qui calme les mouvements d’un enfant malade.
— Marguerite, répétait-il, qu’avez-vous ? pourquoi avez-vous quitté votre demeure ? pourquoi êtes-vous ici en cet affreux état ?
La fermière demeura quelque temps encore debout, agitée de tourments convulsifs, et tordant dans ses mains crispées les mains d’Arthur. Ses muscles se détendirent, ses membres s’affaissèrent ; elle pleura amèrement.
— Arthur, reprit-elle après quelques instants de silence, et en se laissant tomber de nouveau sur le fauteuil qu’elle avait quitté, je vais tout vous dire ; vous méjugerez, et, je l’espère, vous aurez pitié de moi, car c’est à cause de vous que je souffre. Vous me demandez pourquoi je suis ici, pourquoi j’ai quitté ma demeure. La demeure de mon mari ne sera jamais la mienne ; et, telle chose que vous décidiez, je n’y rentrerai pas ; non, je ne me soumettrai plus aux caprices, aux injures, aux mauvais traitements d’un homme ivre.
Marguerite s’arrêta ; une invincible honte semblait enchaîner ses paroles et paralyser sa volonté. Elle se cacha la figure dans son mouchoir, en sanglotant.
— Voulez-vous donc que je retourne auprès de lui pour qu’il m’insulte, pour qu’il me frappe encore ? …
Marguerite avait dit ces derniers mots d’une voix brisée, éteinte ; c’était l’accent désespéré de cet orgueil de femme qui braverait plutôt toutes les douleurs que de subir un seul affront ; c’était le cri de rage de l’ange déchu qui s’indigne et se révolte.
— Frappée ! dit Arthur en se rapprochant encore une fois de Marguerite, avec cette sollicitude qui s’attache aux grandes humiliations.
— Frappée ! dit Marguerite en souriant ; dites, battue ! … c’est là le mot … Marguerite Évon a été battue par son homme.
— Et tout cela à cause de moi ? demanda Arthur.
— Oui, dit Marguerite. Il a prétendu que je vous aimais, et moi je me suis abaissée à la ruse, à la dissimulation, au mensonge ; quand, à chaque instant, je sentais venir sur mes lèvres un aveu énergique et franc, quand mon sang bouillonnait dans mes veines, quand vingt fois j’ai été prête à lui dire : « Eh bien ! oui, je l’aime ! » Oh ! le ciel a été juste ! La honte pour prix de ma lâcheté ; car, voyez-vous, Arthur, je ne suis pas une de ces femmes qui ferment leur bouche sur le secret de leur âme ; la perfidie me pèse, le mensonge m’oppresse, et, dussent tous les malheurs retomber sur ma tête, je voudrais vous aimer sans détour, sans masque, loyalement et sincèrement, à la face du ciel.
Il est des instants où les sentiments de l’homme deviennent intraduisibles et confus, comme le bruit des flots pendant l’orage. Ce sont mille voix qui se heurtent, mille éléments qui se confondent ; le roulement de la foudre, le bruissement des vagues, le sifflement des éclairs ; c’est un pêle-mêle de sons étranges où l’oreille ne distingue rien, et qu’on se borne à décrire seulement, faute de pouvoir l’analyser. L’âme d’Arthur offrait, au moment où nous parlons, un pareil chaos. Il n’est pas un homme qui, en écoutant des paroles d’amour, même lorsqu’elles ne trouvent pas d’écho dans son cœur, ne ressente une âcre et puissante volupté, et cette exaltation de l’orgueil satisfait qui se fait jour à travers nos émotions les plus intimes, et nos sentiments les plus purs. La passion ressemble à ces vins chauds dont le parfum nous enivre autant que la saveur, et qu’on sent, même sans les goûter. Arthur était étourdi et comme ivre : dans son cœur bouillonnaient mille sentiments contradictoires qui se heurtaient comme les vagues, et y laissaient leur écume.
Il se fit un moment de silence.
— Et, maintenant, maintenant ! reprit la fermière avec cet irrésistible accent de la faiblesse qui s’abandonne et se livre, ne me garderez-vous pas ?
Pour la première fois alors, Arthur revint au sentiment distinct de sa position. L’amour de cette femme, sa passion encore échauffée par l’irritation d’un orgueil blessé, les conséquences désastreuses du parti qu’elle voulait prendre, le danger d’une acceptation, et le danger non moins grand d’un refus, il vit tout clairement. Pour la première fois, aussi, l’image de madame de Noï, qui pendant cette scène orageuse, s’était tenue timidement à l’écart, se représenta de nouveau à son imagination, et il se retrouva, pour la seconde fois, en face de ce redoutable dilemme qui déjà avait enfoncé dans la plaie saignante de son cœur des aiguillons si acérés ! … ces deux amours inconciliables, comment les concilier ? comment sortir de cette impasse terrible où il se trouvait acculé comme un lion blessé entre une double haie ? Marguerite ! madame de Noï !… ces deux noms tintèrent encore une fois à son oreille ; et dans son impuissance à soutenir un pareil choc, il s’appuya sur le dossier du fauteuil, et laissa tomber sa tête sur sa poitrine…
— Eh bien ! reprit Marguerite en donnant à sa voix une de ces modulations qui attendrirait un bourreau, suppliantes et plaintives, craignez-vous donc que je ne vous coûte plus que vous ne m’avez coûté ? est-ce vous avoir donné trop peu, que de vous avoir voué mon amour ? refuserez-vous l’offrande d’une pauvre femme qui n’a pour trésor que son cœur, et qui vous supplie à genoux de le prendre ?
Arthur ne répondit pas ; sa volonté, si ferme en présence des intérêts matériels et des passions violentes, était faible et tremblante en présence des sentiments tendres et des intérêts du cœur. Allait-il donc briser d’un seul coup toutes les espérances de cette femme qui se traînait à ses pieds en suppliante ? allait-il, par un mot, la rejeter des hauteurs de son abnégation aux tristes réalités d’un amour méconnu, et d’un sacrifice inaccepté ? Et que dire à cette femme qui, dans l’abandon de son âme, avait prévu tous les malheurs, calculé toutes les chances ? Faire un appel à sa raison ; mais n’était-ce pas insulter son dévouement ? lui représenter froidement les suites probables du parti qu’elle allait prendre, mais se laisserait-elle tromper à un pareil langage ? les subtilités d’un désintéressement hypocrite masqueront-elles, à ses yeux, la dureté du refus et le refroidissement d’un cœur partagé ? Toutes ces banalités, que l’égoïsme des hommes a inventées pour se couvrir d’un manteau de bonté prévoyante, il les savait, et n’osait s’en servir, car il pressentait que Marguerite n’était pas femme à se laisser tomber dans un si grossier piège. Mais aussi, à celle qui venait lui dire, les larmes aux yeux et la mort dans le cœur : « Voulez-vous de moi, oui ou non ? » fallait-il donc répondre : « Laissez-moi ; ce cœur que vous m’offrez, je n’en veux pas ; votre amour est un fardeau qui me pèse ; partez, et laissez-moi marcher librement dans ma vie ? » Pour employer l’un ou l’autre de ces deux moyens, Arthur n’était ni assez hypocritement sot, ni assez cruellement brave ; aussi hésitait-il, ne trouvant dans son esprit aucun subterfuge, troublé, confus, sachant à peine s’il devait fuir ou rester. Marguerite le suivait du regard, et peut-être comprit-elle toutes les hésitations qui l’assaillaient, tous les doutes qui le tiraillaient en tous sens, car sa figure changea encore une fois d’aspect ; elle essuya les larmes qui coulaient sur ses joues, se redressa toute pâle, et s’approchant de lui, comme pour lire de plus près dans son cœur :
— Vous ne répondez pas, dit-elle.
La force d’Arthur, cette force si chèrement acquise pendant toute une vie de contrainte, l’avait abandonné, il était plus faible en ce moment que cet enfant nommé Henri, auquel il avait tant de fois reproché sa faiblesse. Pour toute réponse, il fit un geste de la main, geste plein d’anxiété et de doute, à la façon du gladiateur mourant qui demande merci.
Ce fut à cette supplication détournée et honteuse que Marguerite répondit, lorsque s’adressant à lui :
— Oui, j’ai pitié de vous, dit-elle, et je veux vous épargner un aveu qui vous coûte. Mon cœur vous gêne, ma présence vous importune ; ne le niez pas ; je le sais, je le vois. Il vous tarde d’être débarrassé d’une femme que vous avez prise, dans votre ennui, comme une distraction passagère. Vous parler de partir avec moi, de m’emmener ! Folle que j’étais, de songer à cela ! Folle que j’étais, de croire qu’on pouvait être heureuse après avoir été criminelle ! N’avez- vous pas d’ailleurs un autre intérêt qui vous attire ? un autre amour qui vous occupe ? une autre femme qui vous retient ?
— Marguerite ! dit Arthur d’une voix sourde, et comme s’il eût voulu s’opposer par un dernier effort aux progrès d’un incendie menaçant.
— Ah ! je le conçois ! reprit Marguerite, c’est une grande dame, celle-là ! … une femme du monde, de la société ! À la bonne heure ! voilà la passion qu’il vous faut, le cœur qui vous convient ; mais le cœur d’une fermière, fi donc ! vous en rougissez. Avant-hier, à la fête, ne vous ai-je pas vu suivre ses pas, écouter ses paroles, vous faire humble et complaisant pour elle, vous qui êtes si dur et si impitoyable pour moi ! Ses regards sont bien tendres, n’est-ce pas ? ses paroles bien douces ? son amour s’exprime autrement que le mien ? Ce n’est pas elle qui oublierait comme moi les convenances, qui viendrait vous dire : « Fuis avec moi ![210] » Oh ! non pas ! Elle consentira peut-être à vous aimer, mais sous le couvert d’un mari, sous le manteau d’une réputation intacte ; concilier les bénéfices du vice et les avantages de la vertu, voilà raisonner, n’est-il pas vrai ? Aimez-la donc, c’est moi, moi qui vous le conseille ; elle est digne de tout votre amour, elle ! Puisqu’elle a tant fait que de descendre jusqu’à vous, c’est bien le moins que vous la receviez à genoux !
Arthur avait tressailli douloureusement, alors que la fermière, comparant sa conduite à la conduite probable de cette autre femme qu’elle abhorrait dans son cœur, en avait marqué la différence. La fermière se taisait. Quelque temps, elle voulut soutenir l’apparence de hauteur et d’audace qu’elle avait prise, en balançant sa tête de droite à gauche, avec une intention d’indifférence orgueilleuse, comme un lutteur qui défie son antagoniste et l’appelle au combat. Mais, tout d’un coup, et par une de ces transitions subites que la science attribue spécialement à la délicatesse maladive d’une organisation nerveuse, son énergie s’éteignit, sa tête tomba, et se cachant le visage entre les deux mains :
— Et pourtant, dit-elle en sanglotant, je vous aime bien autant qu’elle !
Pendant quelques instants, le silence de la petite chambre ne fut troublé que par le bruit des soupirs de Marguerite qui s’échappaient, en sifflant, de sa poitrine gonflée. Quel est l’homme, dites-moi, qui ne se fût senti le cœur pris d’une douleur amère en assistant à un pareil spectacle ? quel est celui qui verrait, sans attendrissement, couler les larmes d’une jeune et belle femme, et ne voudrait les recueillir toutes en un calice, dût-il boire d’un seul trait ce calice empoisonné ?
— Marguerite, dit Arthur, ne pleurez pas ainsi, la vie peut encore redevenir belle à vos yeux, et le désert du monde n’est pas si aride que vous ne puissiez trouver, un jour, une source d’eau rafraîchissante, une ombre salutaire ; c’est à moi, à moi seul de pleurer, à moi de mourir [211].
Ces paroles produisirent, sur celle à qui elles étaient adressées, un effet contraire à celui qu’Arthur en attendait. Pour la seconde fois, elle essuya ses yeux avec une vivacité effrayante, et syncopant chacun de ses mots avec une douloureuse affectation de sang-froid :
— Je vous ai promis de ne vous faire aucun reproche, dit-elle ; quoi qu’il m’en puisse coûter, je tiendrai religieusement ma parole. Adieu.
En même temps, elle se dirigea vers la porte avec la roideur d’un malade qui ramasse toute l’énergie de sa volonté pour dissimuler sa faiblesse.
— Où allez-vous ? demanda Arthur avec effroi.
— Je vais retrouver mon mari. Il m’interrogera ; je lui dirai tout, je lui avouerai que je vous ai aimé, que je vous aime encore, que je l’ai trahi, indignement trahi. Et alors, tout sera fini pour moi ; je lui demanderai la mort, et il me la donnera[212].
Elle avait pressé de la main le bouton de la serrure, Arthur se précipita vers elle, et, par un mouvement énergique, quoique doux, la rejeta en arrière.
— Marguerite, dit-il, laissez-moi m’occuper de votre sort, de votre bonheur, sinon pour le présent, du moins pour l’avenir.
Et, en sortant, il ferma la porte au verrou, sur Marguerite, qui n’eut plus la force de faire un pas pour le suivre.
IX.
La fermière demeura seule, en proie à ce désespoir qui s’empare des femmes, alors qu’elles sentent la base de leur vie leur manquer sous les pieds, et qu’elles cherchent vainement autour d’elles, dans ce grand naufrage des illusions et des espérances, un rameau sauveur[213] où se prendre. L’amour ressemble à ces points lumineux qui éclairent un instant la nuit, et rendent en mourant son obscurité plus profonde. Lorsque les rayons de l’amour ont disparu, les objets, qui se doraient naguère à ses reflets, se confondent et s’altèrent, le ciel devient nuageux, les ombres s’épaississent et s’allongent, un morne brouillard enveloppe l’horizon, et l’on ne distingue plus dans l’espace que d’informes silhouettes et d’incomplètes visions. On éprouve alors un étrange besoin d’activité qui vous pousse en tous les sens, on appelle les douleurs, on cherche les blessures, on demande à la vie ses souffrances les plus vives, ses épines les plus acérées ; si on voyait un abîme sous ses pas, on s’y précipiterait avec joie pour échapper à ce vide fatal qui remplit incessamment le cœur, semblable à cette soif inextinguible des damnés, toujours vivante et toujours inassouvie. Quand l’amour nous échappe, notre situation est celle d’un homme richement vêtu qui se trouve dépouillé tout à coup et saisi par le froid ; notre cœur se serre, notre sang se refroidit, nos membres frissonnent, nous avons peur de nous-mêmes, et nous pressons vainement nos mains contre notre poitrine pour lui rendre la chaleur qu’elle a perdue.
Plus encore que les hommes, les femmes se laissent aller à cet abattement, pire que le désespoir ; comme l’amour était toute leur vie, en le perdant, l’existence ne leur est plus d’aucun prix. Les ressorts de leur organisation se détendent, leur esprit s’amollit et s’affaisse ; elles ne sentent plus autour d’elles qu’une nuit épaisse et un froid glacial. Bercées, la veille, au milieu d’une oasis de parfum et de verdure, leur imagination semble s’éveiller le lendemain dans un désert, et elles se laissent tomber lourdement sur la terre nue, en désespoir d’avoir tout perdu.
Assez souvent, dans ces moments d’affaissement, l’esprit s’abandonne à une contemplation rétrospective, et, pour échapper au présent, se jette dans le passé. Alors, on redescend en songe le courant de la vie, on visite encore une fois les sites qu’on a visités pendant son enfance, on s’asseoit sur le banc de gazon où on s’est assis, on suit le ruisseau qui s’enfonce à travers les hautes herbes de la prairie natale, on se laisse aller, malgré soi, au charme décevant qui vous attire, et quand l’esprit s’est fatigué dans cette illusion perfide, on se reprend à pleurer plus amèrement en regardant, l’œil troublé, cette riante image du passé qui rend le présent plus amer et plus insupportable. Madame Évon céda à ces attraits du souvenir ; elle se revit dans sa pension de Lisieux, tranquille quoique déjà curieuse, et dressant dans son cœur un autel de fleurs à ce dieu inconnu qui, plus tard, devait s’appeler l’amour ; elle recommença, en songe, ses lectures favorites, ses promenades solitaires et ses entretiens nocturnes avec une amie ; elle retrouva la maison de son père, blanche, sur un fond vert, et encadrée par de grands peupliers. Les sentiers qu’elle avait suivis, elle les suivit de nouveau, et aperçut encore, sur l’herbe froissée, la trace de ses premiers pas. Les perspectives riantes de la vallée d’Auch se déroulèrent à ses yeux, éclairées comme autrefois par un soleil doux et transparent ; elle s’assit dans sa chambre de jeune fille, et se prit à contempler, le soir, à travers la fenêtre ouverte, la lune qui montait à l’horizon. Rien ne manquait à ses souvenirs pour les rendre vivants. Ses premières parures, ses joyaux, ses meubles coquets sans richesse, et luisants de propreté, un fidèle miroir lui rendait tout cela ; et, comme ses meubles, comme ses joyaux, comme ses parures, ses désirs, ses pensées, ses rêves de l’adolescence lui revenaient à l’esprit, et chantaient à son oreille leur joyeuse chanson. Pauvre alouette qui avait quitté hâtivement le blé paternel et son nid de mousse, et que le plomb du chasseur vient de frapper dans la nue !
Par intervalles, un sentiment de haine et de jalousie ardente dominait l’amertume de ses souvenirs, et réveillait en elle le sentiment âcre de la vie. Elle se rappelait cette soirée du bal qui l’avait glacée de funestes pressentiments ; l’image froide et dédaigneuse de madame de Noï apparaissait à ses yeux moqueuse et triomphante. Elle détestait cette femme pour le mal qu’elle lui attribuait, et pour la supériorité qu’elle n’osait pas lui contester. Elle eût voulu la rencontrer face à face, pour épancher un peu de sa colère, et dégonfler son cœur en lui renvoyant ses mépris. Madame Évon était une de ces femmes en qui les soulèvements de l’amour-propre ne s’apaisent jamais complètement. Habituée dès son enfance aux adulations et aux caresses, elle avait nourri en son cœur un instinct de personnalité hautaine, de vanité roide et dominatrice qui ne pouvait plier[214]. Comme un captif, elle rongeait douloureusement sa chaîne, et il lui semblait que la vengeance seule pouvait consoler de l’amour. C’était un de ces caractères âpres et fougueux qui défient les orages et reprennent des forces dans la lutte. En cela, cette vie des femmes, toute d’étiquette, et pareille dans son immobilité à une longue faction au port d’arme, avait toujours violemment contrarié ses inclinations actives et son aventureuse humeur. Les sentiments intermédiaires n’existaient pas pour elle ; et, de cette chaîne qui unit les passions entre elles, elle ne connaissait que le premier et le dernier anneaux : Aimer ! haïr !…
Accoudée sur l’espagnolette de la croisée, elle suivait de l’œil la ligne droite de la grande allée, lorsqu’un léger coup, frappé à la porte de la chambre, vint la tirer de sa préoccupation. Elle tourna la tête, et ne répondit pas. Un second coup suivit le premier. Presque au même instant, le verrou grinça en dehors, et, par un de ces phénomènes sympathiques[215], qui se rencontrent brusquement dans certaines situations de la vie, madame de Noï se trouva, dans la petite chambre, en face de madame Évon. Les deux femmes, en s’apercevant, tressaillirent à la fois, et tandis que madame de Noï reculait d’un pas, avec une expression de désappointement et de dépit, la fermière avança le cou, comme pour mieux détailler les traits de celle que la jalousie, par un pressentiment instinctif, lui désignait pour rivale. Pour les femmes, ces rencontres inopinées ne peuvent se comparer qu’à la rencontre de deux guerriers irrités qui, autour d’un sentier obscur, entrechoquent leurs armes, et s’arrêtent un instant, l’œil plein de feu, pour se reconnaître et se défier[216]. Madame de Noï baissa le regard devant le regard lucide et ferme[217] de la fermière[218]. Sur les hauteurs où elle avait vécu, dans le sanctuaire que l’idolâtrie de la mode lui avait fait, jamais elle ne s’était trouvée en contact avec une de ces passions ardentes qui méconnaissent les distances et marchent droit à leur but. Émoussés par une longue habitude de royauté incontestée, ses nerfs n’avaient pas ce ressort d’une âme durcie aux émotions du combat. Jetée depuis peu hors de son cercle de convention, elle se sentait faible, déconcertée, hésitante dans cette voie où elle venait d’entrer. L’amour, pour elle, était un apprentissage où sa faiblesse avait plus de part que sa volonté. Elle en était aux rougeurs et aux timidités des jeunes filles. Le sentiment de l’orgueil qui pendant si longtemps l’avait aguerrie et exhaussée outre mesure, la laissait, maintenant, irrésolue et chancelante. La nouvelle et subite influence, qui venait d’envahir son existence, avait dissipé son énergie factice, comme le soleil dissipe les brouillards ; en éclairant son cœur, l’amour l’avait amolli. Vainement vous eussiez cherché en elle les traces d’autrefois. Ce type de la personnalité altière, que nous avons vu trôner si insolemment, s’était évanoui ; la grande coquette ne se retrouvait plus.
Lorsque le premier moment d’hésitation fut passé, madame de Noï voulut fuir, mais la fermière lui adressa un de ces regards de femme à femme, qui renferment mille fois plus de haine vivace et de passion contenue, que le regard de l’homme le plus irrité ; et donnant à sa voix cet accent à demi aigu qui cache la colère sous une apparence de raillerie :
— C’est à moi, madame, dit-elle, de me retirer, et de vous céder la place ; car ce n’est pas moi que vous venez chercher ici, je le sais ; et je me reprocherais de vous porter obstacle. Asseyez-vous donc, madame, et ne rougissez pas ainsi ; on vous prendrait pour une pensionnaire, prise par sa maîtresse en flagrant délit de désobéissance. Pourquoi, au fait, ne viendriez-vous pas ici, dans cette chambre ? j’y suis bien venue, moi !
En même temps, la fermière présentait un fauteuil à madame de Noï, avec cette affectation de politesse ironique que les Italiens comparent à la morsure d’un stylet [219]. Les femmes seules poussent l’instinct de la vengeance au point de se frapper du même coup qui blesse une ennemie, et d’oser se servir de ce glaive à deux pointes, qui transperce à la fois et celle qui s’en sert et celle contre laquelle il est dirigé. Dans une situation parallèle, les hommes cherchent, avant tout, à mettre leur point d’honneur à couvert, et pas un n’eût prononcé l’équivalent du dernier mot de Marguerite : « J’y suis bien venue, moi ! »
— Allons ! asseyez-vous ! répéta-t-elle encore.
Madame de Noï tremblait. Semblable à une reine dépossédée qui, pour la première fois, se trouverait en butte aux vociférations et aux injures de la populace [220], elle cherchait vainement à rappeler en elle une lueur d’énergie. Le ton railleur de la fermière l’épouvantait presque. Chacune des paroles qu’elle entendait appelait la rougeur sur son front, et sans en démêler nettement le sens, elle ressentait une douleur aiguë, et comme des blessures secrètes. Elle n’avait vu qu’une fois la fermière, et pourtant il lui semblait que cette femme avait le droit de la traiter d’égale à égale. Entre ces deux femmes se révélait un lieu douloureusement sympathique[221] ; à la voix de l’une les fibres de l’autre résonnaient fatalement ; leurs deux âmes se trouvaient en contact, et, sans connaître précisément le point de rencontre, elles se rencontraient pourtant, et se heurtaient d’instinct.
— Çà [222], madame, ne rougissez donc pas, continua la fermière, qui avait toujours présents à l’esprit les souvenirs irritants du bal, et ces premiers indices révélateurs qui avaient éveillé sa jalousie. Quoi d’étonnant que vous veniez rendre visite à votre cavalier, à votre danseur ? Une politesse en vaut une autre, et une femme n’est pas perdue pour avoir mis le pied dans la chambre d’un garçon.
Madame de Noï gardait toujours le silence. La main appuyée sur le dossier du fauteuil, et le front obstinément penché, elle ressemblait à une de ces statues de marbre qui pleurent sur les tombeaux ; sa rougeur passagère avait fait place à une pâleur mate, veinée de bleu seulement vers le cou et à l’endroit des tempes. À peine retenues par un bonnet de gaze, placé en arrière sur le sommet de la tête, les mèches blondes de ses cheveux encadraient confusément sa figure douce et maladive. Un long peignoir de soie brune enveloppait vaguement ses formes si élégantes et si gracieuses, sans les accuser nettement, et retombait jusque sur l’extrémité d’un pied immobile.
L’irritation de la fermière s’augmentait de ce silence. Elle avait vu madame de Noï avec cette secrète satisfaction de l’amour blessé, qui trouve enfin sa proie et s’apprête à la déchirer. Mais tant de résignation silencieuse, tant de passiveté craintive la lassait sans la désarmer. Elle eût voulu trouver, en face d’elle, une colère au niveau de la sienne, un orgueil égal au sien.
— En vérité, reprit-elle avec la sécheresse d’intonation qui avait jusque-là accentué ses paroles, vous me faites peine, madame, et je souffre de vous voir souffrir. Il vous avait donné rendez-vous chez lui, n’est-ce pas ? et vous êtes étonnée qu’il ait osé manquer à sa parole. Voulez-vous que j’aille le chercher, que je vous l’amène ? vraiment, vraiment, entre femmes, ce sont là des services que l’on doit se rendre.
Pour la première fois, alors, madame de Noï trouva assez de force pour recueillir ses idées, et comprendre distinctement le sens de ce qui se passait. Un moment sa fierté de grande dame lui revint, et on eût dit qu’elle avait encore un cortège d’adorateurs à ses côtés, et le diadème au front, lorsque, d’un ton lent et froid et avec un sourire dédaigneux, elle laissa tomber ces mots :
— Voici bien des paroles que vous dites, madame, et je vous avoue que je ne vous comprends pas encore. Quelle est la nature du service que vous me proposez ? je l’ignore, et je ne réclame aucun service de vous. Qui voulez-vous aller chercher ? qui voulez-vous m’amener ? de qui parlez-vous ? et où prenez-vous le droit de me parler ainsi ? Si je suis ici, c’est que, apparemment, il me convient d’y être, et la preuve que je ne me repens pas de ma démarche, c’est que j’y reste malgré vous, peut-être, et avec vous.
En même temps, madame de Noï s’assit froidement en face de la fermière, avec cet air de dignité impérative qu’elle venait de retrouver subitement. En entendant ces mots, Marguerite avait tressailli ; ses joues s’étaient empourprées, les veines de son cou s’étaient gonflées ; elle rencontrait une ennemie à sa hauteur.
— Bien, bien, madame, dit-elle ; à la bonne heure, voilà parler, enfin. Mais soyez donc plus franche encore, aussi franche que je le suis. Dites-moi donc que vous venez dans cette chambre chercher votre amant, et que vous ne vous expliquez pas comment vous m’avez trouvée à sa place. Ah ! ne niez pas ! de femme à femme, il est difficile de mentir, et autant appeler les choses par leur nom ; car c’est votre amant, madame, que vous venez chercher ; ne souriez pas ainsi dédaigneusement, et répondez-moi. Voyons, ai-je dit la vérité ?
Madame de Noï se tenait droite et immobile sur son siège, roidissant sa volonté et s’efforçant de vouloir feindre en apparence sous les cruelles atteintes qui prenaient place dans son cœur.
— À tout cela, dit-elle, je me contenterai d’une réponse : de vous demander s’il vous est permis de m’interroger ? Qui êtes-vous, je vous prie ? comment vous nommez-vous ? Je ne me rappelle pas que nous nous soyons jamais rencontrées dans le monde. Êtes-vous du cercle de madame de Castelmare, ou de la duchesse de Presles[223] ?
— Je ne vais pas au bal, interrompit madame Évon.
— Je ne vais pas à la veillée, moi, dit madame de Noï ; vous voyez bien que nous ne pouvons pas nous connaître.
Et la grande coquette avait repris, en parlant, son infernal dédain d’autrefois, et ces grands coups de tête qui, dans le monde parisien, lui avaient valu le sceptre du bon ton. En dépit de la tempête qui grondait violemment dans son âme, elle était calme et souriante, cachant sous le voile de son œil bleu la passion extrême qui la dévorait.
— Si j’étais dans votre salon, madame, dit la fermière avec un redoublement d’amertume, gardée à vue par deux valets galonnés, vous pourriez peut-être me parler ainsi. Mais dans une petite chambre comme celle-ci, vos airs de reine sont déplacés ; toute grande dame que vous êtes, toute obscure villageoise que je suis, nous sommes égales toutes deux ; car nous y sommes venues dans le même but, avec le même intérêt, pour le même homme ; et aux yeux de cet homme, nous avons le même prix, la même valeur, car nous sommes marquées toutes deux à son effigie : vous sa maîtresse d’aujourd’hui, moi sa maîtresse d’hier [224].
Madame Évon était pâle et tremblante, comme le sont d’ordinaire les femmes, toutes les fois qu’il leur arrive de sortir du langage de circonlocutions et de périphrases qui masque toujours leurs secrets sentiments, et d’avouer franchement une situation honteuse ; car pour les femmes coupables, les mots sont presque tout, et vous en verrez plus reculer devant la franchise d’un aveu que devant l’infamie d’une mauvaise action. La figure de madame de Noï demeura tranquille, et à peine son émotion se trahit-elle dans le pli imperceptible de sa lèvre supérieure.
— Si cela était, dit-elle en regardant fixement la fermière, je m’applaudirais de partager un pareil honneur avec vous.
— Vous mentez ! dit celle-ci, que le sang-froid de son adversaire accablait. Fussiez-vous duchesse, marquise, impératrice, vous êtes femme ; ce que je sens, vous le sentez. Allons donc, quittez ce sourire qui ne me trompe pas ; n’essayez pas d’étouffer les battements de votre cœur ; quand même je ne lirais pas dans vos yeux, par ce que je souffre je devinerais que vous souffrez.
Arrivée à son apogée, il est rare que la colère dure ; le cœur est impuissant à soutenir longtemps les émotions fortes, et l’amollissement succède d’ordinaire à l’exaspération. En prononçant ces dernières paroles, la voix de la fermière s’était altérée, et il y avait déjà, dans l’expression de sa figure, plus de douleur que de dépit ; l’amour véritable a d’ailleurs ceci de particulier, que la vanité elle-même est moins forte que lui, et qu’à travers l’âpreté de son langage le plus orgueilleux, on sent percer une secrète mélancolie et un involontaire allanguissement. Par un effet simultané, madame de Noï avait perdu de son ardeur en même temps que madame Évon. La faiblesse et les larmes leur étaient revenues, et des hauteurs de l’orgueil qui s’exhale derrière un amas de mensonges et d’efforts calculés, elles étaient retombées aux douleurs d’une âme souffrante, qui ne se sent plus la force de s’irriter contre le sort, et ne cherche un refuge que dans la solitude. Madame de Noï se leva, et jetant sur la fermière un regard humide où l’attendrissement avait pris la place de la morgue aristocratique et du dédain :
— Vous l’aimez donc bien ? dit-elle.
Cette question si simple, et qui renfermait pourtant tant de compatissance à la fois et de douleur, dissipa les dernières velléités d’un orgueil mourant.
— Oh oui ! dit Marguerite en pleurant.
— Et, comme à moi, continua madame de Noï avec cette simplicité d’accent et cette innocence d’attitude qui caractérise les grands découragements, il vous a promis de vous aimer, de n’aimer que vous ?
— Oui, dit Marguerite.
Il se fit un moment de silence solennel, semblable aux moments de silence que produisent les bouleversements de la nature, ou la ruine des illusions humaines.
Madame de Noï s’avança vers la fermière, et, lui prenant la main, elle la pressa en pleurant à son tour et sans parler.
La péripétie d’attendrissement que nous avons signalée suivait son cours, et ce fut un étrange et beau spectacle que celui de ces deux femmes, victimes sacrifiées sur le même autel, joignant leur amour avant de mourir peut-être, et confondant leurs pleurs, après avoir mêlé leur passion et leur haine.
— Oui, vous l’avez dit, reprit madame de Noï d’une voix lente, et en syncopant chaque mot, comme si la douleur eût brisé ses organes ; l’obscure villageoise vaut aujourd’hui la grande dame, nous sommes vraiment égales, malheureuses toutes deux.
Les deux rivales se turent encore un moment ; leur âme était abattue et comme assoupie, la torpeur du sommeil avait succédé aux élancements de la fièvre.
— Assez pleuré, dit alors madame de Noï en essuyant ses yeux, et en redressant sa taille effacée, comme pour donner plus de fermeté à son attitude et de poids à sa proposition. L’engagement que je vais prendre, le prendrez-vous avec moi ?
— Quel qu’il soit, oui, dit Marguerite.
— Je promets donc d’oublier cet homme…
Elle s’arrêta sur ce mot ; sa pensée n’osait pas aller plus loin, et la parole lui manquait.
— Le promettez-vous aussi ?
— Je le promets, dit encore la fermière.
Ce que cet engagement si bref renfermait de sentiments étouffés, d’espérances évanouies, de souffrances intimes, de déchirement profond, nous n’essayerons pas de le dire[225]. Peut-être cette situation de deux femmes, aux prises avec la même passion, et faisant vœu, en face l’une de l’autre, de renoncement et d’oubli, est-elle une des plus douloureuses que l’histoire de la psychologie[226] ait jamais accusée. C’était quelque chose de semblable à ces emprisonnements du cloître, à ces sacrifices austères imposés par la religion, et que le cœur acceptait en saignant. Étrange contrat, où chacune des parties contractantes [227] apporte, en garantie de sa foi, tout un passé détruit, tout un avenir empoisonné, échange terrible où deux femmes déposent, sur une même tombe, leur couronne effeuillée, et la meilleure part de leur vie.
— Maintenant, dit madame de Noï, songeons à vous, à votre avenir, qui peut encore être heureux, peut-être. Pour venir ici, vous avez fui la maison de votre mari ; retournez-y, croyez-moi.
— Jamais ! dit Marguerite.
— Et que voulez-vous faire ?
— Tout, excepté cela.
La physionomie et l’accent de la fermière avaient repris leur première énergie ; madame de Noï la regarda avec compassion.
— Je vous déclare que j’entrerai, dit en dehors une voix rude, entre les éclats de laquelle on distinguait l’accent bref et sonore d’Arthur Raimbaut.
— Est-ce lui ? mon Dieu ! dit madame de Noï qui, par un instinct de femme, avait presque deviné le drame qui s’était passé, et celui qui se préparait.
— C’est lui ! dit la fermière, sans bouger, sans pâlir.
— Au nom du ciel ! ne bravez pas sa colère, dit madame de Noï avec effroi ; fuyez, cachez-vous ; il est furieux, et vous tuerait peut-être !
Un sourire étrange plissa les lèvres de la fermière ; la mort ne l’effrayait pas, elle l’appelait.
— Si vous ne voulez pas m’ouvrir cette porte, je l’enfoncerai[228], continua toujours en dehors la voix de Guillaume Évon.
— Entrez avec moi dans ce cabinet, dit madame de Noï en entraînant la fermière vers une petite porte obscure à demi cachée dans un enfoncement de la muraille ; faites cela pour moi, je vous en supplie, pour moi, ajouta-t-elle avec un intraduisible accent, qui suis votre sœur[229].
X.
L’énergique volonté de Guillaume Évon, ou plutôt sa fureur aveugle, avait triomphé de la résistance opiniâtre d’Arthur. Comme tous les hommes du monde, celui-ci avait songé d’abord à faire bonne contenance, quitte à chercher ensuite le moyen de sortir d’embarras ; et pendant ce premier moment d’hésitation où l’amour-propre surpris sacrifiait à sa défense des intérêts réels, l’entraînement passionné du paysan avait gagné tout le terrain qui n’était pas défendu. Déjà, Guillaume, écumant d’impatience, appuyait sa large main sur les panneaux de la porte, et attendait en frémissant qu’Arthur lui livrât le passage. Ses dents serrées avec violence, ses yeux enflammés et son silence obstiné, annonçaient assez que sa résolution était bien prise, que sa volonté était ferme et inébranlable, comme la volonté d’un homme possédé d’une idée unique. Arthur sentit qu’il était trop tard pour s’opposer à cette fougue de jalousie, et ouvrit enfin la porte de sa chambre.
— Il n’y a personne ! s’écria Guillaume stupéfait.
— Il n’y a personne ! répéta Arthur[230].
Un moment de silence suivit cette double exclamation, qu’on eût dit arrachée par le choc d’une étincelle électrique. Guillaume était devenu pâle tout à coup. Ses yeux égarés furetaient encore dans tous les coins de cette chambre, mais ses bras étaient retombés sans force le long de son corps immobile, et la fureur, qui venait d’animer si brutalement cette lourde machine[231], semblait avoir fait place à je ne sais quelle terreur fébrile. La réaction fut violente, et lorsque Guillaume se retourna vers Arthur, comme pour lui parler, sa poitrine oppressée lui refusa le souffle, sa langue lui refusa les mots. Enfin, suffoqué par la surprise, terrassé par le contre-coup de sa colère, il se laissa tomber dans un fauteuil, en balbutiant une phrase inintelligible ; puis, il recueillit ses forces comme pour attendre les attaques d’Arthur, qu’il pensait bien devoir prendre l’offensive.
De son côté, Arthur n’éprouvait pas moins d’agitations morales que l’irascible fermier ; mais, habitué dès l’enfance à contenir l’expression de ses sentiments les plus ardents, à lutter contre lui-même, à se dompter, à se vaincre, il avait bientôt repris cette apparence de sang-froid que possèdent les gens du monde comme ils possèdent l’escrime, et qui fait partie d’une bonne éducation comme l’art de tirer le pistolet. Cependant il n’ignorait pas qu’avec toute l’adresse possible, l’homme le plus habile aux armes peut fort bien se laisser enferrer par un adversaire qui n’aurait jamais manié un fleuret ; aussi, malgré toute son assurance, ne voyait-il trop sur quelle garde se tenir, en face d’un homme comme Guillaume Évon[232].
Mais cette incertitude ne pouvait durer longtemps ; Arthur savait qu’un seul instant de silence pouvait lui faire perdre la partie, et il se décida à parler, ne fût-ce que pour occuper les oreilles de Guillaume Évon[233]. Cependant, comme il n’y avait guère moins de danger à réveiller la susceptibilité assoupie du fermier, et que le ton du triomphe n’eût pas manqué de faire sentir à celui-ci, d’une manière plus irritante et plus acerbe, l’échec qu’il venait d’éprouver, Arthur crut faire preuve de bonne politique en abordant la question directement, mais sous un point de vue qui lui permit de s’en isoler en quelque sorte, et de la traiter comme un spectateur désintéressé.
— Monsieur Évon, dit-il, je vous plains sincèrement ; la jalousie est une terrible passion, et personne au monde ne saurait vous faire un crime de céder à sa violence ; mais si vous pouviez employer à la combattre la moitié de l’énergie que vous dépensez à son service, les honnêtes gens éprouveraient pour vous un autre sentiment que celui de la pitié.
Le son de voix d’Arthur produisit sur Guillaume l’effet d’un coup d’éperon. Il tressaillit, secoua la tête avec impatience, et regarda son interlocuteur comme s’il eût voulu s’élancer sui lui[234] ; mais, à son tour, le paysan comprit qu’un mouvement désordonné de son âme pouvait le livrer à la merci d’Arthur, et sentit la nécessité de se contenir. Ce fut avec une voix sourde et un accent mi-parti d’ironie[235] et de simplicité, qu’il grommela cette réponse :
— Vous avez raison, monsieur Raimbaut, et c’est moi qui ai tort ; je ne devrais pas me plaindre si haut, je devrais songer que mes peines importunent les autres, et garder pour moi seul tous mes chagrins ; mais, ma foi, je vous en demande bien pardon, quand je souffre, il faut que je crie, ou bien je suis sûr d’étouffer. Maintenant, faites-moi, si vous le voulez, de la morale, dites-moi que je devrais être philosophe et prendre mon parti en brave ; ou bien prouvez-moi par de beaux raisonnements que je me trompe, et que je n’ai pas le moindre sujet de me fâcher, je ne demande pas mieux que de revenir à mon état naturel[236] ; vous savez bien qu’au fond je ne suis pas méchant [237].
Arthur sentit le piège que lui tendait le paysan sous cette apparence de bonhomie, aussi se garda-t-il bien de répondre à ses provocations ; c’est au dernier mot de la phrase seulement qu’il s’attacha, sorte de parade fort avantageuse dans une discussion, en ce qu’elle écarte le coup sans découvrir son homme.
— C’est en ceci que vous vous trompez, monsieur Évon, reprit Arthur, vous êtes méchant comme vous êtes bon, sans le savoir, sans le vouloir, et uniquement parce que les circonstances ou votre disposition d’esprit vous auront jeté d’un côté ou de l’autre ; ce que je voudrais voir, en vous, c’est une force supérieure à la colère comme à la bonté, une raison capable de dominer l’une comme l’autre, et d’en régler les mouvements[238] ; en un mot, je voudrais vous voir commander, tandis que vous ne faites qu’obéir.
— Cela est bien facile à dire, monsieur Arthur, mais ce n’est pas à mon âge que j’apprendrai à dissimuler. Ce que vous me demandez, voyez-vous, ce n’est pas autre chose. Sans doute il vaudrait mieux pour ceux qui m’entourent que je fusse un mari commode, un vrai badaud qui laissât prendre son bien sans mot dire, et qui se crût encore trop honoré des attentions qu’on veut bien avoir pour sa femme ; le beau rôle [239], vraiment ! Mais si, comme vous le dites vous-même, je ne fais qu’obéir au lieu de commander, vous conviendrez que je ne suis pas responsable du malheur que je puis causer ; tant pis pour ceux qui me barrent le chemin. Après tout, je ne suis pas une poule mouillée, je ne crains personne, et je n’entends pas me gêner pour faire valoir mes droits et pour réclamer mon bien.
— Je ne veux pas discuter avec vous sur un sujet qui paraît vous irriter si violemment ; oubliez le motif qui vous a conduit ici, et parlons d’affaires plus sérieuses. Je me proposais d’aller vous voir, et puisque le hasard…
— Je n’ai aujourd’hui qu’une affaire sérieuse, monsieur Arthur, dit le fermier en se levant avec violence, n’espérez pas rompre les chiens [240] et me donner le change ; voilà un quart d’heure que j’essaye de faire comme vous et de parler posément, mais j’en ai assez ; maintenant, je ne vous prends pas en traître, et je vous demande à vous, monsieur Arthur Raimbaut, où est Marguerite ?
— Monsieur Évon, dit Arthur avec sang-froid, vous me connaissez bien mal, si vous espérez m’intimider par vos brusqueries. Je les supporte parce que je les excuse, mais je ne cède rien aux passions, moi, pas plus aux passions des autres qu’aux miennes. Mettez que je ne puis vous répondre, ou que je ne le veux pas.
— Vous ne le voulez pas ! je ne me suis pas trompé, Marguerite est ici !
Et Guillaume commença ses recherches infructueuses dans la chambre d’Arthur ; deux fois il se précipita vers le lit, et en écarta les rideaux, comme s’il eût voulu les déchirer ; puis il ouvrit quelques armoires, il sonda même la muraille en la frappant de son poing vigoureux[241] ; enfin, il s’approcha du cabinet où se tenaient blotties madame de Noï et Marguerite, et remarqua que la clef n’était pas à la porte.
Arthur suivait avec anxiété chacun des mouvements du fermier. Son cœur dut battre avec plus de rapidité lorsqu’il le vit hésiter un instant devant cette porte fatale, et tout le stoïcisme de son âme ne put effacer les rides de son front.
Mais Guillaume se détourna brusquement, revint une troisième fois au lit, rouvrit les armoires, et parut continuer une recherche désespérée.
La leçon de l’homme du monde n’avait pas été perdue, le paysan dissimulait.
— Monsieur Évon, dit Arthur, toutes ces fureurs doivent avoir un terme ; quand vous serez en état de m’entendre, vous reviendrez me voir, mais pour aujourd’hui, laissez un peu ma chambre en repos ; pour répéter vos paroles de tout à l’heure, je vous dirai aussi : j’en ai assez.
— Écoutez, monsieur Arthur, me voici de sang-froid, et je ne touche plus à vos meubles. Oubliez à votre tour que je suis venu chercher ma femme chez vous, et dites-moi ce que je dois faire si je la retrouve ailleurs. La femme d’un paysan, voyez-vous, est comme la terre d’un paysan ; nous n’aimons pas, nous autres, à céder notre bien, nous y tenons de corps et d’âme, et nous ne livrons pas plus volontiers nos femmes aux galants que nos enclos à la Bande-noire [242] ; c’est bon pour les grands seigneurs. Je ferai donc tout ce qu’il est humainement possible de faire pour rejoindre Marguerite, et je la ramènerai chez moi de gré ou de force. Quant au bonheur conjugal qu’elle doit attendre après son escapade, je me charge de le mesurer à ma guise, et c’est une affaire qui peut se régler entre elle et moi ; mais son complice, monsieur Arthur, est probablement un beau monsieur à belles manières, qui aura trouvé tout simple de déshonorer un homme d’une autre caste, comme ils disent, et qui trouvera commode de ne pas s’en inquiéter. J’ai beau être maire de ma commune et le plus riche fermier du département, je n’obtiendrai certainement pas de lui cette satisfaction qu’il accorderait au dernier spadassin[243] de salon ; je sais ce que c’est que l’égalité, je sais comment on la pratique. Cependant, il faut que je me venge, n’est-ce pas ? et j’ai besoin, comme un autre, de me faire justice. Dites-moi, me suis-je trompé, et croyez-vous qu’un monsieur de Paris veuille se battre avec moi ? [244]
— Je ne puis répondre à cette question, dit Arthur [245].
— Et si je vous appelais en duel, y viendriez- vous ?
— Je ne sais, dit Arthur.
— Eh bien ! donc, comment dois-je punir le ravisseur de ma femme ? car vous ne pensez pas que j’aille quérir à mon aide la gendarmerie et le procureur du roi. Je sais aussi comment les tribunaux pratiquent l’égalité, et je ne veux pas exposer la femme de Guillaume Évon à l’injure d’être condamnée à une amende moins forte que la femme d’un notaire ou d’un sous-préfet. Dites-moi, comment punirai-je le séducteur de Marguerite ?
— Vous l’assassinerez, dit Arthur ; c’est de toute logique.
— C’est vous qui l’avez dit, cria Guillaume d’une voix tonnante.
Et courant à la porte du petit cabinet de toilette :
— Il y a une femme ici, dit-il, n’espérez pas me le cacher plus longtemps.
— Et qui vous assure que ce soit la vôtre, monsieur ? reprit Arthur avec un imperturbable sang-froid.
— C’est ce que nous allons voir. Donnez-moi la clef.
— Non.
Au même instant la porte du cabinet de toilette s’ouvrit avec bruit, et une femme en sortit.
C’était madame de Noï.
— Arrêtez, monsieur, dit-elle ; me voici, que me voulez-vous ?
Rien ne put égaler la surprise de Guillaume Évon à cette apparition subite, si ce n’est peut-être l’étonnement d’Arthur ; mais, par malheur pour celui-ci, l’empire qu’il avait ordinairement sur lui-même n’empêcha pas la manifestation nerveuse de l’émotion qu’il éprouvait, et Guillaume Évon eut le temps de remarquer la pâleur qui couvrit le visage d’Arthur. Ce fut un trait de lumière pour le paysan, et sa perspicacité naturelle, aiguisée par la jalousie, ne resta pas en défaut devant ce nouvel obstacle : il interpréta sans hésitation le mouvement échappé à son adversaire, et resta convaincu que madame de Noï n’était pas seule dans le cabinet.
— Par ma foi, dit-il, monsieur Arthur Raimbaut, je vous en fais mon compliment, une jolie femme, et une grande dame, qui plus est ! ai-je pu vous croire capable de vous encanailler ? si vous me le pardonnez, vous serez plus généreux que moi-même, car je ne me le pardonnerai jamais.
Arthur voulut parler, mais madame de Noï l’interrompit.
— Assez, monsieur, dit-elle. Sortez, je vous l’ordonne ; vous penserez ce qu’il vous plaira de ma présence ici. Si vous êtes homme d’honneur, je n’ai rien à vous demander ; si vous ne l’êtes pas, il vous est permis d’abuser de mon imprudence ; et maintenant sortez.
— Rassurez-vous, madame, je tiens plus à mon honneur que vous ne tenez à celui de votre mari, j’imagine. Aussi n’ai-je pas envie de vous trahir. Je suis venu ici pour mon compte, et non pas pour jouer le rôle d’espion au service des autres.
— C’est bien, dit madame de Noï d’un ton sec, et avec l’intention marquée de terminer là toute discussion.
Mais Guillaume y mettait de l’obstination, et paraissait bien décidé à ne pas comprendre.
— Monsieur Guillaume Évon, dit Arthur, je pense que vous avez maintenant satisfait votre curiosité. Je vous prie de vous retirer.
— Je sais que vous aimez la bonne compagnie, répondit le fermier avec son sourire moqueur, mais il n’y a pas de mal à ce qu’elle soit plus nombreuse ; d’ailleurs monsieur de Noï ne serait pas fâché de voir un tiers dans votre conversation avec madame ; c’est pourquoi je ne veux m’en aller qu’après avoir mis un remplaçant entre vous deux.
Et il fit quelques pas vers le cabinet, pour y prendre Marguerite.
Mais au même moment la porte de la chambre d’Arthur s’ouvrit, et monsieur de Noï parut sur le seuil[246].
XI.
Il arrive, dans la vie humaine, un moment où les passions et les intérêts, longtemps divisés et tenus en suspens, se rejoignent pour éclater et concourir à un dénoûment fatal[247]. Il en est de ces conjonctions, comme de la conjonction des corps célestes, et l’on dirait que le même doigt qui a assigné aux planètes leurs révolutions et leurs points de contact, a également assigné aux événements qui traversent notre existence un cours réglé, un temps prévu et inévitable[248]. L’apparition de M. de Noï compliquait singulièrement la scène dont nous avons décrit la première phase dans le chapitre précédent. Le drame venait de prendre une nouvelle face, dont nul ne pouvait prévoir les péripéties. La figure de l’ancien secrétaire d’ambassade était froide, comme toujours, avec une expression continue de sombre mélancolie et d’ironique découragement [249]. Vu sous une autre face, c’était le développement du même thème déjà reproduit par Guillaume Évon. L’un éclairait l’autre par le contraste ; et sous les différences de l’aspect extérieur perçait une pensée commune et un sentiment homogène. Les passions procèdent presque toujours ainsi, par reflets doubles. Chaque homme a, auprès de lui, son pendant, plus chargé ou plus affaibli de couleur ; et, pour qui observe, il est rare qu’une même situation ne montre pas plusieurs faces différentes, et ne subisse point diverses transformations[250].
Madame de Noï était debout, près du lit, masquant de son corps la porte du cabinet où elle avait entraîné la fermière. À la vue de M. de Noï, ses traits n’exprimèrent ni étonnement ni effroi ; seulement, elle se redressa avec cette affectation de la fierté qui craint de trahir une faiblesse ; et, par un de ces mouvements instinctifs qu’on ne peut ni analyser ni décrire, elle passa la main sur ses cheveux, comme pour leur donner plus de luisant et de poli. Arthur Raimbaut resta aussi immobile, inébranlable ; son regard se fixa sans hésitation sur la physionomie du diplomate, comme pour y chercher la confirmation d’un pressentiment, et le mot d’une énigme à moitié devinée. Quant à Guillaume, il avait été quelque temps sous le coup d’un désappointement véritable, en entendant madame de Noï lui dire, de ce ton railleur qu’elle possédait si merveilleusement : « Eh bien ! monsieur, que me voulez-vous ? » Peu à peu, cependant, sa défiance première et sa jalousie avaient repris le dessus ; et malgré la leçon qu’il venait de recevoir, il soupçonnait toujours quelque piège, et se préparait à une revanche éclatante du sot rôle[251] qu’il venait de jouer. Lorsque M. de Noï parut, un sourire amer plissa ses lèvres, semblable au sourire d’un méphistophélès de village [252], couvant dans son cœur une mauvaise pensée. Le silence dura quelques instants. M. de Noï avait croisé les bras sur sa poitrine, et semblait se résigner à l’attitude d’un rôle passif. De temps en temps, seulement, il jetait sur sa femme un de ces regards ternes et fauves, qui semblent craindre de trahir trop de flammes et de jeter trop d’éclairs.
— Ma foi, dit Guillaume, voici la réunion au complet. Jamais, peut-être, cette petite chambre n’a vu autant de monde. Est-ce que vous comptez nous y donner bal, monsieur Raimbaut ? en ce cas, je serais curieux de savoir qui payera les violons [253].
Arthur tourna son regard sur le fermier, comme pour lui demander le silence. Celui-ci continua :
— Savez-vous qu’il ne nous faudrait plus qu’une femme pour faire un quadrille ? et qui sait ? peut-être n’aurions-nous pas trop de peine à la trouver ?
— Eh bien ! Guillaume, dit Arthur qui pressentait un piège sous chaque parole, et prévoyait distinctement l’orage qui s’avançait, ne retournez-vous pas à vos travaux aujourd’hui ? ne craignez-vous pas que l’absence du maître ne nuise à vos intérêts, et que vos ensemencements n’en souffrent ?
Arthur avait prononcé ces paroles avec l’accent peu convaincu d’un homme qui doute de lui-même, et reconnaît d’avance l’insuffisance des moyens qu’il emploie. Le sourire de Guillaume, et l’expression moqueuse de sa voix, l’effrayaient ; sa présence lui pesait comme un fardeau, dont on essaye en vain de se débarrasser.
— Là, là, monsieur Raimbaut, dit le fermier, nous savons que vous êtes passé maître en culture, et que vous entendez à merveille l’engraissement de la terre, et le défrichement des prairies artificielles ; mais pour aujourd’hui, permettez-moi de vous dire que vous prenez un peu trop chaudement mes intérêts ; soyez tranquille, mes laboureurs sont à leur besogne, et, malgré l’absence du maître, il ne s’en tracera pas un sillon de moins ; quant à moi, je me trouve bien ici, et j’y reste.
En disant ces mots, Guillaume s’établit carrément sur un fauteuil, qu’il approcha de la cheminée. À cette vue, un imperceptible mouvement d’impatience sillonna les traits maigris et pâles de l’ancien diplomate, et les pommettes de ses joues se colorèrent de cette rougeur fébrile qui leur était habituelle[254].
— En ce cas, j’attendrai donc, dit-il en s’asseyant à son tour, que M. Évon, car c’est ainsi, je crois, qu’on nomme monsieur, ait fini sa visite.
— Comme il vous plaira, dit Guillaume en s’enfonçant résolument dans son fauteuil ; la maxime : chacun pour soi, est la mienne, et je la trouve juste pour tous.
Pour un homme actif et intelligent comme Arthur, il serait difficile d’imaginer une position plus pénible et plus irritante que celle où il se trouvait. Il entendait gronder la tempête, sans pouvoir la braver ni la fuir ; acculé dans une impasse, il se voyait contraint d’attendre le danger, les bras croisés, dans l’attitude d’immobilité et de résignation d’un de ces religieux de l’Orient qui subissent fatalement leur destinée, et se contentent de courber discrètement la tête sous le coup qui les frappe, en répétant ces mots, seul formulaire de leur croyance : Allah est grand ! Mille aiguillons menaçants l’assiégeaient, et il ne pouvait pas même se détourner pour en éviter les atteintes. Son âme était oppressée ; de lourdes vapeurs, semblables à celles qui s’échappent de la terre dans les jours d’été, obscurcissaient sa vue ; au péril de sa vie, il eût voulu en finir avec toutes les incertitudes qui l’obsédaient : il ne demandait qu’un coup de poignard, et voilà qu’on le tuait à coups d’épingle.
— Avez-vous à me parler ? demanda Arthur à M. de Noï.
— Oui, dit celui-ci en regardant de côté le fermier redevenu impassible ; j’attendrai.
Guillaume ne répondit pas à cette provocation indirecte, qui s’adressait à lui ; seulement, il leva lentement la jambe droite, et la croisa sur sa jambe gauche en signe d’inébranlable résolution. Peut-être un peintre trouverait-il, dans la scène que nous esquissons, le sujet d’un tableau d’intérieur puissant par l’effet des contrastes et le reflet des émotions intimes ; peut-être étudierait-il avec bonheur ces trois types d’hommes si diversement accentués, et se développant dramatiquement dans leur sphère d’individualité ; peut-être surtout, se prendrait-il d’un enthousiasme véritable pour la blanche figure de madame de Noï qui, toujours debout, demeurait immobile, insoucieuse, et comme détachée de tout ce qui se passait autour d’elle, pareille à une de ces âmes épurées par la méditation ou le martyre, qui abandonnent la terre et s’égarent dans le chemin inconnu des deux [255]. Pour elle aussi, le drame qui se déroulait si lentement n’avait plus de secret ; d’un seul regard, elle en avait embrassé toute l’étendue, et elle en attendait l’issue, sans vouloir ni en détourner, ni en précipiter le cours. Ce cœur, naguère si juvénile, avait vieilli en peu d’instants dans la lutte qu’elle venait de soutenir, ses émotions s’étaient usées au contact de la douleur. Comme les vieillards désillusionnés de la vie, elle se fût volontiers assise sur la tombe qui devait bientôt renfermer sa dépouille.
— Je ne vous ai jamais vu si obstiné, Guillaume, et si peu raisonnable dans vos prétentions, reprit Arthur résolu d’épuiser toutes ses ressources. Monsieur veut me parler, vous comprenez très-bien que votre présence nous gêne, et il semble que vous preniez plaisir à vous boucher les oreilles pour ne pas entendre ; faut-il donc, qu’à mon tour, je vous prie de sortir et de nous laisser ?
Le sourire qui, depuis le commencement de cette scène, paraissait stéréotypé sur les lèvres du fermier, se dessina plus ouvertement. Au degré de surexcitation où son esprit se maintenait, il en était venu à désirer une provocation comme une bonne fortune ; l’inaction le fatiguait plus que la lutte.
— Mon cher monsieur Raimbaut, répondit-il, je suis désolé de vous gêner, et surtout de gêner monsieur ; mais, je vous l’ai déjà dit, je me trouve bien ici, et j’y resterai, à moins que vous ne me fassiez enlever par vos valets.
M. de Noï avait espéré, jusque-là, que l’obstination du fermier ne serait pas difficile à vaincre ; cette dernière réponse imprima à ses traits un nouveau mouvement d’impatience, plus prononcé que le premier.
— Il ne nous reste donc d’autre moyen pour nous distraire, dit-il en agaçant du pied les carreaux du plafond, que de parler culture à M. Évon. Voyons, M. Raimbaut, vous qui entendez si bien l’agriculture, déroulez-lui donc vos théories sur le colza et les oliviers.
— À la bonne heure ! dit Guillaume, voilà parler ; le mieux qu’un homme sage puisse faire, c’est de souffrir ce qu’il ne peut empêcher.
— Seulement, reprit M. de Noï qui, pour la première fois, s’adressait à sa femme, il me semble inutile que madame assiste plus longtemps à la comédie[256] que nous jouons, à moins, toutefois, que le dénoûment ne l’intéresse, ou que M. Raimbaut ne lui ait communiqué ses idées sur la plantation des oléagineux.
M. de Noï avait en vain essayé de dissimuler, par le laisser-aller du débit, et la légèreté insouciante des intonations, l’aigreur qui dominait ses paroles. La signification n’en échappa pas au fermier, qui les accueillit par un éclat de rire, à dessein retentissant.
Madame de Noï hésita quelques instants, et, s’inclinant avec une froideur égale devant les trois personnages dont l’attention se réunissait sur elle, elle sortit lentement, sans trouble, sans colère, et quelque temps encore après son départ, on entendit, dans l’escalier, le frôlement de sa robe de soie. Sa disparition, du reste, ne dégagea pas la situation du nuage qui la couvrait. Quoique absente, peut-être dominait-elle encore intérieurement toutes les pensées ; le fer était arraché, mais la plaie restait envenimée, vivace et saignante[257].
— Savez-vous que vous avez là une jolie femme ! dit le fermier après un instant de silence, en se frottant les mains et en narguant M. de Noï du regard ; seulement, m’est avis que vous lui laissez prendre des libertés un peu fortes.
— Guillaume, interrompit vivement Arthur que la colère commençait à gagner, il n’y a que vous, ici, qui prenez des libertés trop fortes. Faut-il donc que je vous ordonne de vous taire ?
— Parlez, monsieur, dit M. de Noï avec un sang-froid glacial ; puisque je reste ici, c’est qu’apparemment je suis disposé à tout entendre.
— À votre place, continua Guillaume sans rien perdre de son assurance, si j’avais une aussi jolie femme que la vôtre, je lui défendrais de venir rendre visite aux garçons, dans leur chambre. Une femme, voyez-vous, ressemble assez à une bourse, et quand on la laisse traîner, on peut être sûr qu’il se trouvera quelqu’un pour la prendre.
Le fermier avait sans doute beaucoup compté sur cette équivoque provocation, mais, contre son attente, la figure de M. de Noï demeura impassible ; le dépit du fermier s’en augmenta.
— Que disait donc la femme de monsieur, dans votre cabinet de toilette ? demanda-t-il en se tournant vers Arthur.
— Guillaume, vous êtes un imposteur et un méchant, dit celui-ci avec énergie, et vous mériteriez …
— Quoi ! dit Guillaume, parce que je dis la vérité. Allons, allons, monsieur Raimbaut, on sait bien qu’un homme n’est pas de pierre, et je gagerais bien que votre cabinet a déjà renfermé plus d’un trésor comme celui dont je parle.
Cette dernière phrase laissait entrevoir clairement la pensée secrète de Guillaume. Arthur Raimbaut en comprit la signification, et il dévora, en silence, l’inquiétude qui le tourmentait. Jusqu’à quand cet homme s’obstinerait-il à rester ? comment empêcher le scandale d’un dénoûment pénible ? Sans tout s’expliquer, Arthur pressentait tout ; et son esprit se consumait vainement à chercher une issue.
M. de Noï garda quelque temps encore le silence ; se levant à la fin, comme un homme las d’attendre et qui prend enfin une résolution extrême :
— Puisque M. Guillaume, dit-il, est bien décidé à rester ici, je ne vois d’autre moyen d’en finir que de lui laisser la place libre.
Le fermier pencha la tête en signe d’assentiment.
— Monsieur Raimbaut, continua M. de Noï, j’ai à vous parler ; sortons ensemble.
Cette proposition était précisément celle que redoutait Arthur. S’il refusait, que penserait M. de Noï ? s’il acceptait, que deviendrait Marguerite, en face d’un homme irrité et brutal ?
— Si singulier que puisse vous paraître mon refus, dit-il enfin, je ne puis consentir à votre proposition ; ce soir, demain, je serai tout à vos ordres.
— Et moi, je déclare que je veux vous parler à l’instant même, dit M. de Noï en appuyant sur chaque mot, car je suis las de la comédie [258] qui se joue ici.
— Bien, cela ! interrompit Guillaume.
— Ou chasser cet homme, continua M. de Noï en montrant Guillaume, ou partir avec moi ; voilà mon dernier mot.
Arthur baissa la tête. Il était sous le poids d’une anxiété douloureuse, et pourtant, partout où sa pensée se dirigeait, il entrevoyait un abîme.
— Si je trouvais un moyen de tout concilier, dit Guillaume.
— Quel moyen ? demanda M. de Noï.
— Sortons tous trois, dit celui-ci du ton triomphant d’un homme qui tranche victorieusement une question difficile ; je suis certain, d’avance, que ce parti-là accommodera M. Raimbaut.
Arthur regarda le fermier en face, comme s’il se fût défié de ses paroles, et eût entrevu un piège sous cette apparence de laisser-aller.
— Sortons, dit-il en suivant de l’œil le fermier qui s’était levé.
M. de Noï était passé le premier, Guillaume le suivit ; mais, au moment où Arthur allait fermer la porte, le fermier, par un mouvement rapide, se glissa derrière lui, et, rentrant dans la chambre, s’y enferma précipitamment.
— Venez donc, monsieur, dit M. de Noï à Arthur avec plus d’impatience qu’il n’en avait montré jusque-là ; encore une fois, il faut que je vous parle, et à l’instant même !
Arthur hésita encore un instant. Comprit-il que rien maintenant ne pouvait sauver Marguerite ? Je ne sais[259], mais il se décida à suivre M. de Noï.
Arrivé au bas de l’escalier :
— Jérôme, dit-il vivement au vieux portier qu’il rencontra sur ses pas, où est Henri ? cherchez-le, trouvez-le ; dites-lui qu’il monte à ma chambre. Allez, allez vite !
— Maintenant, à nous deux, dit M. de Noï en prenant le bras d’Arthur et en l’entraînant dans une des allées sinueuses du parc.
Nous sommes obligés ici de couper notre récit ; la scène vient de se diviser, et pour la suivre sous une de ses faces, il nous faut absolument renoncer à l’autre ; nous remonterons donc dans la chambre que vient de quitter Arthur, et dont Guillaume est resté possesseur. Bientôt tous les détails de la péripétie de cette histoire s’éclairciront successivement, et se précipiteront d’un commun effort vers un commun dénoûment [260].
Pendant tout le cours de la conversation que nous avons rapportée, Guillaume Évon avait nourri obstinément une amère pensée de défiance et de jalousie. Lorsque M. de Noï avait proposé à Arthur de sortir, les hésitations de celui-ci l’avaient confirmé dans ses soupçons. Marguerite, à n’en pouvoir douter, était cachée dans le cabinet où déjà il avait rencontré madame de Noï. Dès ce moment, son plan fut formé, et nous avons su comment il l’exécuta. Un sourire de contentement éclata dans ses traits lorsqu’il se sentit à l’abri derrière une porte fermée[261]. Il était seul, libre de se livrer aux recherches qu’il méditait, et à l’instinct de vengeance qui germait dans son cœur. Un moment encore, il demeura immobile, prêtant l’oreille au bruit des pas qui s’éloignaient ; puis, d’un bond convulsif et fiévreux, comme le bond d’un tigre, il s’élança vers le cabinet, en présentant avec rage sa main fermée. La porte du cabinet s’ouvrit d’elle-même, et Marguerite apparut sur le seuil, droite et pâle, mais sans effroi, sans trouble, et prête à tout.
— Ah ! … murmura Guillaume en reculant d’un pas à cette vue qu’il n’attendait pas si tôt ; ah ! c’est elle ! …
À peine cette brève exclamation avait-elle pu sortir distinctement de sa bouche, tant le sang affluait violemment à sa gorge et obstruait le passage de sa voix ; ses yeux tournoyèrent dans leur orbite, lançant au hasard ces rayonnements incertains qui accusent le paroxysme de la fièvre. Son émotion était telle que, pendant longtemps, il n’essaya pas même de chercher une formule à sa pensée. Ainsi qu’il nous arrive dans le cauchemar, il ne sentait rien qu’un poids énorme qui l’oppressait. À force de surexcitation, il en était arrivé à l’impuissance[262]. Une circonstance fortuite, un geste, un mot de Marguerite, eût produit l’apoplexie [263]. Celle-ci, du reste, était décidée à ne pas rompre le silence la première ; elle profita donc de ce moment de stupeur pour se glisser auprès de la fenêtre, et là, croisant les bras sur sa poitrine, elle attendit. Le jour extérieur, en tombant sur elle, dessina alors la physionomie de la fermière dans toute son expressive réalité. Ses yeux étaient à demi-fermés, comme ceux de la prière, et les cils noirs de ses paupières projetaient une ombre veloutée sur la surface de ses joues tendues, et pour ainsi dire lissées ; ses lèvres étaient vermeilles comme de coutume, seulement, vers leurs extrémités, une teinte légèrement violacée en affaiblissait le coloris. Nulle trace d’émotion n’altérait la blancheur mate de son col, si ce n’est peut-être une ou deux veines azurées, pointant çà et là, et promenant çà et là les détours brisés de leurs imperceptibles fils. En la voyant, un statuaire eût pu la prendre pour quelque personnification de la Résignation[264] muette et fière, ou pour une reproduction éclatante de l’antique Niobé [265].
— Parbleu ! madame, dit Guillaume essayant son ton d’ironie habituel, j’étais véritablement inquiet de vous, et si je n’avais connu M. Raimbaut pour un galant homme, et surtout pour un homme hospitalier, je vous aurais cru perdue, et je vous aurais fait réclamer par le tambour, avec une récompense honnête pour qui vous rapporterait. Mais M. Raimbaut a aussi peur que moi que vous vous perdiez, car il vous serre soigneusement, crainte des voleurs, sans doute, hein ?… Vous ne répondez pas ?… Oh ! vous êtes une femme précieuse, et vous méritez bien qu’on vous mette sous clef, car, une fois qu’on vous laisse aller, il est difficile de vous retrouver. Et qui diable vous aurait soupçonnée là où vous étiez, dans le cabinet de toilette d’un garçon ? Bravo ! joli refuge pour une femme qui a déserté la demeure de son mari ! belle conduite, en vérité, et qui explique à merveille les grands airs que vous preniez encore ce matin avec moi ! Qu’en dites-vous ? resterez-vous toujours ainsi, comme une statue ? ne répondrez-vous pas à la fin ? Voyons, répondez donc : vous avez bien quelque bonne raison à me donner ? que ne me la donnez-vous ? je suis tranquille et patient, parlez, il me tarde de vous entendre ; une femme embarrassée de trouver un prétexte, une excuse, un mensonge ! cela ne se peut pas ! encore une fois, voyons, je vous attends, je vous écoute [266].
La colère de Guillaume s’augmentait par les efforts même qu’il faisait pour la dissimuler ; le silence opiniâtre de Marguerite lui semblait une provocation, un audacieux défi à lui adressé par ce sentiment d’invincible orgueil qu’il reconnaissait en elle. Chacune des paroles qu’il avait prononcées retournait sur lui, et s’enfonçait dans sa poitrine. Sa violence grossissait faute de pâture, son irritation s’envenimait dans le vide. Tout d’un coup, il renonça au persiflage qu’il avait adopté, et regardant fixement sa femme, la rage dans les yeux :
— Vous ne voulez pas me répondre ? cria-t-il en élevant subitement la voix au timbre le plus éclatant de son diapason ; vous me bravez par votre silence, vous riez de ma fureur[267] ! Marguerite, pour la dernière fois, je vous ordonne, je vous somme de me répondre !
— Interrogez-moi, dit Marguerite avec calme, je vous répondrai.
En entendant ces mots, les traits de Guillaume exprimèrent l’âcre satisfaction de la fureur qui entrevoit à la fin une issue, et ne se sent plus contrainte de se consumer dans l’inaction.
— À la bonne heure, au moins, j’avais hâte d’entendre votre voix ; et, si je vous interroge, vous me répondrez franchement ?
— Franchement, dit Marguerite.
Guillaume se tut un instant. Sa colère le troublait-elle au point d’obscurcir sa pensée ? était-il encore en proie aux vertiges de la passion ? ou bien, semblable à un voyageur qui s’apprête à franchir un abîme, recueillait-il ses forces et ramassait-il tout son courage ? Peut-être, pour trouver la vérité, faudrait-il combiner ces deux éléments opposés. Dans la jalousie même, le plus aveugle et le plus forcené des sentiments, il y a des regrets et de la terreur[268]. Peu d’hommes ont assez de courage, tout en appelant la lumière qui doit dissiper leurs doutes, pour ne pas en redouter les écrasantes lueurs. Avant de risquer une question, Guillaume essaya encore une fois de raccorder sa figure, et de donner à ses paroles le calme qui manquait à son cœur. Malgré lui, le visage impassible et digne de Marguerite lui avait apporté une impression de grandeur ; et il voulait se grandir à son tour, pour être au niveau du rôle de juge impartial et sévère que sa position et son titre lui conféraient.
— Madame, dit-il, vous le voyez, je suis calme maintenant ; mais n’essayez pas de me tromper ; si vous faites un mensonge, je le lirai dans vos yeux.
— Je vous ai promis d’être franche, dit Marguerite.
Les résolutions de Guillaume n’étaient pas de longue durée ; quoi qu’il fît, la colère le débordait déjà, et son calme d’un moment s’était évanoui.
— Qu’êtes-vous donc venue faire ici, malheureuse ? reprit-il en éclatant.
— Chercher un abri, dit Marguerite.
— Un abri ! un abri chez M. Raimbaut ! et à quel titre ? Est-il votre père ? votre tuteur ? a-t-il le droit de vous défendre, de vous protéger contre moi ?
— Je lui avais donné ce droit-là, dit Marguerite.
Un son inarticulé mourut sur la bouche de Guillaume ; semblable à un homme frappé de stupeur, il demeura quelque temps immobile.
— Vous lui avez donné ce droit, reprit-il, et comment ? Est-il donc votre complice, votre amant ?
— Oui ! dit Marguerite.
À cet aveu, Guillaume recula une seconde fois, comme il avait déjà reculé à la vue de sa femme. Tant de simplicité mêlée à tant d’audace, tant d’énergie et de calme à la fois, c’était là un de ces phénomènes que son esprit grossier ne pouvait comprendre ; et, pour un instant, l’étonnement domina la fureur.
— Oui ! oui ! murmura-t-il d’abord ; elle a dit oui ! Et comme l’instinct de sa passion reprenait le dessus : Elle ne prend pas la peine de le nier ; elle est fière de ce qu’elle a fait, elle avoue sa honte, elle me la jette à la face … Oh ! c’est trop fort, aussi[269] !
En même temps, il s’avança vers Marguerite, hors de lui, la main tendue, prêt à frapper.
Celle-ci, par un mouvement plus prompt que la pensée, ouvrit la fenêtre, et appuyant le pied sur la barre de fer qui servait de main d’appui :
— Monsieur, dit-elle, vous m’avez frappée une fois, c’est assez ; si vous faites un pas, je me jette sur ce pavé ; au moins, si vous me frappez, vous me frapperez morte.
Guillaume hésita, puis, reprenant toute sa fureur.
— Qu’il soit fait comme vous le désirez, dit-il.
Mais, au moment où il allait exécuter sa menace, et Marguerite sa résolution, la porte de la chambre céda sous un effort violent, et un bras vigoureux étreignit subitement Guillaume, écumant de rage. C’était le bras de Henri.
— Vous êtes heureuse, madame, dit le fermier, en se débattant, d’avoir tant de protecteurs dévoués. Celui-là aussi, peut-être, est votre amant comme l’autre ![270]
XII.
Entre Arthur et M. de Noï, l’explication n’avait pas été longue [271] ; le ressentiment de l’ancien diplomate n’était pas fougueux et bavard comme celui de Guillaume. L’étiquette des cours et les usages du monde, en passant sur son caractère, en avaient aplani les aspérités et corrigé les saillies ; même dans les situations désespérées, il savait se contenir et conserver une apparence de sang-froid et de politesse étudiée. Pour les hommes de cette nature et de cette classe, le bon ton est un dernier rempart qu’ils n’oseraient franchir ; et, prêts à tomber, encore veulent-ils tomber noblement. Lorsque Arthur demanda à M. de Noï le motif de l’explication qu’il avait sollicitée, celui-ci se contenta de déplier un petit papier à demi passé dans sa main, et le présentant à Arthur.
— Lisez, dit-il froidement.
C’était le billet que, sous l’influence de Henri, Arthur avait adressé à madame de Noï, pour lui annoncer que leur projet de fuite ne s’exécuterait pas [272].
— Je suivrai vos ordres, dit Arthur en s’inclinant.
— Dans une heure, vous saurez mes intentions, répliqua M. de Noï.
Ce fut tout. Pas un reproche, pas un obstacle, pas un mot. Ils se séparèrent en se saluant ; ils s’étaient compris[273].
Le lendemain[274], vers les six heures du matin, Arthur descendit dans la salle du rez-de-chaussée, dont il avait fait son cabinet de travail. Comme la première fois que nous l’y avons vu, il portait une redingote brune, croisée sur sa poitrine, qui encadrait mélancoliquement sa pâle et noble figure ; les mèches de ses cheveux grisonnants étaient lissées avec soin, et s’avançaient en pointes vers le sommet du crâne, comme pour en dissimuler la nudité ; son œil avait perdu cet éclat sauvage qui, par intervalle, communiquait à ses traits une expression puissante de domination et d’orgueil[275]. La teinte de son front, sans être triste, avait quelque chose de plus austère encore, et de plus glacial qu’à l’ordinaire, on eût dit qu’un vent du nord avait balayé cette tête, édifice imposant hier, ruine aujourd’hui[276]. Le seul signe de son passé qui lui fût resté fidèle, c’était ce sourire à demeure qui s’était imprimé fatalement sur ses lèvres ; peut-être fallait-il y voir la grimace du gladiateur mourant, qui refuse de demander grâce, et veut, à son dernier moment, défier le sort qui l’accable [277]. Pendant quelque temps, il se promena lentement dans la salle, écoutant le bruit de ses pas sur les dalles retentissantes. Les premiers rayons du soleil commençaient à se jouer sur le verre des carreaux humides, et à lancer au plafond leurs facettes dorées ; le ciel était pur, et l’on entendait déjà les mille bruits confus de la nature qui s’éveille, et ce bourdonnement lointain qui ressemble aux premiers bégayements d’un enfant. Arthur s’arrêta devant une des croisées, et demeura immobile, contemplant ce spectacle sublime de la création à son lever, et sympathisant avec toutes ces harmonies de la terre en prière devant le Seigneur. Peut-être, malgré lui, le mystérieux concert qu’il écoutait réveilla-t-il en son âme des échos assoupis et de mélodieux souvenirs ; car il passa la main sur ses yeux, comme pour y renfoncer une larme naissante. Il était dit qu’après avoir bu la coupe du stoïcisme jusqu’à la lie, cet homme en viendrait à sentir, une à une, toutes les faiblesses, toutes les douleurs, toutes les jouissances de cette belle et sainte chimère que les uns nomment l’amour, les autres la poésie ; comme toutes les émotions qu’on refoule, cette émotion passagère laissa sur son front un nuage sombre[278]. Il quitta précipitamment la croisée pour se dérober au spectacle qui le captivait jusqu’aux larmes ; et, s’asseyant auprès de la table verte, le dos tourné au soleil, il prit une feuille de papier, et y traça quelques lignes. Au moment où il en relisait le contenu, Henri entra, et se tint devant lui immobile et silencieux. La figure du jeune homme semblait avoir subi la même altération que la figure de son compagnon et de son maître, les teintes roses de ses joues avaient disparu, et on les eût dit cachées sous une couche crayeuse ; le bleu de ses yeux était terne et privé de cette transparence juvénile qui accuse la vivacité du sang et la candeur des premières illusions ; une couleur mate et grisâtre remplaçait l’éclat blondissant de sa chevelure. Comme Arthur, Henri s’était fait vieillard. On les eût pris pour deux frères du même âge, atteints tous deux du même mal, et prêts à s’abîmer dans la tombe[279].
— Voyez donc, Henri, dit Arthur en prenant le jeune homme par la main, et en le conduisant vers la croisée qu’il venait de quitter, comme le ciel est bleu, comme le soleil est brillant, comme le printemps éclate dans toute sa grâce et dans toute sa beauté ! Encore quelques jours, et toute cette plaine reverdira, et tous ces arbres se couvriront de feuilles et de fleurs ; la terre jettera son manteau de frimas, et se revêtira de sa tunique nuptiale ; il n’y a que l’homme, Henri, qui ne rajeunisse pas ainsi, et ceux que le bonheur, ce soleil de notre vie, a une fois abandonnés, n’ont plus à espérer de lui.
Henri hocha la tête, et détournant la vue :
— Poëte !… dit-il avec un sourire amer.
C’est que ce mot réveillait tout un passé, toute une vie désormais éteinte ; c’était, pour ainsi dire, la conclusion d’un drame prêt à finir[280].
— Poëte ! dit Arthur avec une douceur et une mélancolie d’intonation qu’on ne lui eût pas soupçonnée. Ah ! vous vous souvenez, Henri, de nos conversations d’autrefois ; vous vous souvenez de notre arrivée ici et de nos confidences sur la route. Merci… merci ! je suis sûr que vous ne savez ni oublier, ni haïr.
— Ni oublier ! ni haïr ! murmura Henri, comme un écho qui répète les sons qu’on lui confie.
Il se fit un silence ; les deux interlocuteurs étaient évidemment embarrassés de la tournure que la conversation semblait prendre ; tous deux craignaient également d’éveiller des souvenirs trop poignants. Et, d’ailleurs, qu’auraient-ils pu se dire ? Leur pensée n’était-elle pas la même ? et si le cœur de l’un battait douloureusement, le cœur de l’autre ne battait-il pas à l’unisson ? On ne se comprend jamais mieux que lorsque l’on se tait[281].
— Asseyez-vous là, dit Arthur en montrant à Henri la table verte ; nous avons à traiter une affaire sérieuse, et, comme deux enfants, nous nous amusons à regarder le soleil et à saluer le printemps ; n’est-ce pas, Henri, que vous ne me reconnaissez pas ?
Henri s’assit sans répondre, et ouvrant un registre placé devant lui :
— Qu’avez-vous à m’ordonner ? demanda-t-il.
— Vos comptes sont-ils en ordre ? dit Arthur.
— Oui, dit l’autre.
— Et combien aurons-nous de bénéfices sur l’opération que nous venons de terminer ?
— Comme vous l’avez dit, cinq cent mille francs.
— Joli denier, dit Arthur qui avait repris le ton froid d’un spéculateur[282]. C’est une belle chose, après tout, Henri, que la fortune. Se dire : voilà des hommes à qui Dieu a donné une volonté, des désirs, des caprices comme à moi ; eh bien ! avec un peu de cet or que je tiens dans ma main, je rendrai leur volonté esclave de la mienne, j’enchaînerai leurs désirs à mes désirs, je soumettrai leurs caprices à mes caprices ; ceux que Dieu a créés mes égaux, pour un peu d’or, pour un peu de poussière, deviendront mes valets, mes ilotes, mes bêtes de somme ; ce que le ciel a fait, je le déferai, moi, avec un peu d’or. N’essayez pas de le nier, Henri, la fortune c’est tout. Avec de la fortune, on est roi, maître absolu ; on peut se donner en spectacle tous les vices et toutes les infamies humaines. Avec de l’or, Henri, l’amitié viendra te livrer sa main en disant : « Prends-moi, tant que tu seras riche, je te resterai ». La beauté, la beauté elle-même effeuillera sur tes pas ses plus belles couronnes, et le vulgaire sera encore trop heureux de ramasser, dans la haie, les fleurs que tu auras foulées. Si j’étais jeune comme toi, Henri, je voudrais être riche, et essayer un peu si la fortune n’est pas le bonheur. Et qu’est-ce donc que le bonheur, sinon l’accomplissement des désirs, la satisfaction de la volonté, l’indépendance dans le bien-être, la souveraineté dans la jouissance ? Si tu le vois ailleurs, Henri, tu n’es qu’un fou, et tu ne mérites pas d’être heureux[283].
Arthur s’arrêta. Sa voix, qu’il avait essayé de rendre ferme et sonore, était faible et brisée ; c’était la voix d’un prêtre qui préconise une religion sans y croire, et cache des convictions qu’il n’a pas sous les banalités emphatiques du langage. L’effort perçait malgré lui ; ce qu’il disait, il ne le croyait pas. Avant de rompre de nouveau le silence, il fut quelque temps à raviver son courage et à raffermir ses résolutions ébranlées.
— Henri, reprit-il, voudrais-tu être riche, toi ?
Henri était trop initié aux secrets de celui qu’il écoutait et à ses habitudes de pensée, pour se laisser prendre à l’affectation de laisser-aller qu’Arthur simulait en parlant : il se contenta, pour toute réponse, de baisser la tête, semblable à un homme qui laisse passer l’orage sans vouloir ni lui fournir aliment, ni lui opposer un obstacle.
— N’avez-vous rien autre chose à me dire ? demanda-t-il.
— Avant cette opération, j’avais déjà cinq cent mille francs à moi. Un million pour toi après ma mort, Henri.
Le jeune homme ne releva pas la tête, sa pensée entrevoyait trop loin, et il se sentait accablé sous le poids qui pressait sa poitrine.
— Je ne vous comprends pas, murmura-t-il d’un ton glacé.
Arthur déplia lentement le papier qui contenait les quelques lignes qu’il avait tracées avant l’arrivée du jeune homme, et les lui remit.
— Lis, dit-il ; mais quand tu auras lu, pas un mot, pas une question ; promets-le-moi ; c’est un dernier service que je réclame de toi.
Une indicible expression de compassion et de tristesse se peignait dans les traits du jeune homme pendant qu’il lisait.
— Arthur, dit-il, vous voulez donc mourir ?
— Ah ! pas un mot, dit celui-ci avec reproche, tu me l’as promis.
— Écoutez, Arthur, reprit Henri d’un ton grave ; vous avez soutenu mon enfance et prêté un appui à ma faiblesse ; vous avez été plus que mon frère, car un frère ne vaut pas toujours un ami ; vous souffrez, je ne vous abandonnerai pas. Je vous soutiendrai comme vous m’avez soutenu, je vous consolerai comme vous m’avez consolé ; mon cœur réchauffera le vôtre, et, pour adoucir vos larmes, j’y mêlerai les miennes. Voulez-vous de mon amitié pour l’avenir, comme, dans le passé, vous m’avez donné la vôtre ?[284]
Un rayon de soleil colora en ce moment la figure d’Arthur, et en dessina les contours ; ce fut comme une auréole de lumière se jouant sur le tronc desséché d’un vieil arbre ; la ruine[285] se révélait dans toute sa décrépitude, l’ombre avait vaincu la lumière ; Henri se tut. L’inébranlable volonté d’Arthur, empreinte dans ses traits, ne laissait plus de prise à ses soins. La dernière pierre de l’édifice, en tombant, allait, en se détachant, entraîner toutes les autres.
— Mon sort est accompli, dit Arthur ; promets-moi seulement, Henri, d’exécuter fidèlement ma dernière volonté ; si je meurs, c’est à toi que je confie le soin de ma dépouille. À quelques pas de la maison de mon père, dans la vallée d’Auch, il est un berceau formé par des chèvrefeuilles qui s’entrelacent ; l’herbe qui croît à cette place est toujours humide et touffue ; c’est là que tu placeras ma tombe : je veux finir où j’ai commencé ; me le promets-tu ?
— Je vous le promets, dit Henri.
Et tous deux se turent ; et sur un signe d’Arthur, Henri suivit ses pas. Ils marchèrent ainsi quelque temps dans le parc, à petit bruit et sans mot dire. Avancé à un embranchement de route caché par un bois de merisiers et de pins, Arthur s’arrêta. M. de Noï venait à eux accompagné d’un seul homme ; cet homme était Guillaume Évon. Les deux couples, en se rencontrant, n’échangèrent pas une seule parole. Arthur, seulement, prit sous sa redingote deux pistolets qu’il présenta à M. de Noï.
Celui-ci en prit un, et jetant une pièce de monnaie en l’air.
— Pile ou face ? dit-il.
— Pile, dit Arthur.
La pièce tomba pile ; c’était à lui à tirer le premier. Les deux adversaires se placèrent face à face, à dix pas l’un de l’autre, et Henri remarqua qu’en visant M. de Noï Arthur portait trop à gauche ; son coup passa à quatre pieds du but.
M. de Noï tira à son tour ; Arthur tomba.
— Du secours ! dit Henri, en se précipitant sur le corps de son ami. Arthur lui serra la main.
— Merci !… dit-il d’une voix éteinte ; ma volonté est faite ; sois heureux !… essaye…
Henri lui prit la main : elle était froide. Il comprit alors les paroles d’Arthur, et que ce duel était un suicide[286]. Deux domestiques du château emportèrent le corps d’Arthur sur une civière. Henri se retira seul. Au détour d’une allée, Marguerite s’approcha de lui.
— Eh bien ! dit-elle.
— Nous n’avons plus qu’à le pleurer, répondit Henri.
CONCLUSION.
Il a été bruit tout cet hiver[287], dans la haute société parisienne, d’un de ces événements inexpliqués qui alimentent les conjectures les plus contradictoires. Les jeunes gens oisifs, qui donnent le ton à la mode, ont parlé pendant huit jours, en déjeunant, d’une éclipse totale de soleil, d’un cataclysme aristocratique. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue du beau monde, nous dirons tout simplement que madame de Noï (passez-leur la comparaison du soleil) s’est retirée dans un couvent, à cent lieues de Paris. Quelques sceptiques offrent de parier qu’elle reparaîtra dans le monde avant deux hivers. Quant à M. de Noï, il s’est dévoué tout entier à la cause légitimiste[288]. On le dit en Espagne et on espère qu’il deviendra ministre de don Carlos[289].
La femme du fermier Guillaume habite, à quelques lieues de Lisieux, la maison de son père ; comme Arthur[290], elle est retournée à sa vallée d’Auch.
Pour Henri, on le cite comme un des hommes les plus élégants et les plus fous de la capitale ; il a des chevaux et des femmes qu’il promène, le matin au bois de Boulogne, le soir à l’Opéra ; il fait des envieux.
— Il essaye[291].
FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.
Aperçu de la réception de La Bande noire et de l’œuvre de Jules David
- Félix Bonnaire dans Revue de Paris, nouvelle série, année 1837, t. XLVI, Paris, Au bureau de la Revue de Paris, 1837, p. 204.
Il paraît en ce moment, sous les auspices des derniers beaux jours qui retiennent aux champs, un roman de M. Jules A. David, auteur de la Duchesse de Presles et de Lucien Spalma. Dans une action simple, mais bien soutenue, animée par des peintures fraîches, présentée avec des couleurs de style d’une sobriété à la fois choisie et intelligente, M. David a fondu une pensée, qui était un fait il y a vingt ans, et qui n’est plus que de la poésie aujourd’hui ; cette pensée de destruction, en prenant un corps, avait écrit sur sa bannière le titre du dernier roman de M. David : La Bande noire. On ne sait que trop les désastreux résultats de cette association de francs-maçons au rebours, d’hommes mystérieux, qui étaient venus pour détruire et qui se recrutaient dans tous les rangs sans se connaître, unis seulement d’intention pour abattre les vieux châteaux et en revendre les pierres et le plomb. En romancier sérieux et aimant avec respect son art, M. David a personnifié cet esprit de destruction, qui tenait par des liens évidens à ce scepticisme du xviiie siècle, passé à l’état de brutalité sous l’empire. Arthur Raimbaut est le héros de la Bande noire. Il n’a pas en main la pince du démolisseur ; il est plus redoutable ; il démolit avec ses raisonnemens, et il corrompt le propriétaire avant que le marteau de l’ouvrier n’ait abattu la propriété ; si ce n’est don Juan, c’est Robespierre. À ses côtés, il s’amuse à faire pirouetter, pour son amusement, un jeune Child-Harold à son premier chant, et deux femmes prises dans deux conditions différentes, afin de se procurer sa domination moitié infernale, moitié terrestre. Il a aussi sa Zerlina, charmante fermière de Saint-Ry, où se trouve le château déchiré par cet aigle de la Bande noire. Commencé avec une austérité poétique qui élargit l’attention et la dispose aux grands évènemens, ce livre consciencieux finit dans les luttes dramatiques d’un double adultère, puni par une balle qui vient prendre la place de la Providence. Ce dernier tableau est une grande image et une grande leçon.
- Eusèbe Girault de Saint-Fargeau, Revue des romans. Recueil d’analyses raisonnées des productions remarquables des plus célèbres romanciers français et étrangers. Contenant 1100 analyses raisonnées, faisant connaître avec assez d’étendue pour en donner une idée exacte, le sujet, les personnages, l’intrigue et le dénoûment de chaque roman, t. I, Paris, Firmin Didot Frères, 1839, p. 162-163.
DAVID (Jules A.)
LA BANDE NOIRE, 2 vol. in-8, 1838. — Si l’on doit s’en rapporter aux idées que l’auteur a assez longuement formulées dans sa préface, le romancier qui prétend à autre chose qu’à émouvoir les femmes de chambre sentimentales et les amateurs des théâtres du boulevard, doit s’occuper spécialement de l’analyse du cœur humain et de la société. Fidèle à ses principes, M. Jules David procède à cette analyse en promenant le lecteur sur les bords de la Seine, depuis Corbeil jusqu’à Melun ; après lui avoir montré le château de Saintres, il lui fait faire connaissance avec Arthur Raimbault, spéculateur de démolitions, qui, pour se venger des dédains aristocratiques auxquels il a été jadis en butte, entreprend de démolir les retraites orgueilleuses des nobles d’autrefois, lesquels mettaient volontiers le pied sur les petits pour se servir d’eux comme d’un marche-pied. Arthur, pour arriver à l’accomplissement de ses projets, se sert de deux femmes : l’une, qu’il a connue dans son enfance lorsqu’il gardait les troupeaux, et dont il eut l’audace de devenir amoureux, est la femme de M. de Noï, diplomate retiré, joueur à peu près ruiné, auquel Arthur vend une partie du château de Saintres, pour assurer les derniers débris de sa fortune. La richesse d’Arthur lui facilite les moyens de voir et de séduire Mme de Noï. L’autre femme, fermière élégante élevée au pensionnat, est mariée au fermier Évon, rustre qui ne la comprend pas, que Raimbault emploie à revendre les morceaux de terre aux habitants du pays. Arthur devient à la fois l’amant de Mme Évon et de Mme de Noï. Cette double intrigue, après avoir été traversée par mille jalousies, se découvre enfin et amène le dénoûment. Arthur, surpris dans un double tête à tête par M. de Noï et par le fermier Évon, est tué en duel d’un coup de pistolet. Dénoûment qui démontre d’une manière péremptoire que l’analyse du cœur humain et de la société est l’unique objet que doit poursuivre le romancier qui prétend à autre chose qu’à émouvoir les femmes de chambre sentimentales, et les amateurs du gros mélodrame du boulevard du Temple.
Nous connaissons encore de cet auteur : Lucien Palma [sic], 2 vol. in-8, 1835. — La Duchesse de Presle [sic], 2 vol. in-8, 1836.
- Cs-As., « À un élève de l’École des Beaux-Arts à Rome, quatrième lettre », dans L’Artiste, Journal de la littérature et des beaux-arts, première série, t. XIV, Paris, rue de Seine-Saint-Germain, 1837 ; Slatkine Reprints, 1972, p. 193-198, p. 197-198 pour le passage cité.
[…] Ce n’est pas sans intention, mon ami, que j’ai gardé La Bande noire pour la fin de ma lettre. Le livre est tout nouveau, d’abord, tout mouillé encore ; et ensuite il est de notre ami Jules-A. David. Je n’ai pas besoin d’avoir recours à l’amitié pour faire l’éloge de la Bande noire. Vous dire que La Bande noire est supérieur à Lucien Spalma et à la Duchesse de Presles, serait déjà vous montrer suffisamment que je ne peux qu’aimer ce livre, puisque j’aime la Duchesse de Presles et Lucien Spalma. Mais, sans plus ample informé, j’entre en matière. Vous savez, tout comme moi, que les deux premiers romans de Jules David se distinguaient, le premier, par une habileté réelle de composition, par une exaltation vraiment poétique, et non factice ; le second, par le charme et le style, par la simplicité des moyens, par la vérité des caractères. Eh bien ! La Bande noire, outre tous ces mérites qu’elle renferme avec plus de maturité encore peut-être, offre un intérêt plus réel, atteint un but plus haut. Le sujet de la Bande noire, vous le devinez. Il est ce que son titre indique. Il s’agit dans le livre de Jules-A. David de cette espèce de franc-maçonnerie démocratique, qui, sous la Restauration, allait nivelant les tours et les tourelles, renversant et détruisant de fond en comble tous les vieux châteaux. Je regrette que Jules-A. David n’ait pas mieux compris l’intention cachée des hommes connus sous le nom de la Bande noire. L’auteur me semble avoir accepté trop à la légère les accusations que l’on a fait peser sur eux. Vandalisme est un grand mot, sans doute ; mais, de même qu’il n’y a pas de crime en politique, de même, en politique, il n’y a pas de vandalisme. La Bande noire ne méritait donc pas l’épithète de vandale dont on l’a flétrie. Quoiqu’il en soit de l’interprétation de Jules-A. David, voici ce qu’il a fait. Il a personnifié la Bande noire dans un homme, Arthur Raimbaut. Cet homme, né dans le peuple, a juré guerre à mort aux nobles et aux châteaux, dès sa plus tendre enfance, parce qu’il s’était vu brutalement repoussé à cause de sa pauvreté par une jeune fille noble qu’il aimait. Devenu riche, grâce à des spéculations heureuses, il a entrepris d’abattre le plus de châteaux qu’il pourra. Conduit par les circonstances vers le pays où s’écoula sa jeunesse, il se propose de raser le manoir insolent où demeurait jadis celle qui lui fit un affront dont son cœur saigne encore.
Ici commence un drame long et haletant, terrible, dont quelques lignes ne pourraient jamais vous donner une idée. Arthur a pour maîtresse une jeune fermière appelée Marguerite Évon, au moment où il retrouve dans Mme de Noï, propriétaire actuelle du château qu’il renverse, la jeune fille noble, son premier amour. Mme de Noï, sévère autrefois pour le jeune pâtre, s’attendrit pour l’homme élégant et riche. Arthur, revenu à des sentiments plus calmes, oubliera donc volontiers ses projets de destruction ; il abjurera sa haine ; il vouera à l’amour de Mme de Noï les belles années qui lui restent encore à vivre. Mais il ne songe pas qu’à ces beaux projets d’avenir il y a un insurmontable obstacle. Marguerite Évon, la jeune fermière qu’il a pour maîtresse, est aimée d’un amour profond et mystérieux par un tout jeune homme, Henri, qui, ayant découvert la liaison d’Arthur et de Marguerite, avait bien consenti, en faveur de l’amitié qui l’unit à Arthur, à ne point troubler une affection mutuelle, mais à la condition qu’Arthur demeurerait éternellement fidèle à Marguerite, qu’il ne l’abandonnerait jamais pour une autre femme, qu’il ne la trahirait jamais. (Ouf ! quelle phrase !) Pris entre la promesse faite à son jeune ami, et son amour pour Mme de Noï, Arthur va se décider pour Mme de Noï contre Marguerite, lorsque Henri se présente et lui dit : Vous tiendrez ce que vous avez promis, ou je vous tuerai.
Vous en savez assez maintenant de La Bande noire. Je n’irai pas plus loin mon ami. Vous raconter la scène des trois rencontres, dans la chambre à coucher d’Arthur ; vous raconter le dénouement, si émouvant et si dramatique, je ne l’essaierai même pas. – La Bande noire, à mon avis, range décidément Jules-A. David parmi les plus habiles romanciers de notre temps. […]
- Alphonse Karr, « La Bande noire. Par A.-J. David. 2 vol. in-8. Chez Werdet, rue de Seine. » dans Le Figaro, mercredi 1er novembre 1837, 11e année, nº 18, p. 3.
Ne l’oublions pas, M. Victor Hugo avait rimé une ode en trois cents points d’exclamation, sur le sujet dont M. David vient de faire un roman.
M. David, dans La Duchesse de Presles, avait voulu peindre la sensibilité ardente et naïve de la femme, perdue dans la fange des conventions sociales et marchant par la voie de l’imagination au but de l’infamie, comme d’autres y marchent par la voie du vice et des sens. Le même auteur, dans Lucien Spalma, avait voulu montrer l’imagination tendre et poétique, aux prises avec les exigences cruelles et le froid scepticisme d’une société qui se meurt. Or, c’est une préface qui nous le dit, La Bande noire procède au moins en ligne collatérale de La Duchesse de Presles et de Lucien Spalma.
La Bande noire a été personnifiée dans le roman, en un personnage visible, en une idée faite homme, en M. Arthur Raimbaut. Arthur était autrefois un prêtre normand. Il s’élançait souvent, par la pensée, dans le monde brillant des rêves. Il se voyait alors tout ce qu’il n’était pas : riche, éclatant, aimé, aimé surtout. L’amour était le sommet de sa pyramide d’illusions. Il rêvait, comme un berger qu’il était, un amour, un amour d’abnégation. Un jour, une femme lui apparut. Elle avait les trois conditions requises pour plaire à un pâtre de Normandie. Elle était belle, noble, et riche. Avec cela, elle habitait un château, ce qui ne gâta rien à sa jeunesse. Aussi Arthur s’empressa de lui donner son cœur. Une occasion s’offrit de la voir et de lui parler ; mais une réponse méprisante décida de toute la vie de Raimbaut. Il accusa l’injustice du sort, il se mit à exécrer tous les nobles et tous les riches. De là sa destinée. Il jeta son sajou aux orties. Je ne sais pas où il avait pris le génie des affaires, mais il l’avait. Le voici la tête de ce monstre aux cent bras que l’on nommait la Bande noire. Il use son existence à un travail infatigable ; vous croyez qu’il veut s’enrichir ? non pas. Il se venge. Mais au milieu de ses joies excessives, quand il voit tomber les pierres des monuments, une seule rencontre nouvelle bouleverse toutes ses résolutions. Cette femme qui de pâtre l’avait fait démolisseur de châteaux, sitôt qu’il la revoit, il l’aime encore, comme au jour où il la rencontra dans la vallée d’Auch, avec une robe blanche flottant au vent, et un bleuet dans ses cheveux. Au prix de ce souvenir, il lui cède un vieux domaine qu’il avait acheté pour le détruire ; il est même sur le point de se remettre berger, ou du moins il en a les sentimens ; mais le mari surprend sa femme en un lieu qu’elle n’aurait pas dû aller visiter. Arthur, ennuyé de sa fatalité, se bat avec l’intention de faire un suicide de ce duel. Il meurt. Telle est l’histoire de ce héros, dont l’auteur dit que la poésie du malheur avait consacré cet homme : c’était un grand débris !
Tout le roman n’est pas dans l’histoire de M. Raimbaut. La scène s’ouvre entre Corbeil et Melun. Dès le début, Henri, à l’œil bleu, se plaint de l’ironie du sourire d’Arthur dont l’œil est noir. Plus tard, nous verrons paraître M. de Noï, à l’œil gris, et Guillaume Évon, à l’œil jaune. La couleur de la prunelle indique le caractère.
Donne-moi la moitié de tes talens, dit Arthur à Henri, espèce de poète mélancolique et d’amant discret comme le Ralph d’Indiana. Tout en disant cela, ils s’en vont ensemble pour acheter le château de Saintry, dans la Brie. Mais voilà qu’un taureau furieux accourt et menace leur vie. Heureusement une femme vient à passer, comme une vision. Le taureau se retire ; Arthur est sauvé. C’eût été malheureux qu’il ne le fût pas, car il était millionnaire. Il venait de payer le château de Saintry un million, argent comptant. Toutefois il n’est pas fier : il va s’asseoir à la veillée des paysans ; qu’y trouve-t-il ? sa vision. Elle se nomme Marguerite Évon. Elle est la femme du maire du pays. On joue au jeu du sabot. Henri, pour lequel les femmes surtout se montrent d’une remarquable indifférence, soupire. On joue ensuite à laratata, qu’est-ce qui baisera ça ? Arthur se fait donner des gages. Il dit à Mme Évon : un baiser en échange de la vie ! et M. Guillaume, qui est jaloux, paraît sur ces entrefaites.
Marguerite, mariée depuis dix-huit mois, n’a que vingt ans. La lecture de mauvais romans, de Lélia, je suppose, lui a tourné la tête. Elle se croit opprimée et malheureuse. Elle n’aime pas son mari, parce qu’elle se sent supérieure à lui. Cette étude est bien faite.
Marguerite s’éprend d’Arthur. Mais Henri aime Marguerite qu’il a vue autrefois des murs du collège, dans son pensionnat de Lisieux. Henri sait d’ailleurs que le cœur d’Arthur est dévasté par d’autres orages. Il se fait espion. Il écrit une lettre à Marguerite. Il lui défend d’aimer son ami. Il somme son ami de s’enfuir à Paris. Ici finit le premier volume.
À Paris, Arthur reçoit la visite d’un M. de Noï, qui veut lui racheter le château de Sainty [sic], mais il y met une condition, celle qu’Arthur saura décider sa femme à vivre en province. M. de Noï, en réclamant ce service, affecte d’être un joueur ; et toutefois Arthur ne le croit pas. Ce mystère de conduite, il ne le comprend qu’en ne pouvant plus douter de la coquetterie dont Mme de Noï rend son mari victime au milieu des plaisirs de la capitale. Ô surprise ! Mme de Noï, cette affreuse coquette, est la femme au cœur de marbre, aux paroles méprisantes, qu’Arthur n’a jamais pu oublier.
Mme de Noï, de son côté, quand elle apprend ce qu’Arthur a fait à cause d’elle, ne résiste plus à cette puissante passion. Elle suit son mari en Brie. Tout va bien d’abord, excepté pour Arthur, qui se trouve mal à l’aise entre les deux amours qu’il ressent et qu’il inspire. À la fin, la jalousie de Guillaume tranche le nœud. Les scènes du dénoûment sont dramatiques au plus haut degré.
Si les romans étaient possibles, après l’abus que M. Balzac a fait du cœur de la femme et du cœur de l’homme, la Bande noire, de M. David, aurait aujourd’hui un succès à désespérer M. Balzac lui-même.
- Extrait d’un article de Victor Fournel intitulé « Les Œuvres et les hommes. Courrier du théâtre, de la littérature et des arts », dans Le Correspondant, t. CLIX de la collection, nouvelle série. – t. CXXIII, Paris, Bureaux du Correspondant, 1890, p. 1213-1237, p. 1234-1235.
Le dernier survivant des membres fondateurs de la Société des gens de lettres, M. Jules Amyntas David, vient de mourir dans sa quatre-vingtième année. Son père, consul à Smyrne et mêlé de très près à la découverte de la Vénus de Milo, avait été député du Calvados sous la monarchie de Juillet ; il cultivait les lettres, et il a laissé une tragédie de Sélim III, des poèmes sur la Bataille d’Iéna et sur Athènes assiégée ; un autre encore intitulé L’Alexandréide ou la Grèce vengée, en vingt-quatre chants, qui porte sa date avec lui. L’ Alexandréide est une épopée de l’école de Parseval-Grandmaison. Le fils peut être cité comme un exemple significatif des oublis profonds auxquels on est exposé dans la carrière littéraire lorsqu’on n’a point atteint aux premiers rangs et qu’on a cessé de produire. Dans sa jeunesse, Jules David fut le collaborateur de Balzac à la Chronique de Paris ; il avait dirigé le feuilleton de plusieurs journaux, en particulier du Commerce, un des organes les plus importants de l’opinion libérale. De 1835 à 1848, M. J. David publia vingt romans, dont quelques-uns eurent du succès : Lucien Spalma, La Duchesse de Presle [sic], La Bande noire, Le Club des désœuvrés, Le Dernier Marquis, Le Yacht du diable, etc. On les retrouverait encore dans les catalogues des anciens cabinets de lecture ; il n’en est pas un dont on se souvienne et qui ait gardé une place, si petite qu’elle soit, dans les chroniques littéraires des plus minutieuses. Pourtant ils ne sont pas sans mérite : l’auteur savait écrire, et il n’était dénué ni d’esprit ni d’observation. Après la révolution de 1848, il renonce aux œuvres d’imagination, mais publia encore un grand nombre d’écrits et d’agréables notices. Nommé inspecteur principal des ports de la Seine et de la navigation fluviale, il s’était réfugié, pour y ouvrir un débouché nouveau aux restes de son activité littéraire, dans la Société des études historiques, dont il fut président, et la Société philotechnique, qui l’avait nommé son secrétaire perpétuel. Tant que l’âge le lui permit, il remplit avec zèle ces fonctions, où son double talent d’écrivain et de lecteur trouvait également son emploi. Des traditions et de la carrière paternelle, il avait gardé l’amour des études orientales, mais en lettré plutôt qu’en érudit. Ce n’était point du tout un savant orientaliste, digne de collaborer au Journal asiatique ; c’était un amateur instruit, qui butinait comme une abeille dans le parterre des Sadi et des Ferdousi. La dernière œuvre qu’il ait publiée, Orient, est un recueil d’aimables et gracieuses imitations en vers des maouals, des ghazals, des légendes et des poésies arabes ou persanes. M. Jules David avait cueilli toutes les fleurs des jardins de Clémence Isaure. C’était un homme d’un commerce attrayant, plein de souvenirs, et le vrai type de ce qu’on appelait, au temps de Delille, un amant de lettre.
Index des noms de personnes
Index des noms de lieux
Université Paris Diderot
Centre de ressources Jacques-Seebacher
5, rue Thomas Mann
75013 Paris
http://seebacher.lac.univ-paris-diderot.fr/
ISBN/EAN (ePub) : 9782744202018
DOI (ePub) : 10.25665/upd-bibnum-seebacher0002/2018