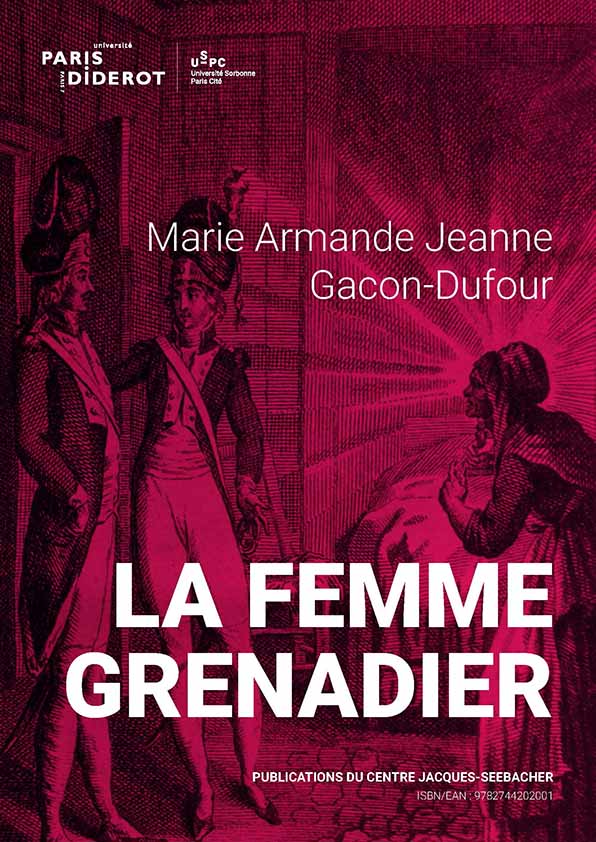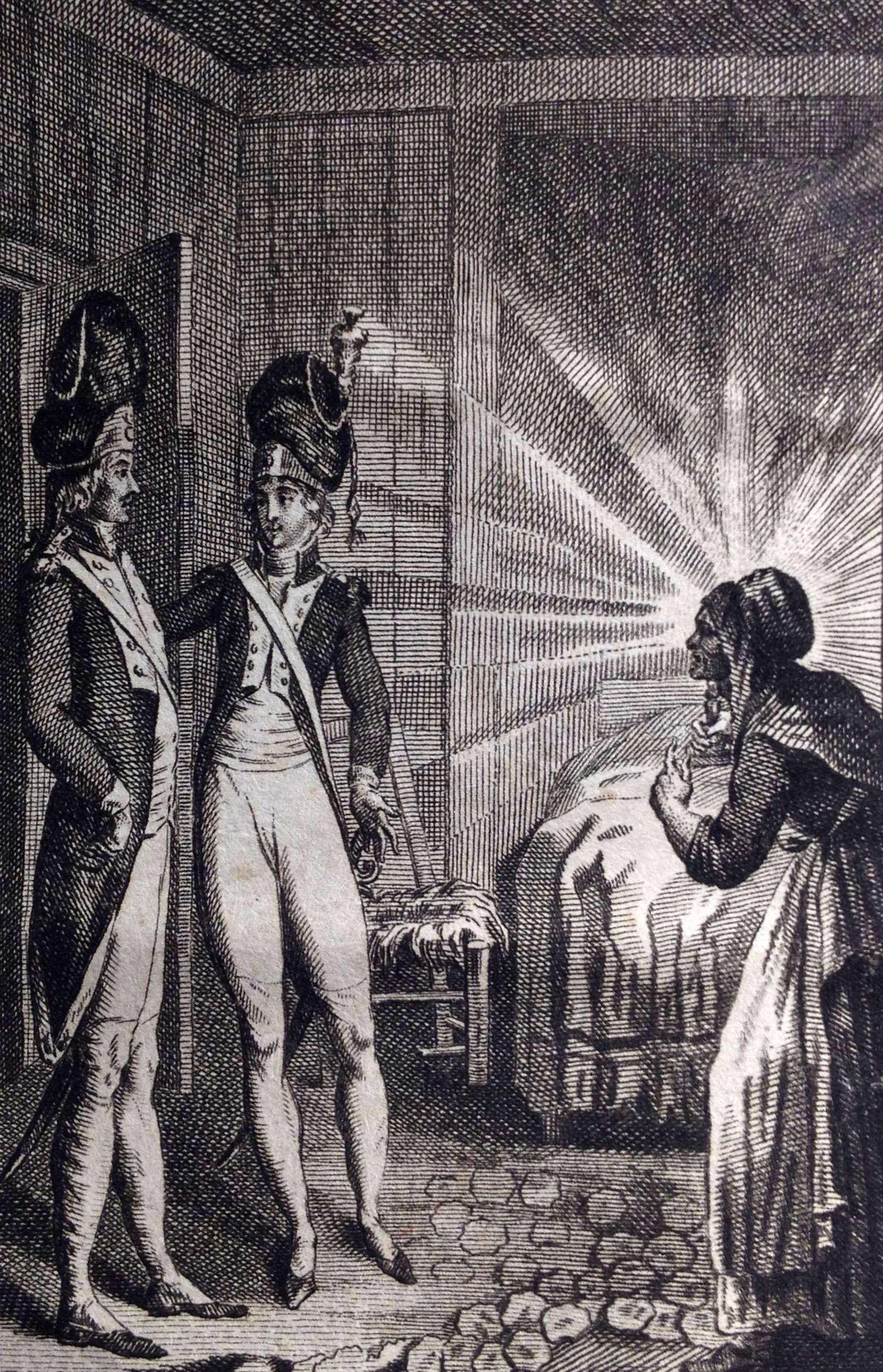Avertissement : ceci est une copie au format HTML du livre électronique téléchargeable au format ePub sur la bibliothèque numérique du centre Jacques-Seebacher.
À propos de cette édition
Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour, La Femme grenadier, édition établie sous la direction d’Olivier Ritz, Paris, Université Paris Diderot, « Publications du centre Seebacher », 2018.
Cette édition a été réalisée dans le cadre d’un cours proposé en troisième année de licence de lettres aux étudiants de l’université Paris Diderot de septembre à décembre 2017. Victoire Bech, Clémentine Brengel, Alexandra Henry, Chloé Thevret et Lothaire Berthier ont rédigé la préface. Ils ont également établi et annoté le texte, avec le concours de Joey Attia, Katia Makedonski et Papa Abdoulfatah Nardat. Olivier Ritz, maître de conférences à l’UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC), a dirigé ce travail.
Le texte a été établi sur Wikisource où il reste disponible. Les auteurs de la présente édition ont également contribué à l’article « Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour » de l’encyclopédie Wikipédia.
Le travail d’annotation du texte a été fait sur la plateforme PLANETE (PLAteforme Numérique d’Édition de TExtes), créée à l’initiative de Paule Petitier, professeur de littérature et responsable du centre de ressources Jacques-Seebacher de l’université Paris Diderot. L’outil grâce auquel cette plateforme a été mise en place a été fourni par Anne Vikhrova de l’université Grenoble Alpes. Il a été adapté en 2016 à des fins d’édition critique par Chloé Menut, étudiante au centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) à Tours, dans le cadre d’un stage financé par un appel d’offre « Projet pédagogique innovant ». Pour cette édition, Chloé Menut a assuré, pour le compte du centre Seebacher, la maintenance de la plateforme et Cécile Brémon, ingénieur d’études au centre Seebacher, a effectué le secrétariat éditorial.
Merci à Erica Mannucci et à Michel Delon de nous avoir fait profiter de leurs précieuses connaissances sur Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour.
Le texte édité est celui de l’édition originale (Paris, Ouvrier, 1801), d’après l’exemplaire numérisé par la Bibliothèque nationale de France, disponible sur Gallica. L’orthographe a été modernisée. Plusieurs fautes ont été corrigées. Sauf exception, la ponctuation d’origine a été maintenue. Dans les annotations, les précisions sur le sens des mots sont souvent reprises du TLFi mis en ligne par le CNRTL.
Préface
La Femme grenadier est un roman-mémoires qui donne la parole à une jeune noble. Contrainte par la Révolution de quitter le couvent où elle a été élevée, Hortense a pour seul appui sa gouvernante Mme Bontems, puisque sa mère est morte en lui donnant le jour, que son père le marquis de Chabry a quitté la France pour s’opposer à la Révolution et qu’elle est sans nouvelles de son frère. Dorimond, un ancien secrétaire de son père, prend les deux femmes sous sa protection et les conduit chez lui, à Paris, en leur demandant de cacher leur identité. La belle-mère de Dorimond, Mme Lavalé, est en effet une révolutionnaire acharnée, qui ne manque pas un débat dans sa section ou à la Convention et qui n’hésiterait pas à dénoncer la fille d’un émigré. Le péril augmente encore lorsque le frère d’Hortense vient lui aussi se réfugier dans la famille de Dorimond, déguisé en jeune femme. Cependant, Hortense et son frère peuvent compter sur l’amitié de Dorothée, la fille de Dorimond et du jeune Lavalé, le vertueux neveu de la terrible patriote…
Gacon-Dufour et La Femme grenadier
Marie Armande Jeanne Gacon-Dufour est née en 1753 et elle est morte en 1835 à Paris. Elle a publié ses premiers ouvrages à partir de 1787, deux ans avant le début de la Révolution française : deux romans et surtout un Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin en réponse à un texte du Chevalier de Feucher. Pendant la Révolution, elle vit à la campagne à proximité de Paris, d’abord à Nogent-sur-Marne, puis à Brie-Comte-Robert. C’est à cette période qu’elle commence à s’intéresser à l’économie rurale et domestique. Elle collabore à la rédaction de la Bibliothèque physico-économique pendant quelques années. Le tournant du siècle marque le début d’une activité littéraire beaucoup plus intense. Elle défend à nouveau la cause des femmes en 1801, dans une polémique vraisemblablement concertée avec son ami Sylvain Maréchal. Elle aide ce dernier à publier certains de ses derniers textes, elle est présente à son chevet lorsqu’il meurt en 1803 et elle écrit la notice biographique publiée en tête de son ouvrage posthume, De la vertu (1807). En 1805, elle publie un ouvrage intitulé De la nécessité de l’instruction pour les femmes. Son féminisme, l’abondance de ses écrits et un goût prononcé pour la philosophie lui attirent de nombreuses critiques d’écrivains ou de journalistes. Elle écrit une dizaine de romans, dont La Femme grenadier en 1801, et quelques ouvrages historiques. Mais elle rencontre surtout le succès avec ses ouvrages d’économie rurale et domestique. Ces livres essentiellement pratiques cherchent à transmettre un savoir susceptible d’améliorer le sort des paysans et des femmes dans leurs foyers.
Dans la préface du roman Les Dangers de la prévention (1806), Gacon-Dufour présente sa conception du genre romanesque. Elle explique que le roman doit s’attacher à avoir un fond de vérité. Elle cite en exemples Don Quichotte et Gil-Blas, en indiquant que les personnages caractérisant ces romans pourraient se trouver dans la réalité. Selon elle, les romans doivent être utiles à la société. Elle prend l’exemple de la comédie qui permet de « corriger les mœurs par le rire » comme l’ont fait Plaute, Térence et Molière. Elle indique par la suite que tous ses romans tendent vers ce but : ils comportent des enseignements utiles.
On ne connaît qu’une seule édition de La Femme grenadier, publiée au début de l’année 1801 (an IX) chez le libraire Ouvrier, rue Saint-André-des-Arts. Le Journal typographique et bibliographique annonce la publication de ce roman le 25 nivôse an IX (15 janvier 1801).
Il n’est fait aucune mention du nom de l’auteur, mais plusieurs indices permettent de le deviner. La page de titre, à défaut de cette information, indique en effet ses romans antérieurs : L’Homme errant fixé par la raison, ou Lettres de Célidor et du marquis de Tobers (1787), Les Dangers de la coquetterie (1788) et Georgeana, ou la Vertu persécutée et triomphante (1797). D’autre part, une « Revue historique de toutes les Jeannes [sic] célèbres » de « Sylvain M*** » (c’est-à-dire Sylvain Maréchal) adjointe à la fin de l’édition originale du roman donne un indice supplémentaire. La « Patronne de Céans » est nommée « Jeanne D*** » et le mot anonymé doit rimer avec « amour » : on reconnaît Jeanne Dufour.
Sylvain Maréchal joue un rôle plus important encore dans cette publication. La Femme grenadier semble en effet répondre à son roman La Femme abbé, publié quatre mois plus tôt et annoncé par le Journal typographique le 1er vendémiaire an IX (23 septembre 1800). On sait grâce aux travaux d’Erica J. Mannucci que les deux auteurs se connaissent et sont bons amis depuis les années précédant la Révolution.
Mais La Femme grenadier prend surtout place dans une série de textes plus connus : Sylvain Maréchal publie le 15 nivôse an IX (5 janvier 1801) le Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes. Son texte reçoit deux réponses, dont une de Mme Gacon-Dufour, intitulée Contre le projet de loi de S… M… portant défense d’apprendre à lire aux femmes par une femme qui ne se pique pas d’être une femme de lettres et publiée un mois plus tard, le 15 pluviôse an IX (4 février 1801).
La polémique qui oppose alors ce duo d’écrivains fait l’objet d’interprétations diverses. Plusieurs commentateurs disent que la réponse de Gacon-Dufour s’accorde avec le texte de Maréchal sur un point essentiel : la place de la femme serait à la maison. Erica J. Manucci considère au contraire que, au vu de l’amitié qui liait les deux auteurs, la proximité de ces deux publications doit être interprétée comme un plan concerté dont le but était de faire parler de la question de l’éducation des filles, alors même que cette question était complètement absente des réformes de l’instruction publique que Chaptal, le ministre de l’Intérieur de Napoléon Bonaparte, était en train de préparer. En publiant chacun un roman et un essai dont le thème principal est l’éducation et la place des femmes dans la société, les deux auteurs, plutôt que de rendre publique une réelle divergence d’opinions, veulent mettre sur la place publique la question de la place des femmes dans une société en pleine réorganisation.
Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). Au moment où La Femme grenadier est publiée, à peine plus d’un an plus tard, il ne remet pas encore en question la République, mais se présente au contraire comme son principal défenseur. L’héritage de la Révolution est revendiqué, dans la prolongation du consensus que le pouvoir a tenté d’imposer après la chute de Robespierre, en juillet 1794 : il faut dénoncer la période appelée « la Terreur » pour exclure du jeu politique ceux qui voudraient revenir à des politiques plus radicales, tout en refusant la parole aux royalistes. En vérité, Bonaparte tente de rallier à lui les royalistes et s’apprête à réconcilier la France avec l’Église catholique par le Concordat, qui sera signé en juillet 1801.
La Révolution dans le roman
L’action du roman se déroule entre 1793 et 1794. Plusieurs éléments permettent de la situer dans le temps historique. Au chapitre III est mentionné le comité de guerre, institution caractéristique de la période. À partir du chapitre XIX apparaît Philippeaux. Seul personnage historique du roman, il a été guillotiné avec les dantonistes le 16 germinal an II (5 avril 1794). Sa mort est évoquée par la narratrice au dernier chapitre. La seule date explicitement mentionnée est celle du « neuf thermidor », au chapitre XXII : il s’agit du 9 thermidor an II (27 juillet 1794), jour de l’arrestation de Robespierre et de la fin de ce qui a été appelé a posteriori « la Terreur ».
Les lieux évoqués dans le roman sont relativement précis. Le couvent d’où sort Hortense est situé à Hieres. Deux villes portent aujourd’hui ce nom, l’une dans l’Isère, l’autre dans le Var, à moins qu’il ne s’agisse d’une orthographe ancienne d’Yerres, dans l’Essonne, plus près de Paris. Gacon-Dufour utilise une initiale suivie de points de suspension pour nommer l’endroit où les personnages se réfugient, à deux heures de route de Paris : J… (probablement Juvisy). Ce procédé romanesque courant au xviiie siècle permet de faire comme si l’histoire racontée était vraie et qu’il fallait taire certains noms pour protéger l’anonymat des protagonistes.
Plusieurs villes ou régions sont également mentionnées, peignant ainsi un fond historique authentique. L’ouest de la France est parcouru par les personnages : Hortense et Lavalé croisent des chouans, paysans insurgés luttant contre la Révolution de 1791 à 1799. Le jeune Durand, ami de Saint-Julien, conduit son bataillon vers la Vendée pour participer à la guerre civile opposant républicains et royalistes. Rennes est plusieurs fois sur la route d’Hortense : ville partisane des Girondins, donc opposée à la Convention dominée par les Montagnards, elle est en état de siège, ce qui empêche Hortense d’y entrer de nuit au chapitre XXI. Une fois devenue grenadier, Hortense doit passer par Versailles pour y recevoir une feuille de route. En ce qui concerne Paris, plusieurs éléments réels cadrent le récit. La barrière du Trône, appartenant à l’enceinte fiscale construite en 1785 autour de la ville, et le district de l’église des Enfants-Trouvés, appartenant à l’un des seize quartiers qui découpent Paris pendant la Révolution, sont évoqués au chapitre VI.
L’effet de réel du roman passe surtout par la peinture du quotidien pendant la Révolution, entre le tambour de la marche militaire qui réveille Hortense ou les cris informant de l’évolution de l’armée qui créent des attroupements dans les lieux publics. Mme Lavalé est l’exemple de la patriote qui « serait tombée malade de chagrin, si elle avait manqué une occasion d’entendre politiquer ». Hortense et son frère, victimes de la Révolution, incarnent la classe visée par ce mouvement historique, la noblesse. Leur père a quitté la France, comme de nombreux nobles après la chute de la monarchie en 1792. Considérés alors comme lâches, traîtres, et condamnés à mort s’ils refusaient de rentrer en France comme l’ordonnait le décret de 1791, ces émigrés voyaient leurs biens confisqués et leurs parents inquiétés. D’où la désillusion d’Hortense qui, ayant rêvé d’une certaine vie en sortant du couvent, comprend grâce à Dorimond qu’elle ne possède plus rien venant de son père et qu’elle doit cacher son nom. Plus loin, Durand lui fait lire un décret stipulant qu’« aucun ex-noble, aucun étranger ne peut habiter Paris, ni les places fortes, ni les villes maritimes, pendant la guerre ». Le contrôle d’identité, utilisé pour faire barrage aux émigrés royalistes, prend une place importante dans le récit. Effectivement, entre carte de sûreté et passeport, la difficulté des déplacements dans la capitale et l’ensemble du territoire se ressent. Au chapitre VI, il est impossible de quitter Paris sans que Saint-Julien n’ait trouvé de carte de sûreté, il achète alors celle d’un homme qui lui ressemble. Dorimond, au chapitre X, quitte la capitale en urgence, le dernier jour d’évacuation des nobles, après de nombreuses démarches pour obtenir une « lettre de passe », grâce aux « bons offices du président ».
Plusieurs personnages, Durand, Saint-Julien, Lavalé et Hortense, intègrent l’armée républicaine, défendant alors les acquis de la Révolution contre les Vendéens et les puissances étrangères. Différentes raisons les poussent vers les armes. Saint-Julien est convoqué avec une vingtaine d’autres jeunes hommes du village à se battre pour la République, mais il pense racheter ainsi la lâcheté de son père, voire de la noblesse elle-même. Hortense, elle, désire rejoindre son frère et, plus encore, suivre l’homme qu’elle aime. Elle se présente déguisée en homme au commandant qui hésite à la faire grenadier plutôt que chasseur, du fait de sa petite taille. À travers ces différents parcours, Gacon-Dufour présente plusieurs facettes de l’armée et de son quotidien. Différents grades et ordres militaires tracent un arrière-plan hiérarchique, notamment quand Hortense passe de « jeune grenadier » à « caporal ». D’autres éléments concrets sur l’organisation de la guerre ponctuent le récit, comme la levée en masse ou le don patriotique que fait Saint-Julien au chapitre VII.
Ainsi Gacon-Dufour construit une œuvre dont le décor se veut authentique : les nombreux détails historiques dépeignent la Révolution française à différents niveaux, du couvent au camp de guerre, de la noblesse à l’armée, de Paris à Juvisy et à Rennes.
L’engagement républicain
À l’époque où Gacon-Dufour écrit le roman, la période révolutionnaire qui précède la chute de Robespierre servait de repoussoir et était présentée comme une période historique caractérisée par le fanatisme des révolutionnaires radicaux. Il s’agissait donc, selon l’opinion commune, de revenir à la modération et la conciliation. La Femme grenadier semble, à première vue, s’intégrer dans ce mouvement. En effet, l’auteur met en scène un certain nombre de personnages caractérisés par la radicalité de leurs positions politiques et idéologiques. On peut citer, à titre d’exemple, le personnage du père de l’héroïne dont le choix de l’émigration est vivement critiqué par l’auteur et qualifié d’antipatriotique dans la première partie du roman. Le personnage de Mme Lavalé, à l’inverse, représente l’archétype de la patriote radicale, prête à sacrifier, elle aussi, ses devoirs familiaux à ses idéaux révolutionnaires. En dénonçant ainsi les abus commis par les deux camps qui s’affrontaient pendant la Révolution, les républicains et les royalistes, Gacon-Dufour fait l’éloge d’une position intermédiaire, fondée sur le compromis. Elle critique également les abus qui ont eu cours dans les deux camps opposés à travers la vieille dévote qui loge Hortense et Lavalé au chapitre XV. La narratrice explique le comportement de cette femme à la fois par un attachement à l’Église qui la détourne des sentiments humains qu’elle devrait avoir et par les abus des soldats de l’armée de la République qu’elle a logés précédemment et qui, selon elle, en auraient profité pour la voler. Ainsi, Gacon-Dufour dénonce l’écueil du fanatisme, d’où qu’il provienne.
Pour autant, cet engagement en faveur de la modération, de la clémence et de la patrie n’exclut pas que Gacon-Dufour se positionne très clairement en faveur des idéaux prônés par les révolutionnaires français, que le Consulat commence à remettre peu à peu en question à l’époque de l’écriture du roman : la disparition de la société d’ordre, l’égalité des hommes entre eux et la nécessité d’une rupture avec l’Église. L’éloge de la modération ne consiste donc pas, comme chez beaucoup d’auteurs de la même époque, à condamner la période historique dans laquelle elle place ses personnages et à remettre en cause les idées prônées par les révolutionnaires. Au contraire, l’une des grandes originalités de ce roman est de décrire la période qui a été appelée rétrospectivement « la Terreur » sans jamais utiliser ce terme dans ce sens. Ainsi, malgré la critique des abus des révolutionnaires, l’ensemble du roman met en valeur l’engagement des différents personnages au service de la République. Le mot « terreur » n’apparaît que deux fois : au chapitre I puis au chapitre II. Il s’agit certes d’exprimer les sentiments de la narratrice quand elle redoute l’action des autorités révolutionnaires, mais dans cette partie du texte, elle est encore pleine des préjugés aristocratiques qu’elle abandonne par la suite.
La perte des préjugés aristocratiques est justement un des grands enjeux de ce roman. En ce sens, on peut parler de roman d’apprentissage. En effet, Gacon-Dufour met en scène une jeune noble à peine sortie du couvent, promise, dans la société de l’Ancien Régime, à un avenir radieux et découvrant que la Révolution a mis à mal ses rêves de gloire. Mais la rencontre de personnages non nobles chez qui elle découvre de grandes qualités morales lui permet peu à peu de renoncer aux préjugés de sa caste. Elle découvre que la séparation en ordres ne repose pas sur une différence de valeur entre les individus de différents états, mais sur une séparation artificielle et arbitraire dont le seul critère est l’hérédité. Toute la première partie du roman relate cette prise de conscience d’Hortense tandis que la seconde partie met en scène les conséquences pratiques de cette prise de conscience : l’engagement de l’héroïne en faveur de la Révolution, sans pour autant tomber dans la détestation de ceux qui tentent de conserver l’ordre ancien.
La conviction qu’Hortense acquiert de l’égalité des hommes entre eux est rendue manifeste par de nombreux changements d’identité dans le roman. Les personnages ne cessent de changer de nom, de filiation et de position sociale. Le frère de la narratrice est d’abord le vicomte de Chabry. Il se déguise et devient Angélique, nièce de Dorimond, puis se fait passer pour Blançai son neveu, avant de prétendre qu’il est le neveu de Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense qui deviendra elle-même Mme Daingreville. Pour finir, il se choisit lui-même un nouveau nom, Saint-Julien. Ces changements de nom correspondent à des changements d’état : l’aristocrate devient paysan puis soldat. Lavalé, membre de la Garde républicaine au début du roman, était, avant la Révolution, avocat au parlement de Paris. Il se déguise un moment en domestique et devient finalement grenadier dans l’armée républicaine. Cependant, la personnalité de ces héros ne change pas. Les changements d’identité apparaissent donc comme un moyen pour Mme Gacon-Dufour de montrer que ce qui fait la valeur d’un homme n’est pas la place qu’il occupe dans la société, mais son individualité propre. Ce faisant, elle affirme l’égalité naturelle de tous les hommes entre eux.
La défense de l’égalité explique en partie son insistance sur le choix de la conciliation dans la résolution des conflits entre les deux camps qui s’affrontent dans le roman. En effet, si les hommes sont égaux entre eux, alors la haine des roturiers à l’égard des nobles n’est pas plus légitime que le mépris des nobles pour les membres du tiers état, de même que la haine des différents camps de la guerre de Vendée qu’elle met en scène dans la seconde partie du roman. Hortense elle-même est née noble, ce qui ne l’empêche pas de pouvoir aimer un roturier et de pouvoir être aimée de lui en retour. La modération que prône Gacon-Dufour prend la forme d’un appel à la réconciliation, mais cette réconciliation prend une forme tout à fait différente de celle prônée par Napoléon à l’époque de l’écriture du roman. Il ne s’agit pas de rallier les royalistes pour obtenir un soutien politique fort, mais de fondre toutes les contradictions qui divisent l’opinion française, en mettant les individus face à un fait indéniable : l’égalité effective des hommes entre eux. Le roman cherche à convaincre des bienfaits du renversement de l’ordre ancien, plutôt que de l’imposer par la force. Cette méthode trouve d’ailleurs un écho dans le roman lorsque Hortense, par la clémence, convertit tout un village ainsi que son père à la cause de la République.
Les réflexions de la narratrice au sujet de la liberté de la presse vont dans le même sens (chapitre XXI). Si elle condamne les pamphlets politiques qui pullulent en cette période révolutionnaire, ce n’est pas pour faire taire une opposition incommode, mais parce qu’elle estime que ces textes, loin de rechercher le bien commun, manifestent l’orgueil de leurs auteurs. Leur violence, dit-elle, « allume dans la société les torches de la discorde, qui arme le frère contre le frère ». Ils sont donc nuisibles à la patrie dans la mesure où ils alimentent une haine qui sépare des individus qui devraient au contraire s’allier pour défendre leur pays. Une fois encore, Gacon-Dufour veut favoriser l’union plutôt que la division qui caractérisait la société d’ordres.
Il reste pourtant un point sur lequel Mme Gacon-Dufour fait preuve d’une grande radicalité : la critique de l’Église et des religions en général. Il est à ce titre intéressant de noter que le seul personnage que la narratrice condamne sans rémission est un curé de village qui profite de la crédulité du peuple pour s’enrichir. De même, elle prononce des phrases très virulentes à l’égard des prêtres qu’elle accuse de tromper les gens (notamment au chapitre XIII). Globalement, les membres du clergé sont, dans le roman, décrits comme des êtres faux et doubles. Alors que sur d’autres sujets Gacon-Dufour dissimule ses divergences d’opinions avec le pouvoir en subvertissant la terminologie dont usent les penseurs dominants de l’époque, elle s’oppose directement, sur la question de la religion, avec la décision de Napoléon de se réconcilier avec l’Église romaine. Le frontispice de l’édition de 1801, représentant la vieille dévote qui loge mal Hortense et Lavalé au chapitre XV, peut d’ailleurs être considéré comme une parodie d’image religieuse.
L’héritage des Lumières
La narratrice de La Femme grenadier fait plusieurs fois référence à d’autres œuvres littéraires. Au deuxième chapitre, les personnages vont à l’opéra assister à une représentation de La Rosière républicaine. Si la musique est de Gétry, le livret est de Sylvain Maréchal et cet opéra de 1793 est également connu sous les titres La Fête de la Vertu et La Fête de la Raison. Tout en renforçant l’ancrage historique du roman, ce choix permet à Gacon-Dufour de rendre hommage à son ami et de mettre en avant ce qu’elle défend comme lui : le culte de la Raison contre le fanatisme. En faisant de Mme Bontems un « second mentor » au chapitre IV, Gacon-Dufour pense sans doute davantage aux Aventures de Télémaque de Fénelon (1799) qu’à l’Odyssée d’Homère : elle souligne ainsi l’ambition pédagogique et morale de son propre texte, et revendique l’héritage du siècle des Lumières. L’œuvre de Voltaire est plusieurs fois évoquée : avec Candide et Zadig. Dans le chapitre VI, Gacon-Dufour cite presque mot pour mot la conclusion de Candide. Mais quand elle écrit « Nous cultiverons notre jardin », elle ajoute « comme la jardinière de Vincennes », préférant une référence inattendue à un roman écrit par une femme : La Jardinière de Vincennes de Gabrielle Suzanne de Villeneuve (1753). Enfin comme pour conclure le roman sur une note philosophique, Saint-Julien se compare à Zadig.
Le roman de Gacon-Dufour s’inscrit aussi dans une tradition rousseauiste. La plupart des personnages se distinguent par leur sensibilité. Pour les Lumières, la sensibilité n’est pas une qualité caractéristique de la gent féminine, c’est-à-dire une forme de faiblesse de sentiments et d’esprit ou de manque de pudeur. Bien au contraire, la sensibilité telle qu’elle est théorisée par Rousseau est une valeur élémentaire de ce qui est humain. On retrouve chez Gacon-Dufour cette volonté de faire évoluer l’idée de sensibilité et de la sortir de la sphère féminine. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles deux personnages masculins sont présentés comme des modèles de sensibilité. Le général est au sommet de la hiérarchie guerrière : on s’attend à trouver la description usuelle d’un personnage strict et distant, mais au lieu de cela, il est très humain, sincère et sensible. Telle qu’elle est présentée chez Rousseau et Gacon-Dufour, la sensibilité est avant tout une véritable faculté réflexive qui nourrit et dynamise la raison humaine.
L’idée de la sensibilité s’accompagne bien souvent d’une réflexion sur l’amitié qui est un thème central du roman. L’amitié, pour Rousseau, est à la fois un don et un risque. Le risque vient de l’arrachement à l’attachement initial. La douleur liée à la séparation est un thème très présent dans l’œuvre. En effet, la protagoniste est à plusieurs reprises séparée des personnes qu’elle aime et elle en souffre terriblement.
Les personnages du roman de Gacon-Dufour sont donc des êtres sensibles, c’est-à-dire des êtres pour lesquels les élans du cœur ont autant sinon plus de valeur que les jugements de la raison et pour lesquels l’amour et l’amitié sont des données fondamentales : c’est grâce à l’amour qui les lie que les personnages accèdent au bonheur. Il existe deux types d’amour dans le roman : l’amour naturel qui naît des liens du sang et l’amour choisi pour des personnes étrangères au cercle restreint de la famille. Loin de s’exclure l’un l’autre, ces deux types d’amour sont mis sur le même plan : l’amour d’Hortense pour son frère, amour a priori, a la même valeur que celui qu’elle éprouve à l’égard de Lavalé. Gacon-Dufour n’établit donc pas de liens hiérarchiques en faveur de l’un ou de l’autre. Elle brouille même volontairement les deux par différentes formes d’adoption dans le roman, qu’elles soient réelles ou symboliques. La première adoption symbolique apparaît au chapitre II lorsque Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense la prie de la considérer désormais comme une mère de substitution. Dans la suite du roman, elle se fera passer pour la tante d’Hortense et de Saint-Julien. À première vue, l’objectif est de protéger les deux jeunes gens et de camoufler leur identité. Cependant, ce nom de tante qu’ils vont donner à la gouvernante d’Hortense perd, peu à peu, son caractère stratégique et devient, dans l’esprit et le cœur des protagonistes, une vérité : ce qui les unit à Mme Bontems est véritablement ressenti comme un rapport de famille et les jeunes gens continuent à la nommer leur tante alors même que tous les personnages en présence connaissent leur identité réelle. Dans le cas de Célestine, il s’agit du cheminement inverse : Hortense commence par adopter la petite fille et à jouer le rôle de mère alors qu’elle pense qu’elle lui est totalement étrangère et ce n’est qu’à la fin du roman que l’on apprend qu’elle est en réalité sa sœur. De plus, lorsque Dorothée décide de l’adopter légalement, elle devient officiellement la mère de la sœur de l’homme qu’elle a épousé. On voit donc que Gacon-Dufour opère une confusion entre les liens familiaux et les liens d’amour, ce qui a une grande portée symbolique : il s’agit de montrer que c’est l’amour qui, pour elle, est à l’origine de la notion de famille et non un quelconque hasard de la nature. Or, comme on le disait, cela n’équivaut pas à renier les liens du sang. Au contraire, elle opère une sorte de synthèse entre l’amour imposé par la société et l’amour volontaire. Lorsque, à la fin du roman, tous les personnages sont réunis dans la maison de J..., il semble que nous assistions comme à une grande réunion de famille. Ainsi, le jeu sur les liens de famille que met en place Gacon-Dufour ajoute à son idéal politique d’égalité une dimension supplémentaire : l’union entre les hommes ne peut être réalisée que par le biais de l’amour qu’ils se portent les uns aux autres.
Enfin, une dernière conséquence de l’importance pour Gacon-Dufour de la sensibilité est la mise en place, par la romancière, d’une ébauche de philosophie morale dont la manifestation la plus évidente dans le roman est la manière dont est traitée la question de l’équilibre entre devoir public et devoir privé. L’analyse de la figure du père nous permet de nous faire une idée des rapports que les deux types de devoirs établissent entre eux. Dès le début du roman, le marquis de Chabry nous est présenté comme l’archétype de l’aristocrate imbu de sa propre supériorité de classe. La narratrice critique à de nombreuses reprises le choix politique de son père. Pourtant, lorsqu’elle le reconnaît au chapitre XVIII dans l’homme qui s’est insurgé contre son autorité et qu’elle a emprisonné dans le chapitre précédent, elle met tout en œuvre pour le faire libérer, ce qui la met en contradiction avec son devoir de grenadier de l’armée républicaine : en tant qu’ennemi récidiviste, il devrait être exécuté. Ce faisant, elle fait primer son devoir filial, qui repose sur l’amour qu’elle porte à son père, sur son devoir public. Gacon-Dufour présente cette décision comme un bien tout en la rendant compatible avec l’intérêt public : son humanité poussera précisément son père, qui ne l’a pas reconnue, à abandonner ses préjugés aristocratiques : face à l’humanité du grenadier, qui est pourtant le représentant du parti contraire, il s’avoue vaincu et reconnaît la valeur des hommes contre lesquels il combat. À travers la conversion de ce personnage, Gacon-Dufour affirme le fait suivant : c’est en suivant les mouvements du cœur, qui fondent le devoir privé, qu’on remplit son devoir public avec le plus d’efficacité. En d’autres termes, il s’agit pour la romancière de montrer que le fait de suivre sa propre sensibilité est le moyen le plus propre à favoriser l’avènement d’une société juste dans laquelle le bonheur de chaque individu peut être réalisé.
La cause des femmes
Dans ce roman comme dans le reste de son œuvre, Gacon-Dufour accorde une place très importante à la question du rôle des femmes dans la société de la fin du xviiie siècle. Elle y expose ses arguments en faveur de l’éducation des femmes et de leur accès à la sphère publique.
Selon Gacon-Dufour, le rôle de la femme dans la société est double. Le premier de ces rôles est lié à l’espace privé et à l’équilibre familial : la mère, figure d’éducation importante, apparaît dans le roman comme celle qui est chargée de guider l’enfant. Les mères biologiques étant absentes, c’est la dimension sociale du rôle maternel qui est mise en lumière. Célestine, enfant du marquis de Chabry née hors mariage, est élevée avec les plus grands soins par Hortense puis par Dorothée. Mme Bontems, la gouvernante d’Hortense, choisit d’assurer un rôle maternel auprès de sa maîtresse, puis de son frère. La femme joue donc un rôle d’éducatrice pour ses enfants, qu’elle guide jusqu’à ce qu’ils deviennent eux-mêmes autonomes et vertueux. Ce rôle éducatif de la femme prend une autre forme dans le roman : la narratrice se charge en effet de l’éducation de la destinataire du récit, qui porte le nom symbolique d’Élévélina. Déclaration de maître à élève, de femme à femme, voire d’une femme aux femmes, ce roman montre tout ce qu’une femme rusée, volontaire, courageuse et sensible peut accomplir dans un contexte politique difficile. Élévélina est associée à plusieurs reprises aux refuges de paix qui ont abrité la narratrice au cœur de ce monde mouvementé, d’abord le couvent où les deux jeunes filles ont grandi, puis le village converti par Hortense dans lequel elles sont réunies quatre mois, enfin la propriété de J… qu’Élévélina est invitée à visiter, lieu où sont abolis les préjugés de classes et de genres, ouvrant ainsi la fin du roman sur cette future réunion et la continuité d’un bonheur alors commun, dans un lieu idéal.
Mais le rôle de la femme dans la société tel que l’envisage Gacon-Dufour ne se limite pas à la sphère privée ou à la sphère féminine. Le thème du travestissement vise au contraire à revendiquer l’ouverture de l’espace public à la femme. Le titre même du roman, La Femme grenadier, associe au nom « femme » un substantif masculin dont il n’existe aucun équivalent féminin. On est d’emblée informé qu’un personnage féminin prendra des attributs ordinairement réservés aux hommes, ceux de la guerre.
Deux personnages se trouvent dans la nécessité de se travestir. Le vicomte de Chabry se fait passer pour une femme parce qu’il doit cacher son identité. Hortense prend des vêtements d’homme pour être acceptée comme soldat. Avec cette idée du travestissement, Gacon-Dufour transgresse la distinction traditionnelle entre l’homme et la femme, fondée sur une répartition des rôles dans la société et une répartition des aptitudes. En faisant d’Hortense un grenadier remplissant parfaitement son rôle de soldat, Gacon-Dufour met en valeur le caractère purement social et non naturel de cette répartition des rôles. À première vue, la romancière nie donc toute distinction réelle entre l’homme et la femme et cherche à le montrer en inventant ce personnage de femme soldat.
Cependant, il semble que cette affirmation doive être nuancée. On constate en effet une différence entre ces deux travestissements, c’est-à-dire entre le passage d’homme à femme à celui de femme à homme. Dans le cas du vicomte, le travestissement n’est pas concluant : au chapitre III, la narratrice nous indique que le vicomte est aussi beau en homme qu’il est laid en femme. En revanche, Hortense grenadier n’est remarquable que par sa petite taille. De même, tandis que Dorothée, instinctivement, sent que le vicomte est un homme, Hortense, elle, n’est pas découverte. Quand elle suscite le désir d’un autre soldat, c’est en tant qu’homme et non en tant que femme !
Mais tout en étant l’égale des hommes par sa valeur guerrière, le grenadier Hortense se distingue par des qualités qui, pour Gacon-Dufour, sont spécialement féminines. Le Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin publié en 1787 développe l’idée que la femme possède une nature qui lui est propre et dont les principales qualités sont la pudeur et la douceur. C’est justement cette douceur que met en œuvre le grenadier Hortense pour soumettre le village qu’elle a la charge d’attaquer, ce qui se révèle extrêmement efficace et lui vaut les félicitations de ses supérieurs. Dès lors, la défense du droit des femmes de participer à tous les événements de la vie publique, y compris la guerre, prend une autre signification : ce n’est pas parce qu’elle est, par nature, semblable à l’homme que la femme est utile à la société, mais parce que, justement, elle est différente. Ainsi, plutôt qu’un rapport de concurrence, c’est un rapport de complémentarité que l’homme et la femme entretiennent. Mais cette complémentarité ne consiste pas en un partage des rôles qui reléguerait la femme à l’espace privé tandis que l’homme aurait la charge de l’espace public : elle se joue au sein de tous ces espaces simultanément.
Reste que c’est la jalousie des hommes qui les pousse à refuser à la femme un rôle dans l’espace public. À la fin du chapitre XIX, le sage Philippeaux conseille à Hortense de se retirer du milieu masculin qu’est l’armée et de garder le silence sur ses réussites guerrières, concluant que dans l’état actuel des préjugés masculins, « on ne voudrait voir que l’amante pour oublier l’héroïne ».
Ces rôles que Gacon-Dufour accorde à la femme justifient qu’elle se penche plus particulièrement sur la question de l’éducation des femmes. Dès le début du roman, Gacon-Dufour s’oppose à l’éducation religieuse imposée aux femmes durant l’Ancien Régime et se place de ce point de vue du côté de la Révolution. Hortense sort du couvent pleine de préjugés aristocratiques et tout à fait ignorante des événements révolutionnaires qui agitent le pays. Il y a plus grave : elle s’ennuie fermement, n’ayant appris au couvent aucune occupation utile. Au chapitre X, elle reçoit quelques leçons de Lavalé et de Dorothée. L’un lui apprend les sciences, l’autre les travaux manuels. Le roman fait donc écho à la réponse qu’elle donne au Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes de Sylvain Maréchal, publiée peu après le roman, dans laquelle elle soutient que l’ignorance forge le malheur de la femme et considère la lecture comme nécessaire pour faire émerger les vertus morales qui feront de la femme une bonne citoyenne de la République. Gacon-Dufour exprime donc dans La Femme grenadier une opinion qui lui est chère : la femme doit être éduquée pour réaliser dans le monde les potentialités que recèle sa nature. Autrement, les hommes courent le risque de faire des femmes non seulement de mauvaises mères, et donc de mettre en danger la formation des futurs citoyens, mais également de se priver d’une aide précieuse dans les affaires publiques, quelles qu’elles soient : le développement de la science, des arts ou de la guerre.
Par l’éducation, la femme devient utile à la société. Cette dernière a donc tout intérêt à former des femmes intelligentes et sensibles, capables de mettre leurs connaissances et leurs expériences au profit du progrès social. Or, pour Gacon-Dufour, le progrès social consiste à rendre effectif le principe d’égalité entre les hommes qui, seul, permet d’assurer le bonheur du plus grand nombre. On peut donc considérer que son combat pour le droit des femmes n’a pas sa fin en lui-même : il n’est qu’un jalon pour accéder à la réalisation d’un idéal plus grand, celui de la Première République. Ce qui importe, c’est de permettre que les hommes vivent dignement et égaux entre eux, non seulement en droit, mais en fait.
Chronologie
1753 : naissance de Marie Armande Jeanne Gacon.
1787 : elle publie un Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin en réponse à un texte du Chevalier de Feucher qui accuse les femmes d’être cause de la dégradation des mœurs. La même année, elle publie son premier roman, L’Homme errant fixé par la raison. On suppose que c’est également de cette période que date son amitié avec Sylvain Maréchal.
1788 : second roman, Les Dangers de la coquetterie.
1789 : début de la Révolution française. Suite à un premier mariage, elle est connue sous le nom de Madame d’Humières et elle vit à Nogent-sur-Marne. Pendant la Révolution, elle collabore à la rédaction de la Bibliothèque physico-économique.
1794 : chute de Robespierre. Dans les mois qui suivent, Marie Armande Jeanne se remarie avec Jules-Michel Dufour de Saint-Pathus, avocat au Parlement de Paris. Elle devient donc Madame Gacon-Dufour. Elle vit alors à Brie-Comte-Robert.
1797 : elle écrit un nouveau roman, Georgeana, ou la Vertu persécutée et triomphante, après neuf ans d’interruption de son activité romanesque.
1799 : prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte. Début du Consulat.
23 septembre 1800 : Sylvain Maréchal publie La Femme abbé.
5 janvier 1801 : Sylvain Maréchal publie un texte intitulé Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes.
15 janvier 1801 : Gacon-Dufour publie La Femme grenadier. Elle publie trois autres romans en 1801 et 1802.
4 février 1801 : Gacon-Dufour publie Contre le projet de loi de S. M. portant défense d’apprendre à lire aux femmes.
1803 : décès de Sylvain Maréchal. Gacon-Dufour est à ses côtés. Elle écrit sa biographie, qui est publiée en 1807 en tête de son ouvrage posthume, De la vertu.
1804 : début du Premier Empire.
1804 : Gacon-Dufour publie un Recueil pratique d’économie rurale et domestique, premier d’une longue série de manuels pratiques, parmi lesquels le Manuel de la ménagère à la ville et à la campagne (1805), le Dictionnaire rural raisonné (1808) et le Manuel du parfumeur (1825).
1805 : De la nécessité de l’instruction pour les femmes, troisième et dernier essai sur les femmes.
1806 : Les Dangers de la prévention, roman.
1806-1808 : elle publie plusieurs textes sur la cour au temps des rois, dont une Correspondance inédite de Mme de Châteauroux (1806).
1815 : chute de Napoléon. Restauration.
1818 : Gacon-Dufour publie son dernier roman, L’Héroïne moldave.
1827 : elle publie son dernier ouvrage pratique, le Manuel théorique et pratique du savonnier.
1835 : décès à Paris.
Bibliographie
Édition originale
Gacon-Dufour, Marie Armande Jeanne, La Femme grenadier, Paris, Ouvrier, 1801. En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720842b.
Études
Delon, Michel, « Combats philosophiques, préjugés masculins et fiction romanesque sous le Consulat », Raison présente, nº 67, 1983, p. 67-76.
Fraisse, Geneviève, Muse de la Raison : Démocratie et exclusion des femmes en France, Paris, Gallimard, « Folio histoire », 1995.
Fraisse, Geneviève (éd.), Opinions de femmes : de la veille au lendemain de la Révolution française, Paris, Côté-femmes, 1989.
Gargam, Adeline, Les femmes savantes, lettrées et cultivées dans la littérature française des Lumières ou La conquête d’une légitimité : 1690-1804, Paris, Honoré Champion, 2013.
Krief, Huguette, « Gacon-Dufour, Marie-Armande-Jeanne d’Humières [Paris, 1753 – id. 1835] », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (dir.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.
Krief, Huguette, « Lectrices de Rousseau dans la querelle des dames (1786-1801) » dans Lectrices d’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003. En ligne : http://books.openedition.org/pur/35562.
Krief, Huguette, « Retraite féminine et femmes moralistes au siècle des Lumières », Dix-huitième siècle, nº 48, 2016, p. 89-101.
Mannucci, Erica Joy, Baionette nel focolare. La Rivoluzione francese e la ragione delle donne, Milano, FrancoAngeli, 2016.
Mannucci, Erica Joy, « Marie-Armande Gacon-Dufour: A Radical Intellectual at the Turn of the Nineteenth Century », dans Lisa Curtis-Wendlandt, Paul Gibbard, Karen Green (dir.), Political Ideas of Enlightenment Women: Virtue and Citizenship, Farnham, Surrey, UK, Ashgate, 2013, p. 79-90.
Martin, Jean-Clément, « Travestissements, impostures et la communauté historienne. À propos des femmes soldats de la Révolution et de l’Empire », Politix, n° 74, 2006/2 (n° 74), p. 31-48. En ligne : https://www.cairn.info/revue-politix-2006-2-page-31.htm.
LA FEMME GRENADIER,
------
------
An IX. 1801.
LA FEMME GRENADIER,
À Élévélina1 son amie.
CHAPITRE PREMIER.
C’est une espèce de confession que vous exigez de moi, mon amie2 ; mais le sentiment qui m’attache à vous depuis ma plus tendre enfance ne calcule point de sacrifice, même celui de l’amour propre qui, je crois, dans notre sexe, l’emporte sur l’amour véritable. Il est inutile que je vous raconte les premiers événements de ma vie, ils vous ont été connus et sont tous à peu près les mêmes, pour de jeunes personnes élevées dans les couvents3. Je ne commencerai mon récit que du jour de notre séparation. L’époque en est mémorable, puisqu’elle date de la suppression de l’asile4 où nous avions passé les plus doux et les plus paisibles moments de notre vie. Votre sort et le mien différaient beaucoup ; vous retourniez dans les bras d’une mère ; la mienne, en me donnant le jour, avait terminé sa carrière. Mon père, entraîné par l’exemple et maîtrisé par les préjugés de sa caste, avait sacrifié le sentiment de la nature à un fol orgueil ; il avait abandonné patrie, famille, tout ce qui attache l’homme sensible, et préféré un faux point d’honneur5. Ma gouvernante était le seul appui qui me restât. J’avais été destinée à prendre le voile dans l’abbaye où je vous ai connue ; mon frère, qui était au collège de Louis le Grand, ne devait me voir qu’après la prononciation de mes vœux, dans la crainte sans doute que je ne lui fisse des reproches du sacrifice qu’on exigeait de moi6. Le hasard qui conduit tout, nous fit rencontrer en entrant dans la diligence qui nous menait à Paris, un ancien secrétaire de mon père qui, m’entendant nommer, demanda à ma gouvernante si j’étais la fille du marquis de Chabry ; sur sa réponse affirmative, il nous proposa de descendre chez lui, parce que, nous dit-il, l’hôtel de mon père ayant été séquestré7, il ne me serait pas permis d’aller l’habiter, et qu’il croyait même que la prudence exigeait que je ne me montrasse pas ; que les dernières nouvelles qu’il avait reçues de Paris le forçaient, par l’attachement qu’il conservait pour notre famille, de retourner dans la capitale, pour conserver, s’il en était encore temps, la liberté au fils de celui qui lui avait assuré un sort heureux pour toute sa vie.
Ignorant tous les événements qui s’étaient succédé avec tant de rapidité, je m’étais imaginée qu’en sortant de l’abbaye d’Hieres8 , j’allais avoir dans le monde un sort digne d’envie. Fille de qualité, riche, je m’attendais que la cour et la ville (que je ne connaissais pas plus l’une que l’autre) me procureraient des jouissances sans nombre ; je m’étais même déjà fait un plan de vie qui flattait si fort mon imagination, que je ne pus retenir mes larmes quand ma gouvernante, à la suite d’un long entretien qu’elle venait d’avoir avec M. Dorimond, (c’est le secrétaire de mon père) me dit qu’il fallait que je l’appelasse ma tante, et que ma sûreté personnelle exigeait que je cachasse à tout le monde mon nom, l’émigration mon père m’en imposant la loi ; que si je commettais la moindre indiscrétion à ce sujet, la perte ma liberté en serait la punition9. La menace m’effraya, et je promis de me conduire par ses conseils. Nous arrivâmes deux heures après dans cette ville que, quelques instants auparavant, je jugeais être un séjour délicieux, et qui ne me paraissait plus, depuis ce que ma gouvernante venait de me dire, qu’une grande prison où j’allais être étrangère à tous les individus qui m’entoureraient ; tandis que si j’avais pu me présenter comme la fille du marquis de Chabry, tout le monde aurait envié un sourire de ma part.
Pour une jeune personne élevée dans les préjugés de la haute noblesse, cette chute était affreuse. La visite qu’on fit dans notre voiture, les passeports qu’on demanda, un homme qui n’en avait point et qu’on arrêta devant nous10, les demandes réitérées qu’on nous fit, m’inspirèrent une si grande terreur que je me jetai dans les bras de ma gouvernante, et ne m’en retirai que longtemps après que la voiture eut recommencé à marcher.
Nous descendîmes chez l’honnête Dorimond, dont la maison était gouvernée par sa belle-mère. Il avait une fille à peu près de mon âge ; le caractère de ces deux femmes contrastait si fort, que je n’ai jamais pu concevoir comment elles avaient consenti à rester ensemble, seulement un quart d’heure.
Dorimond nous présenta à madame Lavalé (sa belle-mère) comme ses alliées ; il dit à sa fille qu’il espérait qu’elle ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour rendre à sa jeune compagne le séjour de Paris aussi agréable que les circonstances le permettaient. À cette époque, les dénominations d’aristocrate et de patriote11 étaient fort de mode ; madame Lavalé était du nombre des patriotes ; et sa petite-fille, seulement par contrariété, car elle n’était susceptible d’aucune réflexion, affichait l’aristocratie. Madame Lavalé, dès le même soir, me proposa de me mener à la section12, où j’entendrais des discours qui me charmeraient ; l’honnêteté exigeait que je consentisse, et je lui promis de l’accompagner. Madame Lavalé nous quitta pour donner quelques ordres relatifs à ses nouveaux hôtes, et Dorothée (sa petite-fille), me prévint, sur-le-champ, du caractère de sa mère qui, me dit-elle, était citée pour une patriote par excellence : que, si je l’écoutais, je ne quitterais ni les assemblées de sections, ni les assemblées populaires ; que rien n’était plus maussade ; que là, j’entendrais sans cesse des vociférations (ce mot me parut nouveau) contre des gens qu’ils devaient regretter, puisqu’ils avaient contribué à leur fortune. Son raisonnement me parut assez sensé, et j’allais me rétracter de ma parole, quand ma gouvernante, qui s’aperçut de l’impression qu’elle me faisait, s’empressa de lui dire que je ne connaissais pas, même de nom, ceux contre lesquels on se déchaînait ; ainsi, que cela devait m’être fort indifférent : elle me lança en même temps un regard qui me disait : Hortense, si vous vous trahissez, vous êtes perdue.
Jamais position ne fut plus embarrassante. Je quittais un asile où j’avais toujours été regardée avec une sorte de respect ; madame l’abbesse, qui était parente de mon père, et qui connaissait ses intentions, n’avait cessé de me représenter que, si je faisais mes vœux de bonne heure, je pouvais espérer d’avoir son abbaye ; que le sort d’une abbesse était digne d’envie. Je me voyais déjà fêtée, honorée, comme madame ; je commandais à l’avance à toute l’abbaye13, et, en moins de vingt-quatre heures, je me trouvais déchue de mon nom, privée de ma fortune, et traitée d’égale par la fille d’un ancien secrétaire de mon père, qui, deux ans auparavant, n’aurait osé m’approcher qu’avec respect. Madame Lavalé rentra que j’étais encore accablée de ces réflexions ; elle nous fit beaucoup d’excuses de s’être absentée, me renouvela sa proposition d’aller à l’assemblée ; je l’y suivis avec ma gouvernante ; Dorothée refusa, même avec aigreur, de nous y accompagner.
Je n’avais, de ma vie, vu d’assemblée nombreuse, mais j’étais loin de me faire une idée de celle où l’on me conduisit ; aucune de mes idées n’était encore assise, lorsque Dorimond monta à la tribune, et rendit compte à l’assemblée que, malgré toutes ses recherches, il n’avait pu découvrir le fils du ci-devant14 marquis de Chabry, mais qu’il espérait être plus heureux, ne se regardant pas comme vaincu. Je me levai précipitamment, en m’écriant : le traître ! ma gouvernante me tira avec force, et, par un regard sévère, m’imposa silence ; madame Lavalé, occupée à causer avec une de ses voisines, ne s’aperçut pas de mon émotion ; ma gouvernante la pria de permettre que nous nous retirassions, la chaleur excessive qu’il faisait m’incommodant ; elle fit signe à son fils de venir nous joindre, ne pouvant prendre sur elle de quitter la place avant la fin de la séance ; elle nous en fit d’assez mauvaises excuses, et nous promit de nous joindre bientôt.
Le court espace que nous avions à parcourir avant de rentrer chez Dorimond, et un de ceux qui était secrétaire de l’assemblée, l’ayant abordé, ne me permit pas de lui témoigner toute l’indignation que m’inspirait sa conduite. Je ne connaissais point mon frère, je ne l’avais jamais vu ; mais le respect qu’on nous inspirait, dès l’enfance, pour le chef de notre famille, m’attachait à lui par préjugé, et la raison me disait : c’est le seul protecteur qui te reste. Arrivés chez Dorimond, Dorothée nous plaisanta sur les plaisirs de notre soirée ; un de ses parents (en uniforme national15), qui était présent, s’apercevant de la gêne dans laquelle j’étais, la lui fit remarquer, et me rendit un grand service en lui imposant silence.
J’attendais, avec impatience, le moment où, retirée dans ma chambre, avec ma gouvernante, je pourrais épancher mon cœur gonflé des scènes déchirantes qui s’étaient succédé dans la journée. Madame Lavalé ne rentrait pas ; Dorothée s’efforçait d’animer la conversation ; Dorimond était pensif, je craignais de rencontrer ses regards, ne voulant pas lui laisser apercevoir le mépris et la colère qu’il m’inspirait ; le garde national me regardait avec une curiosité scrupuleuse ; ma gouvernante gardait un morne silence.
Pour un observateur, notre société eût pu donner matière à beaucoup de conjectures ; j’étais prête à succomber aux efforts que je me faisais de paraître tranquille, quand Dorimond, rompant tout-à-coup le silence, ordonna à Dorothée de nous conduire dans notre appartement ; que sûrement nous avions besoin de repos, et que sa mère avait sans doute oublié qu’elle avait de la compagnie. Cet ordre fit lever le siège au garde national qui se retira, et, à mon grand contentement, je quittai Dorimond, dont la présence me devenait si importune, que je n’avais plus la force de me contraindre.
Seule avec ma gouvernante, je donnai un libre cours à mes larmes. Est-il possible, m’écriai-je, que le sort me poursuive au point d’être redevable d’un asile au bourreau de mon frère ? Était-ce pour m’en rendre spectatrice qu’il m’a offert ses services ? Quel raffinement de cruauté ! Ma gouvernante chercha inutilement à me calmer ; je passai la nuit dans les pleurs ; je voulais aller me dénoncer moi-même, et mettre au grand jour l’atrocité de la conduite de Dorimond ; je voulais sortir à l’instant de sa maison, dussé-je m’exposer au plus grand péril, ne soupçonnant pas de supplice comparable à celui d’être l’obligée d’un perfide qui ne m’avait accueillie, sans doute, que pour me sacrifier plus sûrement.
CHAPITRE II.
Le sommeil, ce bienfait de la nature, qui tempère tous les maux, vous les fait oublier un moment, et quelquefois vous prolonge vos jouissances16, vint enfin apporter un peu de calme à mon esprit agité. L’on était près de se réunir pour le déjeuner17, lorsque je m’éveillai ; ma fidèle gouvernante me prit dans ses bras : je ne chercherai point, me dit-elle, à vous donner des consolations, mais à vous inspirer du courage ; vous allez revoir Dorimond, prenez assez de force sur vous-même pour feindre de n’avoir point entendu hier son discours, et laissez-moi le temps de chercher d’anciennes connaissances qui pourront vous donner un asile qui vous convienne mieux ; ma chère Hortense, permettez-moi de vous servir de mère ; vous fûtes confiée à mes soins quand le sort vous priva de celle qui vous aurait guidée dans tout le cours de votre vie18 ; je remplirai avec soin la tâche que je me suis imposée, et j’espère, si vous voulez me seconder, vous faire couler des jours, sinon heureux, au moins paisibles.
La reconnaissance me fit répandre des larmes moins amères que celles de la veille ; je n’étais pas dans une position à commander aux circonstances, il fallut m’y soumettre ; je consentis à me réunir à la famille pour le déjeuner. Dorimond m’aborda avec beaucoup de civilités, me demanda pardon de me quitter, mais qu’il venait de recevoir une lettre de sa sœur, dont le mari avait été régisseur des terres de mon père, qui lui annonçait l’arrivée d’une fille unique qu’elle avait, et que des raisons importantes la forçaient d’envoyer dans la capitale ; qu’il allait à sa rencontre à la diligence19. C’est une nouvelle hôte que je vais vous amener, ma mère, dit-il à madame Lavalé : pendant mon absence, je vous prie d’avoir pour ma jeune parente, les égards que j’aurais pour quelqu’un qui aurait l’avantage de vous appartenir20. Je dois dire à la louange de madame Lavalé, qu’elle mettait tout en œuvre pour dissiper la mélancolie qui m’accablait, mais cette pauvre femme le faisait avec des manières si plaisantes, qu’elle aurait fait rire une personne moins profondément affectée. Elle me proposa de me mener à la convention nationale21 ; l’essai que j’avais fait, la veille, de son assemblée de section, m’avait ôté toute envie d’en revoir aucune autre ; je refusai positivement. Dorothée m’assura que ce n’était pas la même chose que celle de la veille ; qu’il y avait des gens d’un grand mérite, et qui me feraient beaucoup plus de plaisir ; que souvent elle y allait, elle qui ne voudrait pas pour tout au monde aller aux autres. Toutes ces raisons ne me firent point changer, je persistai dans mon refus, et madame Lavalé, qui serait tombée malade de chagrin, si elle avait manqué une occasion d’entendre politiquer22, quoiqu’elle n’y comprît rien, y fut avec Dorothée.
À peine avions-nous eu le temps de nous concerter, ma gouvernante et moi, que Dorimond rentra avec une grande fille d’une fort mauvaise tournure, un air gêné, un teint basané, gauche dans toutes ses manières. Quand Dorimond se fut assuré que sa mère et sa fille étaient sorties, il dit à cette grande fille : Angélique, voici mademoiselle de Chabry et sa gouvernante ; Angélique se jeta dans mes bras avec un transport que j’eus beaucoup de peine à réprimer : puis, me quittant, elle fut embrasser ma gouvernante, en l’appelant par son nom ; Angélique n’eût pas plutôt parlé que ma gouvernante la serra dans ses bras ; elle nous y mit toutes les deux, et, suffoquée de joie, elle me dit d’embrasser mon frère23 ; je reculai d’étonnement, et pouvais à peine la croire. Dorimond, que je regardais, en cherchant à lire dans ses yeux, mit fin à mon étonnement, en m’apprenant qu’il avait été forcé, pour sauver mon frère, de le dénoncer et de demander, comme une grâce, le privilège de l’arrêter. Je pressais Dorimond contre mon cœur, et cherchais, par mes caresses24, à effacer l’injure que je lui avais faite de le soupçonner. Après avoir recommencé nos embrassements, je considérai mon frère, qui était la vivante image de mon père, dont j’avais le portrait à mon col25. Il fut décidé, vu la parfaite ressemblance, que je me priverais de porter ce bijoux. Dorimond nous assura qu’il était essentiel, pour la sûreté de notre secret, que sa mère et sa fille l’ignorassent. Heureusement l’assemblée où madame Lavalé et sa fille étaient, se prolongea assez pour nous donner le temps de réparer la toilette d’Angélique, et lui faire prendre des manières moins gauches ; c’était surtout la révérence qui était risible ; nous la lui fîmes faire au moins vingt fois sans succès ; nous fûmes obligées de convenir que je me moquerais d’elle, avec Dorothée, sur son air provincial.
Mes craintes sur le sort de mon frère n’existaient plus ; mais je ne pouvais me dissimuler combien il courait de dangers dans une maison où la maîtresse accueillait tout ce qu’elle croyait être patriote, et sans examen.
Quand madame Lavalé rentra, Dorimond lui présenta la grande Angélique qui avait déjà avec nous un air de familiarité très-remarquable ; à toute minute elle se trompait ; au lieu d’appeler Dorimond mon oncle, elle lui disait, mon ami ; à moi, ma chère Hortense ; à ma gouvernante, ma chère madame Bontems ; mais ce qui me fit trembler, c’est lorsque nous passâmes dans la salle à manger, Angélique fut offrir la main à madame Lavalé ; son parent, le garde national, qui était en possession d’être l’écuyer26 de sa tante, fut presque culbuté par la robuste Angélique, à qui Dorimond dit : ma nièce, les manières de la capitale sont différentes de celles de la province. Angélique but et mangea comme quatre, elle paraissait rayonnante de joie ; moi-même je ne pouvais contenir la mienne ; madame Bontems était rajeunie ; nous étions tous contents, à l’exception de Dorothée qui nous examinait avec beaucoup d’attention. Nous étions heureusement à la fin de l’hiver, ce qui empêcha madame Lavalé de nous proposer la promenade, mais nous ne pûmes nous refuser de l’accompagner à l’Opéra, où l’on donnait La Rosière républicaine27 ; cette pauvre Angélique cherchait à se rapetisser le plus qu’elle pouvait ; malgré tous ses efforts, elle était, pour une femme, d’une taille gigantesque.
Dorimond n’avait osé refuser à sa mère la compagnie d’Angélique, dans la crainte de lui donner quelques soupçons : le malheureux était sur les épines ; en effet, dans un moment où tout était suspect, mener à l’Opéra un homme proscrit et dénoncé par lui, déguisé en femme, cela était fort dangereux ; d’un autre côté, mettre madame Lavalé dans la confidence, c’était vouloir divulguer notre secret ; il fallut risquer le tout pour le tout, et attendre du destin qui nous avait déjà réunis, la fin de cette aventure qui pouvait devenir très-tragique.
Heureusement, à la sortie de l’Opéra, nous ne trouvâmes pas cette foule de domestiques empressés de faire avancer les voitures ; le jeune Lavalé28 me donna le bras, ainsi qu’à sa tante ; Dorothée accompagna ma gouvernante, et la fausse Angélique eut pour écuyer le bon Dorimond ; nous regagnâmes, sans accident, la maison de madame Lavalé. De temps à autre je regardais derrière moi, pour m’assurer si mon frère et Dorimond nous suivaient ; je n’étais pas maîtresse d’un secret pressentiment, et la satisfaction que j’avais éprouvée à l’Opéra était mêlée d’une inquiétude qui paraissait sur ma physionomie. Madame Bontems, accoutumée à lire dans mon âme, s’aperçut bientôt de ce qui m’agitait ; elle fut la première à demander ce que pouvait être devenu monsieur Dorimond ; qu’il fallait qu’il eût pris un chemin différent, puisque déjà nous étions rendues, et qu’il ne paraissait pas. Madame Lavalé n’était pas inquiète, et cela me rassura pour un moment. Chaque mouvement de la porte me faisait tressaillir ; mais jugez de ma terreur quand je vis entrer deux gendarmes et un officier de police qui demanda monsieur Dorimond, et qu’on eût à lui rendre compte des personnes qui habitaient sa maison. Je devins tremblante comme une feuille ; heureusement madame Lavalé, qui ne savait rien, ne put que répéter les contes qu’on lui avait faits, et avec une assurance qui en imposa aux visiteurs ; elle nous présenta comme deux parentes de son gendre ; elle donna le nom de madame Bontems. Quand on me demanda le mien ; je fus prête à décliner le véritable, heureusement ma gouvernante ne m’en laissa pas le temps, et déclara que je me nommais Hortense Bontems. Et cette autre grande fille qui était avec Dorimond, reprit l’officier ? Je m’empressai de répondre qu’elle s’appelait Angélique Dorimond ; vous vous trompez, reprit madame Lavalé, c’est la fille de la sœur de mon gendre, elle ne peut porter le nom de son oncle, on la nomme Angélique Blançai ; elle est arrivée ce matin par la diligence de Bourges, et il est aisé de s’apercevoir, à son air gauche, qu’il y a fort peu de temps qu’elle habite la Capitale. Autant j’avais désiré le retour de Dorimond, autant je le redoutai pendant la présence de ces trois hommes, qui semblaient chercher à deviner ce que nous avions grand intérêt de cacher. Ils parurent se contenter de la réponse de madame Lavalé, et sa réputation de patriotisme nous sauva d’un grand embarras.
Dorimond fut encore plus d’une heure à reparaître ; mon inquiétude devint si grande, que le jeune Lavalé me proposa d’aller s’informer où il pouvait être ; je le remerciai, et lui répondis que la visite de ces messieurs causait seule mon inquiétude ; que nous étions dans un temps où toutes les craintes étaient permises ; que je ne me pardonnerais jamais d’avoir été la cause immédiate du moindre désagrément qui pourrait arriver à monsieur Dorimond ; que notre intention n’étant pas d’habiter Paris, je le prierais, dès demain, de me chercher un asile à la campagne, où nous étions résolues de nous fixer.
Le jeune Lavalé parut atterré de ma résolution ; il mit tout en œuvre pour me rassurer, et partit sur-le-champ se mettre à la recherche de son parent.
Madame Lavalé me plaisanta et de mon inquiétude, et de l’intérêt que j’inspirais à son neveu. Elle prit de là occasion de me faire son éloge, et finit par me dire qu’elle concevait l’espoir de m’appartenir29. J’écoutais impatiemment tous ces discours, j’allais même lui en témoigner mon mécontentement, lorsque monsieur de Lavalé rentra avec précipitation, nous annonça l’arrivée de Dorimond et de sa nièce. Je le remerciai affectueusement ; le pauvre jeune homme me baisa la main avec une expression si forte, qu’il me fit apercevoir que madame Lavalé n’avait que trop bien jugé. Dorimond mit fin à notre situation par sa présence ; sa mère lui fit de vifs reproches, et lui rendit compte de la visite que nous venions de recevoir. Tout cela s’arrangera demain, dit Dorimond ; en attendant, allons nous reposer.
Hortense, me dit-il, je suis fâché que ma maison ne soit pas plus grande, et d’être dans l’impossibilité de vous offrir un appartement seul : l’arrivée inattendue de ma nièce en est cause ; il faut que vous occupiez, avec madame Bontems, la même chambre, ayant destiné celle que vous habitez depuis votre séjour ici, à Angélique.
Je souscris, sans répugnance, à son arrangement ; mais il n’en fut pas de même de madame Lavalé, qui voulait absolument que madame Bontems et sa nièce ne fussent point gênées, disant qu’Angélique et Dorothée pouvaient loger dans la même chambre, que le lit de Dorothée était même assez grand pour les deux cousines, et que cela nous gênerait beaucoup moins. Mon frère pouvait à peine se contraindre : un fol rire s’était emparé de lui : l’idée de le faire coucher avec Dorothée lui paraissait si plaisante, qu’il m’a avoué depuis, qu’il avait été tout près de l’accepter.
Dorimond qui en savait plus long que sa mère, décida impérativement que nous logerions comme il l’avait arrangé. Nous prîmes tous congé les uns des autres, et à mon grand contentement, je me trouvai enfermée avec ma gouvernante et mon frère.
CHAPITRE III.
Après de longues souffrances, un quart d’heure de bonheur est saisi avec empressement : telle était ma position ; depuis deux jours, j’avais passé successivement des craintes les plus vives aux sensations les plus douces.
Angélique ne se vit pas plutôt seule avec nous, qu’elle se débarrassa de ses habits de femme ; elle défit une perruque si artistement arrangée, que l’on eût juré que c’était ses cheveux : à la vérité la perruque était blonde et sa figure très brune, ce qui faisait un contraste frappant. Angélique avec des traits réguliers était fort laide, et le vicomte de Chabry30 était un fort joli garçon. Je le priai de nous dire quelle raison l’avait retenu si longtemps loin de nous : il me répondit que dans toute autre circonstance il en aurait éprouvé beaucoup de satisfaction, mais que dans celle où il se trouvait, il avait été trois heures dans une anxiété difficile à décrire. En sortant de l’opéra, nous31 fûmes accostés par un des membres de notre section, qui plaisanta Dorimond sur sa compagne ; as-tu envie, continua ce mauvais plaisant, de donner des frères naturels à Dorothée32 ? Dorimond s’empressa de lui dire que j’étais sa nièce ; il allait nous quitter, quand, par malheur, un maudit colporteur33 se mit à crier une victoire remportée par l’armée de Sambre-et-Meuse34. Notre importun acheta le journal, et nous força d’entrer dans un café pour en entendre la lecture. La foule était grande, beaucoup de nouvellistes35 s’étaient réunis ; chacun parlait diversement et de la victoire et de la position de l’armée. Une femme au milieu de ces groupes attirait l’attention ; j’étais lorgné, poussé, interrogé : je ne pouvais bientôt plus résister. Assis, j’aurais été moins remarqué ; mais debout, à côté de Dorimond qui paraissait sortir de ma poche, j’attirais tous les regards ; heureusement, je fixai aussi ceux de la cafetière qui m’offrit une place à côté d’elle ; je ne fus guère plus tranquille, les quinquets36 qui l’entouraient jetaient un trop grand jour sur moi, et tous ceux qui entraient me fixaient et faisaient foule près du comptoir.
Enfin, le lecteur affidé37 de ce café parut : il était muni d’un bulletin du comité de la guerre38, qui annonçait officiellement le détail de la bataille ; tous les curieux se rangèrent autour de lui. Il était appuyé sur le comptoir et pérorait avec un air qui en imposait à tous les spectateurs. Je levai par hasard les yeux sur lui, et à mon grand étonnement, je vis dans l’orateur mon ancien professeur au collège ; c’était bien là le cas de lui dire : M. l’abbé39, qui vous eût reconnu dans cet équipage ; il était en petit uniforme national, un gros catogan40, un chapeau sur le coin de l’oreille : il ressemblait autant à lui-même, que moi à une femme.
Après qu’il eut fini sa lecture, il en tira la quintessence d’un ton ampoulé41, comme dans le temps où il était professeur ; j’aurais eu les yeux bandés, que je l’eusse reconnu. Il y avait au moins une heure que j’étais sur les épines, quand le maître42 du café prévint l’assemblée qu’il était temps de se retirer : Dorimond ne fut pas un des derniers à prendre son parti. À peine dans la rue, nous entendîmes un rappel ; nous prîmes des rues détournées pour éviter les corps-de-garde, et après une grande heure de marche, nous arrivâmes enfin, non sans avoir été accostés vingt fois par des curieux ou des importuns. Voilà, ma chère Hortense, les motifs qui ont décidé notre arrivée et qui vous ont causé une aussi vive inquiétude.
Madame Bontems représenta à mon frère qu’il était impossible qu’il restât encore longtemps avec son déguisement, que madame Lavalé qui était dans la bonne foi, l’exposerait sans cesse à des inconvénients ; qu’elle croyait qu’il serait plus prudent de sortir de cette maison, et, sous un nom supposé, aller habiter un village à quelques distances de Paris. Vos conseils sont excellents, ma chère amie, lui dis-je, mais comment faire ? Je ne crois pas que votre fortune soit assez considérable pour nous trois, en supposant que nous consentions à vous être importuns ; et celle de notre père n’est plus en notre disposition. Je possède environ trois mille francs en assignats43, dit mon frère ; et moi, répondit ma gouvernante, j’ai entre mes mains plus de trois cent mille francs en valeur réelle : ne croyez pas que cette somme m’appartienne, elle est à vous, Hortense ; votre père en quittant la France, prévit l’instant où vous seriez forcée de sortir de votre couvent ; il m’a remis les diamants de votre mère, en me faisant promettre de ne point vous quitter ; quant à mon fils, ajouta-t-il, il viendra me rejoindre, il a son nom et son rang à soutenir ; mais pour ma fille, les mêmes inconvénients n’existent pas, et si, comme je l’espère, nous rentrons dans tous nos droits, il me sera facile d’obtenir une place pour elle dans un chapitre44 quand ils seront rétablis. Mon frère et moi, écoutions madame Bontems avec une attention mêlée de regret pour la folie de mon père qui, de sang-froid, sacrifiait ses deux enfants en faisant expatrier l’un et en abandonnant l’autre45.
Quand j’aurais la possibilité de quitter mon pays, reprit mon frère, avec la certitude d’y rentrer victorieux, je me croirais un monstre d’aller me joindre aux ennemis de ma patrie ; je respecte les préjugés de mon père, mais jamais je ne partagerai ses erreurs ; je suis jeune, je puis embrasser le métier des armes ; toi, ma chère Hortense, avec la dot que mon père t’a laissée, tu peux vivre heureuse, et m’offrir un asile si je survis aux dangers qu’entraîne avec soi le sort des combats. J’ai du plaisir à penser que mon père, abjurant ses erreurs, viendra finir ses jours au milieu de ses enfants, et m’approuvera de lui avoir désobéi ; il conviendra alors qu’un citoyen n’a rien de plus cher que sa patrie, et qu’il s’avilit à ses propres yeux quand il est ingrat envers elle, tel tort apparent qu’elle puisse avoir.46
Madame Bontems embrassa mon frère et nous pronostiqua un avenir heureux. Nous nous couchâmes dans cette espérance, qui répandit un baume consolateur dans nos âmes, et nous fit passer une excellente nuit.
CHAPITRE IV.
Ô consolante espérance, tu es le plus grand bienfait de la nature ; sans toi, l’homme accablé par la douleur succomberait sous le poids de ses maux ; tu lui donnes du courage, tu rends à son âme l’énergie nécessaire pour parer aux événements, et l’avenir que tu lui montres sous de riantes couleurs, lui fait presque oublier qu’il est malheureux !
Telle était notre position à notre réveil. Nous passâmes un temps infini, madame Bontems et moi, à composer le maintien et la toilette de la fausse Angélique. Dorothée était déjà venue vingt fois écouter à notre porte47, et appeler à voix basse sa grande cousine, avec qui elle prenait des familiarités que les liens du sang48, qu’elle croyait qui l’unissaient à Angélique, pouvaient autoriser ; mais madame Bontems, plus expérimentée que nous, qui trouvions des motifs d’amusement dans l’erreur de Dorothée, recommanda à mon frère beaucoup de circonspection.
Trop de précaution devient quelquefois nuisible, et nous en eûmes la preuve. La froideur que mon frère témoignait à Dorothée, lui occasionna de vifs reproches de la part de madame Lavalé, qui menaça Angélique d’en écrire à sa mère, ce qu’elle exécuta à l’insu de son gendre.
Depuis huit jours je gardais l’appartement, une indisposition m’y ayant forcée ; mon frère et madame Bontems me tenaient fidèle compagnie. Le jeune Lavalé s’était fait des querelles sans nombre avec sa tante en refusant de l’accompagner à toutes ses assemblées. Dorothée, sous le prétexte de me rendre des soins, ne sortait pas d’auprès de moi ; mais le vrai motif était ce sentiment beaucoup trop vif pour notre repos, que sa grande cousine lui avait inspiré.
L’assiduité de Lavalé et de Dorothée donnait beaucoup d’humeur à la grand-mère qui, née avec un caractère très franc, nous la laissait apercevoir sans beaucoup de contrainte.
Un soir que nous étions tous réunis, on apporta des lettres à madame Lavalé, qui ne les eut pas plutôt lues, qu’elle lança un regard foudroyant à son gendre ; c’était réellement un tableau à faire que toutes nos figures, madame Lavalé posant ses lunettes avec gravité, Dorimond tout étonné de la colère de sa belle-mère, Dorothée attendant avec impatience le résultat de cette scène muette, et mon frère riant à gorge déployée de toutes nos figures. Ces rires immodérés49 augmentèrent la fureur de madame Lavalé, qui reprocha avec aigreur à Dorimond d’introduire chez elle des aventurières50. À ce mot d’aventurières, je me levai à mon tour avec colère ; et j’allais imprudemment faire des aveux à madame Lavalé pour la forcer au respect ; mais madame Bontems, comme un second mentor51, était toujours là pour réparer mes sottises ; elle tâcha de calmer madame Lavalé, et la pria de s’expliquer.
Cela n’est pas difficile, madame, répondit-elle avec aigreur. Je viens de recevoir une lettre de la sœur de M. Dorimond, en réponse à une que je lui ai écrite ; elle nie formellement avoir envoyé sa fille à Paris, et cela lui serait bien difficile, ajoute-t-elle, puisqu’elle n’a qu’un fils qui a été obligé de fuir les persécutions52 qu’on lui faisait éprouver dans sa ville. Dorimond et moi nous étions anéantis. Quelle est donc cette grande effrontée, ajouta madame Lavalé, qui tient ici la place de votre nièce supposée ? Après une courte réflexion, Dorimond lui dit : je n’ai qu’un tort, madame, c’est de ne vous avoir pas confié mon secret ; ma sœur n’a pu vous en instruire, puisque je le lui ai caché à elle-même. Mon neveu était dénoncé, son signalement donné, il fallait le soustraire à la poursuite de ses ennemis ; depuis plus d’un mois je le tenais caché, mais le danger croissant, j’ai cru devoir lui donner un asile sous un déguisement impénétrable : ce n’est point ma nièce, mais mon neveu ; voilà tout le mystère.
À mesure que Dorimond fabriquait ce conte, la sérénité se répandait dans mon âme ; je regardais madame Lavalé pour tâcher de découvrir quelle impression cette histoire faisait sur elle ; peu à peu elle parut se calmer, mais elle déclara formellement, que ne voulant pas se compromettre, il fallait que le neveu sortit à l’instant de sa maison. On eut beau lui représenter le danger auquel elle allait l’exposer, rien ne put la faire changer de résolution. J’étais dans une anxiété affreuse ; Dorothée fondait en larmes, Dorimond était bouffi de colère ; mon frère ne savait quelle contenance faire et gardait un morne silence ; Lavalé était pensif et semblait chercher à lire dans mes yeux : c’était le seul qui fut calme. Apparemment qu’il s’aperçut de mon embarras, car pendant que ma gouvernante pérorait madame Lavalé, il s’approcha de moi et me dit : rassurez-vous, mademoiselle, et donnez-moi votre confiance, je vous prouverai que je la mérite. Banissez toute crainte, je me charge d’Angélique et je vous en réponds sur ma tête. Je lui pris la main affectueusement.
Il demanda à madame Bontems la permission de proposer un arrangement qui mettrait tout le monde d’accord ; madame Lavalé voulut lui imposer silence, mais sans beaucoup l’écouter, il dit à Dorimond qu’il avait un appartement assez grand pour en offrir la moitié à son neveu ; qu’il croyait même qu’il serait beaucoup plus en sûreté chez lui, qui, comme garçon53, ne recevait personne. Dorimond accepta avec empressement l’offre obligeante de Lavalé. Dorothée le remercia, en termes très affectueux, de l’asile qu’il donnait à son cousin : je gardai le silence, mais Lavalé s’aperçut, (et me le témoigna par un geste), du plaisir qu’il me faisait, plaisir qui, malgré moi, brillait sur mon visage.
Madame Lavalé s’opposa formellement à cet arrangement, ne voulant pas, disait-elle, que son neveu fut compromis ; elle tenait si fort à son opinion, qu’elle alla jusqu’à le menacer de le dénoncer, et qu’heureusement elle avait pour preuve la lettre de la sœur de Dorimond.
À cette menace, notre indignation fut au comble ; Dorimond lui fit les reproches les plus durs, et lui déclara, qu’il allait la quitter, lui et sa fille. La crainte qu’il n’exécutât sa menace, l’apaisa ou parut l’apaiser. Lavalé envoya chercher une voiture54, et je me trouvai encore séparée de mon frère.
Nous quittâmes à l’instant madame Lavalé qui paraissait avoir envie de continuer sa conversation. Dorimond nous conduisit à notre appartement, et après nous être assuré que nous pouvions causer sans crainte, je lui témoignai toute ma reconnaissance de la conduite généreuse qu’il tenait avec nous, mais que je me croirais coupable si je consentais à rester plus longtemps chez lui ; que madame Lavalé ne pouvait plus avoir de confiance en nous, que nous serions extrêmement gênées avec elle ; qu’il me serait presqu’impossible de voir mon frère, le seul bonheur dont je pusse jouir dans la position où le sort m’avait réduite ; que pour parer à tous les inconvénients, je croyais qu’il était prudent de nous retirer à la campagne ; que madame Bontems serait la maîtresse de la maison, que mon frère y serait mon frère, et que nous passerions pour ses neveux ; qu’alors, la contrainte serait moins grande ; qu’il ne m’en coûterait pas beaucoup pour donner à madame Bontems les soins d’une parente : l’attachement qu’elle nous portait, m’engageant à la regarder comme une seconde mère, que le destin m’avait donné pour apporter un peu de soulagement aux maux qui nous accablaient.
Dorimond, approuva ma résolution, et nous convînmes que, dès le lendemain, muni des petites affiches, il irait visiter les environs de Paris, et nous chercher une habitation. Le bon Dorimond nous offrit sa bourse en nous assurant qu’il se croirait trop heureux dans tous les temps de partager sa fortune avec nous.
Madame Bontems lui fit part de la ressource que nous avions, et qui nous mettait à l’abri du besoin ; Dorimond nous en témoigna sa satisfaction, et se chargea de nous vendre une partie de mes diamants.
CHAPITRE V.
La diligente aurore n’avait pas été plus matinale que moi ; il y avait plus de quatre heures que je me promenais dans ma chambre, à former mille projets dont l’un détruisait l’autre, quand madame Bontems se réveilla ; elle parut étonnée de me voir toute habillée : je lui fis part de ma dernière résolution, qui était d’accompagner Dorimond dans ses recherches pour notre habitation et de nous y fixer à l’instant même. Toutes les raisons de madame Bontems ne purent m’ébranler : je lui dis que c’était le dernier jour que je commandais, et que je voulais être obéi ; que dans notre nouvelle demeure, je lui promettais autant de soumission que j’avais aujourd’hui de volonté.
Madame Bontems me connaissait assez pour être convaincue qu’elle ne gagnerait rien sur moi, et elle consentit, ne pouvant faire autrement.
À peine étions-nous d’accord, que Dorothée vint nous avertir que son papa, désirant aller en campagne, nous priait de permettre qu’on déjeûnât de meilleure heure. Nous passâmes chez madame Lavalé, qui était encore de si mauvaise humeur de la veille, qu’elle dédaigna de nous répondre le bonjour. J’avais à peine fait part à Dorimond de l’intention où j’étais, que la domestique, entrant toute effrayée, nous dit qu’un grand hussard55 demandait à parler à madame Bontems. La frayeur s’empara de moi. Je voulais qu’on renvoyât ce hussard, je m’opposais de toutes mes forces à ce qu’il parlât à ma gouvernante. Dorimond me fit observer que j’avais tort, et que le temps que nous mettions à délibérer, pouvait faire naître des soupçons ; que la prudence exigeait qu’on fît entrer ce hussard ; il en donna l’ordre à l’instant. Dès qu’il fut introduit, il se jeta dans les bras de Dorimond, en l’assurant qu’il n’aurait jamais osé venir chez lui, sans les conseils de son ami Lavalé et du vicomte de Chabry56 ; qu’ils l’avaient engagé à venir demander madame Bontems, afin de le prévenir. Dorimond faisait tous ses efforts pour le faire taire, mais il n’écoutait rien et parlait avec une volubilité57 inconcevable ; en moins d’un quart d’heure, il nous eut conté son histoire. Dorimond, pendant son récit, s’était recueilli, s’attendant bien que madame Lavalé allait l’accabler, et que, maîtresse de notre secret, il était important pour nous de la ménager ; moi, de mon côté, j’étais tremblante de la scène qui se préparait. Madame Lavalé était bouffie de colère, elle attendait impatiemment que le jeune Blançai, car, enfin, c’était le véritable neveu de Dorimond, eut fini son récit ; elle saisit avidemment une pause que Blançai fit, et exhala toute sa fureur. J’ai donc maintenant la preuve, dit-elle à Dorimond, que vous m’avez trompée : voilà tous vos mystères dévoilés ; cette madame Bontems, avec son air prude, n’est pas de meilleure foi que vous, et cette belle demoiselle, qui est si dédaigneuse, cache aussi quelque mystère que j’espère découvrir. Pour y parvenir, je ne ménagerai rien ; ni mon neveu ni vous, ne méritez aucune indulgence ; voyez un peu ce morveux, cacher chez lui le fils d’un proscrit, et proscrit lui-même. Mademoiselle Hortense est sans doute l’amante malheureuse de M. le vicomte58 de Chabry ; et vous, M. Dorimond, à votre âge, vous mêler de pareilles intrigues, vous devriez mourir de honte et de repentir : est-ce ainsi que vous avez rempli la mission dont vous vous étiez chargé ? Ah ! grand Dieu, dans quel embarras vous nous avez jetés ; et moi, qui ai contribué, par mes récits, à tromper d’honnêtes citoyens : oh si je l’avais sue, avec quel plaisir j’aurais dit la vérité ! Mais il est encore temps, je saurai ce qu’est cette demoiselle Hortense et sa tante factice, comme ce neveu sur lequel vous m’avez tant fait de mensonges. Vous vous taisez, vous ne pouvez plus me faire de fausses histoires, mais je vous ferai parler malgré vous ; oui je saurai la vérité, dût-il m’en coûter la vie : oh ! vous m’avez trompée, mais je m’en vengerai bien cruellement. Tous ces intrus que vous avez introduits chez moi seront connus, et je cesserai d’être compromise.
Dorimond avait tenté inutilement de lui imposer silence. Blançai était confondu, les menaces de madame Lavalé m’avaient inspiré la plus grande frayeur, madame Bontems seule conservait un air calme. La fureur de madame Lavalé ne lui en imposa point ; elle lui dit, avec beaucoup de fermeté, que sa conduite justifiait la défiance que M. Dorimond avait eue sur son compte ; qu’elle, en particulier, se glorifiait d’avoir eu autant de réserve ; qu’elle pouvait effectuer toutes ses menaces, qu’elles nous effrayaient peu, puisque d’un mot elle pouvait faire retomber toute la noirceur de sa conduite sur elle-même ; que M. de Blançai et M. de Lavalé étaient tous deux dans l’erreur du nom du jeune homme qui avait habité quelques jours la maison de M. Dorimond, mais qu’elle avait eu ses raisons pour lui faire prendre celui du vicomte59 de Chabry, espérant, s’il lui restait quelques sentiments généreux, que la reconnaissance lui imposerait la loi de respecter le fils de son bienfaiteur ; qu’elle se repentait de l’avoir jugée si favorablement ; qu’elle était très fâchée que cela eût occasionné quelques désagréments à M. Dorimond, pour qui elle avait la plus profonde estime ; que nous allions à l’instant quitter sa maison, emportant avec nous notre secret, sans craindre que sa fureur nous l’arrachât, Madame Bontems se leva dans le même moment, et me fit signe de la suivre.
Sa fermeté en avait imposé à madame Lavalé ; Dorimond ne daigna pas lui adresser la parole. Nous passâmes dans notre appartement pour prendre l’écrin60 qui composait toute notre fortune, et nous nous disposâmes à sortir à l’instant même de cette maison.
Quand nous rentrâmes dans le salon, nous trouvâmes Dorimond, sa belle-mère, sa fille et Blançai, dans la même attitude où nous les avions laissés.
Comme nous allions prendre congé de Dorimond, mon frère et Lavalé entrèrent ; ils parurent étonnés de nos figures. Mon frère toujours prêt à rire de tout, allait faire des plaisanteries à madame Lavalé, quand Dorimond lui dit : il n’est plus temps de feindre, monsieur, madame Lavalé croit savoir la moitié de votre secret, et est prête à sacrifier toute sa famille pour apprendre l’autre moitié ; il faut lui éviter un crime, et la laisser en proie au repentir d’avoir pu un instant en former le projet. Vous, Lavalé, je vous crois assez prudent pour taire ce qu’il faut faire en sorte que toute la terre ignore ; restez avec votre tante, pour tâcher de la ramener à la raison, j’aurai soin de vous instruire du lieu que j’aurai choisi pour ma retraite ; je vous remets mon portefeuille pour subvenir aux besoins de votre tante et de votre cousine. Dorothée se jeta dans les bras de son père, et le conjura de ne pas l’abandonner. Madame Lavalé était suffoquée et prête à s’évanouir ; j’eus pitié de la position dans laquelle elle était ; je lui donnai des secours, et fis signe à madame Bontems de chercher à calmer Dorimond. À force de soins et de prières, nous parvînmes à remettre un peu de calme dans tous les esprits. Dans un moment très pathétique, mon original de frère prit les mains de madame Lavalé et lui dit : allons, ma chère, je vois bien que votre plus grand défaut est la curiosité, et que nous avons un tort irréparable vis à vis de vous, c’est de ne vous avoir pas fait confidence de tous nos petits secrets ; mais consolez-vous, je vous jure qu’avant peu ce sera celui de la comédie, et que vous serez au fait comme les autres. Cette folie nous fit rire, quoique nous n’en eussions point d’envie.
Madame Bontems avait fait entendre à Dorimond que la prudence exigeait qu’il ne quittât pas sa belle-mère, et qu’il la surveillât même jusqu’à ce que nous fussions à l’abri de ses recherches ; que la seule chose qui pouvait lui en imposer, était la crainte de se séparer de lui, et qu’il fallait garder cet épouvantail ; qu’il était nécessaire, avec des esprits comme celui de madame Lavalé, d’avoir un frein à leur imposer. Il goûta ces raisons, et consentit à rester, après que sa belle-mère eut promis de garder beaucoup de circonspection, et de s’abstenir de parler de rien qui pût donner le moindre soupçon. Il fut arrêté que Lavalé nous accompagnerait dans la recherche que nous allions faire d’une nouvelle habitation ; nous promîmes à madame Lavalé de venir la prendre pour passer quelques temps avec nous à la campagne que nous allions chercher, et de lui raconter toutes nos aventures. Mon frère avait eu réellement raison de lui dire que son plus grand défaut était la curiosité, car cette promesse acheva de la calmer. Dorothée ne nous quitta pas sans répandre beaucoup de larmes ; mon frère prétendait que si on avait laissé Dorothée dans l’erreur, et qu’elle eût été plus longtemps sa cousine, il l’aurait consolée ; Lavalé fut nous chercher un remise61, et nous quittâmes la maison de l’honnête Dorimond, avec l’espoir de revoir bientôt cet excellent homme.
CHAPITRE VI.
Après une matinée très orageuse, nous nous trouvions, absolument parlant, sans autre asile que le carrosse de remise que Lavalé nous avait loué ; en montant dans la voiture, il avait donné l’ordre de nous mener à la barrière du Trône62, pour avoir le temps de nous concerter de quel côté nous porterions nos pas ; mais à peine étions-nous en marche, que Lavalé réfléchit que mon frère ne pouvait quitter Paris sans exhiber sa carte, et il n’en avait pas ; il fit arrêter la voiture avant que nous ne fussions devant le district des Enfants-Trouvés63, et nous pria avec instance de venir chez lui jusqu’à ce que nous eussions avisé un moyen pour sortir de Paris sans nous compromettre. Pendant que nous délibérions, la pluie tombait comme jamais on ne l’avait vu ; le cocher jurait et menaçait de nous laisser au milieu de la rue ; un homme, comme il s’en trouvait beaucoup alors, lui conseilla de se ranger et d’entrer dans la voiture avec nous ; le conseil ne fut pas plutôt donné qu’il fut exécuté, et il nous fallut faire place à notre cocher pour attendre que l’averse fut cessée. Dans toute autre circonstance, nous n’eussions pas souffert cette impertinence, mais nous étions plus que suspects ; près d’un district qui ne badinait pas, la moindre résistance eut amené une dispute, on nous conduisait au comité, et dieu sait comment nous nous en serions tirés.
Tout en arrangeant, nous prîmes notre parti ; la pluie cessa, et Lavalé ne pouvant plus nous consulter, donna ordre au cocher de nous mener chez lui ; le temps, ajouta-t-il, n’étant pas assez beau pour aller en campagne.
Nous voici donc rentrés dans le cœur de Paris, sans trop savoir comment nous en sortirions ; et à la merci du jeune Lavalé qui, à la vérité, mettait tant de délicatesse dans sa conduite, que nous lui accordions toute notre confiance.
Lavalé paya la journée du cocher, qui demanda si nous en avions encore besoin ; on lui répondit que non, et fort heureusement cet incident nous arriva, car notre cocher fut questionné par Dorothée et sa grand-mère, pour savoir où il nous avait menés : la grand-mère, par curiosité ; et la pauvre Dorothée, pour satisfaire son cœur. Nous passâmes la journée chez Lavalé ; le soir devint fort embarrassant ; Lavalé n’avait qu’un lit qu’il avait partagé avec mon frère ; mais nous étions quatre ; nous décidâmes de passer la nuit : mon frère exigea que madame Bontems et moi nous nous couchassions et que lui et Lavalé passeraient fort bien la nuit sur des fauteuils. Il fallut consentir à cet arrangement. À la pointe du jour, Lavalé fut chercher lui-même notre déjeuner, et nous amena un juif fort honnête homme, qui nous acheta pour mille louis de diamants ; nous lui en vendîmes aussi pour des assignats.
Lavalé nous proposa d’acheter une carte de sûreté64 à un homme qui montait ordinairement la garde pour lui, et dont le signalement était très-ressemblant avec celui de mon frère ; nous adoptâmes avec empressement ce moyen de quitter la Capitale, et nous priâmes Lavalé de ne rien épargner pour nous procurer ce passeport indispensable. Il revint sur le midi avec la carte, un fiacre, et l’adresse d’une maison qu’il nous dit être fort agréable. Mon frère, étant de la même taille que Lavalé, endossa une redingotte uniforme, et nous nous embarquâmes.
La pluie affreuse qui nous avait pensé mettre dans l’embarras la veille, nous servit supérieurement ; la sentinelle65 regarda à peine les cartes des voyageurs qui les lui présentaient avec assurance. Quand nous eûmes passé la barrière, je crus être quitte de tous mes maux ; je respirai avec le plaisir qu’on éprouve quand on revient d’une forte oppression ; mon étourdi de frère baisait sa carte et pressait les mains de Lavalé ; il était si prévoyant, qu’il avait négligé de voir sous quel nom il était sorti de Paris. Par un hasard fort heureux, le nom de famille du vendeur de carte se trouvait celui de baptême de mon frère. Ah ! s’écria-t-il en riant, mon Sosie ne peut m’empêcher de me nommer comme lui, et par droit d’acquisition et par droit de naissance. Nous nous en assurâmes, croyant que c’était une nouvelle plaisanterie ; et comme c’était la vérité, nous convînmes que mon frère s’appellerait Saint-Julien66, et que moi je me nommerais aussi Saint-Julien. Madame Bontems nous dit qu’elle était dans l’intention de reprendre le nom de son mari, que l’inconstance de la fortune l’avait forcée de quitter lorsqu’elle devint ma gouvernante ; elle était munie de son contrat de mariage, et nous déclara, qu’à dater de ce moment, il fallait la nommer madame Daingreville ; cette disposition nous convint à merveille, parce que cela dérouterait davantage madame Lavalé dans ses recherches.
Au bout de deux heures, nous arrivâmes à J…67 sur la route de Fontainebleau. Nous descendîmes dans une maison de peu d’apparence, mais extrêmement commode, meublée simplement, et cependant rien n’y avait été oublié ; le jardin était très vaste, il contenait environ vingt arpents68 ; des prairies, et des vignes en dehors du clos. On voulait vendre le tout meublé, et l’on abandonnait la jouissance à l’instant, ce qui nous arrangeait fort. Le maître de la maison paraissait très pressé de vendre, et nous fit en conséquence une proposition à laquelle mon frère et moi accédâmes sur-le-champ. Mais la prudente madame Daingreville arrêta notre pétulence, et parut n’être pas si amoureuse que nous de cette habitation, afin de tirer un meilleur parti du vendeur. Après bien des débats, nous convînmes de lui payer sa maison et les dépendances cinquante mille livres, dont moitié comptant, et l’autre moitié après les lettres de ratification : une des clauses secrètes était cinq cents louis de pot de vin que nous comptâmes sur-le-champ.
Lavalé, qui était avocat au parlement de Paris, avant la révolution, rédigea l’acte, et nous fîmes venir le tabellion69 qui le dressa.
Dès le même soir, notre vendeur voulut nous laisser libres dans notre nouvelle demeure ; nous fîmes mille instances pour l’engager à rester encore quelques jours, mais rien ne put l’y faire consentir ; il profita du fiacre qui nous avait amenés, et nous quitta ; depuis ce jour nous n’en avons plus entendu parler. La porte cochère n’était pas encore refermée, que mon frère avait déjà fait une vingtaine de sauts dans le salon : il tenait la tête de notre bonne Daingreville dans ses mains, et la serrait de manière à l’étouffer.
Nous voici donc chez nous, s’écriait-il ; ah ! ma chère, nous allons mener une vie de patriarches. Nous cultiverons notre jardin70 comme la jardinière de Vincennes71. Qui sait si Hortense ne trouvera pas quelque comte de Grigny, comme la belle Flore ; et moi, la bêche à la main, je donnerai peut-être dans l’œil à quelque veuve, comme Maronville. Toutes ses belles acclamations furent interrompues par la présence du jardinier et de sa femme, qui vinrent nous prier de les garder à notre service : oui, répondit mon frère, à condition que vous m’apprendrez votre métier. Madame Daingreville, avec plus de gravité que mon frère, les assura que son intention n’était point de rien changer dans la maison, et quelle espérait qu’ils auraient pour nous le même attachement que pour leur ancien maître, qui se louait beaucoup de leur zèle. Ensuite elle les pria de nous procurer une cuisinière et une fille de basse-cour, son intention étant d’avoir des bestiaux, chose indispensable quand on habite la campagne. La jardinière, après vingt révérences, offrit ses deux filles, qui étaient très fortes. On les fit venir ; elles furent acceptées et gagées, et nous, nous trouvâmes une maison montée sur-le-champ.
Mon frère ne voulut pas attendre au lendemain pour visiter la maison, que nous n’avions vue qu’en courant, notre désir d’acheter surpassant, s’il était possible, celui du propriétaire de vendre sur-le-champ. Nous forçâmes madame Daingreville de prendre l’appartement le plus commode ; nous assignâmes celui de Lavalé et du bon Dorimond ; mon frère voulait toujours que celui de Dorothée fût près du sien, si elle venait nous voir : toutefois, ajouta-t-il, si notre ami Lavalé ne s’y oppose pas.
Lavalé lui répondit fort sérieusement, que quand bien même il aurait eu des vues sur Dorothée, que tous les événements qui lui étaient arrivés depuis un mois, auraient bien changé ses projets, et qu’il voyait trop que sa destinée le condamnait au célibat pour toute sa vie. En finissant sa phrase, il me regarda : je me sentis émue malgré moi, et la rougeur qui couvrit mon front, lui apprit trop, sans doute, que je comprenais son discours, malgré la précaution qu’il prenait pour l’entortiller. Mon frère, dont l’esprit était très pénétrant, prit la main de son ami, et lui dit : mon cher, encore quelques temps, et tout cela s’accommodera : depuis deux ans, nous avons vu des choses plus extraordinaires.
On nous servit un souper du produit de notre jardin, qui nous parut délicieux.
Nous avions été si occupés depuis la scène occasionnée par le jeune Blançai, qu’il ne m’avait pas été possible de demander pourquoi ce jeune homme était venu comme une bombe au milieu de nous, occasionner tout ce tintamarre. Dès ma première question, mon frère s’empressa de disculper son ami : c’est moi, dit-il, qui ai conseillé à Blançai d’aller trouver notre bonne tante, en l’assurant qu’elle était très prudente, et de bon conseil ; et qu’assurément les choses s’arrangeraient à merveille, si elle consentait de s’en charger. Je suis, je te le jure, continua-t-il, enchanté que tout cela ait tourné de cette manière ; les plus petits événements amènent de grandes choses ; et sans mon étourderie, (ainsi que Lavalé l’a qualifiée) nous ne serions pas ici : madame Daingreville aurait voulu mettre des procédés avec cette vieille Lavalé : Dorimond n’est pas aussi expéditif que notre ami ; je n’aurais pas une carte de citoyen ; je ne saurais encore quel nom prendre ; je ne bêcherais pas demain notre jardin, je ne mangerais pas ce soir d’excellents légumes et des fruits divins qui viennent du sol destiné à nous nourrir, vêtir, etc. Tu vois, ma chère sœur que Pangloss72 avait raison ; tout est pour le mieux : nous sommes ici dans le pays d’Eldorado73, jouissons du présent, oublions le passé, et tâchons de rendre heureux l’avenir.
Cette philosophie est fort aimable, reprit madame Daingreville ; mais mon cher neveu, n’oubliez pas que la prudence prévient de grands maux.
Oh ! si vous voulez lui parler sérieusement, vous ne gagnerez rien avec lui, nous dit Lavalé. Croiriez-vous qu’il a failli me quereller lorsque je rentrai, et que j’improuvai sa conduite quand il me raconta qu’il venait d’envoyer Blançai chez Dorimond, en lui conseillant de dire que c’était de ma part et de la sienne ? Mais comment, Blançai vous connaît donc ? Sans doute, il est le fils du régisseur74 de la terre de Chabry ; tous les étés j’y accompagnais mon père, et Blançai était mon camarade d’étude et de plaisir. Et vous avez consenti qu’il vous nommât devant madame Lavalé ? Sans doute. Quelle étourderie ! Enfin mesdames, il ne pouvait concevoir que madame Lavalé trouvât cela mauvais ; il m’a fallu employer toute ma rhétorique pour le convaincre de l’embarras dans lequel vous deviez être. Il se faisait au contraire une image très riante de la reconnaissance de l’oncle et du neveu, de l’étonnement de madame Lavalé ; et regrettait de n’être pas présent à cette scène qui, disait-il, ferait un grand effet sur le théâtre.
Comme la chose avait tourné plus avantageusement que nous ne pouvions l’espérer, mon frère prétendit se justifier par les résultats.
Nous passâmes le reste de la soirée à converser agréablement, et nous nous séparâmes fort satisfaits de notre journée.
CHAPITRE VII.
À la campagne, une belle matinée est plus séduisante qu’à la ville ; nous étions dans les commencements du printemps, les premiers rayons du soleil venaient me caresser, je regardais autour de moi avec ce contentement de l’âme qu’on sent bien vivement, mais qu’il est difficile d’exprimer ; je repassais dans mon imagination tout ce qui m’était arrivé depuis ma sortie de l’Abbaye, et je bénissais le destin qui nous avait conduits dans cette habitation qui m’avait paru délicieuse, malgré la pluie qui nous avait privés du plaisir de la parcourir. Tandis que je m’abandonnais avec une douce mélancolie à toutes ces réflexions, mon frère impatient de se promener seul, et qui avait déjà fait deux ou trois fois le tour du jardin, m’appela de toutes ses forces ; il me donna à peine le temps de m’habiller. Viens donc, me disait-il, j’ai cueilli deux jolis bouquets de violettes75 pour notre bonne tante ; je t’attends pour les lui porter : tu dors, tandis que j’ai déjà ramassé toute la rosée des gazons. Il ne mentait pas, il était mouillé jusqu’à la ceinture ; je voulais absolument qu’il changeât d’habit, mais il prétendit qu’il était devenu paysan76, et qu’il ne pouvait faire trois ou quatre toilettes par jour. Il me fit parcourir, en moins de rien, notre jardin, qui réunissait parfaitement l’utile et l’agréable.
Mon frère s’était déjà pourvu de tous les outils de jardinage qu’il croyait lui être nécessaires. Il avait envoyé une des filles acheter des volailles en grande quantité, et avait écrit une lettre fort honnête au fermier, pour le prier de passer à la maison, ou lui indiquer l’heure à laquelle il pourrait le trouver chez lui. J’avais peine à me faire à ces politesses ; mon frère était bien plus affable que moi ; je conservais cette hauteur dans laquelle j’avais été élevée, et j’éloignais, par mon air dédaigneux, ceux qui auraient pu me rendre de grands services. Je me suis surprise vingt fois (tant les préjugés de l’enfance s’effacent difficilement) à remercier Dorimond et Lavalé, avec un air de protection fort déplacé, vu les services signalés qu’ils nous rendaient. Mon frère me représenta avec douceur, qu’il fallait que je me corrigeasse de ce défaut qui m’attirerait des ennemis77, et m’en donna sur-le-champ l’exemple, vis-à-vis du fermier qui s’était rendu à son invitation. Il le reçut avec cette politesse aisée, qui dit aux gens : vous me ferez plaisir d’en user de même. Il traita si bien cet honnête fermier, qu’en moins d’une heure qu’ils furent ensemble, il en fit un ami. M. Durand, c’est ainsi qu’il s’appelait, lui vendit trois vaches, deux chèvres, une demi-douzaine de brebis, une coche78 pleine, les fourrages et grains nécessaires pour nourrir tous ces animaux. Il se faisait un grand plaisir d’offrir à madame Daingreville, à son lever, tous ces nouveaux habitants ; il engagea M. Durand à dîner avec nous. Celui-ci promit de s’y rendre, et nous quitta pour aller vaquer à ses travaux champêtres. Saint-Julien79, (c’est ainsi que je nommerai dorénavant mon frère) était impatient de ce que madame Daingreville tardait tant à paraître ; il faisait un bruit épouvantable en appelant Lavalé, qui ne paraissait pas davantage ; enfin, à sa grande satisfaction, ils descendirent ensemble dans la salle à manger. Saint-Julien fit servir sur-le-champ le déjeuner, et eut grand soin de dire à madame Daingreville que les œufs étaient de sa basse-cour, et le lait de ses vaches. Nous lui offrîmes les premiers bouquets du jardin, qu’elle reçut avec une satisfaction inexprimable.
À peine mon frère nous donna-t-il le temps de déjeuner : il voulait conduire madame Daingreville à la basse-cour, au jardin, lui faire tout voir en un clin-d’œil ; il était au comble de la joie : rien ne pouvait plus, disait-il, altérer notre bonheur ; je le désirais aussi fortement que lui ; mais un certain je ne sais quoi me disait : tu n’as pas encore tout éprouvé.
Quand Saint-Julien eut tout fait examiner à madame Daingreville, nous entrâmes dans la maison. Lavalé et notre bonne tante adoptive s’étaient occupés de nous pendant que nous les croyions dans les bras du sommeil. Madame Daingreville nous remit une contre-lettre bien cimentée, par Lavalé, dans laquelle elle déclarait que la maison nous appartenait, quoiqu’elle parût en être la propriétaire80. Il y eut un grand combat de générosité de la part de mon frère, qui ne voulait point absolument partager ma dot : je suis jeune, garçon, il me faut beaucoup moins qu’à ma sœur ; je puis faire ma fortune ; et elle, son sexe lui interdit toute entreprise. Oui, lui répondis-je, tu feras une grande fortune avec ta bêche et ton râteau. Hé bien, je te déclare que je quitte à l’instant la maison, si tu te refuses à partager avec moi. Madame Daingreville lui dit qu’elle connaissait trop bien ma façon de penser, pour avoir fait l’écrit différemment. Enfin, après l’avoir sermonné pendant une heure, nous lui fîmes, comme malgré lui, accepter la moitié de la maison.
Lavalé, qui avait eu grand soin de flatter l’amour-propre du tabellion, et qui avait eu ses raisons, ayant appris qu’il était maire du village, engagea mon frère à lui aller faire une visite, afin d’obtenir une carte81 ; car la vôtre, lui dit-il, n’est qu’une location, et il serait même dangereux qu’on vous en trouvât muni : laissez-moi parler chez le maire, je ne vous demande que de dire amen. Dans toute autre circonstance, je me ferai un devoir de vous écouter ; mais, dans celle-ci, j’ai plus d’expérience que vous, et je vous prie de permettre que je sois votre mentor. Saint-Julien rit beaucoup de son mentor, et, cependant, consentit à suivre ses conseils. Ils allèrent ensemble chez le maire ; Lavalé lui dit que Saint-Julien désirant se fixer à J… il était important pour lui d’avoir une carte de la municipalité, celle qu’il avait de Paris, ne pouvant lui être d’aucune utilité dans les autres communes où il déclarerait habiter à J… Il endoctrina si bien le maire, qu’en moins d’une heure, mon frère eut une carte de citoyen, domicilié à J…, fut inscrit dans la garde nationale, fit son don patriotique82, et en tira un reçu. Le procureur de la commune83, qui se trouvait être le fermier qui était venu le matin, signa tout ce qu’il fallut signer. Mon frère amena dîner avec nous le maire et ce fermier. Après le dîner, Lavalé prit congé de nous, et se chargea d’une lettre pour Dorimond, que nous engageâmes à venir nous voir ; il nous promit de n’être pas longtemps absent. Cet honnête jeune homme nous quitta les larmes aux yeux ; et je vous avoue que je ne le vis pas partir sans un serrement de cœur, qui m’avertissait de l’intérêt qu’il m’inspirait. Mon frère le conduisit avec le fermier, qui lui avait prêté fort obligeamment sa petite carriole. Je me crus, le soir, abandonnée de toute la nature. Depuis un mois, je m’étais fait une douce habitude de la société de Lavalé, et son absence m’était insupportable. Mon frère vint nous rejoindre avec le bon Durand, qui passa la soirée avec nous ; il avait une instruction au-dessus de son état. Mon frère le pria de permettre que nous allassions lui faire visite, en l’assurant que nous serions flattés de cultiver sa société. Il nous remercia, et nous pria d’être convaincus du plaisir qu’il en ressentirait. Ce brave homme ne s’est jamais démenti, et nous a été d’une grande utilité dans les événements singuliers qui ont si longtemps traversé84 notre bonheur.
CHAPITRE VIII.
Combien l’homme est lui-même son plus cruel ennemi ! À peine est-il délivré d’un malheur, qu’il s’en forge de nouveaux, ne fut-ce que pour se plaindre. Je ne sais si c’est par une bizarrerie de la nature, mais j’ai souvent remarqué qu’on avait plus de plaisir à maudire son sort, qu’à convenir qu’on était heureux.
Telle était ma position. J’avais désiré ardemment un asile où je fusse réunie avec mon frère ; j’y étais, et je me plaignais. Les jours, me disais-je, vont me paraître bien longs : que ferai-je ici ? Je connais déjà notre jardin par cœur : cette basse-cour, tous ces détails de maison me sont insipides ; me voilà donc destinée à finir mes jours dans cette solitude ! O inconstance de l’espèce humaine ! Hier, mon habitation faisait mes délices ; aujourd’hui elle me paraît ennuyeuse ; je cherchais à me dissimuler ce motif de ma mélancolie : le véritable était l’absence de Lavalé. Je rejetais loin de moi toute idée d’union avec lui : la noblesse de mon sang ne me permettant pas de m’allier à un roturier85. La révolution avait eu beau anéantir tous les préjugés, les miens me restaient ; et en repassant dans mon imagination tout ce que Lavalé avait fait pour nous, j’avais l’injustice de croire que c’était un devoir qu’il avait rempli, et que je lui devais beaucoup moins que je ne me l’étais figuré. Mon frère me donnait beaucoup d’humeur86 quand il exaltait les services de Dorimond et de Lavalé.
Nous avions déjà passé trois grands jours seuls, mon frère ne paraissait pas s’ennuyer. Il était tout le jour avec son jardinier ; il gâtait autant d’arbres qu’il en touchait, mais enfin il s’amusait ; et moi, je poussais de gros soupirs, qu’il ne faisait pas semblant d’entendre. Madame Daingreville s’amusait à faire de la tapisserie87 ; moi, je ne faisais rien, parce qu’on ne m’avait rien appris qui pût me faire passer le temps sans ennui. J’allais cent fois par jour dans le jardin : ma fierté ne me permettait pas d’adresser la parole à nos domestiques, et mon frère toujours occupé ne faisait pas grande attention à mon oisiveté.
Je serais tombée malade sans un petit événement qui me tira de ma léthargie. Le bon M. Durand vint implorer notre pitié pour une petite orpheline dont la mère venait de mourir : elle restait sans appui et sans aucune existence. M. Durand tâchait de réunir une petite somme pour la placer dans une maison jusqu’à ce qu’elle eût atteint l’âge d’apprendre un métier, et de donner les plus belles années de sa jeunesse à celle qui le lui montrerait. Madame Daingreville se disposait à satisfaire à la demande de M. Durand ; mais je m’y opposai, et je priai qu’on nous amenât cette pauvre enfant, observant que n’ayant rien à faire, je l’éléverais et lui assurerais un sort plus doux. Mon frère me prit dans ses bras et me dit : Hortense, tu seras heureuse, car, à part quelques petits ridicules88, tu as un excellent cœur. Madame Daingreville y consentit, et M. Durand fut chercher cette pauvre petite, trop jeune encore pour sentir la perte de sa mère. On la nommait Mariette ; ce nom me parut commun, et je voulus qu’on la nommât Célestine, du nom de ma mère. Ma pauvre petite était à peu près nue. Point de couturières dans le village : comment faire ? Madame Daingreville m’offrit de travailler à son petit trousseau89, et me proposa de lui aider. Le plaisir de contribuer à la parure de ma fille adoptive, me donna le courage de m’abaisser à faire des chemises, jupons, etc. : j’étais fort gauche en commençant.
Mais, enfin, vous savez qu’on s’y prend mal d’abord, puis mieux, puis bien. La première robe que Célestine porta, où j’avais cousu, pour ma part, au plus un quart, me parut un chef-d’œuvre. J’y avais passé deux jours, et deux jours sans m’ennuyer. Cette petite avait des manières tout à fait aimables. Je me plaisais à la faire causer : son petit jargon était tout drôle ; et quand j’avais pu réussir à lui faire bégayer quelques mots, qu’elle écorchait, je riais aux éclats.
Il y avait huit grands jours que nous n’avions entendu parler ni de Lavalé, ni de Dorimond. Mon frère en était inquiet, et projetait d’envoyer le jardinier à Paris, si l’on n’avait point de leurs nouvelles dans la journée. M. Durand devait y aller le lendemain ; il se chargea de nos commissions pour Lavalé. Nous ne voulûmes pas l’envoyer chez Dorimond, pour éviter qu’il ne fût assailli par les questions de madame Lavalé ; mais la précaution était inutile : cette pauvre femme n’était plus en état de nous nuire. M. Durand nous rapporta une lettre de Lavalé, ainsi conçue :
LETTRE DE LAVALÉ,
AUX HABITANTS de J…
Huit jours se sont écoulés depuis que je me suis séparé de vous, et je les ai passés bien tristement. En arrivant à Paris, je me rendis chez Dorimond, que je soupçonnais être inquiet ; il ne me fut pas possible de lui parler une minute seuls : ma tante nous obséda au point que nous fûmes obligés de sortir, pour pouvoir causer à notre aise. Elle avait commencé par me demander ce que j’avais fait de madame Bontems et de ses parents ; ma réponse ne l’ayant pas satisfaite, l’humeur s’était emparé d’elle ; mais il lui fut impossible de se contenir, quand elle nous vit disposés à la lui laisser exhaler ; elle courut après nous jusqu’à la grande porte, nous menaça de nous faire arrêter au premier corps-de-garde. Dorothée faisait de vains efforts pour la calmer : Dorimond voulait absolument la quitter ; le danger, me disait-il, n’est plus le même. Elle ignore, et ignorera toujours ce que cette malheureuse famille est devenue. Je ne puis plus vivre avec votre tante ; elle me fait mourir. Je les fis tous remonter, et je sermonnai ma tante de la belle manière ; rien, me dit-elle, ne m’apaisera ; rien ne me fera garder le silence, si vous continuez à vous cacher de moi ; confiez-moi tous vos secrets, et je vous promets de les garder aussi fidèlement que vous.
J’avais souvent entendu dire qu’il y avait des femmes curieuses ; mais je ne me serais jamais douté qu’elles portassent ce défaut aussi loin. Je lui promis de la satisfaire, si elle voulait se calmer, et surtout éviter des scènes semblables à celles qui venaient de se passer. Enfin, je lui fis le conte que vous étiez à une lieue de Pontoise ; que je vous avais promis de la mener avec Dorothée passer quelques jours à votre campagne. Je lui en fis le détail très circonstancié ; elle m’écoutait avec beaucoup d’attention, en me regardant fixement.
Voilà tout ce que je voulais savoir, me dit-elle ; vous me trompez comme les autres : la maison est bien telle que vous me la dépeignez : je la connais. La seule chose sur laquelle vous ne dites pas la vérité, est l’endroit où elle est située : cette maison est à J… je connais le vendeur ; il est venu me voir en arrivant. C’est vous qui avez rédigé le contrat ; vous avez fait un écrit double pour les meubles ; je l’ai vu ; il est de votre écriture. J’ai voulu me convaincre que vous étiez de moitié pour me tromper. Je sais que cette madame Bontems a encore changé de nom ; que ses prétendus neveux ne portent pas non plus les mêmes que quand ils ont quitté cette maison : ces gens-là sont plus que suspects : il est de mon devoir de les faire connaître.
Heureusement, Dorimond était passé dans son appartement pendant tout ce colloque90, car la scène eût recommencé. Il n’y avait plus moyen de feindre ; je lui fis observer que le désir immodéré qu’elle avait montré de savoir qui vous étiez, avait fait naître votre défiance ; mais que du moment qu’elle aurait donné sa parole de garder le secret, je ne voyais plus d’inconvénient à lui tout dire. — C’est un nouveau piège dans lequel vous voulez me faire tomber ; mais je ne serai plus votre dupe ; toutes mes batteries91 sont prêtes, et bientôt vous serez à ma discrétion. — À peine avait-elle cessé de parler, qu’on annonça le président de la section. Dorothée, qui croyait faire plaisir à son père, fut le chercher ; il entra dans le moment où ma tante racontait tout ce qu’elle savait sur votre compte ; et sans aucun ménagement, m’accusait, ainsi que Dorimond, d’être complices avec vous.
J’étais tombé dans un état de stupeur : la colère avait glacé Dorimond, Dorothée était anéantie. Madame Lavalé profitant de notre silence, continuait à insinuer les soupçons les plus violents au président qui, heureusement, est un des plus honnêtes hommes que je connaisse, assez éclairé pour distinguer les méchants d’avec ceux que le sort poursuit, et né avec des vertus qui ne permettent point d’abjurer le sentiment de la reconnaissance.
Dorimond ne pouvant plus se contenir, interrompit sa belle-mère, et dit au président : madame ne vous a instruit qu’à moitié, monsieur ; je vais vous dire toute la vérité. Je suis né sans fortune, mon heureuse destinée me fit rencontrer, au collège où j’étais externe, le marquis de Chabry qui me prit en amitié. Lorsqu’il eut fini ses études, son père le fit voyager : il obtint que je l’accompagnerais.
À l’âge de dix-sept ans, je parcourus toutes les cours étrangères avec mon protecteur. À son retour en France, il fit un mariage avantageux ; il me proposa d’être son secrétaire, avec cent louis d’appointements92. Il fut, depuis, ambassadeur en Espagne et en Angleterre ; il me fit nommer secrétaire d’ambassade, fut ma caution dans plusieurs affaires commerciales que j’entrepris, et me fit gagner une fortune considérable. La révolution est venue ; M. de Chabry a cru devoir abandonner son pays ; il me proposa de le suivre. Je ne pensai pas que la reconnaissance exigeait un aussi grand sacrifice, mais je me dévouai tout entier aux deux infortunés qu’il abandonnait. J’ai donné asile à son fils et à sa fille, qui ne peuvent être responsables des fautes de leur père. Si je suis coupable, qu’on me punisse ; je sacrifierais volontiers ma vie pour ma patrie, mais je ne dois point lui sacrifier le sentiment de reconnaissance qui m’attache à la famille de mon bienfaiteur93. Voilà mon crime, monsieur ; je le répète, qu’on me punisse, mais qu’on épargne deux innocentes victimes que la méchanceté la plus noire vous présente comme coupables.
Rassurez-vous, M. Dorimond, lui dit le président, votre conduite sera approuvée de tous les gens honnêtes ; il n’y a que des forcenés94 qui puissent vous faire un crime d’une vertu bien précieuse et bien rare. Je vous conseille, madame, dit-il à ma tante, d’être plus circonspecte dans vos dénonciations : la loi punit les coupables, mais respecte le malheur. Il est étonnant que vous, qui partagez avec votre gendre les bienfaits de M. de Chabry, vous soyez la plus cruelle ennemie de ces malheureux enfants : une conduite comme la vôtre est inexcusable.
Après cet entretien il nous quitta, en rassurant Dorimond sur les suites de cette aventure, et lui promit de l’instruire de tout ce qui pourrait compromettre votre tranquillité.
La colère à laquelle madame Lavalé s’était livrée, et les reproches du président, qu’elle croyait pouvoir mettre de son parti, allumèrent son sang au point qu’elle eut, la même nuit, une fièvre très violente. Dorothée avertit son père de la maladie de ma tante ; Dorimond m’envoya chercher. Sa tête fut prise presque en même temps que la maladie se fut déclarée. Tous les secours de l’art lui ont été prodigués en vain : elle a expiré dans nos bras, sans avoir recouvré la raison. Dorimond se propose d’aller vous voir sous peu de jours, et vous prie de permettre qu’il vous mène Dorothée, qui perd dans sa grand-mère, la seule protection qu’elle eut en femme. J’aurai infiniment de plaisir à vous savoir bien établis dans votre nouvelle demeure. Je prie madame Daingreville et mademoiselle de Saint-Julien, de recevoir l’assurance de mon respect et de mon éternel attachement.
La mort de madame Lavalé nous affecta sensiblement. Madame Daingreville nous demanda si nous consentions à ce qu’elle offrit à Dorimond de garder sa fille avec nous ; nous l’approuvâmes dans ce dessein ; et dès le même soir, nous écrivîmes à Dorimond, pour le prier de ne point chercher d’autre asile pour Dorothée.
CHAPITRE IX.
L’horizon politique se noircissait tous les jours : nous ne nous en doutions pas ; mais nos amis veillaient pour nous. La loi qui forçait les jeunes gens depuis dix-huit ans jusqu’à vingt-cinq, d’aller aux frontières, vint frapper mon frère95. Je voulais qu’il se cachât ; qu’il mît un homme à sa place, qu’il payât une grosse somme96. J’abjurai toute fierté : j’allai trouver M. Durand, je le priai de dispenser mon frère : ce brave homme était accablé de chagrin : ses deux fils étaient de la réquisition. Il oublia sa douleur, pour tâcher de calmer la mienne. Dans mon désespoir, je lui dis qui nous étions, et combien mon frère courait de dangers : c’est une raison de plus, me dit-il, pour l’engager à partir ; il sera bien moins exposé à l’armée, qu’en restant auprès de vous, où, d’un moment à l’autre, il serait arrêté. Enfin, M. Durand me donna tant de bonnes raisons pour justifier le départ de mon frère, et m’inspira tant de frayeur de son séjour auprès de moi, qu’il me fit consentir à notre séparation. Il me reconduisit chez moi, et conseilla à Saint-Julien de partir avec les jeunes gens du village, qui étaient au nombre de vingt. Saint-Julien, qui n’était pas très fâché de suivre le métier des armes, y consentit. Dès le lendemain on fit venir un tailleur ; mon frère habilla tous ses camarades, qui le nommèrent leur capitaine97, Dorimond et Lavalé qui pensaient bien que ce départ me serait très sensible, hâtèrent leurs affaires, et vinrent nous rejoindre ; ils arrivèrent la veille du jour où mon frère devait partir. Je l’ignorais ; on avait eu grand soin de me le cacher, et Saint-Julien lui-même avait contribué à me tromper, redoutant l’instant de notre séparation. Je revis Dorimond, sa fille et Lavalé, avec une vraie satisfaction. Les services que je recevais journellement des gens que je croyais fort au-dessous de moi, m’avaient accoutumée à les regarder d’un autre œil, et je leur pardonnais la familiarité qu’ils prenaient avec moi98.
Mon frère avait prévenu Lavalé que son départ était fixé au lendemain. Il lui recommanda de ne point me quitter que je ne fusse accoutumée à son absence.
M. Durand et ses deux fils vinrent souper avec nous. Dorimond qui avait visité notre habitation, en était enchanté. Je faisais mille amitiés à Dorothée qui, depuis qu’elle me connaissait, était beaucoup plus réservée avec moi. La pauvre petite n’osait lever les yeux sur mon frère ; je l’enhardissais le plus qu’il m’était possible. Jamais soirée ne fut plus gaie : j’étais loin de penser que le jour qui lui succéderait, me plongerait dans la plus affreuse douleur. Dorothée et moi étions les seules qui fussions dans l’erreur. Son père avait fait apporter sa harpe et son piano. Mon frère la pria de permettre que nous fussions ses écoliers. Destinée au cloître, on avait négligé de me donner des talents agréables. J’avais une assez belle voix, mais je ne connaissais pas même la musique. Dorothée m’accompagna avec beaucoup de complaisance. Mon frère qui jouait fort agréablement de la flûte, se mêla à notre concert : tout le monde était content ou paraissait l’être.
Saint-Julien, qui pressait toujours l’heure du coucher, cherchait à prolonger la soirée le plus qu’il pouvait. De temps en temps, il me prenait dans ses bras, me fixait avec attendrissement, et m’assurait qu’il reviendrait sans avoir éprouvé aucun accident. Enfin, cette charmante soirée finie, nous nous séparâmes tous, fort contents les uns des autres.
J’avais à peine dormi une heure, que je fus réveillée par le tambour99 ; je me jetai en bas de mon lit : excepté Dorothée et moi, personne ne s’était couché ; je courais les corridors en chemise ; madame Daingreville vint à ma rencontre, me força de rentrer dans mon appartement. Dorimond et Lavalé s’y rendirent dans le même instant ; la tristesse répandue sur tous leurs traits, ne m’avertit que trop de ce que je redoutais. Mon frère est parti, m’écriai-je, et sans me dire adieu ! On me laissa donner un libre cours à mes larmes. Le bon Durand vint partager ma douleur et pleurer avec moi. Rassurez-vous, me dit-il, mes fils m’ont juré de veiller sans cesse sur monsieur votre frère ; le destin n’accable pas toujours ; nous les verrons revenir frais et dispos : notre réunion sera un bonheur que le sort nous réserve.
Je ne recevais que des consolations et des marques d’amitié de tous ceux qui m’entouraient, mais j’étais inconsolable. Ma pauvre petite Célestine, que je n’avais pas vue depuis huit jours, criait sans cesse après sa maman. Un matin, Lavalé me l’amena. Allez embrasser votre belle maman, Célestine, et priez-la de se conserver pour tous ceux qui la chérissent. Les caresses de cette aimable enfant, ses larmes qui baignaient mes joues et se confondaient avec les miennes, apportèrent un baume consolateur dans mon âme ; je la pressai contre mon cœur, et lui promis de me consoler pour lui donner mes soins. Je repris mes occupations auprès de ma chère Célestine, et ma douleur se changea en une douce mélancolie. Dorothée m’était devenue nécessaire par l’attachement qu’elle portait à mon frère ; le bon M. Durand était mon confident le plus intime. Ses deux fils avaient promis de suivre Saint-Julien par tout, et de le garantir de tout leur pouvoir, des périls auxquels il allait être exposé.
M. Durand avait donné un de ses charretiers et une voiture pour conduire les effets de nos volontaires. Tous les jours, Dorothée et moi étions sur la route, pour attendre son retour. Quand nous étions bien fatiguées, nous envoyions Lavalé sur les hauteurs, à la découverte.
Un jour nous le vîmes accourir en grande hâte, il tenait à sa main un paquet qu’il nous montrait de loin. Nous allâmes à sa rencontre. Il avait atteint le charretier au bas de la montagne, lui avait pris ses lettres, et nous les apportait.
Je ne fis attention ni à la suscription, ni à l’écriture ; je rompis le cachet, et m’emparai d’une qui m’était adressée. Voici ce que mon frère me mandait.
SAINT-JULIEN,
À SA CHÈRE HORTENSE
Pardonne-moi, ma chère amie, si je suis parti sans te serrer dans mes bras. J’ai voulu nous éviter à tous deux les angoisses d’une séparation indispensable. Je suis arrivé en très bonne santé : l’exercice que j’ai pris à J… m’a été très utile. Je n’ai point été fatigué de la route ; les fils de M. Durand ont pour moi les plus grands égards, et cherchent à m’éviter toutes les fatigues de mon nouvel état ; c’est celui qui me convenait, mon amie, dès le jour de ma naissance. J’y fus destiné100. Console-toi, ma chère Hortense ; je n’ai de chagrin que de penser que tu es malheureuse de mon absence ; assure notre bonne tante de tout mon attachement ; parle souvent de moi avec Dorothée, que j’embrasse de tout mon cœur ; dis à nos amis Dorimond et Lavalé, que le souvenir de leur amitié me sera toujours cher ; aime-les pour moi et pour toi ; veille à la culture de mon jardin ; que je retrouve mes arbres embellis par les soins que tu leur donneras, et que je puisse dire en les revoyant : ma chère Hortense a veillé à leur conservation. Assure le bon M. Durand de toute mon estime ; embrasse notre chère Célestine : tu ne sais pas combien elle doit t’être chère. Adieu, ma bien-aimée ; donne-moi de tes nouvelles. Je t’écrirai toutes les fois que nous nous battrons, afin de bannir tes inquiétudes.
J’avais déjà parcouru cette lettre vingt fois, sans avoir pu déchiffrer un seul mot ; les larmes obscurcissaient mes yeux. Lavalé me pria de permettre qu’il en fit lecture ; je l’interrompais à chaque phrase, et la lui faisais recommencer. À l’article où Saint-Julien parlait de Dorothée, elle sanglota et se jeta dans mes bras. Pendant ce temps, le charretier était monté la côte ; nous l’accablâmes de questions. Il avait vu mon frère depuis nous ; il était un être précieux. Lavalé nous fit observer que M. Durand devait être impatient de recevoir des nouvelles de ses fils. Nous regagnâmes le village ; je remis à M. Durand ses lettres, et l’engageai à descendre chez nous. Je distribuai, dans ma route, les lettres des autres volontaires. Madame Daingreville pleurait de joie ; nous fîmes venir le charretier, à qui je recommençai toutes mes questions. M. Durand passa la soirée avec nous, la seule agréable depuis le départ de nos jeunes gens.
Je lisais la lettre de mon frère à toute minute : nos amis, qui avaient la complaisance de m’écouter, devaient la savoir par cœur. J’allai au lit de ma Célestine ; je la réveillai pour lui faire baiser la lettre de son petit papa : cette jolie enfant se prêtait à toutes mes folies. Je demandai à M. Durand s’il était instruit de l’espèce de mystère qui enveloppait Célestine. Oui, mademoiselle, me répondit-il, c’est moi qui l’ai appris à monsieur votre frère. Si vous voulez me faire l’honneur de venir demain déjeuner à la ferme, je vous en ferai part. Je le lui promis, et nous rejoignîmes la compagnie à qui je relus, pour la vingtième fois, ma lettre.
CHAPITRE X.
Le jour commençait à peine à paraître, que je fus réveiller Dorothée ; nous relûmes encore la lettre de mon frère, et nous prîmes la route de la ferme. Dans notre course, nous rencontrâmes plusieurs mères de volontaires, qui nous prièrent de leur lire les lettres qu’elles avaient reçues. Vous pensez bien que nous ne nous y refusâmes pas ; tous parlaient de mon frère, et tous en disaient du bien.
M. Durand avait bien pensé que mon impatience me rendrait matinale. Nous trouvâmes le déjeuner prêt. Je sommai M. Durand de sa promesse : il commença ainsi son récit.
Il y a environ deux ans qu’une femme d’une belle figure vint louer une petite maison tout près de cette ferme. Elle avait l’air accablé de chagrin, vivait très retirée, et ne s’occupait que d’élever avec soin un jeune enfant encore à la mamelle ; elle avait acheté une vache, et paraissait très empruntée pour la soigner. Une des filles de la basse-cour allait souvent lui aider, et nous rapportait qu’elle la trouvait toujours en pleurs ; je soupçonnai qu’elle pouvait avoir quelques besoins, et j’allai la voir. Je la trouvai en effet très affligée ; je cherchai à gagner sa confiance, et lui offris mes services. Elle me dit qu’elle avait été élevée chez une dame de qualité ; qu’à sa mort elle était restée dans la maison ; qu’elle avait eu le malheur de se laisser séduire par son maître ; qu’elle était restée chez lui jusqu’au moment où elle était devenue enceinte, qu’alors elle avait quitté l’hôtel ; que son maître lui avait fait douze cents livres de rente, reversibles sur sa fille, mais que la révolution étant venue, le père de sa fille avait émigré, que ses biens étaient séquestrés, et qu’elle se trouvait sans ressource ; que depuis un an elle vendait ses effets pour vivre ; qu’elle sentait bien que sa fin approchait ; que son plus mortel chagrin était de laisser sa fille sans ressource et sans appui dans un si bas âge. Elle me remit son contrat, et me pria de servir de protecteur à sa fille. Je le lui promis ; cette assurance a rendu ses derniers moments moins affreux. Peu de temps après elle me fit appeler, me remit sa fille, en me faisant jurer que je ne la mettrais dans aucun de ces asiles destinés aux enfants abandonnés. Je le lui jurai sur mon honneur : le lendemain elle expira. Vous eûtes la bonté de vous charger de cette infortunée : sans doute un sentiment plus fort que la pitié vous inspira cette bonne action. Lorsque la réquisition vint, votre douleur vous fit m’avouer qui vous étiez ; votre nom que vous me déclarâtes, fût un trait de lumière pour moi ; j’allai consulter le contrat, et je vis que c’était le même ; j’en fis part à monsieur votre frère, qui me recommanda de vous instruire de cet événement. Voici, mademoiselle, le contrat que monsieur votre père fit à la malheureuse Julie ; Célestine est sa fille naturelle, et conséquemment votre sœur.
Je ne pouvais revenir de mon étonnement ; je remerciai M. Durand des soins qu’il avait donnés à cette infortunée, et je pris de nouveau l’engagement de ne jamais abandonner ma petite Célestine.
Je fis promettre à Dorothée de servir, après moi, de mère à Célestine, s’il m’arrivait quelques accidents imprévus101. De retour chez moi, je fis part à madame Daingreville, et à nos amis, de la naissance de Célestine. Je formai mille projets sur son établissement ; j’allai la chercher dans son lit, et je lui renouvelai les promesses que j’avais faites à M. Durand, comme si elle eût compris ce que je lui disais ; cette pauvre enfant ne voyait que les caresses de sa petite maman, et me les rendait avec une gentillesse admirable. Si M. de Saint-Julien était ici, nous dit Lavalé, il concluerait que tous ces événements sont une suite du conseil qu’il donna à Blançai, d’aller trouver son oncle : madame Daingreville trouvait qu’il avait raison. Nous discourûmes longuement sur l’enchaînement des événements, et nous conclûmes qu’ils se tenaient tous, et se succédaient par une suite inévitable des premiers.
Nous passions les jours aussi agréablement que notre position le permettait. Je m’étais convaincue que l’oisiveté, dans laquelle j’avais passé les premiers moments de ma vie, ne m’avaient procuré que de l’ennui. Dorothée m’apprenait à broder, à toucher du forté-piano102 : Lavalé nous montrait la géographie et les mathématiques. Tous nos instants étaient employés utilement, et l’ennui était banni de notre société103. Nous commencions déjà à instruire Célestine, qui touchait à son premier lustre. Nous recevions souvent des lettres de mon frère : il nous assurait toujours qu’il était très content : la paix et la confiance régnaient au milieu de nous ; mais ce calme heureux touchait à son terme.
Lavalé et Dorimond faisaient souvent des voyages à Paris ; quand ils étaient obligés d’y séjourner quelques jours, ils ne manquaient pas de nous écrire. Il y en avait huit qu’ils étaient absents, et nous n’avions point entendu parler d’eux. Je fis part de mon inquiétude à M. Durand, qui ne me répondit rien de consolant, et qui était même très contraint, ce qui redoublait mes craintes. Je remarquai aussi que madame Daingreville avait un air de tristesse, qu’elle cherchait en vain à cacher. Je proposai à Dorothée d’aller à Paris : mes moindres désirs étaient des lois pour elle. J’envoyai prier M. Durand de me prêter sa carriole104 ; il vint lui-même s’informer quelle campagne je projetais. Je lui répondis que le silence de Dorimond et de Lavalé me tourmentait au point que je voulais me convaincre, par moi-même, du sujet qui l’occasionnait. M. Durand s’opposa à mon voyage, m’assura qu’il n’était rien arrivé à mes amis, mais qu’il se passait des choses dans Paris, qui ne me permettaient pas d’y aller ; que je serais compromise, et qu’il exigeait de moi que je restasse à J… Il m’offrit de partir sur-le-champ, et de revenir me donner des nouvelles aussi promptement qu’il le pourrait. Madame Daingreville se joignit à M. Durand, pour me dissuader de ce voyage. Je ne me rendrai à vos raisons, leur dis-je, que quand vous m’aurez démontré le danger que je cours. Alors M. Durand me fit lire un journal dans lequel était le décret qui enjoignait à tous les nobles de sortir de Paris105. M. Dorimond, me dit-il, a acheté une charge qui donnait la noblesse106 : il est sans doute compris dans cette mesure ; mais je vous promets de vous en instruire avant la fin du jour : il partit, en effet, sur-le-champ. Jamais les heures ne me parurent aussi longues. Nous étions à peine sortis de table, que j’engageai Dorothée d’aller sur la route à la rencontre de M. Durand. Nous marchions si rapidement, que nous avions déjà fait plus de deux lieues107, lorsque nous aperçûmes la carriole. M. Durand nous reconnut de loin, et pressa son cheval pour nous joindre ; quand il nous eut abordées, et que je ne vis, dans la voiture, que Dorimond, je demandai, avec effroi, où était Lavalé. M. Durand m’assura qu’il était resté pour veiller aux intérêts de Dorimond, et qu’il se réunirait à nous, au plus tard, le surlendemain. Nous montâmes dans la voiture, et M. Dorimond nous apprit que, forcé par le décret de quitter Paris, il avait passé deux jours entiers à la section pour attendre sa lettre de passe, et que sans les bons offices du président, il y serait encore, quoique le délai fatal expirât aujourd’hui. Il paraissait profondément affecté. Mais Lavalé, disais-je sans cesse, pourquoi reste-t-il ? Dorimond m’expliqua que cette mesure ayant eu une exécution si prompte, il lui aurait été impossible de mettre ordre à ses affaires, et que Lavalé s’en était chargé : toutes ces raisons ne me satisfaisaient pas.
Notre arrivée calma madame Daingreville, qui craignait que mon impatience ne m’eût engagée à aller jusqu’à Paris ; elle parut satisfaite de voir Dorimond, mais témoigna comme moi son inquiétude sur le compte de Lavalé.
Lorsque je consultais mes amis sur mes démarches, ils trouvaient toujours des raisons à opposer à mes désirs ; je me déterminai, sans rien dire à personne, à écrire à Lavalé, pour l’engager à venir sur-le-champ. Je fis partir le jardinier à la pointe du jour, et lui ordonnai de ne point revenir qu’il ne lui eût parlé, et qu’il n’en eût obtenu une réponse. J’avais défendu expressément qu’on dit à madame Daingreville que le jardinier était allé à Paris. Jamais je ne fus si active pour prévenir ma bonne tante ; chaque chose qu’elle paraissait désirer, j’allais la demander à la jardinière. Dorothée qui était la seule qui fût dans ma confidence, vint m’aider à cueillir les fruits ; personne ne se doutait de l’absence du jardinier. Il arriva comme nous étions à table : rien n’était plaisant comme l’embarras de sa fille, qui se cachait derrière madame Daingreville pour me faire signe. J’étais si peu accoutumée au mystère, que je me trahis à force de vouloir prendre des soins pour me cacher. Je me levai de table, et allai joindre mon commissionnaire108 qui me donna une lettre que je vous transcris.
LAVALÉ,
À Mademoiselle de Saint-Julien.
« Combien je vous dois de remerciements, mademoiselle, de votre aimable sollicitude ; ma vie entière ne suffira pas pour vous témoigner la reconnaissance que j’éprouve de vos bontés. Je suis le plus fortuné des hommes, puisque j’ai pu vous intéresser ; je vais hâter, le plus qu’il me sera possible, les affaires de notre ami, et je vole à vos pieds vous jurer un attachement à toute épreuve. Disposez de mon existence, elle vous appartient ; je ne la prise que depuis l’instant où vous avez daigné me montrer quelqu’intérêt ».
En lisant cette lettre, je sentais mon cœur palpiter de joie ; mais je me repentais des expressions de la mienne, qui avait pu m’attirer une semblable réponse. Je n’osais la montrer à madame Daingreville ! Vous ne lui apprendrez rien, me dit Dorothée, il est impossible qu’elle n’ait pas lu dans votre cœur. L’inquiétude que vous avez témoignée depuis l’arrivée de mon père, l’a sans doute éclairée sur vos sentiments, quoique vous cherchiez à vous tromper vous-même. Le mérite de Lavalé a vaincu votre froideur. Croyez-moi, n’affligez point madame Daingreville par un manque de confiance qui lui causerait beaucoup de chagrin. Je sentais bien que Dorothée avait raison, mais je ne voulais pas en convenir ; néanmoins je me déterminai à donner cette lettre à madame Daingreville qui, après l’avoir lue, me la rendit sans faire aucune réflexion. Elle se contenta de dire qu’elle était enchantée de savoir que Lavalé n’était point retenu pour des affaires qui pussent le compromettre.
CHAPITRE XI.
Combien les choses avaient changé dans notre asile ! Un mois auparavant, je le regardais comme le temple du bonheur, mais bientôt les soucis, les inquiétudes nous assaillirent. Je n’avais pas assez du tourment que me causait Lavalé, il fallait encore que mon inquiétude fut au comble sur le sort de mon frère. Depuis plus de quinze jours nous n’avions reçu de ses nouvelles ; tous les soirs j’allais à la poste attendre le courrier. Cette pauvre Dorothée me cachait la peine qu’elle éprouvait, afin de ne pas augmenter la mienne ; nous nous regardions tristement, et nos larmes étaient nos seuls discours.
Lavalé fut encore deux jours à Paris. Dieux ! combien je souffris, et quel plaisir j’éprouvai quand je le vis ouvrir la grille de notre jardin ! Mes yeux étaient malgré moi toujours fixés de ce côté ; c’était aussi par-là que nous allions à la rencontre du courrier. Je fus soulagée de la moitié de mes maux par la présence de Lavalé. Mon trouble décela la position de mon cœur ; il m’aborda avec un respect qui me le fit chérir davantage ; il me prit la main en tremblant, et je la lui laissai avec confiance. Nous descendîmes lentement ; Lavalé me soutenait, j’en avais grand besoin. Il me demanda s’il trouverait M. Durand ; qu’il était bien aise de lui témoigner toute sa gratitude, mais il me cachait le véritable motif.
Madame Daingreville accueillit avec bonté notre jeune ami ; Dorimond s’enquit de tout ce qu’il avait fait pour lui. M. Durand vint un moment après ; Lavalé et lui furent se promener au jardin. Je les suivais de loin avec la fidèle Dorothée ; j’épiais tous leurs gestes. Un secret pressentiment me disait de me préparer à de grands malheurs. Je vis M. Durand, après avoir écouté un moment Lavalé, mettre sa tête dans ses deux mains, avec les marques de la plus vive douleur. J’étais prête de les joindre109, Dorothée s’y opposa. Croyez, me dit-elle, que Lavalé vous dira la vérité aussitôt que vous la lui demanderez. Nous nous réunîmes tous dans le salon ; je cherchais à lire dans les yeux de Lavalé ; je ne rencontrais pas une seule fois ses regards, sans que son trouble n’augmentât ; j’aurais donné tout au monde pour lui parler en particulier, mais la crainte de confirmer les soupçons de madame Daingreville, me retint. J’étais sur les épines110, je ne savais comment lui parler ; je voyais cependant qu’un secret lui pesait sur le cœur, et qu’il aurait désiré le déposer dans le mien. Ne pouvant plus tenir à mon impatience, j’emmenai Dorothée dans ma chambre, et j’écrivis à Lavalé que, lorsque tout le monde serait retiré, ma compagne et moi désirerions l’entretenir. Je chargeai Dorothée de remettre ce billet à son cousin, et nous rejoignîmes la compagnie. Dorothée s’acquitta fort bien de sa commission : personne ne s’aperçut de rien. Lavalé sortit pour lire ce que sa cousine lui avait remis. Il rentra un moment après, je le regardai, il me fit signe qu’il se rendrait à mes ordres. Je fus plus tranquille ; il trouva le moyen de dire à Dorothée, que malgré lui, il me ferait attendre, ayant promis à madame Daingreville de se rendre dans son appartement après le souper. Nous attendîmes en effet près d’une heure ; enfin Lavalé frappa doucement à notre porte. Quand il entra, un froid mortel s’empara de mes sens ; il avait lui-même un air fort triste. Nous fûmes plus de dix minutes sans rompre le silence. Dorothée me tenait la main, et ses larmes coulaient en abondance. Cette excellente fille m’a dit depuis, qu’elle avait un pressentiment si fort de ce que j’allais apprendre, que le récit de son cousin ne l’avait point étonnée.
Je demandai à Lavalé le sujet de son entretien avec M. Durand. Vos moindres désirs sont des ordres pour moi, mademoiselle, me répondit-il ; mon intention était pourtant de chercher à vous cacher le malheur qui m’arrive, connaissant la bonté que vous avez de prendre quelque intérêt à mon sort. M. Dorimond a été dénoncé à sa section ; j’ai cru devoir prendre sa défense, et je suis parvenu à le justifier ; mais son dénonciateur voyant qu’il avait échoué contre les bonnes raisons que j’avais alléguées, a tourné toute sa haine contre moi ; il m’a dénoncé à mon tour, il a peint mes voyages, à la campagne, de marches contrerévolutionnaires, j’ai été épié ; on a su que je venais chez madame Daingreville : tout paraît suspect aux esprits soupçonneux. L’on a écrit à votre comité pour qu’il rendît compte de vos actions, des personnes que vous receviez, de votre moralité, et du genre de vos occupations. Heureusement, la lettre est tombée entre les mains de M. Durand, qui, sans perdre de temps, est venu lui-même rendre, de madame Daingreville, le meilleur témoignage ; a exalté la conduite de son neveu, qui avait équipé et défrayé111 vingt jeunes gens du village, lors de la réquisition, et était lui-même parti à leur tête. Que sa sœur (vous, mademoiselle) passait son temps à soulager les malheureux ; que tout récemment, vous aviez adopté une petite orpheline, dont vous aviez le plus grand soin ; enfin, il a détourné l’orage prêt à fondre sur votre tête112. Je suis resté seul en but à la calomnie. Il a été décidé que, comme allié de M. Dorimond, qui avait acheté sa noblesse, j’étais très suspect à la section ; et, qu’en conséquence, il fallait m’arrêter. Le président m’a fait avertir, et m’a envoyé un passeport pour rejoindre l’armée ; je l’ai fait viser à la municipalité, et j’ai pris la route de la Flandre113. J’ai fait vingt lieues de traverse pour venir vous faire mes adieux. Je ne coucherai même pas ici ; je tremble qu’on ne me soupçonne d’y être venu. M. Durand m’attend à la grille du jardin ; il me donne asile chez lui : j’aurai au moins, pendant quelques jours, le plaisir de vous voir, et de prendre vos ordres pour monsieur votre frère, mon intention étant de l’aller rejoindre.
Lavalé aurait pu parler encore une heure sans que je l’interrompisse ; j’avais le cœur gonflé de douleur, j’étais si oppressée que je ne pouvais pleurer. Lavalé me prit les mains et les baigna de larmes ; il fit un mouvement pour nous quitter, qui me tira de l’espèce de léthargie114 où son récit m’avait jeté. Encore un moment, m’écriai-je, laissez-moi rasseoir mes idées115. Je vous conjure de me laisser partir, reprit-il, une voix secrète me dit qu’en restant davantage, je vous compromettrais ; je vous jure que, dût-il m’en coûter la vie, je vous verrai demain. Il s’arracha d’auprès de nous, et fut rejoindre M. Durand, qui l’attendait patiemment depuis deux heures.
Lavalé avait raison de désirer de se retirer. À peine était-il rendu chez M. Durand, que le maire vint l’appeler ; il ne répondit pas sur-le-champ, afin de donner à Lavalé le temps de se cacher ; et à lui de se déshabiller, pour faire croire qu’il était couché. Il ouvrit enfin, et montra un visage très calme. Le maire était accompagné d’un membre du comité. Monsieur le procureur-syndic116, lui dit-il, voici un monsieur chargé de faire perquisition chez madame Daingreville, où l’on dit que M. Lavalé est caché. Monsieur a ordre de l’arrêter. Je crois, reprit M. Durand, que vos recherches seront vaines ; j’ai soupé chez madame Daingreville, je n’y ai point vu M. de Lavalé, qui y est venu fort peu depuis le départ de M. de Saint-Julien. Au surplus, monsieur, voyons vos ordres, je suis prêt à vous accompagner si vous êtes en règle. Monsieur les recherchant, exhiba ses ordres, et M. Durand se para de son écharpe pour venir faire perquisition chez nous.
À la voix de M. Durand, les portes s’ouvrirent sans difficulté ; un signe qu’il fit au jardinier, à qui il avait eu la précaution de recommander le secret, suffit pour lui imposer silence. Il posa une sentinelle117 à la porte de la maison, demanda une des domestiques, à qui il donna l’ordre d’aller réveiller madame Daingreville. Pendant ce temps, le membre du comité faisait l’inventaire de notre salon, et trouvait fort mauvais que des paysannes eussent des instruments. — C’est sans doute des ci-devant ? Je l’ignore, dit M. Durand, je ne le crois même pas. Ce que je sais, c’est qu’elles font beaucoup de bien dans la commune. — Mais n’ont-elles pas recueilli un nommé Dorimond ? — Oui, il est parent de madame Daingreville : rien ne me paraît plus naturel que de donner asile à un de ses parents, quand la loi lui ordonne de quitter son domicile. Pendant cette conversation, madame Daingreville s’habillait, et se disposait à descendre. Cécile (notre cuisinière) était venue me prévenir de ce qui se passait. Madame Daingreville aborda le membre du comité, avec un air fort tranquille. Je n’ai vu de ma vie quelqu’un vous en imposer comme notre tante, par un sang-froid inaltérable. Elle lui jura, sur son honneur, que M. de Lavalé n’était point chez elle ; elle exhiba même à l’instant une lettre qu’elle dit avoir reçue la veille, timbrée de Meaux118, dans laquelle il lui mandait qu’il allait rejoindre son ami Saint-Julien à l’armée. Néanmoins monsieur, ajouta-t-elle, je n’exige point que vous ajoutiez foi à ma déclaration, vous pouvez visiter partout où bon vous semblera. Elle sonna à l’instant, et donna l’ordre qu’on conduisit ces messieurs où ils désireraient ; puis s’adressant à M. Durand, elle le pria de se ressouvenir qu’elle avait chez elle deux jeunes parentes, et qu’elle priait qu’on entrât, dans leur appartement, avec précaution.
Ces messieurs firent la visite la plus exacte : lorsqu’ils entrèrent dans ma chambre, je tenais ma petite Célestine dans mes bras, qui semblait prévoir ses malheurs, par les cris perçants qu’elle jetait. Voilà, monsieur, dit le bon Durand au membre du comité, la petite orpheline que mademoiselle a adoptée. Je n’osai lever les yeux sur ce vilain homme ; l’air de ma chambre me paraissait étouffant depuis qu’il le respirait avec moi. Enfin, après quatre heures de recherches et d’interrogations à tous nos domestiques en particulier, nous en fûmes débarrassés. Ils firent beaucoup d’excuses à madame Daingreville, et lui dirent que, dans leurs recherches, ils voudraient toujours trouver des personnes aussi irréprochables.
CHAPITRE XII.
Le soleil était déjà sur les montagnes, que Dorothée et moi n’avions point encore pensé à prendre le moindre repos ; elle cherchait à me consoler, et elle-même avait besoin qu’on partageât ses douleurs : je ne savais que la moitié des maux qui m’accablaient. Un des fils de M. Durand avait écrit que Saint-Julien avait été blessé dans une bataille, qu’on ne savait ce qu’il était devenu ; qu’on soupçonnait qu’il était prisonnier ; que l’armée ayant reculé de plusieurs lieues, il était possible qu’il fût à l’hôpital, mais qu’on ignorait absolument son sort ainsi que celui de son frère aîné, qui n’avait point quitté M. de Saint-Julien. Cette bataille avait été très meurtrière ; plusieurs des enfants de la commune avaient péri : il priait qu’on n’en parlât point aux mères de ces infortunés. M. Durand avait fait part de ces tristes nouvelles à madame Daingreville, qui les avait communiquées à Lavalé, ce qui lui avait fait prendre la résolution d’aller à l’armée où servait mon frère, afin de savoir son sort ; s’il était blessé, lui prodiguer ses soins ; s’il était prisonnier, aller partager sa captivité. Dorothée ignorait la résolution de Lavalé ; mais elle savait que Saint-Julien était ou prisonnier, ou mort. Elle passait les jours et les nuits à pleurer ; et devant moi elle se contraignait, pour que j’ignorasse, aussi longtemps que cela se pourrait, ce malheureux événement.
La fatigue de la journée, la nuit orageuse que nous avions passée, les larmes amères que nous répandions, nous avaient affaissées119 ; le sommeil nous accablait. Nous nous jetâmes toutes habillées sur mon lit.
Dans la jeunesse, deux heures de repos réparent bien des fatigues. Lorsque nous nous réveillâmes, nous crûmes sortir d’un songe pénible ; il était midi. Célestine, qui était dans un petit lit près du mien, n’avait osé remuer, quoique l’heure de son déjeuner fût plus que passée ; quand elle me vit descendre du lit, elle me tendit ses petits bras, et me dit : maman, j’ai bien faim. Je me hâtai d’habiller mon petit ange et de la descendre. Je trouvai Dorimond et ma tante réunis, et qui paraissaient fort affligés ; ils voulurent prendre un air plus serein en me voyant ; mais je leur dis que la feinte était inutile ; que je savais tous nos malheurs, et que j’espérais avoir autant de courage qu’eux pour les supporter. Madame Daingreville me dit qu’il ne fallait pas nous faire les maux plus grands ; que l’incertitude, à la vérité, était affreuse, mais que Lavalé se disposant à aller retrouver Saint-Julien, et apprendre, à tel prix que ce fut, ce qu’il était devenu, à coup sûr, nous aurions sous peu des nouvelles satisfaisantes.
Je ne m’attendais à rien moins qu’à ce discours ; je tombai, sans connaissance, dans les bras de Dorothée, qui, me croyant morte, perçait l’air de ses cris. Je restai dans cet état d’immobilité plus de deux heures ; en rouvrant les yeux, je me vis entourée de Dorothée et de M. Durand. Madame Daingreville était dans un coin de l’appartement, dans un abattement difficile à peindre ; Dorimond, les bras croisés et l’air pensif, cherchait à recueillir mes soupirs pour s’assurer de mon existence. Un domestique, qui m’était inconnu, me soutenait ; ses larmes brûlantes tombaient sur mon sein. À son agitation, à la joie qu’il témoigna quand je repris mes sens, je reconnus Lavalé120 ; je tournai mes regards languissants sur lui et le remerciai, par un geste, de ses tendres soins. Madame Daingreville s’approcha de moi, me serra dans ses bras, et me demanda pardon d’avoir causé mon accident ; mais que je lui avais persuadé, par mon air résigné, que j’étais instruite : j’exigeai qu’on me rendît un compte exact de tout ce qu’on savait. M. Durand me donna la lettre de son fils ; Lavalé me jura que, sous peu, il me donnerait des nouvelles de son ami. Peu à peu je revins de ce spasme affreux. Dorothée, qui n’avait plus de raison de se contraindre avec moi, m’avoua que, depuis huit jours, elle avait souffert le martyre, quand je la menais à la poste chercher des lettres, qu’elle savait bien ne pas devoir arriver. Je la priai de dire à son cousin et à M. Durand, que je voulais absolument leur parler ce soir même dans mon appartement ; que s’il arrivait encore quelques visites, notre maison ayant plusieurs issues, il serait facile de se garantir.
Mon indisposition me fournit un prétexte de me retirer de bonne heure ; et tout le monde ayant besoin de repos, je me trouvai bientôt libre. J’attendais avec impatience l’arrivée de Lavalé et de M. Durand qui, dans la crainte de faire naître des soupçons, s’était retiré avant le souper, et avait emmené avec lui son prétendu domestique.
Dorothée me dit que c’était elle qui avait envoyé chercher M. Durand, quand elle m’avait vue sans connaissance, espérant qu’il amènerait avec lui son cousin, et que les soins d’un ami étaient précieux dans la circonstance où j’étais. Je la remerciai de son attention, et la prévins que j’allais mettre son attachement à une dure épreuve. Elle me regarda fixement, en me priant avec instance de lui dire quels étaient les nouveaux projets que j’avais formés. Quand nos amis seront arrivés, ma chère Dorothée, je vous instruirai de ma résolution. Mais sachez, lui dis-je, à l’avance, que dans l’exécution de mes projets, je n’oublierai pas ma fidèle compagne ; et que si le destin me favorise, j’espère lui prouver que mon bonheur sera sans cesse lié au sien. Je lui dis cela avec tant de tranquillité, que je lui inspirai de la confiance. Je me fis répéter encore tous les détails de la lettre que le jeune Durand avait écrite à son père, et la conjurai de me dire s’il en avait reçu de postérieures. Elle m’assura qu’elle l’ignorait absolument, et me promit, s’il en arrivait, de m’en instruire sur-le-champ.
Deux heures s’étaient déjà écoulées depuis que nous étions retirés dans notre appartement, et Lavalé ne venait pas. Mon imagination active commençait à travailler. Je me déterminai à aller à la ferme. Nous étions à la moitié du jardin, la nuit était d’un sombre effrayant, le mouvement des feuilles me faisait frissonner ; je crus entendre le bruit de la grille, je pris le bras de Dorothée et m’arrêtai court. Je cherchais à démêler dans l’ombre si je ne découvrirais pas quelque chose ; mon cœur palpitait, je n’osais respirer. Nos robes blanches nous firent remarquer de nos amis, qui, en effet, avaient ouvert la grille ; ils vinrent à nous, eurent la précaution de nous parler de loin afin de ne pas nous épouvanter. M. Durand proposa de rester au jardin, mais Lavalé lui fit observer que la nuit était fraîche, et que cela pourrait m’être contraire. Nous regagnâmes tous quatre mon appartement, occupés diversement du sujet qui nous réunissait.
CHAPITRE XIII.
J’ai toujours remarqué qu’un appareil121 imposant vous cause une espèce d’admiration, et vous force même, pour ainsi dire, à approuver, sans trop savoir pourquoi. C’est ainsi que les prêtres de tous les cultes en ont toujours usé pour tromper les faibles mortels122. Bien convaincue de cette vérité, j’avais éclairé mon cabinet avec des quinquets enveloppés de gaze123, ce qui donnait une teinte mélancolique. Mon secrétaire était ouvert ; les portraits de mon père et de mon frère étaient en évidence ; les lettres de Saint-Julien étaient éparses, celles du jeune Durand étaient enveloppées de crêpes124.
Je fis asseoir M. Durand et Lavalé en face de moi, et Dorothée à côté. Ensuite je leur dis que l’amitié avait aussi son culte125, et que je les en croyais les plus fidèles observateurs.
Jurez, leur dis-je à tous trois, en présence de ces deux portraits, que vous garderez éternellement le secret que je vais vous confier ; et écoutez-moi sans m’interrompre. Ils me le promirent. Après m’être recueillie, je commençai ainsi mon discours :
Vous n’ignorez pas qu’abandonnée de celui que la nature m’avait donné pour protecteur126, je me trouvai, pour ainsi dire, seule au milieu de l’univers. Le destin, qui semble quelquefois se ralentir, et me faire couler des jours moins amères, me fit rencontrer l’honnête Dorimond, dont les soins et l’amitié seront sans cesse présents à ma mémoire. Il me procura le bonheur de me réunir à mon frère, qui possédait seul alors toutes mes affections. Je vous ai connu, Lavalé, et tout mon être changea ; vous me fîtes abjurer les préjugés de mon enfance ; longtemps j’ai combattu avec l’orgueil, vous l’avez emporté sur lui127. L’honnête M. Durand m’a tout à fait dessillé les yeux : je me suis dit en abjurant mon erreur ! Les sentiments nobles et délicats ne sont pas tous concentrés dans la caste où je suis née ; je les ai rencontrés au dernier degré, dans les amis que le sort m’a donné. Mon frère, qui avait découvert mes sentiments, me fit promettre, avant de me quitter, que je ne formerais aucun engagement qu’en sa présence128 ; et que, si le sort des combats terminait sa carrière, je garderais mon serment jusqu’à ce que j’eusse la preuve incontestable qu’il n’existait plus. Un voile impénétrable enveloppe cette existence, et je suis liée par mon serment. L’attachement que je porte à mon frère, ou le respect que je dois à sa mémoire, si j’ai eu le malheur de le perdre, m’ont inspiré un projet, hardi sans doute, mais dont rien ne pourra me détourner. J’ai résolu de vous accompagner à l’armée, sous des habits d’homme129 ; je suis d’une très grande taille, et je ne paraîtrai pas ridicule dans ce déguisement. Je m’enrôlerai sous les drapeaux de la République130 ; mon frère expie les fautes de mon père131, je veux partager ses périls : je me mets sous votre protection, et je vous estime assez pour me livrer à vous sans crainte. Vous tenteriez vainement de me faire changer de résolution ; elle est irrévocable. Si vous vous refusiez à m’accompagner, je vous retirerais mon estime, et me hasarderais seule. Vous, M. Durand, si contre mon espoir je ne devais plus jouir du plaisir d’oublier avec vous, et dans le sein de l’amitié, les maux affreux qui nous accablent en ce moment, je vous lègue ma chère Dorothée et Célestine. Je laisse à celle-ci une mère dans mon amie ; elle m’a promis de lui en servir ; et je compte sur sa parole. Secondez ma chère Dorothée dans les consolations qu’elle donnera à madame Daingreville. Chargez-vous de faire exécuter mes volontés, si je ne dois plus vous revoir. Coopérez avec Lavalé à me procurer les habits nécessaires pour exécuter mon projet ; et croyez que ma reconnaissance sera aussi forte que l’attachement que je vous ai voué.
J’avais cessé de parler depuis plus de cinq minutes, et ils m’écoutaient encore. Dorothée me regardait avec un étonnement qui tenait de la stupeur ; Lavalé était combattu entre l’espérance et la crainte ; M. Durand se recueillait132 ; il rompit le premier le silence. Moi seul, mademoiselle, ai le droit de vous faire des observations ; M. de Lavalé doit se regarder comme le plus fortuné de tous les hommes. Mademoiselle Dorothée vous aime avec une tendresse qui ne lui permet jamais aucune objection. Mais moi, que vous daignez regarder comme votre ami, je dois vous faire envisager les inconvénients qui viendront en foule vous faire repentir de n’avoir écouté que votre passion.
Figurez-vous une femme au milieu d’un camp, reconnue et exposée aux insultes de gens sans mœurs et sans délicatesse.
— J’ai tout prévu ; je ne suis pas la première133 qui ait projeté et exécuté ce que j’entreprends.
— Et si le sort vous a ravi votre frère, et qu’il vienne encore vous frapper dans la personne de M. de Lavalé ?
— Je saurai les suivre, et vous me tenir parole. Je compte sur vous, Lavalé ; ayez le courage de me refuser134 ou d’accepter sur-le-champ. Il me prit la main, la posa sur son cœur ; il me dit : il est à vous jusqu’à son dernier battement ; disposez de moi, je ne m’appartiens plus : mon existence entière vous est dévouée.
Allons, M. Durand, dis-je à mon tour, les réflexions sont inutiles ; je compte autant sur vos services que sur votre discrétion. Nous allons nous quitter jusqu’à demain au soir. Peu de jours suffisent pour l’exécution de notre projet. Je ne puis vous aider ; tout doit être fait par vous ; ajoutez cette marque d’amitié à celle dont vous m’avez déjà comblée.
Un secret pressentiment me dit qu’un jour nous serons tous réunis, et que nous ne nous rappellerons des moments actuels que comme d’un songe pénible à qui un beau jour succède.
Je connaissais tant le bon M. Durand, que je lui arrachai son consentement. Ils nous quittèrent, et je leur promis d’aller le lendemain déjeuner à la ferme.
Il me semblait que tous mes maux étaient finis. Dorothée n’avait pas encore eu la force de proférer une parole ; je la serrai contre mon cœur, et lui fis entendre que ce n’était qu’une séparation momentanée ; que j’allais chercher son bien-aimé ; que c’était à moi que le destin avait réservé le plaisir de réunir tout ce qui nous était cher ; que je lui confiais le soin de me représenter auprès de nos amis, de servir de mère à ma Célestine ; que tous les embarras que j’allais lui causer obtiendraient leur récompense à notre retour. Enfin je fis si bien, que je parvins à consoler Dorothée, et à lui faire convenir que ma résolution était fort sage. Elle me pria de lui laisser le portrait de mon frère, et me fit promettre de lui écrire aussi souvent que je le pourrais. Je joignis mon portrait à celui de Saint-Julien ; elle les mit dans son sein135, et me jura qu’ils n’en sortiraient que quand nous serions réunis.
Le jour commençait à poindre quand nous nous couchâmes ; je dormis tranquillement ; l’avenir se présentant à moi sous des couleurs très satisfaisantes.
CHAPITRE XIV.
Je fus réveillée par un message de M. Durand, qui me priait de remettre notre visite à l’après-midi, étant forcé d’aller à Corbeil faire quelques emplettes. Il avait eu la précaution de m’envoyer sa lettre par son nouveau domestique ; les nôtres nous étaient entièrement dévoués, et nous pouvions, chose extrêmement rare alors, compter sur leur discrétion136.
Lavalé fut étonné du calme de Dorothée ; elle paraissait aussi tranquille que si elle eut dû être du voyage. Je lui expliquai cette espèce d’énigme, et il m’avoua que personne n’avait l’art comme moi de faire adopter son opinion. Nous causâmes longtemps de nos nouveaux projets ; il me dit que M. Durand était allé nous acheter tout ce qui nous était nécessaire, et qu’il croyait que nous serions en état de partir sous très peu de jours.
Pour éviter que Lavalé ne fût vu des personnes étrangères qui auraient pu venir, et qui se seraient aperçues qu’il n’était pas un domestique, nous passâmes la journée dans mon appartement ; sur la brune137, nous nous rendîmes chez M. Durand ; il n’était pas encore de retour. On apporta un paquet de lettres, timbrées de l’année. Je ne pus tenir à mon impatience. Après avoir pris et repris vingt fois ce paquet, je rompis le cachet ; il contenait plusieurs lettres des volontaires, et une du jeune Durand, qui nous mandait qu’il venait de recevoir des nouvelles de son frère ; qu’étant dans la division qui avait été repoussée, on les avait incorporés sur-le-champ dans un bataillon qui partait pour la Vendée138. Il témoignait son étonnement de n’avoir reçu aucune réponse à vingt lettres qu’ils avaient envoyées. Ce silence avait beaucoup inquiété Saint-Julien, et avait retardé sa guérison ; il était toujours à l’hôpital, et déterminé, aussitôt que ses forces le lui permettraient, à venir s’assurer par lui-même s’il n’était rien arrivé à ses amis.
Il me serait difficile de vous peindre la joie que me causa cette lettre. J’avais un point fixe ; je pouvais en très peu de temps me réunir à mon frère, sans courir les hasards d’une recherche inutile. Dorothée partageait mon bonheur, et se persuadait que notre retour serait très prochain. M. Durand revint peu de temps après ; je lui fis mes excuses d’avoir décacheté le paquet qui lui était adressé ; mais que mon impatience ne m’avait pas permis de réfléchir que je commettais une indiscrétion.
Il trouva mon pardon dans mon inquiétude, qui était fort naturelle. Il était comme nous très satisfait d’avoir des nouvelles de ses enfants. Il faut avouer, me dit-il, que le sort vous sert bien mieux que la raison.
M. Durand avait fait toutes les emplettes nécessaires pour notre voyage ; et il avait, de plus, amené avec lui un tailleur. J’envoyai Lavalé chercher un des habits de mon frère, que je revêtis, afin de faire prendre ma mesure. Je ne paraissais point empruntée dans ce déguisement ; et je vous assure que ma grande taille élancée était moins ridicule en homme qu’en femme.
Madame Daingreville et Dorimond vinrent nous rejoindre chez M. Durand, où nous passâmes le reste de la soirée. Les nouvelles que nous avions reçues de mon frère, nous avaient causé à tous de la joie ; et nous ne paraissions pas être les mêmes personnes qui, la veille, étaient accablées de chagrin.
Il s’écoula une semaine entière avant notre départ ; nous passions toutes les soirées ensemble, et le jour à faire nos préparatifs ; mais cela allait lentement, parce que nous étions obligés de nous cacher de Dorimond et de madame Daingreville. Enfin, le moment tant désiré arriva. Je vous avoue que j’aurais été beaucoup moins affectée, si j’eusse parti aussitôt que j’en formai le projet.
M. Durand, comme procureur de la commune, pouvait écrire sur les registres sans consulter le maire, qui, heureusement, se trouvait absent pour quelques jours ; il nous inscrivit tous deux comme deux volontaires allant à la Vendée, sous le nom de Bontems139 ; il n’y avait aucun inconvénient à prendre ce nom à J… où nous ne l’avions jamais porté. La prudence de M. Durand lui fit prendre une précaution, qui ne nous fut pas inutile dans la suite.
Il fit un écrit dans lequel il déclarait notre intention d’aller rejoindre Saint-Julien à l’armée de la Vendée. Il y mettait nos véritables noms, et les raisons qui nous forçaient à les cacher. Un des notables qui avait une grande confiance en lui, qui ne savait point lire, mais qui signait, accola son nom à côté des nôtres. Je suivis avec Dorothée la même marche qui avait été observée lors du départ de mon frère ; je la trompai sur le jour de notre séparation ; je redoutais sa douleur, qui aurait inquiété son père et ma tante, surtout dans un moment où rien ne paraissait devoir nous alarmer. Je lui écrivis deux lettres, une ostensible et une pour elle seule : je lui en laissai une pour madame Daingreville.
À deux heures du matin, M. Durand et Lavalé vinrent me prendre ; j’allai au lit de ma Célestine, que je pressai contre mon cœur, en la baignant de mes larmes. Je ne pus me refuser au plaisir d’aller voir ma bonne Dorothée, et je lui dis adieu tout bas, cherchant à m’excuser par cette démarche de l’avoir trompée.
J’ai su depuis que sa douleur avait été si forte à son réveil, quand elle aperçut les lettres que j’avais déposées sur son lit, que Dorimond et madame Daingreville avaient été convaincus qu’elle ignorait comme eux ma résolution. M. Durand nous accompagna jusqu’à Versailles140, où l’on nous distribua nos feuilles de route141. Nous ne quittâmes point ce respectable ami, sans répandre un torrent de larmes ; je lui renouvelai ma prière de consoler Dorothée, et ma bonne tante de veiller sur Célestine. N’oubliez pas, mon ami, lui dis-je, que mon être est partagé en deux, que j’en laisse la moitié à J… sous la garde de l’amitié.
CHAPITRE XV.
Pour bien se faire une idée de ma position, il faut se représenter une jeune personne de vingt ans, élevée dans la mollesse142, n’ayant jamais eu que des malheurs domestiques, et ne connaissant aucune des privations de la vie, portant le havre-sac143 sur le dos, entreprenant une route longue et dangereuse à pied, exposée à l’intempérie de la saison, mal couchée, plus mal nourrie, (car la disette pesait alors sur toute la France). Mais que ne fait point entreprendre l’amour ? Je cherchais à en imposer aux autres et à moi-même. Il était bien prouvé que j’avais eu le courage de supporter le départ de mon frère, et que celui de Lavalé m’avait seul déterminée à courir les champs, au risque de tout ce qui pouvait en arriver. J’étais avec lui, et je me persuadais qu’aucun accident ne pouvait m’atteindre.
Nous fîmes six lieues à notre première journée ; l’étape que nous reçûmes nous fût d’une grande ressource. Dans tous les villages où nous avions passé, il nous avait été impossible de nous procurer du pain.
Nous fûmes logés chez une vieille dévote144, qui s’en prenait à tous les militaires de ce qu’on ne disait plus la messe ; à peine avait-elle daigné nous donner un lit pour deux, composé d’un mauvais matelas et d’une paillasse, où toutes les souris de la maison avaient établi leur domicile ; un drap très petit et sale, une chaise de bois et une mauvaise table, composait tout notre mobilier145. Nous étions soldats, et nous ne pouvions exiger, comme les officiers, qu’on nous couchât seuls. Lavalé était désolé ; je pris mon parti plus vite que lui. Notre hôtesse ne nous avait point donné de lumière ; nous allâmes en acheter ; elle fit beaucoup de difficultés pour nous prêter un flambeau : elle prétendait que tous les soldats qu’elle avait eu le malheur de loger, l’avaient volée, et que sûrement, nous ne valions pas mieux que les autres. Nous fûmes obligés de nous servir de la bouteille que nous avions achetée, pour poser notre chandelle. Notre faiblesse faisait sa force ; nous ne jurions point, nous ne lui faisions aucune menace, et elle se vengeait sur nous de ce qu’elle avait éprouvé de ceux qui nous avaient précédés146.
Nous ôtâmes le matelas que Lavalé mit par terre ; il arrangea nos habits sur la paillasse, m’enveloppa de la couverture ; il se fit un oreiller de nos havre-sacs, et se coucha sur le matelas, qui n’avait pas quatre pouces d’épaisseur. Allons, mon ami, lui dis-je, à la guerre comme à la guerre. Tâchons de dormir, nous avons besoin de nous reposer pour recommencer demain notre route.
Le lendemain nous étions moulus ; mon lit m’avait plus fatiguée que la marche de la veille. Nous quittâmes notre hôtesse sans lui dire adieu, tant nous avions d’humeur contre elle.
Notre bonne étoile nous fit rencontrer, en sortant du bourg147, un charretier qui tenait la même route que nous. Nous le priâmes de nous recevoir dans sa voiture, bien entendu, en payant ; il y consentit. Au premier village, il nous fallut descendre, et déjeuner avec notre conducteur, qui nous fit donner, moyennant un écu de trois livres, tout ce dont nous eûmes besoin : après quoi nous remontâmes dans la charrette. J’achetai quelques bottes de paille sur lesquelles je me couchai : je dormis beaucoup mieux que sur la paillasse de la veille. Nous prîmes en passant notre pain d’étape, et nous continuâmes notre route, le voiturier allant à Rennes, et ayant consenti à nous y conduire. Mais le destin ne l’avait pas décidé ainsi. Nous fûmes rencontrés le lendemain par une vingtaine de chouans148, qui nous arrêtèrent et nous forcèrent de les suivre : la résistance eût été inutile. On nous mena dans un château, où nous fûmes reçus par des femmes, qui nous accablèrent d’injures, et nous menacèrent de nous faire souffrir tous les maux qu’elles pourraient imaginer. On commença par nous dépouiller de la tête au pied, et l’on nous donna une blouse de toile grise, qui pesait au moins vingt livres. On nous laissa nos assignats, et l’on me prit environ dix louis149 que j’avais sur moi. Je ne sais comment fit Lavalé, mais il trouva le moyen de soustraire, à leur rapacité, plus de cent louis dont il était porteur.
La position où se trouvent les individus change leur opinion, et les sentiments qui les animent, leur font blâmer ou approuver les événements. Nous avions été reçus par des domestiques, et leurs injures nous avaient peu affectés ; mais les mauvais traitements de la maîtresse de la maison nous furent très sensibles ; elle ordonna qu’on ne nous donnât que ce qu’il faudrait pour nous empêcher de mourir ; qu’on nous fît coucher dans l’écurie, et que personne ne communiquât avec nous jusqu’à ce que nous eussions consenti à nous joindre au parti qui protégeait la religion. Une espèce de prêtre hibernois150 vint nous catéchiser151. Ses discours remplis du fiel de la vengeance, m’inspirèrent une horreur que je ne pus m’empêcher de manifester. Alors ils nous menaça d’aller rendre compte de notre résistance à madame la marquise de Roucheterre. Madame de Roucheterre, m’écriai-je ! Est-elle la maîtresse ici ? Oui. La connaissez-vous ? De nom ; mais j’ai eu des liaisons avec des personnes de sa famille. Il nous quitta ; et un moment après vint nous reprendre pour nous conduire devant ma tante ; car madame de Roucheterre était la sœur de mon père. Je ne l’aurais pas su, que sa parfaite ressemblance avec M. de Chabry, me l’eût fait soupçonner ; elle nous reçut avec toute la hauteur d’une marquise bretonne, me questionna sur mes liaisons avec sa famille. Je lui répondis que j’avais été élevé dans le même collège que monsieur le vicomte de Chabry, que l’amitié la plus vive nous unissait, que nous ne nous étions quittés qu’au moment où, sous un nom supposé, il avait été obligé de partir pour l’armée ; que j’avais appris qu’il était à l’hôpital à Rennes, et que, malgré ma grande jeunesse, je m’étais déterminé à prendre l’habit de volontaire, pour venir apporter des secours et des consolations à mon ami ; que mon camarade, qui était aussi l’ami du vicomte, avait bien voulu m’accompagner dans ce pénible voyage ; que nous nous rendions en droiture à Rennes, lorsque nous avions été conduits dans ce château ; que si elle voulait se faire apporter les effets qu’on nous avait pris, elle y verrait un portrait de monsieur le marquis de Chabry, son frère, que je portais à son neveu, qui s’était engagé de le remettre à sa sœur, qui était à Londres152 avec monsieur le marquis, et que je n’avais entrepris le voyage que pour faciliter à mon ami les moyens de se réunir à son père et à sa sœur.
Qu’on vienne nous dire que le sang parle, et qu’un certain je ne sais quoi nous entraîne vers nos proches parents. Je vous jure qu’il n’en est rien. Madame de Roucheterre continua de me traiter malgré l’explication avec beaucoup de froideur. Elle se fit apporter le portrait de mon père, fut un peu émue, et me dit que puisque notre intention n’était point de nous joindre aux bleus153, elle consentait à ce que nous continuassions notre route ; qu’elle allait nous faire délivrer les passeports nécessaires pour que nous ne fussions point arrêtés par l’armée royale. On nous donna à chacun un pain de sarrasin154 ; mais on ne nous rendit aucuns de nos effets, pas même le portrait de mon père. On nous conduisit après hors du château, dont le pont levis se releva à l’instant.
Nous nous regardâmes, Lavalé et moi ; il avait l’air de me dire, vous l’avez voulu : je me repends d’y avoir consenti. Je compris parfaitement son silence, et je le rassurai : Une seule chose m’inquiète, lui dis-je, nous sommes sans argent. Il me fit un signe rassurant, et paraissait craindre de me parler, de peur d’être surpris ; nous traversâmes en hâte l’avenue du château ; et quand nous en fûmes sortis, nous dévorâmes notre pain de sarrasin : depuis la veille, nous n’avions pris aucune nourriture.
Convenez, mon ami, dis-je à Lavalé, que l’appétit est un excellent cuisinier ; si l’on m’eût offert ce pain, pendant que nous étions à J… je l’aurais rejeté loin de moi ; aujourd’hui, il me paraît délicieux.
Lavalé était étonné de mon courage et de ma sécurité.
J’ai tremblé de tout mon corps, me dit-il, quand nous avons paru devant madame de Roucheterre. J’avais une frayeur mortelle que vous ne vous compromissiez ; votre tante ne vous aurait jamais pardonné, si elle vous eût reconnu, et j’aurais été chassé impitoyablement. Je vous avoue, repris-je, qu’elle m’a révolté avec sa hauteur. Dites-moi, mon ami, j’étais donc aussi ridicule avant que les sentiments que vous m’avez inspirés m’eussent corrigée ? Il me baisa la main pour toute réponse. La nuit commençait à nous envelopper de son ombre, que nous n’avions encore rencontré que quelques paysans cachés derrière des haies, et qui semblaient attendre les passants. Enfin, nous aperçûmes une espèce de hameau ; nous nous hasardâmes d’y entrer. Le curé fût aussitôt averti de notre arrivée, et vint nous interroger.
À son aspect mélancolique, à son teint blafard, je le pris pour un énergumène155. Nous lui exhibâmes les passeports qu’on nous avait délivrés chez madame de Roucheterre ; il y mit sa signature, et nous souhaita de n’être pas rencontrés par les bleus.
Nous étions entrés chez une jeune femme qui, entendant les souhaits que son curé nous faisait, nous prodigua ses soins ; elle nous fit à souper, fut nous chercher de quoi nous rafraîchir en attendant. Elle nous dit qu’elle ne pouvait nous offrir de lit, parce que son mari dormait depuis trois jours, et qu’elle ne pouvait le déranger ; que demain il devait se réveiller, que son curé le lui avait assuré. Je demandai à voir ce dormeur ; j’en fus effrayée : la putréfaction156 commençait à se faire, et j’appris, non sans le plus grand étonnement, que ces bonnes gens étaient convaincus, lorsqu’ils allaient se battre pour leur prêtre, que s’ils étaient atteints d’un coup mortel, le curé avait le pouvoir de les ressusciter. Ces bons prêtres, me dit-elle, ne les rappellent pas tous à la vie ; il faut qu’il n’ait jamais murmuré contre la religion pour que le miracle s’opère. Mais je suis bien sûre que mon mari n’est qu’endormi ; monsieur le curé me l’a assuré, et j’ai donné mon dernier sac de farine pour l’armée royale, en reconnaissance du service que ce saint homme me rend de rappeler mon mari à la vie.
Cette malheureuse femme nous contait cela avec une bonne foi, qui m’inspirait pour elle infiniment de pitié. Dans toute autre circonstance, j’aurais cherché à la dissuader ; mais dans celle où nous nous trouvions, le silence était tout ce que nous avions à observer. Je me contentai intérieurement de gémir sur les opinions des hommes, qui pour satisfaire leur haine, se livrent à des passions qui déshonorent l’humanité. Je blâmais dans mon cœur les Vendéens ; j’abhorrais leurs prêtres, et je détestais ceux qui leur avait mis le poignard à la main.
Nous nous couchâmes dans la grange sur de la paille fraîche. Il y avait à peine une heure que nous y étions, qu’un grand bruit se fit entendre : nous y courûmes ; les cris des femmes et des enfants se confondaient ; nous voyions, à la lueur de la lune, le brillant des armes ; le tumulte était à son comble. Lavalé aperçut un uniforme national ; il me prit par la main, et nous nous jetâmes au milieu du peloton, en demandant protection. C’était en effet un détachement de gardes nationaux, qui venait délivrer plusieurs de leurs camarades, qui avaient été conduits dans ce hameau. On alla les chercher ; ils étaient enchaînés dans la cave du curé qui nous avait interrogés. On leur avait coupé les cheveux : le lendemain ils devaient être faits mourir157.
Le curé avait pris la fuite aussitôt qu’il avait été instruit de l’arrivée de la troupe ; c’était un parti fort sage, car la fureur était si grande du mauvais traitement qu’il avait fait aux volontaires, que je suis convaincue qu’il en aurait été puni bien cruellement.
Quand on eût délivré les prisonniers, on s’éloigna du hameau, et nous fûmes réunis au bataillon158. Un sergent vint nous prendre pour nous conduire devant le commandant ; jugez de notre joie et de notre étonnement, quand nous reconnûmes dans ce sergent le fils aîné de notre ami Durand. Nous nous jetâmes dans ses bras avant qu’il eût eu le temps de nous reconnaître ; je le priai de garder le secret sur mon sexe et sur mon nom : il me le promit, nous conduisit auprès du commandant, à qui il nous présenta comme ses amis.
CHAPITRE XVI.
Toutes les actions des hommes sont blâmées ou approuvées selon le point de vue d’où elles sont examinées, et tel dont on exalte la conduite, encourrait le blâme si l’on scrutait dans son cœur, et si l’on découvrait le motif qui le fait agir ; il en est bien peu, il n’en est point, peut-être, qu’un intérêt personnel n’excite.
Je faisais cette réflexion en écoutant les louanges que le commandant nous prodiguait de notre dévouement à la chose publique. Nous le priâmes de nous enrôler dans la compagnie de Durand. Il me fit observer que je n’étais pas d’une taille à être grenadier159, que je serais mieux dans les chasseurs160. Je le priai avec tant d’instances de ne pas me séparer de mes camarades, qu’il y consentit. Je me trouvai donc grenadier ; j’avais presque un air martial avec mon bonnet. Il fallut prendre son parti pour le coucher ; Lavalé me protesta qu’il aurait pour moi le respect et les égards qu’il me devait : j’en étais si convaincue, qu’il ne m’était pas venu à l’idée la moindre inquiétude.
Nous allions presque tous les jours à la découverte des chouans ; Durand et Lavalé me couvraient de leurs corps. Je me battais, je vous jure, aussi bien que mes camarades ; je n’étais pas très-hardie au sabre, mais j’ajustais un coup de fusil avec autant d’assurance que le plus vieux soldat.
Mon intention n’est pas de vous rendre compte des opérations militaires, et des combats qui furent livrés de part et d’autre : mon but est de satisfaire votre curiosité sur mes aventures.
Nous fûmes renforcés par l’armée de Mayence161, et nous regagnâmes du terrain. Les communications, qui avaient été interceptées, furent rétablies ; et je pus avoir des nouvelles de mon frère, qui était toujours à Rennes. Il fut question d’y envoyer un détachement ; Durand demanda à en être ; mais le commandant, ayant fait d’autres dispositions, ne voulut point y consentir ; il nous destina, au contraire, à faire l’attaque du château de Roucheterre162. Lavalé dit au capitaine, qu’ayant été fait prisonnier dans ce château, il y aurait peut-être du danger à nous exposer d’y retourner ; qu’à coup sûr, si nous étions pris et reconnus, on nous ferait un mauvais parti. Il ne faut pas vous laisser prendre, dit le commandant. Mais, répliqua Lavalé ; point de mais ; obéissez. Et il lui tourna le dos.
Un détachement qui nous avait précédé, nous avait aplani163 les plus grandes difficultés ; et nous entrâmes dans le château de Roucheterre sans coup férir164 : les maîtres en étaient délogés ; nous y établîmes le quartier-général. Le commandant qui avait pris le château était fort embarrassé ; il fallait qu’il dressât un procès-verbal165 des choses dont il s’était emparé. La nature l’avait doué d’un grand courage ; mais la fortune lui avait refusé les moyens de le seconder par une éducation soignée. Enfin, il ne savait point écrire.
Un penchant irrésistible, qui entraîne un sexe vers l’autre, l’avait fait me distinguer. Je lui avais inspiré une sorte de confiance ; il s’adressa à moi ; et me demanda si j’étais en état de lui rendre le service de dresser son procès-verbal. Je lui dis que je ferais mon possible pour m’en acquitter selon ses désirs. Il me dicta fort bien ; et à nous deux nous remplîmes parfaitement son objet.
Il présenta son compte au général, qui en fût très satisfait.
La loyauté est ordinairement compagne de la bravoure ; mon commandant ne voulut pas s’approprier les louanges qui m’appartenaient ; il eut la générosité de dire au général qu’il ne savait pas écrire ; que ce travail était fait par un jeune grenadier, qui annonçait autant d’intrépidité que de savoir. Le général me fit venir, me donna beaucoup d’éloges, et me promut au grade de caporal166 !
Dès le même jour, je me trouvai à la tête d’un petit détachement, qui fut à la découverte dans le hameau où nous avions été si bien accueillis, Lavalé et moi, par cette pauvre femme qui croyait à la résurrection de son mari. Cette malheureuse guerre ne ressemblait en rien aux autres ; on se battait pour s’assassiner, piller, et commettre tous les crimes qu’enfante le fanatisme de toutes les opinions167. La maison de notre hôtesse allait être livrée au pillage ; je volai à son secours ; je défendis, sous peine d’être fusillé à l’instant, de faire le moindre dommage aux habitants. Tâchez, dis-je à mes soldats, de les ramener à des sentiments plus doux ; tirez-les de l’erreur dans laquelle on les a plongés, et ne les aigrissez pas davantage par de mauvais traitements ; votre but est de remporter avec vous des vivres : laissez-moi faire ; et je vous réponds que vous serez satisfaits. J’entendais murmurer à mes oreilles ; et le mécontentement se manifestait d’une manière fort dangereuse pour moi ; la fermeté que je montrai, me tira de cet embarras. Si vous croyez mieux faire que moi, dis-je à un des plus mutins168, prenez le commandement ; je vous promets de vous obéir sans réflexion. Le premier devoir d’un soldat est la soumission à ses chefs ; commencez par le remplir, ce devoir ; et si j’ai manqué aux miens, et à ceux que commande impérativement l’humanité, il vous sera très facile de m’en faire punir.
Le langage de la raison a un empire absolu, même sur ceux qui la connaissent le moins ; je calmai mes camarades ; nous parcourûmes le hameau plus en amis qu’en ennemis. Ces malheureux venaient en foule nous offrir tout ce qu’ils possédaient. Nous allâmes chez le curé qui, trop criminel pour espérer de l’indulgence, avait fui ; nous trouvâmes chez lui des croix d’or, des claviers169, qu’il s’était fait donner par les femmes de ceux qu’il promettait de ressusciter. Je rendis à chacun leurs objets, et je distribuai à mes soldats l’argent que le curé possédait en assez grande quantité. Je fis un long discours aux habitants, pour leur démontrer combien ils étaient criminels dans leur révolte, et combien ils devaient abhorrer ceux qui les y avaient entraînés ; je leur promis un pardon absolu, s’ils voulaient rentrer dans le devoir ; un assentiment général fut la récompense de mes soins : un seul s’y opposa, et les blâma de se rendre aux sophismes d’un blanc bec. J’arrêtai à temps le discoureur ; je lui dis que, puisqu’il était le seul qui résistait aux mesures sages que je proposais, qu’il en serait la victime ; qu’il était de toute justice de punir celui qui alimentait la discorde, et j’ordonnai qu’on l’arrêtât à l’instant.
La conduite équitable que j’avais tenue vis-à-vis de ces malheureux, leur avait inspiré pour moi une sorte de respect ; aucun n’empêcha l’arrestation de cet homme : je laissai un piquet170 dans le hameau, et je retournai au quartier-général, chargé de provisions et des bénédictions des habitants.
Mes soldats fort contents du butin qu’ils avaient fait, étaient bien éloignés de porter des plaintes contre moi. Je rendis compte de mes démarches au commandant, qui m’embrassa, et me promit de me faire avancer. Il me présenta sur-le-champ au général, à qui je dis que je croyais qu’il était nécessaire d’envoyer plus de troupes dans le hameau, parce qu’il était un passage continuel des chouans, qui n’auraient pas beaucoup de difficultés à s’emparer de dix hommes de garde que j’y avais laissés. Il commanda sur-le-champ cent hommes : je lui conseillai de choisir un officier, qui eût des sentiments humains, ayant la preuve que la douceur que j’y avais mise, avait beaucoup contribué à faire rentrer les habitants dans leurs devoirs. Cette action me valut d’être sergent171.
CHAPITRE XVII.
Lavalé et Durand vinrent me féliciter sur les heureux résultats de ma journée. Ils me remîrent une lettre de mon frère, qui me témoignait toutes les craintes que le parti que j’avais entrepris pouvait lui suggérer. Il me conjurait de retourner auprès de madame Daingreville, querellait Lavalé d’avoir consenti à une pareille démarche, et se proposait de venir incessamment nous rejoindre, pour me déterminer à un prompt départ.
La vie que je menais ne me déplaisait pas du tout ; mon cœur était satisfait : Lavalé prévenait mes moindres désirs, m’épargnait, autant qu’il était en son pouvoir, les fatigues de mon état ; les nouvelles que je recevais de la santé de mon frère, me faisaient espérer sa prompte guérison ; le souvenir des amis que j’avais laissés à J… empoisonnait quelquefois mon bonheur ; mais l’amour heureux fait supporter, avec constance, les chagrins causés par l’amitié. Ce sentiment bien plus durable, préférable même, à tous égards, n’est pas apprécié, quand la passion nous gouverne ; et il fallait que la mienne fût bien forte pour m’avoir déterminée à quitter une vie agréable dans le sein d’amis qui me chérissaient, et que j’aimais avec ardeur, pour courir des hasards où je ne pouvais éprouver que malheurs et fatigues. Souvent je jetais un regard sévère sur ma conduite ; je me représentais le chagrin de madame Daingreville, de Dorimond, et de l’excellente Dorothée ; j’avais honte de moi-même. Un moment d’entretien avec Lavalé me faisait oublier le chagrin de mes amis, le ridicule de mes démarches : je ne pensais plus qu’au bonheur de le voir. Il faut convenir que nous aimons beaucoup mieux, et avec plus de constance que les hommes ; et qu’à-coup-sûr, le premier crime d’infidélité n’a pas été commis par une femme172.
J’avais oublié mon prisonnier ; je fus le soir le visiter, et m’informer si l’on avait eu soin de lui donner la nourriture nécessaire.
Quand je l’abordai, je le trouvai plongé dans la plus affreuse douleur ; je fus frappée du désespoir auquel il se livrait. Je cherchai à lui donner quelques consolations, et l’assurai que je ferais mon possible pour le faire comprendre dans l’amnistie173 que j’avais obtenue du général, pour le hameau où il avait été arrêté. II me répondit qu’il était reconnaissant de mes offres, mais que rien n’était capable de le consoler de se voir prisonnier dans un château où, peu de jours avant, il commandait en maître ; qu’il se trouvait en France par la trahison des Anglais, qui avaient refusé de le rembarquer174 ; exposé à être fusillé, et ignorant ce qu’était devenue la maîtresse de ce château, auquel il prenait le plus vif intérêt. — Vous la connaissez donc particulièrement, lui demandai-je. — Jeune homme, me répondit-il, votre conduite franche et généreuse m’a inspiré de la confiance ; et quoique nous défendions une cause différente, je puis, en blâmant votre conduite, vous avouer que celle que vous avez tenue, lorsque vous me fîtes arrêter, vous a acquis mon estime. Vous paraissez avoir reçu une éducation au-dessus de celle qu’a ordinairement un soldat ; et vous pourrez apprécier le chagrin qui doit m’accabler, quand vous saurez que, né dans une caste que vous avez proscrite, j’ai fui ma patrie et tout ce que j’avais de plus cher, pour servir la cause de ceux qui s’occupent peu de notre sort, et seraient prêts à nous abandonner si leur intérêt l’exigeait175. Je n’en suis pas moins proscrit dans mon pays ; je suis prisonnier et destiné à périr sur un échafaud, sans pouvoir être instruit du sort de ma famille ; la nommer, serait la livrer : j’attendrai mon sort avec résignation. Je vous demande une seule grâce, si vous pouvez me l’accorder sans vous compromettre. Lorsque vous vous êtes emparés de ce château, madame de Roucheterre a-t-elle été faite prisonnière ? Existe-t-elle encore ; savez-vous son sort ?
Pendant que le prisonnier me parlait, je l’avais reconnu. Un froid mortel m’avait saisi ; j’avais été obligée de m’asseoir sur la paille à côté de lui ; heureusement l’obscurité de sa prison l’avait empêché de s’apercevoir de mon trouble ; je le laissai se plaindre du sort, aussi longtemps qu’il le voulût, pour me donner celui de me remettre. Je commençai par le rassurer sur le compte de madame de Roucheterre ; je lui dis que je n’étais pas connue de lui, mais que je le connaissais parfaitement ; que s’il voulait accepter ma proposition, je le ferais conduire, sous un nom supposé, à quelques lieues de Paris, dans une maison où il serait accueilli, et même chéri ; qu’il y trouverait des gens de sa connaissance intime. Je lui nommai Dorimond, et lui offris de le faire causer avec Lavalé, le parent de Dorimond. Je lui peignis, en termes si énergiques, le plaisir qu’il aurait de se réunir à d’anciens amis, et de concevoir l’espérance de n’être plus étranger dans son pays : que je lui fis répandre des larmes ! Il me serra tendrement dans ses bras, et m’avoua qu’il jouissait du seul moment heureux qu’il eût éprouvé depuis son départ de France.
Je ne voulus pas laisser refroidir le sentiment qui l’affectait ; j’allai chercher Lavalé, à qui je confiai ce qui venait de se passer entre mon prisonnier et moi. Jugez, mon ami, lui dis-je, de ma douleur et de ma joie, quand j’ai reconnu mon père ; allez le voir, et le consoler. Gardez-vous de lui dire que c’est sa fille qui l’a mis dans les fers176. Je vais trouver le général ; je lui ferai un roman pour obtenir la liberté d’une tête si chère ; je ferai tant, auprès de lui, que j’obtiendrai un congé pour Durand, afin qu’il accompagne M. de Chabry à J… Allez, mon ami, je vous en conjure ; tâchez d’adoucir l’amertume de son sort : je ne veux revoir mon père que pour lui annoncer sa liberté, ou partager ses fers.
Lavalé croyait à peine ce qu’il entendait. Il connaissait particulièrement M. de Chabry ; il vola à sa prison ; et moi, je me rendis chez le général, à qui je fis demander audience, pour lui communiquer une affaire importante.
Notre général était affable, et doué d’une sensibilité peu commune dans un homme de guerre177. J’étais si émue, qu’il crut qu’il m’était arrivé quelque accident ; il me le demanda avec bonté. Je lui témoignai ma reconnaissance, de l’intérêt qu’il voulait bien prendre à moi, et je lui fabriquai l’histoire que voici :
« Vous savez, général, que j’ai été assez heureux pour conquérir tout un village, sans avoir la douleur d’en venir aux mains avec des Français. La défiance m’inspira de prendre un otage pour garant de leur sincérité. Un homme d’un certain âge me parut posséder la confiance de tous les habitants ; ce fut lui que je désignai. Il se livra à moi de la meilleure foi du monde. Je l’ai amené au quartier-général, et l’ai confié à la garde de mon ami Lavalé. J’ai voulu voir, le soir, l’homme qui avait consenti avec tant de générosité, à payer de sa tête l’infidélité de gens que le fanatisme peut encore égarer. Jugez de mon étonnement, quand j’ai reconnu dans ce vieillard, un ami intime de celui qui m’a servi de père, et garanti des plus grands périls ; un vieillard innocent des crimes auxquels ces malheureuses contrées sont en proie, qui ne s’est trouvé parmi les chouans que par l’infidélité de ses conducteurs ; qui a son fils dans l’armée : son fils que j’aime, et que je traite en frère, qui dans ce moment est à l’hôpital de Rennes, couvert de blessures, qui a équipé, à ses frais, vingt volontaires, dont Durand, le premier sergent de ma compagnie, en est un. Jugez, dis-je, de mon étonnement et de ma douleur, de le voir sans cesse sous le couteau de la vengeance. J’ai recours à votre humanité. Accordez à Durand (qui depuis deux ans combat sous les drapeaux de la République), un congé d’un mois, pour aller embrasser son père avant qu’il descende au tombeau ; permettez que Saint-Julien le père aille avec lui attendre, au milieu de ses amis, que la guérison de son fils lui permette de cueillir de nouveaux lauriers : je m’offre pour otage à sa place ».
Ce général m’écoutait avec une attention pleine d’intérêt. Jeune homme, me dit-il, j’aime à voir dans un soldat des sentiments aussi respectables ; je suis loin de blâmer votre demande : j’admire avec vous la générosité du père Saint-Julien ; j’estime trop son fils, que j’ai vu souvent combattre à mes côtés, pour ne pas venir à son secours. Allez à l’état-major faire expédier le congé de Durand et le passeport de M. de Saint-Julien ; et dites-lui de ma part que les vertus et les talents militaires de son fils, lui ont acquis l’estime de ses chefs et l’amitié de ses camarades : c’est la plus grande consolation qu’un père vertueux puisse recevoir.
Je rougissais de tromper le général ; mais la position de mon père le commandait impérativement. Je courus à l’état-major : j’endoctrinai Durand ; je lui remis cinquante louis pour faire sa route. Je voulus absolument qu’il prît la poste ; je frissonnais, quand je pensais qu’une heure de retard pouvait compromettre l’existence de mon père. J’allai le trouver ; je lui remis son passeport, à peine lui donnai-je le temps de me remercier. Il nous serra dans ses bras, sans pouvoir parler. Je le fis monter en voiture avec Durand, et ne respirai que quand je le vis hors du camp.
CHAPITRE XVIII178.
Combien une bonne action rend heureux, et que je plains ces cœurs froids qui n’éprouvent aucune jouissance du bonheur des autres ! Je partageais celui dont Durand allait jouir en revoyant son père. Je me faisais un délicieux plaisir de la réunion du mien avec madame Daingreville et Dorimond. Il allait être chez lui, accueilli et préservé de tout accident, par notre ami Durand. Un avenir heureux s’offrait à mon imagination ; j’étais d’une si grande joie, que je voulus la faire partager à tous les soldats de ma compagnie, en leur donnant à dîner. Une compagnie de grenadiers n’est pas toute composée d’hommes moraux. Je I’épprouvai ; cela me corrigea pour longtemps de mes expansions de joie : en voici le sujet.
Un homme de cinq pieds neuf pouces, avec des moustaches proportionnées à sa taille, se trouvait à table près de moi ; il avait essayé vainement de me faire partager son goût pour la débauche179. Souvent, je lui avais refusé d’aller boire avec lui ; il en avait pris beaucoup d’humeur, et voulait se venger de ce qu’il appelait ma fierté, en me faisant perdre la raison par des toasts réitérés.
Cet homme, avant d’être soldat, avait été au service de ci-devant grands-seigneurs, jouissant d’une réputation plus que dépravée : peut-être avait-il partagé leurs vices180 ; du moins, on l’en accusait ; et la prédilection très prononcée qu’il avait pour moi, ne tenait point du tout au soupçon que la délicatesse de mes traits pouvait faire naître181. Un jeune homme incorporé des pays méridionaux, ayant le cœur excellent, mais la tête un peu exaltée, le plaisanta sur son goût pour moi, dans des termes qui faisaient assez comprendre le degré d’estime qu’il lui portait. Loin de rougir, il avoua sa turpitude182, et n’entreprit pas de se justifier ; il poussa l’impudence183 jusqu’à vouloir nous persuader que nous avions tort de ne pas être de son avis.
J’avais été souvent exposée à des scènes très désagréables, pour une femme élevée dans les principes les plus sévères ; mais jamais je ne m’étais trouvée à une aussi scandaleuse. Elle fut poussée au point que Lavalé, ne pouvant plus se contenir, imposa silence à ce vilain homme, et invita tous nos camarades à le chasser de la compagnie. La bravoure est la fidèle compagne de l’honneur ; mais, à la honte de l’humanité, elle se trouve aussi accolée avec le vice. Le grenadier à moustaches trouva fort mauvais qu’on lui fît des leçons : pour toute réponse, il jeta son assiette à la tête de Lavalé, qui tomba à la renverse baigné dans son sang. Il tira en même temps son sabre, et offrit de tenir tête à tous ceux qui se présenteraient. Je donnais mes soins à Lavalé, qui était blessé dangereusement, et m’inquiétais fort peu de ce qui se passait. Le jeune Marseillais, qui avait le premier essayé de faire taire le perturbateur, le prit au collet184 et le força de sortir. Ils se battirent dans la cour. Le Marseillais, qui avait toute sa tête, eut bon marché de son adversaire, à qui la colère troublait la raison. En moins de trois minutes, il fût désarmé, et reçut une blessure mortelle.
Celle de Lavalé, pansée par son amie, ne tarda pas à être guérie.
L’on rendit compte au général de ce qui venait de se passer : il nous consigna tous au quartier, et me fit venir pour savoir les détails d’une scène, dont le résultat était la mort d’un homme, et la tête d’un autre à moitié fracassée.
Encore toute émue du danger qu’avait couru Lavalé, je peignis le mort sous des couleurs si défavorables, que la colère du général diminua de moitié. Il fit conduire le Marseillais en prison, seulement pour vingt-quatre heures, et nous défendit de sortir du quartier avant qu’il nous en eût donné l’ordre.
Les plus petites choses amènent de grands événements ! Un dîner donné à mes camarades pensa dissoudre le bataillon : l’envie et la jalousie se liguèrent pour perdre le général ; l’indiscipline en fut le motif : le désir d’avoir sa place le seul but.
Rentrée au quartier, je fis part à mes camarades des ordres du général. Le mécontentement se manifesta dans toute la compagnie : il fut au comble quand on vit venir quatre fusiliers pour conduire en prison le Marseillais ; tous s’opposèrent à ce qu’on l’arrêtât. Les quatre hommes furent désarmés et bafoués ; ils en rendirent compte au général, qui ordonna qu’on employât la force. Il fût décidé qu’on la repousserait ; et que le dernier grenadier expirerait avant qu’on saisît un de leurs camarades, qui n’avait fait que repousser l’injure, et punir un insolent de sa témérité. Je voulus leur faire entendre raison ; ma voix se perdait au milieu du bruit épouvantable qui se faisait ; je ne pris conseil que de moi : je forçai la sentinelle qui était à la porte du quartier, et je me rendis chez le général, dans l’espoir de l’apaiser. Projet fou ! espoir mal fondé ! Il ne voulut pas m’écouter, et ordonna qu’on me conduisît au cachot. J’y fus à l’instant renfermée ; le bruit s’en répandit sur-le-champ. Le petit grenadier est au cachot, fut répété de proche en proche, et parvint en moins de rien au quartier.
Lavalé écumait de colère ; il engagea tous nos camarades à rompre les arrêts et à venir me délivrer. L’éclair est moins rapide que ne le fut leur décision : ils s’arment tous, traversent le camp comme des fous, arrivent à la porte de mon cachot, se la font ouvrir, et me rendent à la liberté.
Lavalé me prend dans ses bras, et m’emporte en triomphe au quartier, escorté de toute ma compagnie.
L’idignation des chefs fut à son comble. Ils assemblèrent un conseil de guerre, qui décida que nous serions jugés185. On nomma des commissaires pour examiner cette affaire ; et tout devait nous faire croire que plusieurs d’entre nous paieraient de leur tête le mauvais exemple que nous avions donné à l’armée. On commença par séparer ceux qu’on accusait d’être les chefs de l’insurrection ; Lavalé fut mis aux fers. Je demandai, avec instance, de les partager ; pour première punition, on me le refusa, et je fus conduite dans une autre prison.
Le lendemain, quand on m’apporta mon pain et mon pot d’eau, je priai qu’on dît au général que j’avais des choses de la plus grande importance à lui communiquer. Un moment après, un aide de camp186 vint pour recevoir la déclaration que je voulais faire au général.
Mon cachot était obscur, et je ne pouvais discerner les objets ; néanmoins je reconnaissais le son de voix ; je cherchais à m’en ressouvenir : peut-être, me disais-je, est-ce une illusion ; mais, certainement, cette voix ne m’est pas inconnue. À ma première réponse, l’aide de camp m’interrompit pour me demander mon nom, et depuis quel temps j’étais au service. Je satisfis à sa demande. Au nom de tout ce que vous avez de plus cher, me dit-il, avouez-moi votre véritable nom ; ou si vous craignez de vous confier à moi, dites-moi seulement si vous connaissez Dorimond, Lavalé, madame Bontems, son neveu, sa nièce ? À mon tour, lui répondis-je, je vous supplie de me dire qui vous êtes, et comment vous savez que les noms que vous venez de prononcer sont gravés dans mon cœur !
Je ne me suis donc pas trompé, s’écria-t-il ; vous êtes Hortense de Chabry ? J’étais restée confondue, en entendant mon véritable nom : mon silence confirma son soupçon. Non, je ne me trompe point, reprit-il ; reposez-vous sur moi, je vous sauverai, je vous le jure. Il me quitta à l’instant, sans me dire qui il était, et me laissa dans une anxiété difficile à rendre.
CHAPITRE XIX.
Je passai le reste du jour dans une inquiétude mortelle ; le moindre bruit me faisait frissonner ; je me perdais dans mes réflexions. Au milieu de l’armée, mon nom et mon sexe connus ! Ce ne pouvait être le jeune Durand ; Dorothée m’avait mandé dans sa dernière lettre, qu’il avait eu une jambe emportée ; qu’il avait obtenu son congé, et était auprès de son père. Ce n’était pas Lavalé qui avait trahi mon secret : dans quelle intention, et pour quel motif ? Plus je cherchais à asseoir mes idées, moins j’en venais à bout.
Je tombai dans une espèce d’anéantissement. Je n’avais rien pris depuis la veille ; mon pain et mon pot d’eau étaient restés sans que j’y eusse touché ; j’étais épuisée, et mon imagination ardente, à force de travailler, avait usé les ressorts de ma pensée.
J’étais dans cet état de faiblesse, quand l’aide de camp reparut dans mon cachot ; il était accompagné d’un officier.
Grenadier, me dit-il, j’ai obtenu du général qu’on vous transférât dans une autre prison ; votre jeunesse et votre faible complexion ont plaidé en votre faveur : suivez-moi. J’entendais bien cette voix consolatrice, mais je ne pouvais faire aucun mouvement, mon épuisement était total. Il fut effrayé, appela le geôlier, et me fit sortir du cachot. L’air pur, quelques gouttes spiritueuses187 qu’on me fit avaler, me rendirent un peu de forces. Je jetai un regard reconnaissant et curieux sur mon bienfaiteur, je ne le reconnus point, mon inquiétude en augmenta. Je voyais bien que ses traits ne m’étaient pas tout à fait étrangers, mais jamais il n’avait été du nombre de mes amis ; et, conséquemment, ne pouvait savoir mon secret que par un hasard malheureux.
Je reprenais difficilement mes sens. L’aide de camp s’adressa à l’officier qui l’accompagnait, et le pria d’aller rendre compte au général que le jeune grenadier était dans un état qui demandait de prompts secours ; dites-lui, camarade, que je le prie de permettre qu’il soit conduit à l’hôpital ; l’humanité doit marcher à côté de la justice.
L’officier nous quitta pour remplir sa commission. L’aide de camp, se voyant seul avec moi, me dit : Mademoiselle, j’ai vu avec plaisir que vous ne m’aviez pas reconnu ; la moindre expansion de votre part vous eut perdue, et m’aurait ravi le bonheur de vous servir. Je suis Blançai188 qui, par mon étourderie, accélérai votre départ de chez mon oncle. J’ai quitté il y a deux jours votre frère, qui m’a instruit de tous vos secrets. Le sort m’a beaucoup mieux servi que vous : je suis dans un grade où je dois vous commander, mais je n’exécuterai que vos ordres. Je bénis le destin qui m’a conduit auprès du général ; il est furieux contre votre compagnie, et veut absolument qu’on fasse un exemple terrible de votre insubordination ; Lavalé, surtout, excite sa colère. Beaucoup de vos camarades, soit faiblesse ou lâcheté, l’ont accusé de les avoir, pour ainsi dire, forcés à se révolter contre l’autorité du général ; sans les précautions que j’ai prises, son procès eût été terminé aujourd’hui ; et je ne doute pas que son sort n’eût été affreux189. Je me suis privé du plaisir d’aller lui donner les consolations de l’amitié, pour le servir plus efficacement ; j’ai vu ses juges, je leur ai fait entendre que vous et Lavalé aviez des révélations précieuses à faire pour le salut de l’armée ; mais qu’ayant appris que le représentant Philippeaux190 arrivait cette nuit, vous aviez juré tous deux de mourir avec votre secret, si vous ne pouviez le confier au vertueux Philippeaux. J’ai trouvé le moyen de réunir ce Marseillais avec Lavalé, je lui ai promis de le sauver s’il voulait me servir ; je lui ai remis une lettre pour Lavalé, dans laquelle je lui ai enjoint de dire à ses juges ce que je leur ai dit moi-même : il a parfaitement rempli mes vues191, et votre procès est suspendu jusqu’à l’arrivée de Philippeaux.
Il est des êtres privilégiés qui inspirent la confiance au premier abord. Les vertus qu’ils professent sont un sûr garant qu’ils n’abuseront pas des aveux qu’on peut leur faire. Philippeaux est du petit nombre de ces êtres192. Je vous conseille donc, mademoiselle, d’aller le trouver, de lui confier votre nom, votre sexe, les raisons qui vous ont déterminée à vous travestir : l’excuse de Lavalé se trouve dans cet aveu. Il était juste, il était dans la nature qu’il risquât tout pour vous tirer des fers ; je ne vois que ce moyen de vous sauver tous deux.
Je ne trouvais pas de termes assez expressifs pour témoigner à Blançai toute ma reconnaissance ; je lui promis de suivre ponctuellement ses avis, je le priai de ne pas faire savoir à mon frère l’embarras dans lequel nous nous trouvions.
L’officier revint avec l’ordre de me faire transférer à l’hôpital ; je fus recommandée par Blançai, et parfaitement traitée.
Trois jours s’écoulèrent encore sans que ce représentant arrivât ; l’inquiétude que je témoignais de ce retard confirma le récit de Blançai ; je ne le voyais pas, mais il nous servait avec une chaleur et un zèle qui prouvaient incontestablement l’attachement qu’il nous portait.
Enfin l’arrivée de Philippeaux mit la joie et le désordre dans mon âme ; je craignais et je désirais ardemment de l’entretenir. Blançai me fit dire que le représentant m’entendrait le lendemain. Je passai la nuit à m’étudier ; la renommée de Philippeaux ne me laissait pas la moindre pensée de lui trahir la vérité ; il fallait tout lui avouer, même ma faiblesse pour Lavalé. Si ma conduite, me disais-je, est improuvée de cet homme estimable, ma franchise réclamera son indulgence ; d’ailleurs, le sentiment que m’inspirait Lavalé était trop pur, trop dégagé de tout ce qui tient à la faiblesse humaine, pour que je ne crusse pas qu’il y avait une sorte de gloire à en faire l’aveu. Je m’endormis dans cette douce idée, et le lendemain je parus devant le représentant avec une confiance proportionnée à sa réputation.
Blançai était avec lui lorsqu’on m’annonça : il se leva, me salua avec respect, et me dit : je vous ai, mademoiselle, aplani les premières difficultés. Le représentant m’a promis de vous écouter avec bienveillance : après cet avis, Blançai se retira.
Une physionomie où se peignait la candeur193 et la bonté, prévenait en faveur de Philippeaux ; son aménité194 et son extrême honnêteté achevaient de vous confirmer dans la bonne opinion que son abord vous inspirait.
J’entrai sur-le-champ en matière, et lui rendis compte de tout ce qui m’était arrivé depuis ma sortie de l’abbaye, sans omettre la moindre circonstance.
Quand j’eus fini mon récit, il me dit fort obligeamment, vous oubliez, mademoiselle, que par votre douceur et vos discours persuasifs, vous avez conquis à la République des amis. J’ai passé hier dans un village où tous les habitants sont les plus zélés défenseurs de la liberté et de la justice ; surpris de trouver au milieu d’un pays insurgé des gens aussi fidèles, j’en ai témoigné mon étonnement ; ils m’ont répondu qu’ils avaient donné leur parole au plus petit grenadier de l’armée, et qu’ils n’y manqueraient pas, quand ils devraient tous mourir. Blançai m’a dit que c’était vous qui aviez opéré ce miracle.
J’admirai la générosité de Philippeaux qui oubliait mes fautes, pour me louer d’une bonne action.
Vous pouvez, continua-t-il, vous reposer sur moi ; je vous donne ma parole, que vous et vos camarades en serez quittes pour la peur ; néanmoins, je vous engage à vous retirer du service, c’est un métier qui ne convient ni à votre sexe, ni à votre manière de penser. Au milieu d’un camp, vous avez dû être souvent exposée à rougir ; la dernière scène qui met votre ami si fort en danger, en est une preuve incontestable. Si vous étiez officier, vous éviteriez ces inconvénients ; mais dans l’ordre des choses actuelles, vous ne pouvez l’espérer que par une action d’éclat ; et cette action vous exposerait peut-être à divulguer votre sexe : la jalousie du nôtre ne permettrait pas qu’on vous sût gré de votre dévouement ; on ne voudrait voir que l’amante pour oublier l’héroïne195. Demain je vous rendrai compte de mes démarches. Je quittai Philippeaux aussi satisfaite que je l’étais le jour fortuné où je délivrai mon père.
CHAPITRE XX.
Blançai m’avait devancée à l’hôpital, sous le prétexte de visiter les malades. Aussitôt qu’il m’aperçut, il me fixa avec inquiétude ; ma physionomie rayonnante de joie, le rassura ; il continua son inspection, et évita de me parler.
Dès le même jour, l’honnête Philippeaux vint à l’hôpital, rien n’échappait à son œil vigilant ; il entrait dans les plus petits détails, écoutait avec attention toutes les demandes qu’on lui faisait. Il délivra des congés à des blessés, et y joignit des gratifications196 pour rejoindre leurs foyers. Quand il fut près de moi, il m’adressa la parole : Grenadier, me dit-il, vous n’avez ni la taille, ni l’âge requis pour servir : votre dévouement est louable, mais la République n’exige pas des sacrifices aussi grands que ceux que vous lui faites : voici votre congé, vous êtes libre de vous retirer ; que le sort de vos camarades ne vous inquiète pas, les soldats de la liberté ne doivent pas être traités comme les esclaves des rois, ils sont libres aussi : au nom du peuple français, je leur fais grâce. Soldats, dit-il en se retournant vers ceux qui l’entouraient, que cet acte de clémence ne vous engage pas à l’insubordination : vous êtes les soldats d’une République : les lois qui vous ordonnent la soumission à vos chefs sont approuvées par vous, c’est un crime de les transgresser ; une première faute peut être oubliée ; une seconde serait impardonnable. Général, je vous prie de rendre votre estime à ces braves soldats ; ils seront, j’en suis garant, empressés à réparer une faute que la circonstance a provoquée, elle nous maîtrise quelquefois.
Philippeaux sortit de l’hôpital accompagné des bénédictions de tous ceux qui se pressaient sur son passage, pour avoir le plaisir de contempler un homme aussi juste.
La noire jalousie, armée des poignards de la haine que l’homme vicieux conçoit pour la vertu, fit un crime à cet être sensible et de sa clémence, et de sa franchise. Il est tombé sous les coups de la calomnie et de la méchanceté, mais ses accusateurs sont en exécration197 quand sa mémoire est révérée198. Le souvenir de ses bienfaits est écrit en lettres de feu dans les cœurs d’un millier d’individus qu’il a arrachés à la mort et à l’infamie.
Pardonnez-moi cette petite digression, la reconnaissance m’impose la loi bien douce pour moi, de faire connaître ce que cet homme vertueux a fait de bien. Le faible hommage que je lui rends est au-dessous de son mérite ; il faudrait une âme comme la sienne pour le bien peindre199.
Dès le même soir je fus réunie à Lavalé ; notre joie était égale au bonheur dont nous jouissions, honneur d’autant mieux senti, que nous avions été au moment le plus périlleux, et que nous en sortions par une espèce de miracle ! Blançai vint nous rejoindre, il se précipita dans les bras de Lavalé, et me témoigna combien il était satisfait de l’issue de notre affaire. C’est à vous seul, lui dis-je, que nous en sommes redevables : un bon ami est le plus grand trésor que le destin puisse donner.
Nous allâmes remercier Philippeaux qui, d’après ce que Blançai lui avait dit, nous conseilla d’attendre un temps plus opportun pour nous réunir à nos amis ; votre frère est beaucoup plus tranquille à l’armée, que près de la capitale ; votre père y vit ignoré, cela seul fait sa sûreté. Je vous en conjure par l’intérêt que vous m’avez inspiré, restez dans ces parages, il viendra un temps où la clémence fera place à la férocité, vous serez ici au milieu des factions et à l’abri de toutes.
Le discours que Philippeaux nous avait tenu, avec beaucoup d’émotion, m’inspira une tristesse qui empoisonna la joie que ces bons offices m’avait causée. Nous le quittâmes en le priant d’être convaincu que notre reconnaissance serait éternelle.
Blançai nous retint à souper. Je lui demandai si quelques raisons particulières avaient engagé le représentant à nous donner le conseil de fuir les environs de Paris. Oui, nous répondit-il, pendant que le malheur vous accablait, je me serais cru coupable de l’augmenter par le récit de ce qui se passe à J… Dorimond et madame Daingreville sont en arrestation, votre père est sous la garde de M. Durand, qui a trompé tous les argus200, en soutenant que M. de Chabry s’appelle Saint-Julien, d’après le passeport que vous aviez obtenu pour monsieur votre frère ; et d’après l’attestation de Durand le fils, M. de Chabry a obtenu une carte de citoyen. Il a eu le soin de faire venir un certificat de l’état-major, qui constate que Saint-Julien, son fils unique, sert sous les drapeaux de la République ; qu’il est couvert de blessures ; qu’il n’a d’autre fortune que la gloire de son fils et la bienfaisance de ses amis. À force de peines et de soins, M. Durand est parvenu à conserver la liberté à M. de Chabry et à Dorothée, sous sa propre responsabilité ; j’ai su tout cela par Durand le fils, dont le congé est expiré, et qui a rejoint sa compagnie ; il voulait vous aller trouver dans votre prison, mais j’ai bien pensé que vous lui feriez cent questions sur le compte de vos amis, et que son embarras pour répondre vous ferait naître des soupçons que votre position aurait encore rendus plus affreux. J’ai exigé de Durand qu’il ne vous vît que quand vous auriez l’âme assez tranquille, pour écouter avec courage le détail de ce nouveau malheur.
Je priai Blançai de faire venir Durand, qui n’attendait que l’instant où nous serions prévenus pour venir nous embrasser. Cet intéressant jeune homme mêla ses larmes aux nôtres, et nous pria, de la part de son père, de nous tranquilliser, nous dit qu’il veillait sur tout ; il nous remit deux cent louis que M. Durand nous envoyait : ce respectable homme faisait valoir notre bien comme le sien propre. Il avait eu le soin de s’emparer des bijoux, et dans les besoins urgents il en vendait, mais avec une discrétion qui, dans le moment où je vous écris, fait le sujet de notre étonnement, de voir qu’avec si peu, il ait fait autant. Durand me remit une lettre de Dorothée ; un petit billet de ma Célestine y était joint : Vous verrez, mon amie, me disait cette excellente fille, que je n’ai rien négligé pour l’éducation de votre aimable enfant.
Nous résolûmes de prier Philippeaux de nous donner un passeport pour aller à Rennes voir mon frère. Durand était commandé pour un détachement qui se rendait aussi dans cette ville ; nous nous arrangeâmes pour partir avec eux. Blançai nous promit de venir nous rejoindre aussitôt qu’il aurait rempli sa mission auprès du général et du représentant. Philippeaux nous donna le passeport que nous demandions, et nous partîmes le lendemain pour Rennes.
CHAPITRE XXI.
Au lever de l’aurore nous nous mîmes en route : mon cœur palpitait de joie en pensant que j’allais revoir mon frère ; mais je vous peindrais difficilement le bonheur et la satisfaction que j’éprouvai quand nous traversâmes le hameau où j’avais arrêté mon père. Les habitants vinrent au-devant de nous avec l’expression du plaisir : un d’eux demanda des nouvelles du petit grenadier. Durand me prit par la main, et me présenta à ces bonnes gens, qui firent éclater une joie indicible201 ; je passais successivement dans les bras des uns des autres, ils me dirent qu’ils suivaient exactement mes conseils, qu’ils étaient heureux, et n’oublieraient jamais qu’ils me devaient leur bonheur. La jeune veuve qui nous avait si bien accueillis, vint aussi jouir, disait-elle, du plaisir de me voir ; elle tenait un jeune enfant, nouveau né, dans ses bras ; elle m’apprit qu’elle avait épousé le maire, et que son sort était digne d’envie. Je souhaite, ajouta-t-elle, que la paix vienne bientôt nous rendre la joie et le bonheur, que vous preniez une femme, et qu’elle vous donne des enfants aussi vertueux que vous. Durand et Lavalé me regardèrent en souriant. Je remerciai ces bonnes gens des marques d’amitié qu’ils me prodiguaient, le détachement s’en trouva fort bien. On lui fit faire halte, et l’on nous apporta tout ce qu’on put trouver de meilleur.
Le soir, nous quittâmes le village comblés de bénédictions. Je leur promis que je les reverrais bientôt. En effet j’avais conçu le projet, en recevant leurs témoignages d’amitié, de venir au milieu d’eux passer le temps d’orage qui grondait sur la tête de mes amis. Heureuse inspiration ! puisque c’est dans cet asile de paix où j’ai retrouvé l’amie de mon cœur202, qui, obligée comme moi de fuir la persécution, y vint sous la livrée203 de l’indigence204 cacher le meilleur cœur et l’âme la plus candide qui existe. Les quatre mois que j’ai passés avec vous, au milieu de ces vertueux villageois, ont été les seuls parfaitement heureux, jusqu’au jour de ma réunion avec tout ce que j’ai de plus cher.
Deux jours après nous arrivâmes à Rennes. Dans les différents pays que j’ai parcourus, j’ai bien rencontré des gens divisés d’opinion, et se vouant une haine implacable en raison de tel ou tel vœu, émis souvent plutôt par orgueil que par sentiment ; mais je n’en ai jamais trouvé qui se détestassent plus cordialement que les habitants de Rennes. Dans tous les quartiers que vous visitiez, il fallait changer de langage, de costume, de manière de vous présenter, sous peine d’être honnis205.
Nous entrâmes dans la ville à la nuit tombante ; les portes en furent fermées, parce que Rennes était en état de siège206 ; et nous fûmes forcés de remettre notre visite à mon frère, au lendemain matin ; l’hôpital étant hors de la ville, dans un des faubourgs.
Lavalé fut porter une lettre à un aide de camp ami de Blançai, dans laquelle il le priait d’avoir pour nous les égards que nos malheurs exigeaient de tout être sensible. Je restai avec notre ami Durand pour attendre Lavalé. Un instant après il revint avec l’aide de camp, qui nous invita de venir passer la soirée chez une dame où il logeait, et qui recevait fort bonne compagnie.
Depuis si longtemps, repris-je, que je ne me suis trouvée en société, j’y serai fort gauche : dispensez-m’en, je vous prie.
Il nous pria avec tant d’instances, que nous nous rendîmes à son invitation.
Nous trouvâmes, ainsi qu’il nous l’avait annoncé, un cercle nombreux ; la maîtresse de la maison était affable207, et faisait parfaitement les honneurs de chez elle.
Depuis l’instant où la révolution a commencé, il est rare de voir plusieurs individus réunis sans qu’ils parlent des nouvelles du jour, de celles anciennes, des résultats qu’elles ont amenés, et des probabilités pour l’avenir. Il était question alors de pamphlets208 qu’on avait colportés dans la ville : on en recherchait les auteurs.
Un monsieur de la société, trouvait fort mauvais qu’on arrêtât l’essor de la pensée. À quoi sert donc, disait-il, la liberté de la presse, si nous ne pouvons, comme autrefois, écrire que sur tel et tel sujet.
Permettez-moi, monsieur, repris-je, de vous faire une observation. Une liberté illimitée deviendrait fort dangereuse et dégénérerait en licence ; un gouvernement qui permettrait tous les sarcasmes209, que l’imagination pourrait répandre contre lui, montrerait ou une trop grande faiblesse, ou serait assuré de sa force. Le régime sous lequel nous vivons n’est point encore assez affermi, pour que son silence ne lui devienne pas nuisible. Il faut donc qu’il sévisse contre ceux qui, comptant sur sa faiblesse, croient pouvoir l’insulter impunément, et provoquer sa ruine. Je suis loin de blâmer les opinions, je les respecte même ; il ne dépend pas de nous d’être organisés de telle ou telle manière. J’estime un franc républicain, je ne méprise point un royaliste paisible ; mais j’ai en horreur celui qui allume dans la société les torches de la discorde, qui arme le frère contre le frère : nous en avons la preuve en ce moment ; de pareils êtres font le malheur de leurs contemporains. Ne voyons-nous pas autour de nous des Français, armés contre des Français : remontez à la source de cette guerre désastreuse, vous verrez que l’orgueil et l’ambition la suscitèrent. Pour être sans reproches, il faut être juste envers tous ; le pamphlet qu’on recherche aujourd’hui ne l’est envers personne. Il y a longtemps qu’on a dit que des injures ne sont pas des raisons : consultons notre propre intérêt, il dira qu’il vaut mieux persuader que tyraniser ; si cette maxime était gravée dans les cœurs, nous serions tous paisibles dans nos foyers.
J’approuve vos raisons, Citoyen210, reprit le monsieur, avec une dérision bien marquée, vous êtes au service de la République, votre corps est dans un pays insurgé, et c’est le vrai moment de faire fortune ; je ne suis point surpris que vous trouviez mauvais qu’on attaque le gouvernement.
Vous tombez en contradiction avec vous-même, lui dis-je, monsieur ; et tout en disant que vous adoptez mes raisons, vous me démontrez que vous avez mis de côté la maxime, que les injures ne sont pas des raisons. Je commence par vous déclarer que le sort m’a fait naître dans une caste211 qui a pour principe d’abhorrer la République ; que la révolution m’a privée de mon état, de ma fortune, et de tous les agréments qui pourraient faire aimer la vie, quand on est encore dans l’âge où les événements et les réflexions ne vous ont pas amené à l’apprécier à sa juste valeur : j’ai donc de fortes raisons pour ne pas aimer le régime actuel ; mais l’honneur, qui parle impérativement aux cœurs de tous les Français, me dit que je dois chérir ma patrie, détester ceux qui cherchent à la déchirer, et que mes ancêtres n’avaient acquis cette noblesse, dont ils se targuent, que parce qu’ils avaient servi cette même patrie, en proie aujourd’hui à toutes les factions212. Voilà, monsieur, ma profession de foi ; vous en tirerez telle induction que vous voudrez213.
Le ton ferme et honnête avec lequel je prononçai cette dernière phrase, imposa silence à l’auteur du pamphlet, car j’ai su, depuis, qu’il défendait son enfant. L’aide de camp, qui nous avait menés dans cette maison, fût enchanté de ce que j’avais tenu tête à ce monsieur, qui était l’ennemi déclaré de tous ceux qui annonçaient tant soit peu de raison.
Le lendemain, aux portes ouvrantes, nous nous rendîmes à l’hôpital ; l’aide de camp, à qui Blançai nous avait adressés, nous donna une lettre pour l’officier qui commandait le poste ; il voulut bien aller prévenir mon frère, que deux de ses amis désiraient le voir : il eût l’adresse de l’amener par gradation, à nous nommer lui-même : après quoi il nous introduisit.
Il était nécessaire que je susse que c’était mon frère que j’allais embrasser ; jamais je ne l’eusse reconnu, si l’on ne m’eût pas dit, voilà Saint-Julien. Je me précipitai dans ses bras, nos larmes se confondirent ; Lavalé était resté anéanti, heureusement nous lui donnâmes le temps, par nos embrassements réitérés, de se remettre de son étonnement. Les deux amis s’embrassèrent avec ce plaisir sincère qui n’appartient qu’à des cœurs vraiment purs.
Vous avez vu le portrait de mon frère, et vous savez qu’il était d’une superbe figure ! Hé bien ! je le retrouvai avec un œil de moins, un coup de sabre au travers du visage, et un bras emporté ; ainsi mutilé, vous pensez qu’il avait le droit d’obtenir son congé ; aussi n’attendait-il que l’arrivée du commandant.
Saint-Julien avait sollicité les invalides214, ayant appris les événements de J… et n’espérant pas que le hasard me servirait assez bien pour obtenir ma liberté sans me faire connaître. L’asile que j’ai réclamé, nous dit-il, me mettait à l’abri de toutes recherches, et me rapprochait de nos amis. Votre sort à tous deux m’inquiétait, mais j’ai une grande confiance dans le destin ; vous voyez qu’il commence à me récompenser, puisque j’ai le plaisir de me retrouver avec vous.
La gaîté de Saint-Julien ne l’avait point abandonné : j’en fis l’observation. C’est elle, nous dit-il, qui m’a fait supporter tous les maux dont j’ai été accablé. Durand vint nous rejoindre dans la journée ; je vous jure qu’elle fut une des plus heureuses que j’aie passées de ma vie.
Je proposai, et il fut résolu que nous fixerions notre demeure dans ce village, que vous connaissez, en attendant que le calme nous permît de nous réunir. Durand se chargea de nous y louer une chaumière, en retournant au quartier général.
Peu de jours après, le commandant expédia le congé de mon frère, et nous reprîmes la route du hameau du bonheur.
C’est ainsi que Saint-Julien le nomma, lorsque sa santé le força de nous quitter pour aller aux eaux. Il y était encore lorsque mon heureuse destinée vous y amena.
CHAPITRE XXII.
Je vous peindrais difficilement la joie de ces bonnes gens, lorsqu’ils nous revirent. Durand avait été embarrassé de choisir notre demeure : tous, à l’envie, voulaient avoir le plaisir de nous loger. Nous allâmes descendre chez le maire, qui avait épousé la petite veuve. À peine sut-on notre arrivée, que nous fûmes visités par tout le hameau.
Voilà bien la preuve, dit mon frère (en voyant l’accueil qu’on nous faisait), qu’une bonne action obtient toujours sa récompense.
Nous fûmes conduits à notre nouvelle habitation, que nous trouvâmes pourvue de toutes les choses nécessaires à la vie.
La santé de mon frère était languissante ; son heureux caractère n’en était point altéré, toujours aussi égal, et toujours le premier à imaginer ce qui pouvait nous distraire : nous menions une vie paisible ; mais qui, sans lui, eût été fort triste. Le seul plaisir réel dont nous jouissions, était les jours où nous recevions des nouvelles de Dorothée et de mon père. Mon frère lui avait écrit pour lui faire part de notre réunion. Il nous recommandait souvent de tâcher de découvrir le jeune grenadier, qui l’avait fait prisonnier et rendu à la liberté. Si vous le trouvez, nous disait-il, témoignez-lui le plaisir que j’éprouverais, si j’étais assez heureux pour le presser sur mon sein.
Vous veniez de nous quitter, et ma solitude m’était devenue insupportable, quoique l’ami de mon cœur la partageait. Depuis quinze grands jours nous n’avions reçu aucune nouvelle de J… et mon inquiétude croissait toutes les minutes. Durand venait nous voir aussi souvent que son devoir le lui permettait ; chaque fois qu’il arrivait, je consultais ses yeux pour tâcher de découvrir s’il n’avait point reçu quelques mauvaises nouvelles.
Mon frère revint des eaux beaucoup mieux portant ; il s’était fait mettre un œil de verre, un bras postiche215 : réellement il pouvait encore plaire.
Sa présence nous rendit un peu de joie ; et ce qui y mit le comble, fut une lettre de mon père que nous reçûmes le lendemain. Je fus, au premier moment, très affectée de n’en point trouver de Dorothée dans le paquet. Lavalé, craignant quelques mauvaises nouvelles, s’en empara ; et après l’avoir parcourue rapidement, il nous lût ce qui suit :
LETTRE
DE M. DE SAINT-JULIEN LE PÈRE,
à ses enfants.
« Je me reproche votre inquiétude, mes amis ; elle a dû être grande, si j’en juge par celle que j’éprouve quand je ne reçois point de vos nouvelles : rassurez-vous, mes enfants, il ne m’est rien arrivé ni à moi, ni à la bonne, très bonne Dorothée.
Hortense, votre Célestine a été aux portes de la mort : grâces soient rendues à la seconde mère que vous lui avez donnée. Tous ses moments lui ont été prodigués ; elle s’est oubliée elle-même pour ne s’occuper que du dépôt que vous lui avez confié. Dorothée n’a craint ni la perte de ses charmes, si elle gagnait la maladie, ni la perte de sa santé qu’elle a compromise par ses veilles continuelles. Ses soins ont été récompensés : Célestine est hors de danger.
Vous aimiez Dorothée, ma fille ; mais lorsque vous vous en séparâtes, les circonstances ne vous avaient pas mise dans le cas d’apprécier ses rares qualités. Elle se centuple, si je puis me servir de cette expression, pour se rendre utile à tous.
Le matin, au lever de l’aurore, elle va visiter son père et madame Daingreville ; elle revient prodiguer ses soins à l’aimable Célestine, elle a pour moi les attentions les plus délicates. Je puis dire que le destin barbare, qui me prive de la société de mes enfants, a au moins adouci ma peine en me donnant pour compagne la vertueuse Dorothée, Quand donc, mes amis, n’aurons-nous plus à nous plaindre du sort ? Ne jouirai-je plus de la satisfaction d’embrasser mes enfants ? L’honnête Durand m’exhorte à prendre courage, et me fait espérer, que bientôt nos maux finiront. Adieu, mes enfants, adieu, mon cher Lavalé, votre vieil ami vous chérira jusqu’à son dernier soupir ».
Cette lettre nous fit répandre de bien douces larmes, et mit fin à toutes nos inquiétudes. Je ne pouvais me lasser de faire l’éloge de Dorothée. Je m’étais souvent aperçue que mon frère en parlait avec un tendre intérêt, et je le regardais avec une attention scrupuleuse toutes les fois que je prononçais son nom. Tu veux m’arracher mon secret, me dit-il un jour : hé bien ! je vais satisfaire ta curiosité.
Lorsque Dorimond me donna asile dans sa maison, Dorothée me convint. Je formai le projet de lui faire ma cour ; mais l’honneur vint me dire tout bas à l’oreille que mon crime serait impardonnable de séduire la fille de notre bienfaiteur ; je pris assez sur moi pour feindre de l’indifférence. Quand l’amour le plus violent m’embrâsait, je désirais ardemment, et redoutais presqu’autant d’inspirer le même sentiment. La franchise et l’innocence de Dorothée me mettaient quelquefois dans le cas de me flatter d’être payé de retour : mon départ fut résolu, et je n’eus plus aucun doute sur sa tendresse. Jamais je n’ai tant souffert ; mais aussi, jamais je n’ai été si content de moi ; j’eus le courage de partir, sans faire à Dorothée l’aveu de mon amour. J’en fis confidence à notre ami Durand, ayant besoin de soulager mon cœur, et ne voulant pas me priver du plaisir de parler d’elle.
Maintenant que je suis libre, si Dorothée m’a conservé sa tendresse ; et si, comme la belle Sémire, maîtresse de Zadig216, elle n’a point d’aversion pour les borgnes, je lui offrirai de partager mon sort. Je ne doute nullement, continua-t-il, que mon père ne nous accorde son agrément. Ainsi, ma chère Hortense, j’aurai été bon prophète : mon ami Lavalé fera ton bonheur ; Dorothée mettra le comble aux miens ; mon père verra croître sous ses yeux ses petits enfants ; madame Daingreville les élévera ; le bon Durand, Dorimond et mon père politiqueront les soirées d’hiver auprès du feu, et nous, nous folâtrerons ; car alors, les malheurs qui nous ont poursuivis seront même effacés de notre mémoire, et nous aurons repris toute notre gaîté. Tu conviendras, ma chère Hortense, que mes rêves valent bien les tiens ; ils sont moins rembrunis, et leur exécution, dût-elle être bien éloignée, me laisse au moins le plaisir d’une riante perspective. Je trouve qu’il est toujours assez temps de se chagriner quand le sujet est près de nous.
Hé bien ! lui dis-je à mon tour, je vais te faire un aveu : je ne sais si tu m’as persuadée, ou si réellement notre réunion s’effectuera ; ou si (comme tu me l’as dit souvent), j’ai ainsi que Socrate un démon familier217 ; mais je ne regarde plus tes prédictions comme des fables, et je me surprends quelquefois à rêver dans le même sens que toi. Mon frère fut enchanté de m’avoir (ainsi qu’il s’en flattait) convertie.
Notre vie était très monotone ; elle se bornait à la promenade, et le soir à faire des lectures ; Lavalé était le plus occupé de nous trois. Je vous ai dit qu’il était avocat au Parlement, avant la Révolution. La confiance dont ces bons habitants nous honoraient, ne leur permettait pas de faire rien sans nous consulter. Il dressait les contrats de mariage, applanissait tous leurs différents, contribuait, de sa bourse, pour les arranger, et se rendait très utile.
Nous touchions au moment fortuné où un autre ordre de choses allait rendre l’espoir et la confiance à des milliers de familles. Depuis la mort du vertueux Philippeaux218, j’avais renoncé à tous les journaux, et nous étions dans une ignorance parfaite de ce qui se passait dans la capitale.
La chaleur excessive qu’il faisait alors nous forçait de ne sortir que le soir. Il était près de dix heures lorsque nous rentrâmes au village ; le maire et son épouse venaient au-devant de nous, et nous dirent que plusieurs d’entre eux étaient allés dans les autres routes. Je fus effrayée : rassurez-vous, me dit le maire, la personne qui vous demande ne vous veut point de mal, ce n’est qu’à nous qu’elle en fera. Nous hâtâmes notre marche. Je vis, en approchant de notre chaumière, une jeune femme qui, sitôt qu’elle nous aperçut, vola dans mes bras, et y resta presque sans mouvement. J’étais si étourdie de cette apparition, que je n’avais pas reconnu celle qui me serrait si étroitement.
Le cœur de mon frère l’avait instruit ; mais il n’osait retirer sa bien-aimée de dessus mon sein, où elle était restée sans pouvoir parler. Il craignait de l’interroger ; sa présence, sans que nous en fussions prévenus, cachait peut-être quelques grands malheurs : il n’eut la force que de prononcer son nom. Elle le regarda, et lui tendit la main. Ma surprise fit place à la joie la plus vive : je rendis à Dorothée ses caresses. Pendant une heure nous ne pûmes, ni les uns ni les autres, dire autre chose ; est-il bien vrai ; n’est-ce point un songe ? puis de recommencer à nous embrasser. La joie qui brillait sur tous les traits de Dorothée, avait banni les craintes de mon frère : je vous avoue qu’il ne m’en était pas venu une à la pensée.
Quand notre joie fut un peu plus calme, Dorothée nous dit qu’elle venait nous enlever à nos bons campagnards : je n’ai pas voulu, mes amis, laisser à qui que ce soit le plaisir de vous embrasser avant moi. Aussitôt que j’ai eu le bonheur de réunir mon père et madame Daingreville à M. de Chabry, j’ai pris la résolution de venir vous chercher. J’ai fait comme vous, Hortense, le bon M. Durand a été mon seul confident ; il s’est chargé de m’avoir des passeports pour vous et pour moi. J’ai laissé une lettre à madame Daingreville, pour l’instruire de ma démarche ; je lui ai promis que nous la rejoindrions bientôt. Partons, mes amis, je suis sûre qu’elle compte les minutes.
Nous la priâmes de nous faire part des événements heureux, qui mettaient le comble à notre félicité ; elle s’en acquitta à merveille. Vous les connaissez comme moi. Nous convînmes unanimement, qu’il est une justice éternelle qui, tôt ou tard, dévoile et punit les grands criminels. Ceux que le glaive national219 venait d’atteindre en étaient la preuve : heureux si l’événement qui abattit leur pouvoir colossal, n’eut duré que vingt-quatre heures : combien de nouvelles victimes eussent été épargnées220 !
Nous allâmes, dès le lendemain, faire nos adieux aux bons villageois qui nous avaient donné asile : nous leur fîmes à tous des présents, qui ne les consolèrent point de notre départ : il fallut que nous les trompassions. Nous partîmes la nuit : nous nous arrêtâmes un jour à Roucheterre, où était toujours le quartier général. Le neuf thermidor221 y avait été annoncé par un courrier. Durand et Blançai obtinrent un congé d’un mois, et firent le voyage avec nous.
Nous arrivâmes au bout de cinq jours à J… Nous avions fait tant de diligence, qu’on ne nous attendait que le lendemain.
Nous descendîmes chez notre ami Durand, qui pleura de joie ; il nous précéda chez madame Daingreville. Malgré cette précaution, notre présence fit perdre à mon père l’usage de ses sens ; nos larmes et nos embrassements le rappelèrent à la vie.
Il y avait déjà huit jours que nous étions réunis, que nous nous demandions si ce n’était point une illusion de nos sens.
Nous n’eûmes pas besoin de réclamer l’indulgence de mon père, pour nous être engagés sans son aveu. Il fut le premier à nous dire qu’il ne fallait pas que Blançai et Durand retournassent à l’armée, encore incertains de notre bonheur ; que nous leur devions assez de reconnaissance, pour les prier d’honorer, de leur présence, notre union.
Nous remerciâmes mon père de ses bontés. Mon frère le pria de lui accorder encore une grâce. C’est, lui dit-il, de permettre que Dorothée et moi adoptions Célestine. La nature lui a destiné votre nom, et mon respect pour vous m’en impose la loi. Mon père serra son fils dans ses bras pour toute réponse.222
M. Durand fut chargé de tous les préparatifs, qu’il accéléra le plus possible. Peu de jours après, mon père, madame Daingreville, Dorimond et notre ami Durand nous conduisirent au temple, où tous nos vœux furent comblés. Depuis deux ans que nous sommes réunis, notre félicité n’a point été troublée. Dorothée est mère d’un joli petit garçon, qui fait la joie de son grand-père : moi j’ai une fille que je nourris. Madame Daingreville prétend qu’elle annonce déjà des dispositions à devenir grenadier comme sa mère. Mon frère dit quelquefois que, sans Blançai et lui, nous serions encore à réfléchir sur ce que nous aurions à faire. Si vous voulez, mon amie, voir l’asile du bonheur, venez passer quelque temps à J…
FIN.
REVUE HISTORIQUE
de toutes les Jeannes célèbres
J’ai fait l’appel, pendant la nuit,
Des femmes que l’on nomme Jeanne :
Sans crainte d’être contredit,
Ou bien de passer pour profane,
Je réserve tout mon encens223
À la Patronne de Céans.
Jeanne de Bourgogne, à Paris,
Fonda Collège, dit l’histoire224 :
À sa place, mes bons amis,
J’aurais planté vigne pour boire ;
Pour boire, dans de doux moments,
À la Patronne de Céans.
De Nonains, à Bourges, un couvent
Fut doté par Jeanne de France225 :
La nôtre instruit en amusant,
Dans des récits pleins de décence :
Relisons les jolis romans
De la Patronne de Céans.
Épouse de quatre maris,
Jeanne, à tous les quatre infidèle ;
Jeanne de Naples, mes amis,
N’a point de place ici pour elle226 :
Gardons nos plus chers sentiments
À la Patronne de Céans.
Mère du tyran Charles-Quint,
Jeanne d’Espagne, ou bien la folle227,
Dans ce séjour républicain,
Ne saurait obtenir un rôle :
Gardons nos plus chers sentiments
À la Patronne de Céans.
Dans nos biographes savants,
Une autre Jeanne, dite Flore228,
Fit des contes plus que galants :
Passons vite ; passons encore ;
Et réservons nos cœurs aimants
À la Patronne de Céans.
Enfin, la Cité d’Orléans,
De Jeanne d’Arc229 est toute fière :
Quoiqu’on en dise, aux faits vaillants
De cette femme, je préfère,
Je mets au-dessus les romans
De la Patronne de Céans.
Mes amis ! j’avais donc raison :
Jeanne la folle, ou Bourguignonne ;
Jeanne d’Arc, ou tout autre nom
Ne valent pas notre Patronne :
Amis ! portons avec amour
Nos toasts230 à Jeanne D*** 231 .
Sylvain M***.