Test - Journée d'études "Le triangle des approches critiques : La Fortune des Rougon"
Lire les textes avec l'Histoire, la sociologie, l'ethnocritique, la psychanalyse, etc.
Mercredi 10 février 2016 (au lieu du 17 février)


Critique génétique et philologique (établissement de textes, de catalogues) associée à une forme d’histoire littéraire intéressée par le biographique et ouverte sur des perspectives sociologiques et sociocritiques envisageant les conditions dans lesquelles se développe la « vie littéraire » (attention portée au monde de la presse et des revues, à la situation matérielle des gens de lettres, à l’économie de la librairie…)
Péguy ; Giono ; Sand
poésie, correspondances, littérature d’idées
Origine corse (Carticasi).
Poésie et expression personnelle ; littérature, politique et société ; univers de la presse et des revues ; écritures féminines.
À l’exception de travaux consacrés à Jean Giono et à George Sand, les recherches de Julie Sabiani portent exclusivement sur la période de la Belle Époque, période que le livre qu’elle a rédigé avec Géraldi Leroy s’efforce de définir et de caractériser (La Vie littéraire à la Belle Époque, Paris, PUF, 1998).
Séjour en Afrique noire durant son enfance.
Péguy au cœur : de George Sand à Jean Giono. Mélanges en l’honneur de Julie Sabiani, dir. Denis Pernot, Paris, Klincksieck, « Circare », 2011. [Contributions de Frédérique Asklund, Yves Avril, Bruno Clément, Bénédicte Didier, Jeanyves Guérin, Nicole Laval-Turpin, Géraldi Leroy, William Marx, Denis Pernot, Gérard Peylet, Bernard Ribémont, Jean-Pierre Sueur, Thanh-Vân Ton-That, Romain Vaissermann].
- Le Pacifisme dans les lettres françaises de la Belle Époque aux années trente, Centre Charles Péguy, Orléans, 1985.
- Écrivains de la dissidence (Pierre Leroux, Charles Péguy, Boris Souvarine), Centre Charles Péguy, Orléans, 1987.
- La Réception de Péguy en France et à l’étranger de 1900 à nos jours, Centre Charles Péguy, Orléans, 1990.
- Jaurès et les écrivains, avec G. Leroy, Centre Charles Péguy, Orléans, 1994.
- Lectures de Victor-Marie, comte Hugo, La Revue des Lettres modernes, « Série Péguy », n° 6, 1995.
Inventaire, classement, conservation et catalogage, des fonds du Centre Charles Péguy (fonds anciens et acquisitions de 1984 à 2008) :
A. Inventaire, classement et conservation
- Manuscrits, placards, épreuves de Péguy et des collaborateurs des Cahiers de la quinzaine.
- Correspondances autographes de Péguy : originaux et “copies de lettres”.
- Correspondances autographes des amis, des abonnés et des collaborateurs des Cahiers de la quinzaine.
- Pièces biographiques de Péguy (généalogie, état civil, dossier militaire).
- Travaux scolaires de Péguy (de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur).
- Photothèque de Péguy et de ses contemporains (portraits, lieux et événements).
- Périodiques de la Belle Époque.
- Iconographie de la Belle Époque : cartes postales, affiches, lithographies, gravures…
- Récolement de la bibliothèque (plus de 15000 volumes) et adoption, pour les fonds nouveaux, d’une classification Dewey).
B. Catalogage des périodiques, des manuscrits et des correspondances conservés au Centre Charles Péguy
- Catalogue des périodiques conservés au Centre Charles Péguy, Centre Charles Péguy, Orléans, 1986.
- Catalogue des manuscrits de Charles Péguy, Centre Charles Péguy, Orléans, 1987.
- Charles Péguy et les Cahiers de la quinzaine, catalogue de la correspondance générale. I. Lettres reçues, avec G. Leroy, Presses universitaires d’Orléans, novembre 2001.
Organisation d’expositions
A. En collaboration avec G. Leroy
- « L’Affaire Dreyfus », Centre Charles Péguy, 1981.
- « Péguy en son temps », Centre Charles Péguy, 1982.
B. Commissaire général
a. Au Centre Charles Péguy
- « La Grande Guerre », 1984.
- « L’Affaire Dreyfus par l’image », 1996.
- « 1897 : Jeanne d’Arc », 1997.
- « Les Cahiers de la quinzaine et les peuples opprimés », 1998.
- « La Belle Époque des villégiatures », 1999.
- « La Belle Époque de Montmartre », 2000.
- « Images de la Grande Guerre », 2001.
- « La Belle Époque de la caricature politique », 2002.
- « La Belle Époque des écoliers », 2003.
- « La Loire et ses poètes », 2003.
- « L’Adieu au dimanche, 1914-1918 », 2003.
- « La Belle Époque des chansons », 2004.
- « La Belle Époque de l’enfance », 2005.
- « Orléans, le temps des jardins », 2005.
- « Présentation de la Beauce », 2006
- « Orléans 1900 », 2006.
- « La Belle Époque de la femme », 2006.
- « Orléans, portrait gourmand », 2007.
- « La Belle Époque de nos terroirs », 2007.
- « La Belle Époque des saisons », 2007-2008
- « Charles Péguy, sa vie, son œuvre », exposition permanente, depuis 2001.
b. Autres lieux
- « Hommage à Maurice Genevoix », Collégiale Saint-Pierre le Puellier, Orléans, 1986.
- « Albert Camus, sa vie, son œuvre », salle Albert Camus, Orléans, 2001.
Julie Sabiani fait ses études supérieures dans le cadre de l’hypokhâgne et de la khâgne du lycée Thiers de Marseille, où résident ses parents. Elle y a pour professeur Jacques Viard qui lui fait alors découvrir deux des écrivains sur lesquels elle travaillera par la suite, Péguy et Giono. Julie Sabiani est reçue à l’ENSJF de Sèvres (1962). Elle se consacre dès lors à l’œuvre de Péguy et signe un mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieures de lettres [DES] consacré à ses quatrains, mémoire qu’elle effectue sous la direction de René Pintard. Au terme de sa scolarité normalienne, elle est reçue en rang 1 à l’agrégation de Lettres classiques (1966). Son mémoire ayant reçu un excellent accueil dans l’univers des spécialistes de Péguy, accueil qui lui permet de nouer des liens étroits avec L’Amitié Charles Péguy, Julie Sabiani poursuit ses recherches en s’intéressant aux œuvres poétiques du fondateur des Cahiers de la quinzaine.
Julie Sabiani soutient en 1970 une thèse de 3e cycle à l’Université d’Aix-en-Provence devant un jury composé de Bernard Guyon (dir.), Jacques Viard et Jean Daniélou : Étude des quatrains de Charles Péguy et publication des strophes inédites puis, en 1989, à l’université d’Orléans, sous la direction de Géraldi Leroy, un doctorat nouveau régime : Les Vers inédits et posthumes de Charles Péguy (jury : Simone Fraisse, Françoise Gerbod) et, l’année suivante, à l’université Paris X, une habilitation à diriger des recherches [HDR] que parraine Françoise Gerbod : Recherches sur la poétique du cœur dans l’œuvre de Charles Péguy (jury : Michel Autrand, Bernard Duchatelet, Géraldi Leroy, Michel Raimond).
Julie Sabiani a fait toute sa carrière universitaire à Orléans où l’a conduit l’intérêt qu’elle a très tôt porté à l’œuvre de Péguy et où est créé en 1964, à l’initiative de Roger Secrétain, alors maire de la ville, un centre de recherches où sont réunis de nombreux manuscrits légués par la famille de l’auteur. Après avoir été chargée de cours à l’université d’Orléans (1966-1970), années où elle enseigne au lycée Pothier, Julie Sabiani devient successivement assistante (1970-1977), puis maître-assistante (1977-1984), maître de conférences (1985-1990) et professeur (1990). Elle prend sa retraite en 2008. À l’université d’Orléans, elle se lie avec plusieurs spécialistes de Péguy, notamment avec Géraldi Leroy, avec qui elle cosigne divers articles et ouvrages. Elle est également la directrice de travaux de doctorat qui révèlent, au-delà de la seule œuvre de Péguy, l’intérêt qu’elle porte à la période du tournant des siècles, notamment à l’univers des petites revues ainsi qu’à certaines figures et à certains parcours de femmes de lettres, Annie de Pène ou Hélène Picard. Son implantation dans la région orléanaise l’amène à s’intéresser aussi à des auteurs de la région Centre, en particulier à George Sand, à Maurice Genevoix, à Max Jacob et à Louis d’Illiers. Tout en poursuivant sa carrière universitaire, Julie Sabiani prend en 1984 la direction du Centre Charles Péguy d’Orléans. Elle y conduit des activités de classement et de catalogage des fonds et mène une ambitieuse politique d’achats d’ouvrages et de manuscrits qui contribue à faire de cette institution un lieu incontournable pour les spécialistes de l’œuvre de Péguy et, plus largement, pour les chercheurs, littéraires ou historiens, qui s’intéressent à la Belle Époque. Elle y organise nombre de manifestations, des colloques et des expositions, s’efforçant ainsi de faire mieux connaître l’œuvre de Péguy ainsi que la vie politique, sociale et culturelle du tournant des siècles dans l’univers des universitaires mais également dans celui du grand public. À cette double intention répond la création en février 2001, dans les locaux du Centre, d’une salle de musée consacrée à la vie et à l’œuvre de Péguy (salle rénovée à l’occasion du centenaire de la disparition de l’écrivain en 2014). Julie Sabiani assure la direction du Centre Charles Péguy jusqu’en 2008.
Né le 12 juin 1927 à Portland dans l’Oregon, Frank Paul Bowman commence à apprendre le français à l’âge de douze ans sous la férule de Helen Desmond qui applique la “Direct Method”, l’encourageant à tenir un journal et à retenir par cœur des poèmes (dont Le Lac de Lamartine) plutôt qu'à commencer par l'étude de la grammaire française, qu’il n’entreprend méthodiquement qu’à l’âge de 24 ans. Il étudie le latin et l’espagnol au lycée mais choisit les French studies quand il s'inscrit en 1944 en Premier cycle au collège universitaire de Reed.
Romantisme français.
Le fait religieux dans ses manifestations politiques, sociales et littéraires. Christologie. Utopies : dans Le Christ romantique, il écrit que la promotion d’un avenir utopique est « peut-être la plus belle contribution du romantisme français à notre culture. »
1789-1848 (avec une incursion dans le xvie pour Montaigne)
Elle comprend 6 ouvrages, deux éditions d'ouvrages et 72 articles (voir Bibliographie complète dans Mary Donaldson-Evans, Lucienne Rapier-Mazur, Gerald Prince, Autobiography, Historiography, Rhetoric: a Festschrift in Honour of Frank Paul Bowman, Rodopi, 1994.
Éditeur scientifique :
Eliphas Levi visionnaire romantique, Paris, Presses universitaires de France, 1969. L'Abbé Grégoire, évêque des Lumières, Paris, éditions France-Empire, 1988.
Il obtient un premier poste à l’Université de Berkeley en Californie, où il devient rapidement Professeur assistant en littérature française et donne son premier cours sur le romantisme (Aspects of Romanticism). Il est ensuite Professeur associé à Reed (1962) mais il est recruté dès l’année suivante à l’Université de Pennsylvanie où il est d’abord Professeur associé puis obtient en 1965 une chaire de Professeur de littérature française qu’il occupe jusqu’à sa retraite, en 1991. En 1992-1993 il dirige le département de French Studies de l'Université de Pennsylvanie, à laquelle il a donné un rayonnement international: professeur invité notamment à la Sorbonne Nouvelle (1973-1975), à Paris VII (1990) et à Princeton (1993), il reçoit les Palmes académiques (Chevalier en 1979, Officier en 1991).
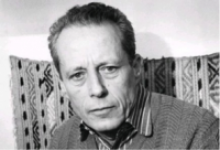
Luc-sur-Mer
Critique marxiste – Sociocritique
« La littérature des écrivains, les histoires qu’ils racontent anticipent souvent sur l’Histoire des historiens et ne devient en conséquence réellement lisible que le jour où une nouvelle Histoire, motivée et équipée différemment, autrement ancrée dans l’HISTOIRE, formalise et théorise ce qui, dans le texte littéraire, était avancée diffuse, mal contrôlée, aussi bien par l’écriture que par la lecture (c’est le fameux problème, si souvent faussé par certaine nouvelle critique, du réalisme des écrivains malgré eux), saisie et promotion du réel dans des réseaux fictionnels ou symboliques dont le caractère émotionnel ou plaisant pouvait dissimuler ou porter (peut-être plus exactement comme tresser) tout un pouvoir de connaissance. La littérature n’est donc ni ornement ni supplément (si l’on est méchant on dira d’âme), mais avant-garde seulement à définir et situer si l’on entend ne pas tomber dans un avant-gardisme purement verbal. […] Peut-être vaut-il mieux parler d’effets de connaissance» ? Il faut en tout cas aborder ces problèmes de manière non pas mécanique mais dialectique : l’écriture n’est pas dépositaire, tenancière, d’un sens anticipateur […] certaines écritures, certaines organisations fictionnelles et symboliques du réel […] font apparaître ce que les saint-simoniens appelaient « de nouvelles combinaisons […] Je dirai ici plutôt les signalent […] » (Le Prince et le Marchand, 1980, p. 18-19).
Région parisienne
Mélanges offerts à Pierre Barbéris, textes réunis par Gérard Gengembre et Jean Goldzink, E.N.S Éditions, coll. «Hommages», 1995.
Inhumé au cimetière de Courseulles-sur-Mer (Calvados)
1- Disponibles sur http://flenet.unileon.es/docauteurs2.html
2- Disponibles sur http://e-sonore.u-parisouest.fr/matiere/259/15
3- Disponibles sur http://e-sonore.u-paris10.fr
« Le mythe du cancre », Volume, émission de Marc Gilbert, 25 février 1971 http://www.ina.fr/video/CPF86656625/le-mythe-du-cancre-video.html
7 juin 1970, Université de Paris, faculté des Lettres et Sciences humaines, Sorbonne, “Balzac et le mal du siècle, contribution à une physiologie du monde moderne”
Le Centre de Ressources Jacques-Seebacher, prolongement d’une tradition de recherche, vivace à l’Université Paris-VII, qu’illustrèrent dans le passé Pierre Albouy, Jacques Seebacher et Guy Rosa, est consacré à la littérature et à la civilisation du xixe siècle. Il est d’abord un lieu de travail et une bibliothèque de recherche dotée d’un fonds documentaire pluridisciplinaire (littérature, philosophie, histoire, arts, sciences sociales…) regroupant des ouvrages anciens aussi bien que des études critiques et savantes, des thèses et des microfilms (de manuscrits et de journaux du xixe siècle). Ce fonds est consultable sur place ; une partie des ouvrages peuvent être empruntés. Le centre offre également…
Aucune actualité à venir pour le moment.